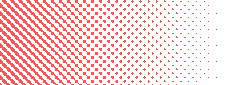L’humanité face au tribunal des espèces : enjeux éthiques des bestiaires de science-fiction
“Since cuteness is an aestheticisation of powerlessness (‘what we love because it submits to us’), and since soft contours suggest pliancy or responsiveness to the will of others, the less formally articulated the commodity, the cuter 1”.
Sianne Ngai (2015, p. 64)
1La thématisation par les récits de science-fiction des rapports de l’humanité à l’animalité se déploie surtout dans deux directions, qui dans la majorité des cas donnent lieu à des traitements séparés. La voie du bestiaire imaginaire consiste à représenter une faune extraordinaire, souvent associée à une flore spécifique, voire à des conditions physiques déterminées. Ces récits reconduisent avec inventivité la démarche descriptive d’un Jules Verne énumérant les poissons observés depuis le Nautilus, ou celle de Conan Doyle faisant de l’animal exotique un enjeu de dramatisation à l’instar des dinosaures du Monde perdu. Ces animaux abondent alors ce que Richard Saint-Gelais appelle la « xénoencyclopédie » du récit de science-fiction (1999, p. 140), et qu’il est possible d’interroger selon une démarche pseudo-naturaliste, à l’instar de ce que pratiquent Lehoucq, Steyer, et Boulay (2016). Souvent associée au paradigme de l’exploration, la représentation de l’animalité peut n’être qu’un élément de décor, mais elle sert aussi dans de nombreux cas de point d’appui pour l’expression du novum central du récit, c’est-à-dire le changement paradigmatique que le récit nous donne à saisir et interpréter2. Le fameux « ver des sables » géant du cycle de « Dune » (Frank Herbert, 1965-1985) est ainsi présenté comme un élément massif, mais rationnel, d’un système écologique complet, mais au-delà de sa puissance physique et de sa force symbolique dans le cadre des croyances locales, l’exploration du lien de son cycle de vie à une substance essentielle dans cet univers, « l’épice », occupe une place centrale dans la construction du récit sériel et du monde de science-fiction3. L’animal est un élément saillant de l’énigme ontologique que représente la nature imaginaire à plus grande échelle.
2La deuxième direction majeure consiste à faire du rapport à l’animalité le novum même, en un sens qui engage, conteste, met à distance toute arrogance anthropocentrique.
Dans ces scénarios, la science-fiction qui recourt aux formes animales lézarde le splendide isolement auquel une certaine philosophie a condamné les humains. Pacifiquement ou non, ces rencontres avec l’Alien sont l’occasion de reprendre une place d’animal humain. (Langlet, 2022, p. 29)
3Cette perspective tend à se construire de manière scalaire, interprétant l’animalité comme le point de repère d’un « progrès » ou d’une « régression », et de ce fait se concentrer sur une seule espèce, en jouant souvent du trope de l’inversion des rôles, l’humain prenant la place de l’animal et se voyant contraint de lutter pour une forme de reconnaissance4. Le rapport à l’animalité peut être littéral, comme dans La Planète des singes de Pierre Boulle (1963). Les humains de ce roman sont véritablement des animaux dominés par l’instinct, tandis que les singes, tout en gardant leurs caractéristiques morphologiques, sont des êtres dotés de pensée et de parole. Dès la première adaptation (Schaffner, 1968), et jusqu’à l’opus le plus récent (Ball, 2024), les versions cinématographiques n’ont cessé de mettre en évidence le caractère scandaleux d’une telle inversion, en la construisant comme une lutte ; mais le roman la présente comme une défaite actée, et définitive, qui fait de la domination humaine une sorte de hasard heureux, et surtout fragile5. Néanmoins, le plus souvent ce rapport scalaire à l’animalité se complique d’un rapport de pouvoir, et d’un déni de reconnaissance. C’est la logique d’un roman comme Oms en série, de Stefan Wul (1957), qui montre des extraterrestres gigantesques longtemps incapables d’accepter de voir leurs « oms domestiques » autrement que comme des animaux. C’est aussi, selon un dispositif plus brutal, la démarche d’un Vincent Message dans Défaite des maîtres et possesseurs (2016), qui adopte le point de vue d’un extraterrestre pris dans ce qui nous apparaît comme une dissonance cognitive, puisqu’il reconnaît dans les humains conquis des interlocuteurs possibles, ou des supports d’affection, tout en acceptant volontiers que certains d’entre eux soient élevés comme des animaux d’abattage. La compréhension du novum au sens cognitif est ici inséparable d’un investissement affectif – le récit vise à choquer – et axiologique – il nous invite à nous positionner, à prendre parti pour ce que les humains dominés représentent, de manière à faire retour sur notre appréhension du réel, en particulier la place des animaux dans nos sociétés.
4Notre objet d’étude se situe à l’intersection des deux démarches, lorsque la dynamique axiologique rencontre celle du bestiaire, ce qui a pour effet de remettre en cause tant la verticalité d’un « progrès » indexé sur la distance symbolique postulée entre humanité et animalité, que l’horizontalité propre à la pseudo-naturalisation d’un monde animal exotique. Selon la terminologie conceptuelle propre à la critique de science-fiction, les « novums secondaires » (quasi-ornementaux) qui constituent le bestiaire se voient réinvestis de sens, formant un « novum principal », c’est-à-dire l’objet de l’enquête aussi bien que le levier d’un réexamen de nos certitudes (Langlet, 2006, p. 24-29). Il s’agira de cerner ce mécanisme de revalorisation, pour identifier selon quelle logique le bestiaire, envisagé non plus comme une simple collection d’espèces à admirer ou à affronter, mais comme un pôle d’agentivité à part entière, peut devenir le lieu d’un questionnement éthique, voire sociopolitique. Notre réflexion s’appuiera sur l’étude de quatre romans, Cette Crédille qui nous ronge et Le Chant du Cosmos de Roland C. Wagner (1999), Les Fables de l’Humpur de Pierre Bordage (1999), et Les Furtifs d'Alain Damasio (2019), qui réinvestissent l’inventivité des représentations animales propre à la science-fiction dans une perspective critique, confrontant d’une manière nouvelle l’humanité au tribunal des espèces.
I. Un plaisir créatif, mais aussi chargé de sens
5La démarche propre à la science-fiction consiste à introduire des éléments de divergence dans nos points de repère ontologiques, selon une dynamique de défamiliarisation-refamiliarisation qui est la source à la fois d’une jouissance esthétique et d’une enquête cognitive (Spiegel 2022). Il s’agit de proposer quelque chose de nouveau, de surprenant, de frappant, que ce soit de manière spectaculaire et massive, dans le cas d’un « Planet opera » déployant une large faune bigarrée, ou de façon plus subtile, sur un mode ludique, en se concentrant sur un animal phénoménal. Mais les récits construisent aussi ces manifestations plaisantes comme des points d’appui pour des questionnements, sur l’architecture, ou les soubassements du monde, et au-delà sur notre propre conception du réel. La structure de dévoilement de leurs novums respectifs est dès lors simultanément narrative et axiologique.
6Les plaisirs suscités par la représentation de l’animalité imaginaire dans les récits contemporains de science-fiction peuvent être ramenés à un principe essentiel, qui se manifeste ensuite de différentes manières. Ce principe est, classiquement, la construction d’une altérité significative au travers, ou dans, des figures animales ou animalisées.
7À un premier niveau, il s’agit tout simplement de rééditer dans l’animal imaginaire le geste de la découverte zoologique, de retrouver la fascination du spécialiste explorant les recoins du monde à la recherche d’un spécimen inconnu, mais aussi la jubilation intense de l’enfant confronté à des livres d’images ou visitant un zoo. Cette crédille qui nous ronge (Wagner, [1991], 2008) joue le plus nettement d’un tel effet, par des descriptions d’animaux extraterrestres résidant sur la planète Océan. Ces créatures, désignées collectivement comme les bébêtes d’Océan, ont à la fois des traits biologiques qui les rendent plausibles, sinon viables, et une rondeur, une mignonnerie, qui rappelle des personnages de bande dessinée. Leurs noms d’espèces renvoient à cette étrange conjonction de bizarrerie et de connivence, comme le marsupialami, qui pointe vers la créature de Franquin tout en réutilisant comme lui un terme scientifique, ou plus explicitement encore le familier, une créature appréciant le contact, et le frigo, des humains :
Le familier nous laissa passer puis nous emboîta le pas. C’était une curieuse créature anoure, de la taille d’un chat, avec une longue tête effilée rappelant celle d’un lévrier et quatre courtes pattes qui me parurent trop rapprochées. Il se dandinait de comique manière, le regard rivé sur moi. Un instant, j’eus l’impression qu’il sentait que j’étais un étranger sur cette terre. (Wagner, 2008, p. 20)
8La référence à des animaux domestiques connotés positivement (« chat », « lévrier »), ainsi qu’à des caractéristiques neutralisant tout sentiment de danger (« longue tête effilée », « courtes pattes », « se dandinait »), accompagne l’acclimatation du regard humain sur cette créature extraterrestre, que nous sommes incités à accepter sans difficulté dans notre xénoencyclopédie. Les illustrations réalisées par Caza [Figure 1] pour la réédition de l’ouvrage captent aussi bien les caractéristiques diégétiques que les implications affectives que ce type d’être non seulement inoffensif, mais mignon6, sont censées provoquer tant chez les personnages que chez les lecteurs et lectrices. Néanmoins, cette manière de désamorcer l’étrangeté conduit ici explicitement à une inversion du regard : l’être humain perçoit dans ce petit être la résistance potentielle d’une conscience susceptible de le juger, lui « l’étranger sur cette terre ».

Fig. 1. Un familier de la planète Océan (Wagner, 2008, p. 38© Caza. Tous droits réservés).
9Interroger ce type de démarche permet déjà de constater l’efficacité d’un jeu avec le connu, pour en tirer des effets qui atténuent ou au contraire accentuent l’altérité extraterrestre. Animalité et altérité entrent en résonance et se renforcent, selon des lignes de partage symbolique rappelées ainsi par Irène Langlet :
Les extraterrestres ont souvent des formes inspirées de l’irréductible différence animale, qui s’entend bien dans le mot alien. On y distingue sans peine une véritable cartographie des valeurs et fantasmes projetés sur les animaux dans la culture occidentale. Sans surprise, les insectes, les serpents, les êtres visqueux sont plutôt hostiles ; les mammifères, les oiseaux, plutôt bienveillants. (Langlet, 2022 p. 29)
10Cela se manifeste de deux manières dans Le Chant du cosmos (1999), roman situé dans le même univers. Roland C. Wagner y accentue la logique suivie pour les bébêtes, sous l’aspect du mystérieux maedre, pelucheux et attendrissant, qui accompagne le protagoniste [Figure 2]. A contrario, interviennent dans l’intrigue des « cafards de l’espace », dénommés clapotes, qui sortent de plis de l’hyper-espace pour grouiller dans les stations spatiales et y siphonner leur énergie [Figure 3].

Fig. 2. Le maedre
Détail de la couverture de Roland C. Wagner, Le Chant du cosmos,1999
© Caza. Tous droits réservés.

Fig. 3. Les clapotes
Quatrième de couverture de Roland C. Wagner, Le Chant du cosmos, 1999
© Caza. Tous droits réservés.
11Ce faisant, le roman mobilise la répulsion que cristallise ce qu’Anne Simon appelle les « animaux liminaires », lesquels « ne cessent d’émerger et de s’enfouir, d’évoluer entre le retrait et la visibilité », manifestant « une altérité obscure, tenace, ténue voire tyrannique », « une outrance du vivant dont on ne sait trop si elle englobe l’humanité, ou si elle l’exclut » (Simon, 2021, p. 317). Or c’est justement cette question de la place de l’humanité dans l’édifice du vivant qui est en jeu dans Le Chant du cosmos, dont le titre renvoie à la découverte progressive de boucles de rétroactions entre des modes de manipulation de l’énergie, qui participent de l’équilibre ou au contraire de la disruption du bon ordre physique de l’univers, et la propension au pacifisme ou à la violence. Dans ce cadre, la présence de clapotes signale et amplifie un déséquilibre naturel et axiologique.
Si les mauvaises vibrations favorisent la multiplication des clapotes, cela n’aurait rien d’étonnant qu’ils disposent d’une faculté, même instinctive, qui leur permette d’influer sur l’harmonie universelle – et que cette même faculté, ou une autre, puisse susciter une dégradation du sens moral. (Wagner, 1999, p. 350)
12Se mettre du côté du maedre ou de celui des clapotes : en dépit de toutes les péripéties développées par ailleurs dans le roman, c’est à ce choix fondamental que la valeur morale de l’humanité doit se révéler. La démarche pseudo-naturaliste est inséparable d’un double jeu avec la reconnaissance : l’objectif est bien de remotiver, au sein même de formes identifiables, la nécessité d’un regard analytique, initialement désarmé par ce que la familiarité construit comme fausse évidence. Les bébêtes ne sont pas simplement des variantes du vivant tel qu’il se manifeste sur la Terre, et la question qu’ils posent aux colons est plus complexe qu’il n’y paraît. L’enjeu mis en avant dans l’essentiel du récit est celui de la « Question Alimentaire » : à l’instar de ce sympathique précurseur qu’est le Dodo, sympathique symbole post-mortem d’une consommation humaine irraisonnée, le destin des bébêtes, qui n’avaient pas de prédateur, pourrait se ramener à des extinctions de masse, dont le roman indique qu’elles se sont produites sur Terre7. Néanmoins, des indices de plus en plus décisifs permettent de saisir que les bébêtes disposent d’un moyen de défense subtil : un champ d’empathie qui impose aux chasseurs de ressentir les émotions de leur victime. La question se transforme : il ne s’agit de plus de savoir si les humains parviendront à épargner leur gibier, mais si l’humanité est en mesure de s’adapter dans un environnement qui, petit à petit, rend intenable la plupart des actes violents.
13La représentation d’un bestiaire extraterrestre dans la science-fiction peut ainsi conduire, au-delà de la transposition ou réécriture d’aventures exotiques, à favoriser un changement de regard, en faisant apparaître le caractère fragile et arbitraire de notre position dominante, non par une inversion brutale mettant les humains à la place des animaux, mais par la mise en évidence d’autres équilibres possibles, dont ils doivent se rendre solidaires, au risque sinon de disparaître à leur tour.
II. Une hybridité ambivalente
14Le plaisir de reconnaître des formes connues à travers des configurations nouvelles entre en tension avec ce que ces reconfigurations produisent, malgré tout, de radicalement nouveau : c’est tout le paradoxe de la représentation d’êtres hybrides ou chimériques dans la science-fiction. Construit non plus à partir d’une séparation nette entre humain et animal, mais en exhibant une hybridité humain-animale à grande échelle8, le cadre établi par Pierre Bordage dans Les Fables de l’Humpur ([1999] 2002) joue lui aussi de fausses familiarités, que le récit s’emploie à déconstruire à plusieurs niveaux.
15Le monde animalisé que propose le roman s’appuie sur trois pôles majeurs de reconnaissance, qui tendent initialement à se renforcer. En effet, il s’inscrit dans une sorte de Moyen Âge rejoué par des peuples animaux, dont les caractéristiques sont à la fois symboliques et réalistes. La reprise de structures sociales féodales stéréotypées se superpose à des projections anthropomorphiques rappelant aussi bien Le Roman de Renart que les Fables de La Fontaine. Les carnivores occupent des positions de pouvoir : les loups, désignés comme des Hurles et les serpents, les Ssifles, dominent des fiefs rivaux, tandis que les chats, rats, ou renards, trouvent à s’employer comme mercenaires, marchands ou voleurs. Quant aux cochons, désignés comme des Grognes, ou aux moutons, ils sont à la fois des serfs, obligés de travailler la terre, et du bétail, consommé périodiquement par leurs seigneurs.
16À la reconduction convergente de stéréotypes sociaux et symboliques, s’ajoute la caractérisation concrète de caractéristiques physiques. Ces loups, cochons, serpents anthropomorphes sont soumis à des impératifs biologiques, tout en disposant de facultés héritées de leur nature animale. Ainsi des Ssifles, qui disposent d’un venin redoutable et d’une puissance de fascination hypnotique, tout en étant tributaire de la chaleur de leur environnement, animaux à sang froid obligés de passer par des périodes d’hibernation. En apparence, tout devrait concourir à une stabilité maximale des relations entre ces êtres hybrides, doublement déterminés, par une structure sociale hiérarchisée et par la reconduction d’une sorte de fatalité naturelle.
17Toutefois, l’interprétation de ce que signifie cette hybridité se révèle rapidement ambivalente. La solidité même de cet édifice fictionnel, qui offre une galerie de peuples animaux, de coutumes et de « gueules » expressives et typiques pour les incarner, n’est offerte que pour être mise à bas par les actions des personnages, en premier lieu le grogne Véhir, qui s’arrache à sa condition de paysan promis à l’abattoir pour se mettre en quête de l’Humpur, où nous reconnaissons sans peine la racine de l’« Humain pur ». Cette quête remet en cause toutes les justifications pseudo-biologiques que nos propres représentations tendaient à naturaliser. En ce sens, Bordage ne reprend Le Roman de Renart et les Fables de La Fontaine que pour les subvertir à leur tour, en marquant ce que ces récits entérinent de déterminisme social. À rebours de cette logique, ses protagonistes sortent non seulement de leur condition, mais aussi de ce que leur prétendue « nature » biologique semble leur programmer comme destin personnel et social. En cela, ils font autre chose que « s’élever » : Véhir le grogne ne devient pas un seigneur, et Tia, la princesse hurle [une louve humanoïde] qui l’a rejoint dans sa quête ne vient pas « récompenser » par son amour le succès de son entreprise. En tenant tête à l’ordre établi, mais aussi en perçant à jour le mystère de leurs origines génétiques, l’un et l’autre sortent complètement de la pyramide sociale, en promettant de la remettre en cause radicalement.
18Cette rupture paradigmatique complète tient aussi, et peut-être surtout, à un double rejet, de l’humanité d’une part, de l’animalité de l’autre. La quête de l’Humpur a mis Véhir face à un vestige humain : un enregistrement holographique par lequel un homme livre le testament de l’orgueil démiurgique qui a donné naissance au monde de ces hommes-animaux. Cherchant un dieu, le grogne nous a trouvés, nous : des êtres cherchant à se créer des serviteurs, dans une étape ultime de domestication par cette « chimérisation animale à des fins consuméristes, voire scientifiques » dont Anne Simon rappelle qu’elle est l’« antonyme de la métamorphose », qui permet de décentrer notre regard en interrogeant la figure de l’animal : « reconnaître intuitivement ce qu’est une bête – et, par ricochet, un être humain » (2021, p. 271).
19À cet égard, Les Fables de l’Humpur rejoue à plus grande échelle le conflit de L’Île du Docteur Moreau, avec son « imaginaire faustien », dont « l’ambition démiurgique conduit au malheur des créateurs comme des créatures » (Langlet, 2022, p. 34). Ce cycle de révolte a entraîné un projet inverse, mené en secret par des hommes-oiseaux, les kroaz, des freux génétiquement modifiés qui ont préservé les savoirs humains mais s’en servent pour manipuler les autres peuplades. Les kroaz cherchent à ramener les hybrides vers une « animalité pure ». Pour cela, ils encouragent le « cannibalisme chimérique », la dévoration des faibles par les forts, qui mine tout l’édifice social, et ils ont élevé au rang d’interdit religieux le « rut entre clans », ce qui « accélérait la dégénérescence » (Bordage, 2002, p. 463), en accentuant par la consanguinité le retour à la simple animalité.
20Le parcours de Véhir et de ses compagnons se solde ainsi par un double rejet, pour conquérir et affirmer une agentivité nouvelle. En prenant « le meilleur de l’animal et le meilleur de l’humain » (ibid., p. 473), ils refusent les contraintes héritées de l’humanité, la duplication de structures sociales injustes et de contraintes religieuses qui assignent à chaque homme-animal une place héritée de nos représentations, mais tout autant l’obéissance aveugle à un instinct animal, qui ramène l’existence aux deux seuls enjeux de la survie et de la reproduction. L’amour réciproque de Véhir et de Tia scelle cette double résistance, en manifestant la possibilité d’un choix parfaitement libre. Ce que signifie exactement cette liberté accomplie en dépassant déterminismes humains et animaux est laissé à l’imagination, puisque le récit s’interrompt alors9. C’est qu’il ne s’agit pas exactement d’une puissance, qu’il faudrait voir réalisée en acte pour en prendre la mesure, mais d’un potentiel, d’une ouverture vers d’autres états du vivant. De la même manière que le regard porté sur les bébêtes ou les clapotes conduit à réexaminer la place de l’humain dans l’édifice du vivant, pour l’arracher à l’illusion d’une séparation entre l’humanité et le monde biologique dont elle est solidaire, et même tributaire, la mise à l’épreuve des barrières pseudo-naturelles érigées entre les hommes-animaux des Fables de l’Humpur conduit à penser le rapport humanité-animalité non comme une liste de caractéristiques figées, mais comme un ensemble de points de contact, dont il serait possible de jouer pour ouvrir un jeu infini de possibilités.
III. Repenser l’agentivité animale
21L’appel à l’humilité adressé à l’espèce humaine résonne d’une manière similaire dans Le Chant du cosmos et Les Fables de l’Humpur : voir en l’humanité un sommet de la hiérarchie du vivant y est associé à des comportements répréhensibles, mais aussi et surtout à un manque de perspective, en comparaison d’une posture ouverte à l’altérité animale, qu’elle soit extraterrestre ou génétiquement modifiée. Pour autant, ces récits ne proposent pas en réponse une valorisation de l’animalité en tant que telle. Celle-ci peut bien être vectrice d’une agentivité spécifique : le champ d’empathie des bébêtes d’Océan devient un point d’appui déterminant pour aider les personnages humains à restaurer l’équilibre de l’univers lors d’un ultime affrontement (contre les forces fascistes favorisant l’apparition des clapotes). De même, la puissance vitale du grogne Véhir est à mettre au crédit d’une corporéité animale. Néanmoins, comme le montre le dépassement dialectique de l’opposition humain-animal qui est thématisé dans ces récits, il s’agit moins de cerner une spécificité prêtée à un bestiaire imaginaire, que de nous inciter plus largement à réinterpréter l’agentivité humaine au sein d’un continuum, non seulement de l’animalité, mais du vivant tout entier.
22En ce sens, donner une place plus éminente à l’animal au travers d’un bestiaire imaginaire – mettre donc en scène la découverte d’animaux radicalement nouveaux – devient le moyen de retrouver l’un des horizons essentiels qu’autorisait, selon Anne Simon, notre rapport à l’animal sauvage, non domestiqué ni protégé, en nous donnant l’occasion d’un « élan vers une sortie de soi, qui est une des pentes et une des chances de l’humain » (Simon, 2021, p. 262). La réinterprétation de l’agentivité animale devient en elle-même un enjeu diégétique, pour des personnages qui doivent accepter de se départir d’une perspective anthropocentrique s’ils veulent résoudre le problème central posé par le récit, faisant dès lors de la question de l’altérité animale son novum principal. Symboliquement, la capacité des protagonistes à saisir cet enjeu et à le résoudre, par une meilleure compréhension de l’animalité, se confond avec la capacité de notre espèce entière à relever un défi darwinien de l’adaptation au milieu.
23Cette logique structure en profondeur la quête de sens animant les personnages dans le roman Les Furtifs d’Alain Damasio (2019). Les créatures éponymes représentent un mystère fondamental. Leur seule existence trouble la conception même du vivant, en raison des multiples paradoxes qu’ils représentent. Vivant en marge de nos perceptions, ils pourraient être tenus pour des « animaux liminaires », sans être pour autant des parasites répugnants : au contraire, lorsqu’ils sont capturés, ils sont caractérisés par une beauté saisissante ; au moment où ils cessent d’interagir avec le reste du vivant, ils se vitrifient en une fascinante statue de céramique. Si les saisir par la vue signifie les tuer, leur absence de nature stable renvoie à la fois à une essence chimérique et à une « capacité métamorphique », laquelle « épouse […] la plasticité d’une phrase musicale à plusieurs dimensions, où l’être ne se fixe jamais mais fluctue heureusement et s’augmente à mesure dans une transformation vitaliste sans terme » (Rabaté, 2022, p. 133). Les autres sens, en particulier le toucher et l’ouïe, sont donc particulièrement sollicités pour aller à leur rencontre. En témoigne ce premier contact – physique – avec un spécimen, pour le novice qu’est alors le personnage de Lorca :
[Lorca] Il y a quelque chose sur mon dos. Entre mes omoplates. L’adrénaline gicle dans mon sang. Je plie le bras derrière ma nuque et j’arrive à l’effleurer du bout des doigts, mon dieu. C’est chaud, fourré et doux comme un pelage de chat. Ça frétille tel un colibri. C’est calme et incroyablement véloce à la fois, hypranerveux et zen, je n’arrive pas à trouver l’image en moi, cette sensation que ça me donne et la forme que je sens que ça a. Il est là. C’est tout. (Damasio, 2019, p. 17)
24La définition même des furtifs suppose qu’ils soient instables, toujours mouvants, même s’il apparaît au fil du récit qu’ils ont une forme d’identité personnelle, liée à une signature sonore, « une manière de canevas rythmique, de thème », que le personnage de Saskia, sensible aux rythmes et aux sons, dénomme leur « frisson » (ibid., p. 148.). Enfin, puisqu’ils sont capables de métaboliser le minéral et le végétal en plus de l’animal, ils évoluent dans un espace transversal, qui prend peu à peu un sens conceptuel, en devenant un symbole même de la vie dans son mouvement, qui se redouble d’une réalité concrète et physique, autour de laquelle se construit un enjeu de survie de l’humanité. En effet, il ne s’agit pas seulement de les valoriser comme le propose le personnage de Varech, qui y voit « la forme la plus élevée du vivant précisément parce qu’ils ont renoncé à la forme parfaite » (ibid., p. 397), mais de constater qu’ils remplissent un rôle essentiel pour toute la chaîne du vivant. En effet, leur nature vibratoire intervient discrètement dans la recomposition des chaînes de l’ADN : ils contribuent à provoquer les mutations génétiques qui déterminent à long terme l’adaptabilité de toutes les espèces.
[Varech] Tuer les furtifs serait plus grave encore que l’extinction des singes, des pandas ou des abeilles parce que les furtifs jouent un rôle crucial dans l’empire du vivant : les mutations qu’ils impriment à l’évolution permettent la variété des espèces et leur renouvellement. Ils sont donc l’un des garants de la biodiversité future. (Ibid., p. 619.)
25Les différentes lignes d’intrigue du roman font apparaître peu à peu, en même temps que des manières concurrentes de traiter la question des furtifs, un conflit axiologique lié à la façon même d’envisager le vivant, et ses répercussions sur la conception de l’humain comme être physique mais aussi social et politique. Aux postures xénophobes ou utilitaires, qui voient dans les furtifs un potentiel menaçant ou une ressource à domestiquer, s’opposent des attitudes scientifiques – cherchant à intégrer le novum des furtifs dans le champ des connaissances humaines – mais surtout artistiques et contestataires. En effet, une continuité apparaît entre la perspective qui tient à distance les furtifs, et donc la force essentielle de la vie, et la tendance dystopique à réguler, contrôler, surveiller les individus, au risque de briser l’élan créatif qui anime l’humanité. Face à ce risque de sclérose, un personnage en particulier en vient à symboliser la résistance, une jeune fille qui est devenue une hybride de furtif, et qui a obtenu leurs facultés de métamorphose, de dissimulation et de déplacement liminaire. Pourtant, en dépit du caractère fascinant d’un tel hybride, aux yeux d’un philosophe comme Varech, cette jeune fille est moins une promesse de puissance transhumaine qu’une preuve de concept, la manifestation qu’une coexistence pacifique, et désirable, est possible entre humains et furtifs.
[Varech] Tout est déjà là, en nous… Nous n’avons pas besoin d’être hybridés pour exprimer ce potentiel. Mais à l’évidence, côtoyer les furtifs, accepter qu’ils nous affectent, les rencontrer ne peut que nous aider à grandir. Vous savez, il n’est qu’une seule vraie révolte, au fond : c’est contre les parties mortes en nous, cette mort active dans nos perceptions saturées, nos pensées qu’on mécanise, nos sensations éteintes. Être du vif, relever du vif. (Ibid., p. 622.)
26À l’instar des romans de Roland C. Wagner et de Pierre Bordage, Les Furtifs continue de centrer la perspective sur un questionnement humain, en utilisant le motif de l’animalité, poussé ici presque jusqu’au mystère métaphysique, pour subvertir et déplacer notre regard sur la façon dont l’humain s’intègre à son propre monde. La complexité de l’énigme animale construite par Alain Damasio donne corps au même type de dépassement que dans les autres récits : ne pas se laisser enfermer dans une fausse binarité entre un espace humain, domestique et potentiellement mortifère, et un espace animal, idéalisé pour son rapport à une nature vitale, mais que l’humain ne peut toucher sans le faire disparaître, à l’image des furtifs qui cessent de vivre si un regard humain parvient à se poser sur eux. Tout le roman s’emploie à faire ressentir, par le rythme des discours et par les alternances de points de vue, ce que signifie cerner la question furtive sans la figer dans un dogme ou dans une représentation. Le dépassement qui nous est proposé consiste bien à situer en nous un potentiel de créativité et de renouvellement : « être du vif, relever du vif », en acceptant de le saisir en nous-mêmes et non au prix d’un arrachement à l’espace naturel.
*
27Les quatre œuvres étudiées ici ne doivent pas être tenues pour représentatives de ce que des récits de science-fiction élaborent systématiquement autour de leurs bestiaires imaginaires. Néanmoins, elles permettent d’établir que, dès lors qu’elles cessent d’être prises dans le seul paradigme de l’aventure, les créatures représentées dans des récits conjecturaux se trouvent nécessairement intégrées à la démarche d’investigation propre à la mise en intrigue d’un novum problématique. La question animale fait alors retour sur une question humaine, en imposant de redéfinir à neuf les fondements de nos rapports à la nature, mais surtout des relations entre êtres humains, ainsi que des structures sociales et politiques. S’il est toujours possible de reconnaître en partie des animaux réels, transposés, comme nous invite à le faire le dispositif ludique des récits de Roland C. Wagner, leur irréductible singularité, tel que le champ d’empathie des bébêtes, permet de réinvestir le motif de l’altérité animale pour décaler notre regard sur nous-mêmes. L’hybridité des hommes-animaux de Bordage n’est pas seulement biologique : nous sommes incités initialement à interpréter les hiérarchies sociales entre espèces comme des faits de nature, mais pour saisir à quel point ce prétendu ordre naturel résulte d’une construction arbitraire. La quête de sens autour des furtifs dépasse la simple expérience de pensée xénobiologique pour interroger la fatalité apparente d’une société de surveillance contraignant et réduisant de plus en plus les possibles politiques, pour en révéler les fondements fascistes. Les bestiaires de la science-fiction se révèlent ainsi sources à la fois d’un plaisir de l’imagination et d’une jouissance de l’interprétation, dans une double dimension affective et cognitive.