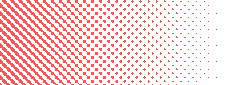Tous touristes ! Intuitions romanesques d’un phénomène de masse
Après le plaisir de voyager, le plus grand est de raconter ses voyages ; mais le plaisir de celui qui raconte est rarement partagé par celui qui écoute ou qui lit. Aujourd’hui nul pays n’est nouveau, tout le monde a été partout […] (Ampère, 1842, p. 161).
1La figure du touriste ne peut plus être convoquée aujourd’hui sans être accompagnée de son cortège de représentations moqueuses. Elle incarne tout ce que chacun de nous, par amour-propre, prétend ne pas être : un individu grotesque, qui imagine se fondre dans le paysage grâce à une panoplie censée faire couleur locale, mais qui se fait toujours remarquer par la lourdeur de son attirail ; un consommateur, abîmant le monde qu’il parcourt, rabaissant les cultures différentes de la sienne au rang de curiosités locales, dénaturant les lieux en sites et les édifices en monuments ; un conformiste, incapable de sortir des ornières tracées par les guides de voyage, et réservant ses admirations à ce qui aura préalablement été approuvé par la vaste communauté de ses semblables ; plus même un individu, mais l’élément anonyme d’une foule innombrable, visitant l’endroit que tout le monde a visité, immortalisant le point de vue que tout le monde a immortalisé, racontant une expérience que tout le monde a racontée.
2À ce mot, tourisme, nous avons probablement tous en tête les mêmes images de ces pratiques que nous trouvons volontiers ridicules, et qu’il est même de bon ton de trouver ridicules : l’aimant faussement artisanal, générateur de souvenirs, qui vient rejoindre la hideuse collection sur la porte du réfrigérateur ; la conventionnelle photographie originale ; les visiteurs alignés à quelques dizaines de mètres de la tour de Pise pour s’immortaliser en train de soutenir le poids du campanile penché, suivant un effet d’optique prétendument subtil ; la perche télescopique annonçant l’entrée en scène du voyageur sur un lieu jugé digne d’intérêt, – mais moins tout de même que sa propre personne – ; sans oublier la conversation amicale qui finit toujours par couronner tous ces efforts – on se doit d’avoir fait l’Islande, Dubrovnik ou le carnaval de Rio pour être à la page.
3Il n’a pourtant pas fallu attendre les smartphones et Instagram, ni même les appareils en bandoulière et les Guides Verts, pour voir émerger, au sujet de telles pratiques, discours critiques et représentations railleuses. Au xixe siècle, en plein âge d’or du récit de voyage, celui-ci connaissant alors à la fois son plus grand succès éditorial et son entrée en littérature, de nombreux romanciers prennent déjà conscience du changement en train de s’opérer autour de la figure du voyageur : le touriste au sens ancien du terme – celui du Grand Tour –, individu remarquable animé par l’envie de parfaire son éducation et de découvrir le monde, cède progressivement la place au touriste au sens actuel du terme, associé à la bêtise et au pullulement. Déjà, au moment où l’Anglais Murray, l’Allemand Baedeker et le Français Joanne inventent le guide touristique moderne, au moment où Thomas Cook lance les premiers voyages organisés, des romanciers ont l’intuition d’un phénomène de masse qui n’adviendra, pourtant, qu’au xxe siècle.
4Que l’on ait affaire à une peinture détaillée des nouvelles modalités du voyage, ou que l’on ait simplement affaire à une scène ponctuelle dans un roman dont le sujet est tout autre, le constat est le même. Dans les romans et nouvelles humoristiques d’Alphonse Daudet, Alphonse Allais, Jerome K. Jerome, H. G. Wells ou des frères George et Weedon Grossmith, comme dans les pages satiriques de leurs contemporains, les personnages de touristes se bousculent au point de créer un effet de masse. Sous la plume vengeresse de Samuel Butler, le portrait en voyageur prévoyant et prévisible sert à faire perdre tout crédit à une figure honnie ; sous la plume assassine d’Octave Mirbeau, il s’agit plutôt de livrer au mépris du lecteur des échantillons de ces populations crétinisées que l’écrivain exècre. Il n’y a jusqu’à Jules Verne, chantre du roman d’aventures, qui ne ménage une place à ces voyageurs tout sauf extraordinaires, afin de mieux mettre en valeur ses héros. Par leurs attitudes et leurs discours, les touristes, nouvelles incarnations du conformisme, offrent alors la possibilité de s’interroger et sur l’écriture viatique, et sur nos pratiques de voyage à l’heure où, pour reprendre les mots d’Ampère à Sainte-Beuve, « tout le monde a été partout ».
Ces touristes qui pullulent
5Au sein de chacune des œuvres que nous mentionnerons ici, grâce à d’habiles systèmes de personnages notamment, les romanciers s’attachent à dépeindre le fourmillement de ces nouveaux voyageurs qui se pressent en bord de mer, en Italie ou dans les Alpes, et qui ne parviennent jamais à ne pas marcher dans les pas de tous leurs prédécesseurs.
6Le touriste, figure si remarquable dans ses travers, a souvent droit, certes, à son portrait singulier. Comme dans la vraie vie, sa silhouette se détache de l’arrière-plan. Il ne se fond pas dans le paysage ; il ne se confond pas davantage avec les autres personnages. Les écrivains lui accordent volontiers plusieurs lignes voire plusieurs paragraphes de description pour détailler son portrait physique, toujours en pied. Les textes marquent une pause pour le mettre en lumière par l’intermédiaire de véritables scénographies. On pensera notamment ici, chez Alphonse Daudet, à la fameuse apparition de Tartarin au sommet du mont Rigi, dans l’incipit de Tartarin sur les Alpes. La scène pourrait presque avoir pour bande sonore l’ouverture du Zarathustra de Strauss dérapant tout à coup en une succession de fausses notes :
Monter si haut, venir des quatre coins du monde pour voir cela… Ô Baedeker !...
Soudain quelque chose émergea du brouillard, s’avançant vers l’hôtel avec un tintement de ferrailles, une exagération de mouvements causée par d’étranges accessoires (Daudet, [1885] 1994, p. 553).
7S’ensuit un portrait dépeignant tour à tour Tartarin en « vache égarée », en « rétameur chargé de ses ustensiles », en arbalétrier puis, finalement, en « parfait alpiniste » (p. 553-554).
8Le touriste, trop original dans l’accoutrement qui était censé le camoufler, se retrouve au centre de l’attention. Il passe au premier plan du récit de voyage dont il n’aurait dû être que le support, attire les regards des autres personnages, contraint la narration à se focaliser sur lui. Dans le roman de Jerome K. Jerome, Three Men on the Bummel (soit « trois hommes en balade », mais l’œuvre est plus souvent traduite sous le titre Trois hommes sur un vélo), le touriste devient ainsi lui-même le monument à visiter, la curiosité à immortaliser :
Je me retournai et vis ce que peu d’Anglais, j’en suis sûr, ont pu voir dans leur vie. Le touriste britannique, dans sa perfection et tel que l’imagine l’homme du continent, accompagné de sa fille. Ils venaient vers nous, bien vivants, en chair et en os si j’ose dire – à moins qu’ils ne fussent qu’un rêve. C’était le Milord et la Miss anglais tels que la presse comique et le théâtre, sur le continent, se plaisent depuis toujours à les caricaturer : parfaits jusque dans les moindres détails. [I turned my head and saw what, I suppose, few living Englishmen have ever seen before – the travelling Britisher according to the Continental idea, accompanied by his daughter. They were coming towards us in the flesh and blood, unless we were dreaming, alive and concrete – the English « Milor » and the English « Mees », as for generations they have been portrayed in the Continental comic press and upon the Continental stage. They were perfect in every detail. (Jerome, [1900] 2008, p. 245-246, trad. p. 156)
9Le texte propose ensuite deux pages de portrait, au cours desquelles les protagonistes cherchent à prendre le duo de touristes en photo.
10L’impression de singularité est néanmoins trompeuse. Systématiquement moqué pour son apparence excentrique, le touriste se transforme dès le xixe siècle en type. Les caricatures proposées par les romanciers s’avèrent très fréquemment construites autour de quelques éléments qui sont toujours les mêmes, si bien que se retrouve d’un texte à l’autre ce qui apparaît comme la panoplie complète du parfait touriste, véritable modèle de prêt-à-porter donnant lieu à des morceaux littéraires de prêt-à-écrire. Voici le portrait de Tartarin :
[…] un gros homme, trapu, râblé, qui s’arrêtait pour souffler, secouer la neige de ses jambières en drap jaune comme sa casquette, de son passe-montagne tricoté ne laissant guère voir du visage que quelques touffes de barbe grisonnante et d’énormes lunettes vertes, bombées en verres de stéréoscope. Le piolet, l’alpenstock, un sac sur le dos, un paquet de cordes en sautoir, des crampons et crochets de fer à la ceinture d’une blouse anglaise à larges pattes complétaient le harnachement de ce parfait alpiniste. (Daudet, [1885] 1994, p. 553)
11Est-il si différent du Milord décrit par Jerome ?
Sur son costume poivre-et-sel, il portait un long manteau clair qui lui tombait presque sur les talons. Il avait un casque blanc à voilette verte, une paire de jumelles en bandoulière et des gants bleu-lavande. Il tenait un alpenstock plus grand que lui. [Over a pepper-and-salt suit he wore a light overcoat, reaching almost to his heels. His white helmet was ornamented with a green veil; a pair of opera-glasses hung at his side, and in his lavender-gloved hand he carried an alpenstock a little taller than himself.] (Jerome, [1900] 2008, p. 246, trad. p. 156)
12Bien des textes de l’époque mentionnent en effet l’alpenstock, les lunettes vertes ou le chapeau-casque.
13Au portrait-type sérialisé s’ajoute fréquemment un autre procédé permettant de créer l’impression qu’affluent déjà, sur les lieux que l’on dira plus tard touristiques, les foules. Il s’agit du retour cyclique de personnages.
14Certains de ces personnages sont encore chargés de remplir un rôle. Dans les textes d’H. G. Wells centrés sur des figures de cyclistes par exemple, comme la nouvelle « A Perfect Gentleman, a Bicycling Adventure and What Came of It » (1897), l’individu qui ne cesse de se retrouver sur la route des protagonistes fait office d’opposant. Ainsi, si dans The Wheels of Chance (traduit sous le titre La Burlesque Équipée du cycliste) le romancier ne cesse de faire se croiser son héros, modeste employé de boutique en congés, et un autre cycliste, plus doué et mieux équipé, c’est parce que cet autre homme symbolise d’abord une forme de concurrence. Les deux personnages, lancés sur le même chemin, rêvent d’ascension sociale ; la route trop fréquentée fait voir le caractère illusoire de ce désir.
15Le plus souvent, les personnages croisés et recroisés dans les lieux de villégiature remplissent au contraire un rôle tout à fait secondaire, quand ils ne sont pas de simples figurants. On pourra penser, dans Les 21 jours d’un neurasthénique de Mirbeau, à l’importun qui encombre la route de M. Tarte, et qui finit poussé dans un précipice pour avoir exaspéré l’excentrique personnage (Mirbeau, [1901] 2010, p. 373-376). Il n’est qu’une silhouette sans épaisseur, quasiment résumée à un front – une créature sans identité, à l’existence de laquelle on croit donc à peine.
16Dans le roman humoristique des frères Grossmith, The Diary of a Nobody (Le Journal d’un homme sans importance), le protagoniste, évidemment coiffé d’un chapeau-casque, tombe de manière tout aussi évidente, au bord de la mer, sur ses fréquentations londoniennes (Grossmith, 1892, p. 91, trad. p. 68) ; les personnages n’ont d’autre fonction que de créer le sentiment d’une éternelle répétition. Chez Jules Verne, ces voyageurs d’un nouveau genre, qui ne se déplacent d’un lieu dans un autre que pour reproduire la monotonie de leur quotidien, ne donnent alors plus lieu qu’à des portraits collectifs qui les fondent dans une masse. Ainsi se déploie la description des foules se pressant à Oban, dans Le Rayon vert :
[…] ce monde d’oisifs, qui constitue la population flottante des villes de bains, à peu près la même partout : des familles, dont l’unique occupation est de voir monter et descendre la mer […] ; des gentlemen, graves et flegmatiques, sous leur costume de baigneurs […] ; quelques touristes de passage, la lorgnette en bandoulière, le chapeau-casque sur le front, les longues guêtres aux jambes, l’ombrelle sous le bras […] (Verne, [1882] 2004, p. 94-95).
Les sentiers piétinés de la littérature
17Ce qu’expriment les romanciers, en dépeignant ces troupeaux de touristes, c’est bien le manque d’originalité d’individus persuadés de devenir les protagonistes remarquables d’expéditions remarquables, lesquelles expéditions ne pourraient dès lors que donner lieu à des récits remarquables. Le xixe siècle connaît en effet une profusion de récits de voyage, puisque la pratique du voyage est encore indissociable de la pratique de l’écriture. Chacun y va donc de son récit, un phénomène qui s’accentue en même temps qu’il change radicalement de nature et se dégrade à partir de 1871, une fois qu’est inventée la carte postale. Or, si le ressassement des mêmes lieux communs a longtemps été un élément indissociable et tout à fait acceptable de l’écriture viatique, le phénomène devient suspect au moment où le voyage se démocratise et où l’explorateur éclairé cède la place à la horde des touristes aveuglés. À quoi bon retranscrire encore les impressions de son voyage, quand tout le monde les connaît déjà pour les avoir déjà expérimentées ? L’écriture se fait alors souvent compensatoire, et l’est d’autant plus que le récit sera court : le touriste surcharge son récit d’expressions ronflantes (tous les paysages coupent désormais le souffle), pour masquer le conformisme de son expérience.
18Par le recours à la caricature, les écrivains disent cette monotonie paradoxale qui s’empare du récit de voyage, la litanie des « sublime » et des « magnifique ». Au prestige du Grand Tour succèdent de risibles circuits qui voient les personnages tourner littéralement en rond. Chez Alphonse Allais, dans la nouvelle « Un viaduc cyclable autour du monde » (1897), le touriste va jusqu’à faire le tour de la terre sans jamais prendre la peine de s’arrêter nulle part, définitivement séparé de tout ce qui lui est étranger par cette route qu’il ne peut quitter. Chez Daudet, de manière à peine moins caricaturale, c’est le circuit Cook qui déroule son itinéraire sans surprise.
19Tout au long de Tartarin sur les Alpes, Daudet ne se contente pas, en effet, de faire réapparaître périodiquement les personnages des touristes engagés dans un voyage organisé. Pour écrire les scènes de ces figurants à peine ébauchés, il se sert aussi de séquences figées qui enferment chacun d’eux dans un leitmotiv ridicule. Les touristes, fantoches à la merci de compagnies de voyages qui leur dictent leurs désirs et leurs admirations, sont comme produits en série, agissant toujours de la même manière, s’exprimant avec les mêmes mots. Ainsi les personnages du circulaire Cook sont-ils associés, à chacune de leurs réapparitions, à un nombre limité de syntagmes qui se répètent. Ces expressions figées apparaissent par exemple dans la scène qui voit Tartarin traverser le lac des Quatre Cantons :
[Tartarin] avait bien retrouvé des figures de connaissance, le membre du Jockey avec sa nièce (hum ! hum !...), l’académicien Astier-Réhu et le professeur Schwanthaler, ces deux implacables ennemis condamnés à vivre côte à côte, pendant un mois, rivés au même itinéraire d’un voyage circulaire Cook, d’autres encore […]. (Daudet, [1885] 1994, p. 584-585)
20On les repère encore quand Tartarin descend à l’hôtel Baltet de Chamonix : « [Tartarin] lisait à haute voix les noms des voyageurs qui, depuis huit jours, avaient traversé l’hôtel : “Docteur Schwanthaler et madame… Encore !… Astier-Réhu, de l’Académie française…” Il en déchiffra deux ou trois pages […]. » (p. 657) Ou encore dans cet autre passage, lorsque Tartarin se retrouve malencontreusement enfermé au château de Chillon : « […] cinq minutes après, il voyait son cachot envahi par ses anciennes connaissances du Rigi-Kulm et de la Tellsplatte, l’âne bâté Schwanthaler, l’ineptissimus Astier-Réhu, le membre du Jockey-Club avec sa nièce (hum ! hum !…), tous les voyageurs du circulaire Cook. » (p. 651-652)
21Au xixe siècle, le personnage qui s’offre un voyage d’agrément enfonce volontiers un salacot sur sa tête, comme il s’empare d’un alpenstock. Il se rend aussi invariablement en Suisse ou en Italie, quand il ne se contente pas d’une villégiature dans une ville de bains ; le nombre de destinations touristiques évoquées dans les romans de cette période reste très limité.
22Or la reprise de mêmes topoï, parfois de mêmes syntagmes d’une œuvre à l’autre, finit par créer l’impression que les différents univers fictionnels pourraient bien n’en former qu’un seul. En s’accordant une incursion du côté du théâtre, on imaginerait assez Tartarin croiser sur les sommets alpins un M. Perrichon en extase devant la « mère de Glace » ; en restant dans le domaine romanesque, on l’imaginerait aussi arriver à l’Hospice du Grand-Saint-Bernard et rencontrer, dans ce lieu où le mythe napoléonien s’est transformé en attraction touristique, un autre personnage jouant à l’aventurier épique, George Pontifex de Samuel Butler, dans The Way of All Flesh (Ainsi va toute chair, 1903), auquel nous allons à présent nous intéresser.
De la population fictionnelle à la foule réelle
23De fait, les repères se brouillent entre les œuvres, comme au sein de la diégèse, si bien que touristes fictifs et touristes réels se font écho les uns aux autres jusqu’à créer le sentiment d’une foule innombrable : ces sentiers que parcourent des personnages se rêvant pionniers s’avèrent au contraire bien piétinés.
24Ainsi, lorsque Butler relate l’ersatz de Grand Tour effectué par George Pontifex, il ne se contente pas de tourner en dérision les attitudes de son détestable personnage, l’un des antagonistes du récit, en se moquant de son conformisme :
Je me rappelle avoir vu […] le journal qu’il tint au cours de son premier voyage. C’est un document typique. Je sentis en le lisant que l’auteur, avant de partir, avait résolu de n’admirer que les choses pour lesquelles son admiration lui ferait honneur, et de ne voir la nature et les arts qu’à travers les lunettes que des générations de pédants et d’imposteurs lui avaient transmise. La première échappée sur le mont Blanc jeta M. Pontifex dans un transport de banalités : « Je ne puis exprimer ce que je ressentis. Je haletai et cependant j’osai à peine respirer, lorsque je contemplai pour la première fois le monarque des montagnes […]. » [I remember seeing […] the diary which he kept on the first of these occasions. It is a characteristic document. I felt as I read it that the author before starting had made up his mind to admire only what he thought it would be creditable in him to admire, to look at nature and art only through the spectacles that had been handed down to him by generation after generation of prigs and impostors. The first glimpse of Mont Blanc threw Mr Pontifex into a conventional ecstasy. « My feelings I cannot express. I gasped, yet hardly dared to breathe, as I viewed for the first time the monarch of the mountains […]. »] (Butler, [1903] 1966, p. 4, trad. p. 48)
25Par un habile jeu de collages, le romancier englobe, dans sa critique, des touristes bien réels. Butler compose ainsi l’une des scènes de ce Grand Tour dégradé à l’aide d’une lettre que Felix Mendelssohn, le compositeur, adressa à ses sœurs en 1831, à l’occasion de son propre séjour en Italie (Mendelssohn, 1980, p. 218). La citation, authentique, est insérée après une autre citation, fictive – celle du journal de voyage tenu par le personnage –, les deux citations offrant, à quelques détails près, le même contenu (Butler, [1903] 1966, p. 47-48, trad. p. 50-52). Or la lettre de Mendelssohn, document réel que le romancier a pastiché pour inventer le discours de George Pontifex, remplit dans la diégèse la fonction exactement inverse. Le personnage de Butler effectuant son voyage en Italie au sortir des guerres napoléoniennes, sa version est en effet la première sur le plan chronologique. Le pastiche devient la version originale, la citation originale devient le plagiat : si Butler copie habilement Mendelssohn, c’est Mendelssohn qui copie maladroitement George Pontifex, et non l’inverse. Tout célèbre qu’il soit, le compositeur n’est lui-même qu’un membre du troupeau.
26Romans et nouvelles anticipant l’émergence du tourisme de masse interrogent donc la propension de chacun à se croire un individu exceptionnel et à se prétendre créateur, alors que l’on ne parvient à s’affranchir ni des idées communes (on se rend au même endroit que tout le monde), ni du discours commun (on conserve le souvenir de cet endroit, par l’écrit ou par l’image, en opérant les mêmes choix que tout le monde).
27Il paraît dès lors particulièrement intéressant d’approfondir l’étude de la pratique du pastiche dans l’écriture des guides touristiques, pratique qui contribue à brouiller les frontières entre fait et fiction et à faire succéder aux populations fictionnelles des foules réelles.
28Beaucoup d’écrivains se moquent des guides touristiques dès l’invention de ceux-ci. Ils rient d’abord de la fonction du guide touristique – dicter ce qu’il faut admirer –, à l’instar de Mirbeau :
[…] ce sont les mêmes falotes images qui reviennent, les mêmes faces mortes, les mêmes âmes errantes et les mêmes tics, les mêmes alpenstocks et les mêmes jumelles photographiques ou télescopiques, braquées sur les mêmes lourds nuages, derrière lesquels tous ces gens espèrent découvrir les montagnes illustres dont Baedecker [sic] décrit la splendeur horrifique, et que nul n’a jamais vues, et dont ce serait vraiment une admirable ironie qu’elles n’existassent point, bien que, sur la foi mystificatrice des hôteliers, des guides et des compagnies de chemins de fer, des générations entières eussent défilé devant leur imposture géographique… (Mirbeau, [1901] 2010, p. 208)
29Les romanciers raillent ensuite la prétention des auteurs de ces guides qui, dans la description des sites et des monuments qu’ils présentent, affichent clairement leur désir de proposer de véritables morceaux littéraires. Avec le plus grand sérieux, le guide touristique pastiche fréquemment la littérature afin de donner, par la promesse d’émotions esthétiques exceptionnelles, l’envie du voyage :
Un faible crépuscule à l’E., qui fait pâlir la clarté des étoiles, est l’avant-coureur du jour naissant. Cette clarté douteuse se change en une bande dorée apparaissant à l’extrême horizon ; une lueur rosée commence à teindre les pics des Alpes et leurs neiges éternelles. L’un après l’autre, ils se couvrent de ces reflets diaphanes ; l’intervalle rempli de ténèbres qui sépare le Rigi de l’horizon s’éclaircit par degrés ; forêts, lacs, collines, villes et villages commencent à se dessiner, tout en conservant une teinte froide, jusqu’à ce qu’enfin le soleil, surgissant tout à coup de derrière les montagnes, inonde de lumière ce splendide paysage. […] plus tard, les brouillards s’élèvent, se condensent en nuages et cachent souvent une grande partie du paysage. (Baedeker, [1844] 1883, p. 117)
30Le romancier pastiche alors volontiers à son tour le guide touristique. Sa finalité est néanmoins cette fois humoristique :
Une lueur commençait à éclaircir l’orient, saluée d’un nouvel appel de cor des Alpes et de ce « ah ! » soulagé que provoque au théâtre le troisième coup pour lever le rideau. Mince comme la fente d’un couvercle, elle s’étendait, cette lueur, élargissait l’horizon ; mais en même temps montait de la vallée un brouillard opaque et jaune, une buée plus pénétrante et plus épaisse à mesure que le jour venait. C’était comme un voile entre la scène et les spectateurs. Il fallait renoncer aux gigantesques effets annoncés sur les Guides. (Daudet, [1885] 1994, p. 578)
31D’une version à l’autre, la scène décrite demeure la même. Sous la plume de l’auteur du Baedeker comme sous celle de Daudet, le soleil, lentement, se lève sur le mont Rigi, avant que ses rayons ne soient occultés par le brouillard. D’une version à l’autre, cependant, les choses se gâtent : quand la description devient littéraire, les couleurs se salissent, les images se dégradent. Il ne suffit pas de chanter les « reflets diaphanes » et la « clarté des étoiles » pour faire de la littérature ; il ne suffit pas davantage de se décréter vrai voyageur pour n’être plus le touriste superficiel et borné saccageant le paysage même qu’il se pique d’admirer.
*
32En anticipant le phénomène d’un voyage accessible à tous et, surtout, raconté par tous, les romanciers du xixe et des premières années du xxe siècles ont fait évoluer l’écriture viatique. Ils ont participé à la dévalorisation du lieu commun et ont attiré l’attention sur le fait qu’un tourisme de masse allait nécessairement galvauder des notions comme le pittoresque ou le sublime.
33Parallèlement, ces romanciers ont soulevé des questions intéressant la littérature dans son ensemble, en particulier sur la responsabilité de celle-ci dans les changements sociétaux. Leurs textes posent notamment aujourd’hui la question du rôle joué par la fiction et, de manière beaucoup plus générale, par les arts, dans la croissance exponentielle du tourisme. La plupart du temps, le récit de voyage alimente le désir de voyage. Or tel n’est pas le cas ici : c’est plutôt un sentiment de honte, voire de culpabilité, qu’instillent les écrivains chez leurs lecteurs. Qui ne serait pas gêné de se reconnaître dans leurs textes ? Difficile, en effet, d’échapper aux moqueries de Jerome ou de Daudet, aux sarcasmes de Butler ou de Mirbeau. Si le lecteur ne s’identifie pas aux caricatures qui peuplent leurs pages, à ces types et à ces figurants au fonctionnement mécanique, coincés dans des séquences figées et des retours cycliques dénués de tout réalisme, il est moins sûr qu’il ressorte indemne d’une confrontation aux populations fictionnelles de ces mêmes œuvres. Grâce à de facétieux pastiches de pastiches et à des jeux de collages féroces, certains écrivains parviennent à prendre le lecteur au piège et, en l’incluant implicitement dans leurs portraits collectifs, à le placer face à ses propres contradictions. Chez Daudet et Butler en particulier, ce ne sont plus seulement les univers fictionnels qui fusionnent, donnant l’impression que la masse des voyageurs ne fait que croître et croître encore. Ce sont aussi les foules de touristes fictifs et de touristes réels qui se mêlent, brouillant les limites de la diégèse et privant le lecteur de son si précieux garde-fou – la frontière nette qui le séparait du personnage. En anticipant la démocratisation du voyage d’agrément, les romanciers du xixe siècle remettent donc aussi en question, avec une lucidité singulière, nos propres pratiques, de voyage comme d’écriture, à l’heure où nous sommes effectivement, tous, devenus touristes.