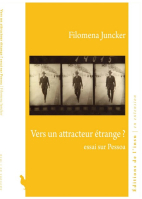
Au-delà du nom, la poésie de Pessoa
L’énigme du nom de personne
1L’énigme de l’œuvre se trouve dans la vie du poète, selon une équation qu’Octavio Paz voudrait ramener au nom, puisque Pessoa en portugais signifie « personne » : « Masque, personnage de fiction, personne1 ». Ce manque est le passage de l’irréalité de sa personne vers la réalité de ses fictions, c’est-à-dire le jeu des masques qui fait apparaître tous les noms de poètes qui peuplent cette « malle pleine de gens », selon le titre du livre d’Antonio Tabucchi2. En effet, de son vivant, Pessoa était un poète et essayiste fort peu connu en dehors d’un petit cercle d’initiés. Après sa mort, il laissa derrière lui quelques rares plaquettes poétiques et sa célèbre malle (deux en fait) où fut découvert une œuvre immense à la fois inachevée et pour une grande partie inédite, composée de près de 27543 documents, dont 18816 manuscrits. Au centre de cette œuvre dispersée se trouve le grand Livre qui forme son aboutissement, dont le centre est articulé autour du mystère des hétéronymes, un lieu où l’auteur peut devenir autre.
2Fernando Pessoa s’explique sur la genèse des hétéronymes dans une lettre à Adolfo Casais Monteiro datée du 13 janvier 1935. Il évoque comment il aurait voulu commencer son œuvre par « la publication d’un grand ouvrage en vers — un volume de trois cent cinquante pages environ — qui aurait englobé les diverses sous-personnalités de Fernando Pessoa lui-même3 ». D’emblée, le poète reconnaît une dimension organique et psychiatrique au processus de la dépersonnalisation des hétéronymes. Pessoa ajoute qu’il s’agit de la « tendance profondément hystérique4 » qui existe chez lui, qui le mène vers une forme intérieure de simulation. La genèse historique remonte à son enfance où le poète s’entoure d’un monde fictif où il dessine des personnages irréels mais qui sont pour lui tout aussi visibles que des objets réels. Le premier fut le Chevalier des Pas qui écrivit une correspondance fictive au jeune Fernando. La création d’un univers peuplé d’êtres imaginaires se poursuit, mais quelques années plus tard, il commence à entendre, voir et sentir ces êtres fictifs. Vers 1912, le poète écrit une suite de poèmes païens, qu’il mettra de côté. Il sentait pourtant se préciser les traits de l’auteur des dits poèmes, qui allait devenir Ricardo Reis. Deux ans plus tard, le 8 mars 1914, il s’approche d’une commode assez haute, prend une feuille de papier et se met à écrire debout, plus de trente poèmes dans une espèce d’extase qu’il ne parvient pas à expliquer. Ainsi naît la « coterie inexistante », une compagnie fictive de noms, de visages et d’écritures qui jaillissent de la plume ou de la machine à écrire, de la manière la plus spontanée, presque sans rature. Pessoa précise le nom et la physionomie de chaque auteur et retrace leur biographie. Bref, les hétéronomes sont plus que des noms. Ils forment un espace dans lequel le poète peut s’effacer à peu près complètement pour laisser émerger une personne à part entière. La dépersonnalisation de cette écriture extatique et la coterie qui en naît offrent une réponse inédite au problème de la solitude profonde qui affecte le poète. Ainsi, à partir de l’hétéronymie se cultive une œuvre qui se déploie dans le quasi-anonymat. Ce manque fait circuler le plus comme un opérateur de démultiplication sous les apparences du moins ou de l’opérateur négatif. Derrière le nom, opère donc la foule de ses hétéronymes que l’on dénombre aujourd’hui à 136 noms fictifs. Derrière le nom se trouve donc l’énigme du 136 + 1, alors que ce plus ne peut se réduire à la simple addition du nom de Pessoa aux cent-trente-six personnalités littéraires engendrées par son écriture, car la vie de Pessoa ne manque pas de se résumer à peu de chose, comme un bref écart entre la naissance et la mort qui sera peuplé cette multitude d’êtres imaginaires, dont le nombre ne peut que croître.
3L’énigme Pessoa ira-t-il grandissant, au fur et à mesure que l’on étudie plus en détails les nombreux feuillets provenant de sa célèbre malle. Dans son dernier essai, Filomena Juncker ouvre cette malle en proposant d’étudier ses habitants à partir d’une perspective dédoublée : premièrement en recourant aux concepts de la psychanalyse et, dans un second temps, aux mathématiques pour mettre en évidence l’orbite d’une trajectoire qui est inscrite au cœur de la démarche de l’hétéronymie. De fait, la dépersonnalisation et la fréquentation de cette coterie imaginaire offre une réponse inédite au problème de la solitude du poète, tandis que le livre tisse les liens étroits entre l’orthonyme et le fait de porter un nom qui n’est pas le sien mais celui de son auteur présumé ou imaginaire. Filomena Juncker y repère une rupture de filiation liée à la mort prématurée du père. Le passage d’un nom à l’autre relève d’une poétique propre qui se rapproche d’un processus de traduction, avec lequel Pessoa va rapidement devenir familier. Son œuvre fut écrite en anglais, en français et en portugais. Ce passage d’une langue à l’autre marque le passage d’une identité linguistique vers une autre, ce depuis la mort du père de Pessoa en 1893 et son départ subséquent de sa famille pour l’Afrique du Sud où le jeune enfant poursuit ses études en anglais.
4Pour l’instant, considérons que l’hétéronomie est une extension exploratrice du langage qui vise à découvrir ses limites et les possibilités de la fiction. Il se tient non pas dans les parages du trop-plein mais dans celui du non-être. Il est la voie par laquelle le poète fuit la réalité pour une fiction qui est bien plus réelle que le réel. L’enjeu est une sorte d’irréalisation du moi à travers les vers de Pessoa, un moi qui glisse du retrait du masque devant le miroir vers la découverte d’un autre moi altéré, vieilli et méconnaissable. En partant de l’« illusio », Filomena Juncker propose d’étudier les jeux de l’enfance qui s’organisent autour du déplacement du « je » et le principe de la dépersonnalisation qui nourrira plus tard la genèse des hétéronymes. Se met en place un principe de « l’au-delà du miroir » dont le visage de la mère (à moins que ce soit la main, cette main qui conduit l’enfant innocent au cimetière afin de le confronter à cette chose qu’il ignore : la mort) devient le vecteur de remémoration et d’écriture. De fait, Pessoa écrit en vue de retrouver ce visage perdu. La mort de la mère est donc une triple perte, bris du miroir, perte du visage et conduite de l’enfant ignorant la mort vers sa propre identité, vers un processus d’identité qui est au cœur de l’identification. Le principe selon lequel le poète peut reconnaître son identité (se voir identique dans le miroir de ses masques) repose donc sur le regard de la mère. Celui qui se perd dans la perte de vue d’une mère morte appelle donc une invocation du regard de la mère qui transforme le poète à nouveau en un enfant. Cette perte est déchirante. Elle opère une levée du masque derrière laquelle on devine les différentes couches de masques. Cette superposition des multiples masques montre comment l’œuvre de Pessoa est la somme des non-moi, ou comme il le suggéra avec le terme d’une « biographie de personne » (p. 10).
Les jeux du je
5De l’illusio à l’expérience de dépersonnalisation, s’opère une perte de l’identité dans laquelle le « je » se confond avec le « ils » et le « tu ». Cette plongée dans les souvenirs de jeunesse, à la recherche des traces de dépersonnalisation, permet de découvrir des images introspectives qui se glissent entre celui qu’il est et celui qu’il fut, dans « cet intervalle entre moi et moi-même que j’appelle moi5 ». Des pratiques de correspondances imaginaires avec ses hétéronomes amène Pessoa à concevoir des ex-Libris avec les noms de ses créatures, des cartes de visite portant l’adresse même de Pessoa et permet de concevoir un au-delà de la « pseudonymie mystificatrice » à la question du « je ». « Qui suis-je ? » pose un questionnement ontologique sur mon être. « Qui est je » propose plutôt un glissement ou un déplacement nominal du jeu au sein de la construction des hétéronymes.
6L’œuvre élabore un espace de substitution dans lequel le jeu et l’illusion ludique ouvrent la voie à une valorisation des dédoublements comme réponse possible au processus de dépersonnalisation. L’illusion est la croyance ou l’engagement d’être dans le jeu comme une sorte de libido ou de croyance. Elle est un rapport enchanté au jeu selon Bourdieu, qui est perceptible uniquement pour ceux qui participe au jeu. Introduisant l’illusio dans le champ des production artistique, Bourdieu montre comment celle-ci produit une fétichisation de l’œuvre d’art6, en d’autres mots, ce n’est pas l’artiste qui produit l’œuvre d’art mais le champ de production comme univers de croyance de tous ceux qui y participent (lecteur, critique, éditeur, la recherche académique). Dès lors, Pessoa n’est pas seul, même si nous considérons l’hypothèse excessive d’un monstre qui serait sorti de la malle, il faut penser Pessoa comme un alter ego de lui-même, un Fernando Pessoa en tout point identique au premier. Il y a un passage de main autant que de nom dans le jeu de l’hétéronymie, où le fait d’écrire sans être, de tenir la plume pour quelqu’un d’autre sans que l’on puisse y ajouter son nom relève d’une réaction face à l’inexistence. Ces séances d’écriture relèvent de la transe mystique, une forme de voyance dans laquelle on n’est plus tout à fait présent. Ceci appelle un autre geste, plus profond, qui relève de la psychanalyse pour remettre en jeux à nouveau et incessamment dans ce qui sera une chasse sans fin, comme si l’inachevé est l’horizon d’une œuvre fondée sur l’hétéronyme. L’hétéronyme est synonyme d’une écriture à multiples facettes ou à multiples visages, une écriture qui au lieu de se concentrer et se rarifier pour devenir elle-même, ne cesse de se dilater pour diffuser comme des cours d’eaux avant de se jeter dans la mer.
Pessoa encore une fois
7Il ne s’agit pas d’entrer dans le mythe Pessoa, mais de s’aventurer parmi les mythes de ces hommes qui n’ont jamais existé, dont la fragmentation des persona équivaut à son absence. À sa mort, ses proches découvrent une malle en bois de camphre qui comporte une matière textuelle imposante, sorte de « war chest » d’une œuvre qui n’est autre qu’un « work in progress », mais dont la difficulté réside dans le fait que cette masse de feuillets s’organise autour de 136 noms d’auteurs différents. L’organisation des personnages devient une quête de la vérité. La dépersonnalisation poétique du nom orthonyme est encore plus plurielle que les hétéronomes. Il est celui qui choisit d’être lui-même ou un autre un jour, et un troisième le lendemain. Le jeux des masques et des noms se traduit par l’incapacité de finir son grand livre car dans ce travestissement identitaire, l’être se défait de sa condition d’être. Mais quelle est la limite de cette déprise ontologique ? Jusqu’où l’être peut-il ainsi se défaire de lui-même ? Aucun de ces écrits ne pourra jamais être terminé, car il laisse toujours s’interposer de nouvelles pensées, de nouvelles associations d’idées, pour extraordinaires qu’elles soient et impossibles à exclure, avec l’infini pour seule limite. Bref, la perte de soi se dissout dans les méandres du temps, comme une perte de « l’être que je fus » (p. 47). Il aura fallu à Proust plus de cinq mille pages pour découvrir la vocation du narrateur de la Recherche, que le « je » du narrateur qui écrit peut sous le signe de la littérature traverser le temps et la mémoire pour enfin commencer à écrire son œuvre comme une forme de cristallisation de celui qu’il fût.
8L’œuvre de Pessoa s’articule autour de cette difficulté d’être. Elle relève d’une esthétique de l’absence ou du débris, qui est ce qui reste d’un bris. Fragment défait d’un vase brisé, il tient tout entier dans la défaite de ce morcellement. Ses amis imaginaires issues du mouvement spectral son aussi vrais que des images dans un miroir : jeu sonore, le double est un écho, alors que le miroir ne vient qu’après, comme si une méconnaissance du moi démultiplie les « moi ». De cette démultiplication d’êtres, on saisit la transformation du désir, un désir qui est un cas de ce qu’il désire. Il est une quête indéfectible de l’illusion ou de ce qui n’est pas. Face à cette illusion, il existe chez Pessoa une conscience aiguë des mécanismes de clairvoyance qui dépasse le miroir, une conscience unie face au désir démoniaque ou céleste d’une totale auto-transparence. En se demandant qui est Pessoa, Octavio Paz rappelle que « feindre c’est se connaître », tout en évoquant combien le poète rappelle le « fantôme taciturne du midi portugais »7 qui cultive la méprise et aime à s’effacer comme un spectre. Pessoa se lance dans une quête de soi qui finira par l’aliéner. À force de se chercher, le poète qui porte le nom de personne finira par s’inventer. C’est ainsi qu’il met le feu aux poudres en cette année 1914, au moment même où Marinetti en Italie, Apollinaire en France et Maïakovski en Russie, Pessoa invente une révolution poétique qui portera le nom du futuriste Alvaro de Campos.
9Avec l’hétéronyme, l’autre est un alter égo. En se glissant sous la peau de tous ses autres, le poète ouvre la porte de bien des possibilités qui le ramène toujours vers cette solitude première, existentielle et métaphysique. « Creux au dedans de moi, sans avant ni après » (p. 181). Telles sont les œuvres poétiques aléatoires de Campos. C’est donc sous la peau de quelqu’un qui creuse, comme dans le terrier de Kafka où un étrange troglodyte cherche à échapper à ses assaillants finit par élaborer une architecture si échevelée qu’elle devient le piège même à partir duquel il devient impossible de s’échapper. C’est donc le drame de la perte de soi qui se déploie à travers l’œuvre de Pessoa, un drame qui prend une dimension cosmique, comme un être expulsé d’un Univers lointain, joint à une lassitude extrême et insoutenable de celui qui voudrait cesser même d’avoir existé. En même temps, dans le commentaire sur la lettre des hétéronymes, on découvre une sorte de pure jouissance de l’auteur qui se laisse traverser par une parole qui lui est étrangère. Une fois qu’Alvaro de Campos est né, il faut rapidement lui donner des disciples, comme une tension psychique qui donne naissance à une impulsion créatrice. Au cœur des hétéronymes apparaît une dépersonnalisation aliénante de l’auteur tant que ne se forme pas une totalité qui soit capable de le combler. Ainsi, Pessoa nous confronte à une hystérie masculine passé au moule des phénomènes hallucinatoires, dans lesquels le langage n’est pas un signe mais un nœud de signification dont problème est celui de sa vérité.
Science du chaos : de l’intranquillité à l’instabilité
10Le Livre de l’intranquillité est un anti-livre. Sa composition à partir de la logique de l’hétéronymie revient à une étrange équation, ou une inquiétude qui gagne à être éclairé par l’étude des systèmes dynamiques non linéaires et instables. Ici, Filomena Juncker propose de considérer un nouveau paradigme mathématique afin d’étudier l’œuvre de Pessoa, qui relève de la dynamique des systèmes ou des structures complexes et de la théorie du chaos. L’essai nous fait glisser sur un terrain nouveau, clairement en rupture avec le paradigme de la physique classique et l’utopie d’une prédictibilité totalement déterministe. La démonstration cherche à concilier des points de vue complémentaires d’une même réalité pour pénétrer la connaissance des choses, à partir des concepts de fractal et d’attracteurs étranges. Pour commencer en douceur, l’auteur nous propose différents fragments de Pessoa qu’elle confronte avec des citations de Stephen Hawking, afin de nous montrer que l’éclectisme et la modernité de Pessoa l’amena à s’intéresser de près aux sciences et aux mathématiques, à l’instar de Paul Valéry. Sous la signature de Bernardo Soares et d’Álvaro de Campo, elle nous fait lire des fragments qui annoncent certaines des grandes découvertes scientifiques comme la théorie des trous noirs. Des fragments de prose, des « petits riens » font résonner des bruits étranges qui peuvent être localisés au fond de soi et parmi les coins les plus reculés de l’univers, au gré d’une architecture dynamique en devenir, afin de montrer comment chaque hétéronyme développe son propre système d’écoute et manipule différemment le matériau sonore d’une langue.
11Étrangement, nous assistons à une démonstration mathématique par l’absurde à partir du matériaux sonor de la langue. En déclarant « Dans chaque sensation, je suis autre », Bernardo Soares montre comment une construction très riche de l’univers sonore est possible où l’instabilité est cultivée ou favorisée. « Passant de tout — et même de mon âme propre — je n’appartiens à rien, ne désire rien, ne suis rien — centre abstrait de sensations impersonnelles, miroir tombé sensible, à terre, tourné vers la diversité du monde » (p. 237). Ce centre abstrait est une étrange orbite qui décrit la diversité du monde. Elle est une figure d’une grande complexité, celle des systèmes chaotiques développés à partir de comportements dynamiques complexes. Ici, nous entrons dans l’espace de phases, qui est différent de l’espace euclidien et où tous les états sont possibles pour un système dynamique. Dans cet espace, un système dynamique complexe est attiré par un volume restreint, qui déclenche une errance au hasard sans jamais repasser par le même point. Tel est la définition d’un attracteur étrange dans la théorie des fractal que Filomena Juncker tente ici d’appliquer à la poétique de Pessoa. L’auteur reconnaît qu’il s’agit d’une invitation à un éparpillement paradoxale, par lequel on prend le risque d’abandonner le formalisme mathématique pour une intersection improbable entre poésie et science. Mais en revenant sur le concept de fractal et d’attracteur étrange, dont la courbe représente l’état d’un système qui paraît en désordre mais où règne un type d’ordre que l’on nomme chaos déterministe, l’attracteur est l’agent qui attire le système par la dynamique d’un ordre particulier. En suivant de telles courbes, qui sont représentés dans le livre par des photographie de Jos Leys, l’auteur suit les multiples voyages du/des poète(s) au pays de la sensation qui déclare qu’au plus il aura de personnalités, au plus intensément il ressentira. Comme le système revient toujours vers ce même attracteur, le poète ressentira comme plusieurs personnes différentes une même sensation mais abordées par des perspectives et des poétiques différentes. À partir de ce formidable éparpillement qui vise à tout ressentir comme plusieurs personnes, s’opère soudain une cristallisation vers une totalité-limite que le poète identifie avec une « existence totale de l’univers » (p. 225). Le processus est vertigineux car il opère une identification avec la totalité de l’espace qui pourrait bien ressembler à l’expérience de la psychasthénie, où l’identité se dissout dans ces idées qui traverse l’espace et donc le corps du poète. Chaque personnalité ou chaque hétéronyme répond différemment à une sensation, en ce sens où c’est cette dynamique qui génère cette altérité : « Dans chacune des sensations je suis autre » (p. 229) déclare Bernardo Soares. Chaque sensation offre un surplus de réalité et donc d’émotion. Elle ouvre à un espace propre, qui se doit d’être occupé par quelqu’un d’autre. Celui-ci devient un espace mental d’une sensation intériorisée, alors que le mouvement du système sur un attracteur étrange présente un phénomène de dépendance sensitives des conditions initiales.
12L’intranquillité de Soares propose des conditions initiales assez proches l’une de l’autre (l’attracteur) et qui vont évoluer en suivant une courbe qui ne va plus ressembler aux autres. Chaque personnalité, chaque hétéronyme, suit donc une trajectoire exponentiellement divergente. L’espace mental des sensations intériorisées aboutit à un subtil mélange entre hasard et confinement. Soares évoque l’image d’une cellule sans limite, pour donner l’intuition de cet espace clos et borné dans lequel se déplace les infinis trajectoires d’un système dynamique chaotique. Telle est l’intranquillité du poète où l’hétéronomie part de conditions initiales pour aboutir à des évolutions très divergentes à partir d’un même attracteur. Comme le dira Pessoa, la résonnance intime des mots et des sons divergent au moment même où ils convergent.
Plaidoyer pour les sciences poétiques
13Le recours de la poétique aux mathématiques n’est pas nouveau. La poésie a recours aux prémices et aux contraintes de la seconde afin d’édifier des règles de sa propre écriture. Paul Valéry en se tournant vers Léonard de Vinci, Roger Caillois en dressant l’éloge des sciences diagonales ou Raymond Queneau invoquant les mathématiciens pour fonder l’OULIPO offrent différents exemples d’une telle démarche. Elle relève d’une même direction de l’esprit, une identique volonté d’établir une poétique comme un jeu dont les règles sont aussi précises et rigoureuses que celle des sciences. Les sciences diagonales tentent l’hasardeux rapprochement des pensées de Mendeleïev avec la poétique de Saint-John Perse afin de souligner comment une poétique peut viser à un dénombrement de la diversité du monde selon les principes mêmes qui présidaient à l’établissement de la table périodique des éléments8. Et dès que Caillois se tournent vers les jeux, voilà qu’il invoque la capabilité combinatoire du calcul informatique ou le troisième principe de la thermodynamique pour montrer comment les lois de la symétrie, qui structurent et organisent la matière, nécessite l’apparition de la dissymétrie pour atteindre des niveaux d’organisation plus élaboré à travers l’organisation de la matière. Dès lors, il suggère que cette récurrence de formes à travers les différents règnes offre ses lointaines analogies que le poète met au jour. Les sciences diagonales ne sont autre que la tentative de formaliser et systématiser le dénombrement des répétitions et des analogies à travers les règnes et les niveaux d’organisation de la matière. Tout en fondant sa poétique sur ces récurrences, Caillois reconnaît qu’une tentative d’approches scientifiques de ces faits relève de cohérences aventureuses. On retrouve un similaire enjeu des récurrences chez Queneau, dont le travail des répétitions dans Exercices de styles annonce une tentative de systématiser les occurrences dans le domaine de la stylistique, reprenant un même épisode qui est réécrit dans différents styles, explorant la complexité et la répétition d’un même évènement, à l’instar de la sensation chez Pessoa. Chez Queneau, pareille logique aboutit aux Cent mille milliards de poèmes, qui par la logique de sa combinatoire où à un infini de la lecture que l’auteur quantifie à deux cents millions d’années de lecture9.
14De même chez Pessoa et l’attracteur étrange, la démonstration est risquée. Elle nécessite bien des précautions. Mais là réside la thèse de Filomena Juncker qui considère l’orthonyme Pessoa comme « l’attracteur étrange » qui permet de stabiliser l’évolution d’un système dynamique vers un état limite, c’est-à-dire l’usage et le recours des hétéronymes pour décrire poétiquement les états successifs d’une sensation en vue de l’épuiser. On peut considérer que l’attracteur étrange est l’ordre caché du chaos. La stabilité de cet attracteur est la conséquence de la structure sous-jacente d’un système qui peut paraître turbulent, mais dont la dynamique relève d’un ordre complexe. L’attracteur offre le point stabilisateur à partir duquel il est possible de reconstituer la progression dynamique des différents hétéronymes. De même, le recours à des théories stochastiques pour aborder une poétique les plus déroutantes du xxe siècle peut paraître non seulement risquée, mais difficilement compréhensible pour la plupart le lecteur qui ne possède pas une solide culture mathématique, l’hypothèse n’en demeure pas moins riche et intéressante. En tant qu’hypothèse, elle mérite probablement une investigation plus approfondie, bien que le livre se termine sur une affirmation étonnante d’Álvaro de Campos : « Ne me faites pas le coup des conclusions » (p. 257).
15De fait, on ne s’attendra à aucune conclusion car un système localement imprévisible mais globalement stable dans la complexité de sa trajectoire relève d’un ordre inattendu, et que nous pouvons tout au plus laisser l’expérience ouverte afin qu’elle continue, tant que le poète dit quelque chose sur le monde. Les mathématiques et plus largement les sciences aident à ordonner et porter quelques clartés sur ses pans d’obscurité. Ici, avec Pessoa le désordre semble avant tout intérieur. Il s’agit d’adresser cette pléthore chaotique des hétéronymes comme un système dynamique avec derrière chaque nom la logique des poétiques respectives. De la métaphysique de l’ingénieur à l’inquiétude de l’insomniaque, il convient de se tourner vers la psychologie pour adresser la contradiction de chaque poète, avec ses obsessions et ses a priori esthétique, ses références culturelles. Chaque poète est un univers en soi et pour suivre l’hypothèse leibnizienne d’une une monade sans limite, on s’aperçoit que l’hypothèse est stimulante. Et si l’auteur déclare que le but de son essai n’est pas de produire de la science quantitative (p. 245), elle souligne le rôle joué par l’intuition et certaines analogies, bien qu’implicitement elle rappelle comment la poétique de Pessoa anticipe la science du chaos, son entreprise de dépersonnalisation se déployant sous forme d’une construction vertigineuse. Dès lors, la thèse de Filomena Juncker s’arrête-t-elle à l’analogie, à une lointaine métaphore, ou doit-on s’attendre à ce qu’elle produise des motifs structuraux qui clarifie la thématique des hétéronymes ?
16« Certains travaux des sciences, par exemple, et ceux des mathématiques en particulier, présentent une telle limpidité de leur armature qu’on les dirait l’œuvre de personne10 », déclare Paul Valéry à propos de Léonard de Vinci. Cette dépersonnalisation de l’œuvre mathématique n’est donc pas étrangère à la dépossession de l’identité et de la personne dans la poétique de Pessoa. Les processus de cognition et de création sont passibles d’une même activité de l’esprit, d’une même structure de l’esprit. Depuis la parution des cours de Valéry sur la Poétique11, qui se penche sur le faire ou la fabrication des œuvres de l’esprit (poétiques, littéraires ou scientifiques), de nombreux neuroscientifiques demeurent étonnés de la pertinence des concepts employés par Valéry, car ils sont proches des plus récentes découvertes de la neuroscience. En poursuivant ces prémices, une telle démarche aboutit à la réunion du monde extérieur et intérieur en établissant des ponts entre science et poésie et entre la découverte scientifique et la création. Ces ponts permettent de combiner les normes de la peinture, la poésie, l’architecture, les mathématiques, la physique ou la mécanique. En poursuivant cette investigation sur la convergence des démarches de l’esprit, sur la transformation des sensations, Valéry note : « tout ce qui se manifeste intus et extra, admet un invariant12 ». Si un invariant est une propriété qui reste constante sous certaines transformations dans un système dynamique, il offre dès lors une « signature » de stabilité. Par contre, l’attracteur étrange propose un ensemble d'états vers lesquels un système tend à évoluer en exhibant un comportement chaotique et imprévisible. Dans les systèmes dynamiques chaotiques, les invariants sont souvent utilisés pour décrire les propriétés géométriques de ces attracteurs étranges. L’invariant peut fournir des informations sur la structure et la dimensionnalité de l'attracteur, permettant ainsi de mieux comprendre la complexité sous-jacente du chaos. Voici donc le point où l’esthétique scientifique de Pessoa et de Valéry se rencontrent. Ainsi, Valéry qui aimait les nouvelles façons de « voir » et de « penser » que lui proposait les sciences, se servait de ces méthodes pour aborder la complexité de la pensée humaine, même s’il n'a pas directement abordé le concept d'espaces fractals dynamiques, car ces idées sont apparues après sa mort. Toutefois, l’intérêt de Valéry pour les dynamiques de la forme et les modèles mathématiques pourrait être vu comme une préfiguration de certaines idées modernes en géométrie fractale, dont les analogies et les modèles l’invitait à établir des continuités entre les arts et les sciences.
17Si Tabucchi évoque la galaxie des hétéronymes, le travail de Filomena Juncker propose l’image d’un espace fractal dynamique. Les poétiques mise en mouvements par les hétéronymes sont dès lors pensées comme des trajectoires, alors que les écrits de Pessoa s’inscrivent dans l’inachevé, de nouvelles idées viennent les traverser « ayant l’infini comme limite » (p. 250). Nous sommes en présence d’une pensée qui conçoit les multiples trajectoires dans lesquelles l’auteur devine « la croissance exponentielle de l'écart entre deux trajectoires proches en régime chaotique » (p. 251). Plutôt que de tenter de mettre fin à cette pensée trajectoire et abandonner le poème à l’inachevé, on voit comment la poésie de Pessoa pourrait se « rapprocher métaphoriquement d'un système dynamique chaotique, lequel, dans son évolution temporelle, serait attiré par une structure géométrique de fractale feuilletée, objet hors-norme, invariant d'échelle, occupant un espace plus grand que ce qu'indique sa dimension topologique » (p. 253). La cohérence de cette thèse du livre qui apparaît dans les dernières pages ne peut être démontré mais suggéré comme l’hypothèse d’une enquête dans laquelle on verrait comment Alberto Caeiro vit Parménide et annonce Ponge, Ricardo Reis lit Horace et préfigure Valéry, ou encore comment Alvaro de Campos fait surgir Whitman en sourdant les avant-gardes, de Marinetti aux surréalistes. Bref, ce que l’hypothèse de l’attracteur étrange nous propose est de retrouver derrière le chaos apparent des hétéronymes un système dynamique complexe dans lequel on voit émerger la bibliothèque universelle de la poésie et de la littérature, sans oublier la philosophie et les grandes traditions mystiques.

