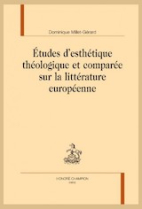
L’art de la rencontre ou la spiritualité de la littérature comparée
« J’ai toujours défendu les mêmes valeurs : la conscience européenne et la tradition occidentale. […]
J’ai attaché plus de prix à la continuité qu’à l’actualité »
Ernst‑Robert Curtius, Essais sur la littérature européenne [avant‑propos]
1Beaucoup de livres sont publiés chaque année, afin que leurs auteurs puissent emplir leur fier curriculum vitae ou distraire leur intempérant besoin de parler. Mais peu nombreux sont les ouvrages qui nous livrent l’expérience de toute une carrière, en nous enseignant l’art de la lecture grâce au patient dévoilement d’une manière de faire non seulement éprouvée mais encore méditée. Affirmons donc immédiatement que le présent travail souhaite heureusement nous élever loin des modes éphémères, parce qu’il appartient aux grands professeurs de pouvoir mêler érudition et passion, sans jamais parler avant d’avoir quelque chose à dire.
Un triple projet esthétique
2La parfaite intelligence de l’ouvrage et la claire expression de l’auteur frappent notre esprit à la seule lecture d’un titre en lequel se trouve contenue toute une démarche littéraire. L’« esthétique théologique » assume la quête spirituelle animant de nombreuses œuvres (avec ou sans préoccupation religieuse) et explicite leurs modes d’expression souvent lumineux (par l’union de la beauté et des transcendantaux classiques que sont l’un, le bien et le vrai) ; il s’agit de réconcilier l’art et la théologie par‑delà leur moderne divorce et de s’inscrire dans le sillage de Balthasar (La Gloire et la Croix. Styles). L’« esthétique comparée » s’empare de la place singulière occupée par la littérature française au sein de la culture européenne (par l’entrelacs d’une histoire et d’un style) afin de l’enrichir de tous les effets d’échos et de surimpressions que constituent les œuvres d’autres pays dialoguant avec le nôtre (au sein d’une construction rhétorique unifiée par‑delà les fécondes différences de tonalités) ; il s’agit de superposer les savoirs par‑delà toute optique univoque et d’honorer l’héritage de Marc Fumaroli (Exercices de lecture. De Rabelais et Paul Valéry) ou d’Alain Michel (In hymnis et canticis. Culture et beauté dans l’hymnique chrétienne latine). La « littérature européenne » signale un fondement commun à tous les textes observés (la culture gréco‑latine) et permet à la littérature de demeurer cet art de la conversation qu’elle est bien en son sens le plus profond (la reconnaissance d’une dette honorant celui qui l’accepte et la respecte) ; il s’agit de lire dans la profondeur de la culture et de suivre Curtius (La Littérature européenne et le Moyen‑Âge latin) et Auerbach (Mimesis. La représentation de la réalité dans la littérature européenne). Or ces références fondatrices, respectant la continuité d’une histoire et la profondeur des textes, sont d’autant plus précieuses qu’elles sont aujourd’hui oubliées.
L’amour du beau & la mémoire du passé
3En cette triple dimension pratique fondant une vraie poétique de la lecture se déploient alors vingt‑six études aux couleurs variées, restituant chaque texte dans le cadre de l’histoire littéraire de son pays et convoquant des voies jadis fréquentées par la romanistique mais dont le chant s’est hélas perdu. S’y trouvent interrogés le latin classique et le latin chrétien. S’y entendent les questions de traduction et les questions d’intériorité. Balthasar lisait certes aussi, avec une même minutie n’équivalant jamais à la monomanie parfois épousée par les approches contemporaines (les études de genre en étant sans doute l’exemple le plus frappant, lorsque les textes ne sont plus interrogés pour ce qu’ils sont mais que l’idéologie les force à signifier tel ou tel présupposé), des auteurs très variés de littérature européenne dans l’essentielle unification des langues romanes — sur dix‑neuf siècles et en huit langages différents (grec, latin, allemand, anglais, français, espagnol, italien, russe) —, dans le but de saisir « l’épiphanie de la beauté et de la gloire dans le monde, le rayonnement, l’éclat de principes d’être puissants et cachés jaillissant dans une figure expressive1 ». On ne peut être qu’admiratif de l’ampleur de la tâche. L’art est en effet porteur d’un sens qui le transcende, et c’est la raison pour laquelle l’esthétique théologique, en redonnant simplement ses lettres de noblesse au beau, au vrai et au bien, y est constamment autorisée, sans que les préoccupations religieuses des auteurs n’aient par ailleurs à être nécessairement manifestes — seules la puissance de rayonnement d’une figure et l’intelligence du style d’un dessein importent ici en réalité. Le travail de D. Millet‑Gérard consiste donc à favoriser des rencontres, comme aurait dit Montaigne, pour faire aimer le beau et donner un visage aux œuvres :
Nous n’avons plus, hélas, l’extraordinaire bagage de la mémoire qui fut celui des générations antérieures, qui connaissaient par cœur tant de poèmes et de pages qui faisaient d’eux, comme spontanément, des Européens au sens le plus noble du terme. Ce constant échange, d’abord avec les Anciens, puis d’une langue européenne à l’autre, est ce que j’ai aimé faire avec mes étudiants : s’inscrire dans le contexte d’une culture que l’on possède et respecte, et en même temps y découvrir cette originalité, cette touche de renouveau, ces trouvailles de style qui transportent un thème d’une époque dans une autre, d’une langue dans une autre et font d’une œuvre un objet neuf dont la pensée est celle de son temps et de l’individu qui l’a créée (p. 9).
4Entrer dans une culture et acquérir ainsi le tact que nécessite le travail respectueux de textes qui, par réfraction, éclairent aussi nos horizons, nous aide évidemment à nous trouver nous‑mêmes dans la saisie de ce ton ou de ce climat, comme dirait Péguy, dont la valeur est aussi réelle que manifeste. Voilà ce que peut la littérature comparée comme exercice spirituel :
Transposé[e] aux exercices littéraires, [l’intelligence] désigne la pénétration du sens insinué, entre les lignes, dans des œuvres écrites hier ou longtemps avant nous, et la reconnaissance que ce sens caché, échappant au conditionnement historique, pointait déjà en nous avant de le découvrir chez autrui ? C’est ce que Montaigne appelait la « rencontre ». […] Elles fondent, face à la montagne d’illusions et de maux qui nous assaillent ou qui nous guettent, une solidarité, voire une complicité clandestine, qui, sans nous rendre le moins du monde invulnérables, nous préserve, au plus intime de la solitude, de nous sentir seuls et dépourvus d’écoute2.
Un vaste panorama européen
5L’ouvrage chemine dès lors au gré de similitudes variées : thématiques (le motif de l’interior intimo meo dans Marius l’épicurien de Pater, le visage de Philomèle chez Bonaventure, Balde et Jammes, l’enfer de la jalousie dans Partage de midi de Claudel et L’Éternel mari de Dostoïevski, la figure d’Anima chez Claudel, Pater et Ivanov ou la forme du romanesque chez Balzac et Lermontov) ; génétiques (la réécriture de l’Enfer de Dante par La Cité de l’horrible nuit de Thomson ou la dette du Don Juan de Pouchkine envers les Don Juan de ses prédécesseurs) ; rhétoriques (l’écriture de l’émerveillement dans les Métamorphoses d’Apulée et dans Marius l’épicurien de Pater) ; génériques (le sublime des Lettres d’Abélard et Héloïse lu dans la tradition des Lettres héroïdes d’Ovide) ; ou stylistiques (le ton des Bucoliques de Chénier lu dans la matrice des Bucoliques de Virgile). Ne sont pas oubliées ces singularités tonales dont la formation scolaire actuelle nous interdit malheureusement l’accès : Claudel hymnode et séquentiaire, Péguy médiéval et marial, Spenser épique et bucolique ou les symbolistes passionnés par l’oxymore de l’omnipotentia supplex. Et le monde de grands auteurs s’en trouve ainsi descellé (Hopkins, Suarès, Tolstoï ou Balthasar), grâce à une scrupuleuse attention aux questions de traduction (Gaspard de la nuit par Merrill, Le Centaure par Merrill, Rilke et Sikélianos, Anabase par Eliot, la Bible par Green ou l’Orestie par Claudel et Ivanov). On mesure là l’incroyable richesse de l’ouvrage, organisé, non selon les axes que nous venons de détailler, mais selon quatre ensembles souples (« antiquité et modernité », « héritage européen », « slavistica » et « traduction »). On apprend enfin à lire :
C’est l’histoire littéraire qui permet de comprendre, à partir des documents laissés par Hopkins sur sa formation, quelle étonnante synthèse il représente de philosophie, de théologie, de savoir rhétorique, de virtuosité poétique, d’expérience spirituelle intime. Mais il n’est pas faux de dire que le poème, ce bel objet intellectuel clos sur lui‑même, forme un tout, et qu’un regard pénétrant sur ses structures internes fait apparaître ce que l’on peut appeler après Hopkins son inscape et son instress : car il a une forme et une dynamique qui lui sont absolument propres et qui, si elles devaient fatalement rester opaques à qui ignorerait tout de leur auteur, se mettent à vivre lorsqu’on les projette dans le champ magnétique de leur créateur, afin d’éclairer, si peu que ce soit, cet autre mystérieux outstress qu’est l’irruption du poème, son jaillissement (p. 255).
Une chasse aux trésors : quelques exemples
6Si Charles Péguy commente souvent les textes médités par la liturgie — comme en témoignent ses essais en prose —, nous pouvons chercher là une clé herméneutique de ses spécificités d’écriture poétiques — selon les leçons spitzeriennes. En constatant donc que le long texte intitulé Ève s’intéresse à la figure mariale, nous observerons alors les hymnes consacrés à cette même figure pour en cerner les spécificités de vocabulaire et voir si celles‑ci ne se retrouvent pas à l’aventure dans le texte péguyste. Ainsi l’hymne O gloriosa virginum emploie‑t‑il cet adjectif tristis (« Quod Eva tristis abstulit / Tu reddis almo germine ») dont on sait toutes les significations plurivoques (il signifie ‘affligé’, mais aussi ‘qui est (ou qui met) dans l’adversité’, et encore ‘sombre’ ou ‘renfrogné’). Or on retrouve cet adjectif chez Péguy, exprimé en plusieurs variations qui relèvent du tissage cher à l’auteur mais déclinent aussi, à proprement parler, les significations latines contenues dans la liturgie — se trouve ainsi expliquée l’apparente station des vers qui, en réalité, travaillent et déroulent la musique du texte latin : « Et moi je vous salue ô la première femme / Et la plus malheureuse et la plus décevante / […] Et moi je vous salue ô pleine d’épouvante / […] Et je vous aime tant, première soucieuse, / Et vainement assise au jardin de la peur ». Tout l’ouvrage est de cette teneur et de cette précision. Il est en ce sens très nécessaire et pourrait devenir un manuel d’étudiants — si l’on aimait lire et si l’on ne transformait pas la littérature en communication.
7La jalousie chez Claudel et Dostoïevski, constituée en système triangulaire et vérifiant les analyses de René Girard, se voit encore rehaussée par une source biblique qui glisse discrètement à l’arrière des textes et les configure à la réflexion de Dante (fortis ut mors dilectio, dura sicut infernus aemulatio). Tout le système symbolique des images est alors explicité grâce aux lectures patristiques et liturgiques, littéraires et philosophiques, des auteurs dont les œuvres sont regardées de près — sans oublier leurs propres textes théoriques, comme l’Art poétique chez Claudel. L’ensemble est resitué dans la chaîne critique.
Un agréable ton de confidence
8Or la vocation pratique de l’ouvrage, qui nous enseigne essentiellement un geste, est aussi baignée par quelques passages de confidence qui incarnent l’ensemble de la proposition dans une connaissance raisonnable du monde de la recherche contemporaine. Voilà qui permet de situer les orientations par ailleurs suggérées et de comprendre ce qu’est, en principe, l’école française de littérature comparée3. On désirera alors retrouver le vrai sens de notre métier :
Je lui fis compliment [à Franco Marucci] du courage qu’il avait eu d’en faire son affaire propre [il s’agit de la colossale Storia della Letteratura inglese], individuelle, lui donnant ainsi la cohérence d’une œuvre personnelle, à l’heure où l’on est si souvent sollicité pour des entreprises collectives tirées à hue et à dia par des intérêts de pouvoir et d’argent. Franco Marucci, aux "réunions de concertation", a préféré la solitude studieuse de son bureau et le contact authentique avec tous les auteurs dont il parle. C’est là la marque d’un grand professeur (p. 241).
Une française de ma génération, rescapée des terrorismes critiques qui s’abattent régulièrement sur le paysage intellectuel de son pays, ne peut être insensible à cette volonté d’écrire, tout simplement, oserait‑on dire cum grano salis, une histoire littéraire (p. 241‑242).
J’étais [alors] aux premières loges pour assister, par professeurs interposés, à la grande querelle Barthes‑Picard […]. Vingt‑cinq ans plus tard, on assistait, non sans perplexité, à une reconversion à l’histoire littéraire des anciens ‘barthésiens’ ; le mot de « contextualisation » circulait, on ressortait des auteurs mineurs, de vieilles écoles oubliées ou décriées, on portait Lanson au pinacle. (p. 242).
***
9Ces constats sur l’air que nous respirons, joints aux magnifiques exemples de lectures érudites et inspirantes qui les accompagnent, nous donnent véritablement envie d’entrer en littérature — c’est‑à‑dire de nous retirer du monde pour un moment, de travailler livres en mains pour de bon et pour longtemps, et de ne plus nous occuper des modes qui nous font perdre temps, énergie et (sans doute) passion. Voilà qui ne peut être que salutaire.

