Le Cercle de Jafar Panahi, ou la figure infernale
1Chargé d’une grande force symbolique héritée des pratiques cultuelles, religieuses ou artistiques l’ayant très tôt adopté, le cercle apparaît depuis la démonologie hébraïque jusqu’à Dante, comme la figure emblématique de l’infernus. Attachée au thème de la damnation et de la chute, cette figure traverse les trois religions du Livre, la tradition islamique l’associant au Voyage nocturne de Mahomet de la Mecque à Jérusalem et son ascension divine, ou encore Livre de l’Échelle, qui est un récit-légende de tradition orale fixé après la mort du Prophète et que l’on attribue, sans preuve, au plus érudit de ses compagnons, son cousin Ibn ‘Abbâs. Ce récit apocalyptique à finalité eschatologique se présente comme une digression littéraire inspirée des premiers mots de la sourate XVII du Coran : « Loué soit Celui qui a fait voyager de nuit son serviteur / de la Mosquée sacrée jusqu’à la Mosquée très éloignée / dont nous avons béni l’enceinte, / et ceci pour lui montrer certains de nos Signes »1. Ce texte, apocryphe pour certains et transmis en Islam par la voie des Hadith-s, constitue ce que l’on appelle la littérature du Mi‘râdj (ascension), et compte de nombreuses versions, latines notamment, dès le Moyen-Âge. Nous devons à l’orientaliste espagnol Asίn Palacios d’y avoir vu le premier, il y a près d’un siècle, une source de la Divine Comédie2, controverse qui fait toujours débat chez les dantologues. Ainsi par exemple la figure du cercle, chère à Dante, que convoque ce texte de tradition populaire lorsqu’il l’associe, dès la deuxième partie du récit, « Le Trône de Dieu », au dispositif où siègent les anges du « ciel ultime » (les « chérubins ») que rencontre le Prophète, accompagné de l’ange Gabriel, avant qu’il ne se présente devant le Créateur :
Nous marchâmes jusqu’à des courtines qui séparaient Dieu de ses anges. Ces courtines dessinaient des cercles. Autour de chacun de ces cercles se tenaient des anges […] Je regardai alors les courtines qui dessinaient des cercles […] Les cercles se succédaient ainsi, formés chacun par soixante-dix courtines de toutes les couleurs, plus éclatantes les unes que les autres3.
2 Attachée d’abord à la demeure de Dieu, à son éclat, à sa beauté, cette figure réapparaît ensuite dans les premières lignes consacrées à l’Enfer pour s’associer alors aux ténèbres de ce monde, à ses « sept terres » ignées qui « reposent sur une pierre elle-même soutenue par un poisson dont la tête et la queue se rejoignent en formant un cercle »4. Dans l’imaginaire arabe ainsi le cercle renvoie-t-il à la topologie de l’Au-delà, chargé d’obscurité et de clarté, comme il évoque, pour nous autres Occidentaux lecteurs de Dante, celle du voyage initiatique de La Divine Comédie. Certes, associe-t-on plutôt chez Dante, tant la force de cette figure y est prégnante, le cercle au monde de l’Enfer, mais rappelons tout de même que, dans La Divine Comédie, le passage d’un cercle (cerchio) à l’autre conditionne tout autant la chute vertigineuse vers le tréfonds du royaume infernal, que l’ascension libératoire du Purgatoire vers le Paradis. Ainsi, au motif de la corniche très présent dans L’Enfer (cornice) se substitue parfois, dans Le Purgatoire, celui du giron (giro) qui suggère la circularité de ces espaces de transition. Le cercle devient aussitôt une figure plus complexe dont le mouvement, en écho au voyage mouhammedien, ouvre et ferme à la fois, et que l’on associe à l’obscurité comme à la clarté5.
3Lieu de passage et d’étranglement (chez Dante particulièrement), seuil de tous les vertiges du Paradis et de la malédiction infernale dans l’imaginaire religieux, le cercle demeure par ailleurs une des figures de l’aliénation : le cercle asservit, le cercle emprisonne, le cercle clôture, c'est pourquoi l'on cherche, comme chez Fritz Lang – rappelait Jean Douchet –, à le briser6. Mais « briser le cercle », celui de la comptine dans l’ouverture de M le Maudit ou celui des « mobiles » égoïstes dans Moonfleet, revient à s'exposer, à prendre des risques, à convoiter, en somme, la liberté. Or, viser la liberté conduit parfois à une mort certaine. C’est là tout le dilemme dont nombre de héros langiens fera l’expérience. C’est pourquoi l’on craint de briser le cercle, de s’affranchir de sa tutelle, car le cercle protège de l’extérieur tout autant qu’il nous en exclut, de la même façon que la liberté, tout autant qu’elle inquiète, fascine, dialectique qui de tout temps a fait le lit du totalitarisme. Ce qui nous conduit à rappeler combien le cercle est aussi une figure du champ politique. Milan Kundera l’avait rappelé lorsque, notant « la signification magique du cercle », il remarquait combien dès lors qu’il nous exclut, « le cercle [entendu « du parti »] se referme et on le quitte sans retour ». Et l’écrivain d’ajouter : « Pareil à la météorite arrachée à une planète, je suis sorti du cercle et, aujourd’hui encore, je n’en finis pas de tomber » 7.
4Loin de nous éloigner de notre sujet, ces quelques remarques liminaires au contraire nous y ramènent. Figure assez complexe, paradoxale même, le cercle semble en effet contenir et induire ces questions d’ouverture et de fermeture qui dans ces pages nous mobilisent et que le film de Jafar Panahi, dont il sera question ici, creuse, nous semble-t-il, de résonances d’une grande richesse. Lion d’or à la Mostra de Venise en 2000, Le Cercle est le troisième long métrage de ce cinéaste iranien né en 1960, diplômé de l’école supérieure de cinéma et d’audiovisuel de Téhéran en 1990, mais venu au cinéma par l’entremise des ateliers du célèbre Kanun, institut d’éducation populaire fondé à l’origine par l’épouse du Shah dans le cadre de la « révolution blanche » et qui, dès 1969, vit naître une section de cinéma dont la direction fut confiée au simple graphiste et réalisateur publicitaire qu’était encore Abbas Kiarostami. Grand admirateur de l’auteur de Où est la maison de mon ami ? auquel il rendra hommage dans L’Ami, un de ses premiers courts métrages réalisé en 1992, c’est tout naturellement que l’on retrouve Jafar Panahi en 1994 sur le tournage du troisième opus de la trilogie du Gîlan d’Abbas Kiarostami, Au travers des oliviers, où il occupe et joue le poste d’assistant réalisateur. Poussé par son mentor qui le convainc de transformer son projet de court métrage Le ballon blanc en un long métrage, Jafar Panahi saute le pas avec succès et remporte, en 1995, la Caméra d’or à Cannes où ce premier film se retrouve en compétition.
5Si l’esprit de Kiarostami plane indéniablement sur ce premier long métrage d’une très grande richesse stylistique (les mésaventures de la petite Razieh ne sont pas sans rappeler là encore celles du Ahmad de Où est la maison de mon ami ?), Le Miroir, son deuxième long métrage récompensé en 1997 au festival de Locarno quelques mois après la Palme d’or de Kiarostami pour Le Goût de la cerise, montre toute la difficulté qu’éprouve alors l’élève à s’affranchir justement de l’univers de son maître trop présent dans les procédés de mise en abyme convoqués ici. Néanmoins, à partir de ce second film le monde de Panahi peu à peu se précise, celui des adultes8 mais surtout celui de la très jeune société contemporaine iranienne dont le vote féminin, en partie, venait de porter l’ancien ministre de la Culture et de l’Orientation islamique et maire de Téhéran, Khâtami, à la présidence du pays. Il est vrai qu’à la faveur de cette ouverture politique, la société iranienne, et plus particulièrement sa part féminine, se prenait à rêver sinon d’un changement, du moins d’un assouplissement en matière de liberté d’expression et de circulation des biens et des personnes. Bien que tourné dans une demi-clandestinité comme le précédent, Le Cercle semble avoir voulu profiter du climat de détente que promettait alors d’offrir le mandat de Khâtami. Jugé plutôt modéré, le nouveau président avait par exemple nommé à la Culture un personnage qui passait pour un libéral, l’âyatollâh Mohajerani dont une des premières mesures fut d’autoriser la distribution de certains films jusqu’alors interdits. Ainsi l’affaire d’état que provoqua la sortie du Bonhomme de neige de Davud Mirbaqeri9. Il est indéniable que le changement politique qu’incarnait Khâtami dont les pouvoirs restaient cependant limités (in fine les décisions importantes reviennent toujours aux religieux et à leur « guide suprême », Ali Khamenei depuis 1989), devait jouer un rôle important dans le choix du sujet dont traiterait Le Cercle. Comme tout dernièrement avec Hors-jeu, Jafar Panahi ne craint pas de choisir le sujet politiquement le plus risqué. Il traitera de la place et du sort réservés aux femmes dans la société iranienne contemporaine, question particulièrement sensible et imprescriptible aux yeux des religieux les plus extrémistes, mais que la nouvelle donne politique, sans l’autoriser explicitement, permettait sans doute de poser. Ainsi en est-il de la liberté comme l’eau : elle s’infiltre par l’ouverture même la plus étroite qu’on lui concède. D’où peut-être le recours, ici, à cette figure emblématique du champ politique que constitue, comme nous le remarquions avec Kundera, le cercle. En effet, à mesure que celui-ci se referme, ne cherche-t-on pas en réaction à l’ouvrir, à échapper à son étreinte effroyable ? Mais dans le même temps, parce que le cercle exclut, ne souhaite-t-on pas aussitôt regagner sa confiance sans laquelle, nous dit Kundera, on n’en finit pas de « tomber » ? Ce régime d’opposition n’est pas sans doter ainsi le cercle d’une grande puissance dynamique : puissance d’ouverture et de fermeture jouant d’obscurité et de clarté sur le modèle de Dante ou dans l’esprit de l’imaginaire religieux (tout autant arabe, nous l’avons vu, que du reste chrétien), et à laquelle, comme nous allons le voir maintenant, le film de Jafar Panahi semble offrir un prolongement formel indiscutable. Que l’expression de cette tension trouve une indéniable résonance politique autour des forces conservatrices et progressistes mises en présence dans ce film, pour autant elle ne le cède en rien au traitement visuel et sonore dans lequel le cinéaste choisit ici de les inclure. Et il n’est que d’observer les choix stylistiques, les motifs esthétiques ou la conduite narrative pour constater combien, du premier plan jusqu’au dernier, le film grave en creux la compulsive figure de son infernale circularité.
6
7Traditionnellement dans un film, rappelait Jean-Louis Leutrat dans sa belle étude de l’incipit du Mépris, le générique d’ouverture constitue « un lieu institutionnel […] comme étant donné en plus […], une excroissance du film »10 située dans un espace extradiégétique informant le spectateur sur les personnes ayant participé à la réalisation du film qu’il s’apprête à regarder mais qui, pour autant, n’a pas moins déjà commencé. Si, d’un point de vue visuel, l’ouverture du Cercle procède des mêmes intentions, sur le plan sonore il en va néanmoins tout autrement. Alors que les noms défilent sur fond noir, deux voix de femmes en effet se font rapidement entendre. La nature comme le registre de l’échange dévoilent l’origine de la situation dramatique où l’on se trouve : un accouchement. La fiction n’a pas démarré que déjà une femme hurle sa souffrance, une femme dont la vue, mais nous ne le savons pas encore, nous sera jusqu’au bout refusée. À peine est-il ouvert que Le Cercle déjà se referme sur la mère et la condamne à l’obscurité, à l’infernus de ce noir générique. En désignant par le son « le film comme quelque chose qui est déjà là »11 tout en en occultant la figuration par l’image, le générique prend par ailleurs une valeur de manifeste. L’équipe ne s’exclut pas de la fiction qui suivra, au contraire elle fait corps avec elle. Solidaire, elle en épousera les points de vue à venir, quoi qu’il lui en coûte12.
8Un violent raccord signale l’entrée dans la fiction, le noir du générique cédant la place à l’extrême blancheur d’une image surexposée. À ce corps de femme exclu dont les cris rédiment l’absence, répondent alors les hurlements du nouveau-né que la mère enfante et dont la fonction incohative n’échappe pas (un peu à la manière dont Hou Hsiao-hsien ouvrait La cité des douleurs en 1989). Le passage à la fiction se mue en acte libératoire doué d’une grande force ouvrante que retient momentanément la blancheur de l’image. Affranchi de son obscurité générique, Le Cercle célèbre une naissance dont l’espoir qu’elle suscite ne fera guère longtemps illusion. L’image, en effet, peu à peu se matérialise pour laisser apparaître un judas. Le film ouvert est déjà pris dans la série de ses motifs rectangulaires à forte connotation carcérale dont le film proposera par ailleurs de nombreux prolongements. Ainsi les nombreux effets de surcadrages où l’on retrouve le motif du judas initial13 et qui, tout en signant leur dette à l’égard de Kiarostami, rencontreront de vibrants échos dans l’œuvre de Panahi (nous pensons par exemple au plan d’ouverture et de fermeture de Sang et or – 2003). De la même manière pourrions-nous citer les nombreuses compositions emprisonnantes qui saisissent souvent le visage des femmes derrière ou à proximité de grilles suggérant combien le monde extérieur demeure pour celles-ci identique au milieu carcéral qu’elles viennent de quitter (ou qu’elles fuient, comme c’est le cas pour Pari) et dans les griffes duquel nombre d’entre elles, ainsi que le montre le finale, finira par retomber (Fig. 1 et 2)14.

 Mais revenons à notre plan d’introduction. À la double ouverture sonore puis visuelle postgénérique succède donc la vision du judas où apparaît, en gros plan, le visage de l’infirmière qui vient d’accoucher Solmaz Gholami et qui appelle maintenant la famille de la jeune mère. Une femme, de dos, entre dans le champ, le tchador noir tranchant sur le fond blanc que rehausse la tenue de l’infirmière, de face. Cette dernière lui apprend la nouvelle qui tombe comme le couperet du judas qu’aussitôt elle referme : sa fille a accouché d’une petite fille. Si l’ouverture-fermeture du judas n’est pas sans évoquer les effets de rideau qui à l’époque du muet ponctuaient les ouvertures et les fermetures de séquences, elle n’en affirme pas moins son caractère également tranchant. Ce Cercle ne semble s’ouvrir que pour, de nouveau, se refermer avec violence. La grand-mère, désespérée, insiste. Et la porte du judas de se rouvrir sur le visage maintenant d’une assistante dont la jeunesse suggère le lien générationnel évident qui l’unit à la toute jeune mère, analogie dont la portée politique n’échappe pas (toutes les deux sont des enfants de la Révolution islamique de 1979). À l’instar de la mère et de l’enfant qui vient de naître, le visage de la grand-mère nous est par ailleurs refusé. L’occultation, tout au moins provisoire, du visage de la grand-mère inscrit ainsi ces trois générations de femmes dans une profondeur signifiante. Ce sont les trois âges de la vie qui frappent à la porte du malheur que constitue, dans cette société patriarcale, le simple fait de naître femme. En atteste l’empathie de la jeune assistante sitôt qu’elle comprend la situation que lui expose la grand-mère. Son visage réfracte le désarroi immense de cette jeune mère qui vient d’accoucher et que le hasard d’une naissance condamne à un divorce désormais évident (Fig. 3a et 3b). Elle rend intensément présent le visage et de la mère absente et de toutes ces femmes que l’arbitraire des pratiques religieuses et culturelles retient désormais dans l’obscurité et relègue à la seule fonction de reproduction des mâles.
Mais revenons à notre plan d’introduction. À la double ouverture sonore puis visuelle postgénérique succède donc la vision du judas où apparaît, en gros plan, le visage de l’infirmière qui vient d’accoucher Solmaz Gholami et qui appelle maintenant la famille de la jeune mère. Une femme, de dos, entre dans le champ, le tchador noir tranchant sur le fond blanc que rehausse la tenue de l’infirmière, de face. Cette dernière lui apprend la nouvelle qui tombe comme le couperet du judas qu’aussitôt elle referme : sa fille a accouché d’une petite fille. Si l’ouverture-fermeture du judas n’est pas sans évoquer les effets de rideau qui à l’époque du muet ponctuaient les ouvertures et les fermetures de séquences, elle n’en affirme pas moins son caractère également tranchant. Ce Cercle ne semble s’ouvrir que pour, de nouveau, se refermer avec violence. La grand-mère, désespérée, insiste. Et la porte du judas de se rouvrir sur le visage maintenant d’une assistante dont la jeunesse suggère le lien générationnel évident qui l’unit à la toute jeune mère, analogie dont la portée politique n’échappe pas (toutes les deux sont des enfants de la Révolution islamique de 1979). À l’instar de la mère et de l’enfant qui vient de naître, le visage de la grand-mère nous est par ailleurs refusé. L’occultation, tout au moins provisoire, du visage de la grand-mère inscrit ainsi ces trois générations de femmes dans une profondeur signifiante. Ce sont les trois âges de la vie qui frappent à la porte du malheur que constitue, dans cette société patriarcale, le simple fait de naître femme. En atteste l’empathie de la jeune assistante sitôt qu’elle comprend la situation que lui expose la grand-mère. Son visage réfracte le désarroi immense de cette jeune mère qui vient d’accoucher et que le hasard d’une naissance condamne à un divorce désormais évident (Fig. 3a et 3b). Elle rend intensément présent le visage et de la mère absente et de toutes ces femmes que l’arbitraire des pratiques religieuses et culturelles retient désormais dans l’obscurité et relègue à la seule fonction de reproduction des mâles.
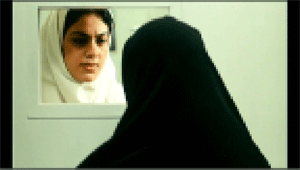
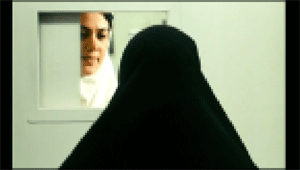
9Plus le film tend à s’ouvrir à la faveur de la fiction qui démarre, plus les issues semblent se refermer sur son passage. C’est dire combien un des enjeux formels du film, consiste, dès son ouverture, à mettre en présence deux régimes dynamiques concurrents : l’ouvrant et le fermant, le linéaire et le circulaire, double régime que représenterait ici le devenir du récit aux prises avec des situations entravantes. Dès lors, la grande vitalité du film résidera dans sa capacité à affranchir ses héroïnes du mouvement centripète et des itérations clôturantes où voudrait justement les maintenir la tradition discriminante du cercle. Ce qu’illustre magnifiquement le traitement de la deuxième partie de l’incipit dont le caractère programmatique force l’évidence : le film devra abattre les obstacles que cette société oppose au déploiement du corps et de la parole des femmes.
10Dans la continuité du cadrage d’ouverture sur le judas et alors que la grand-mère se retourne, un panoramique horizontal l’accompagne jusqu’à la salle d’attente voisine. Arrivent alors les belles sœurs qui s’introduisent dans le cercle que dessine habilement ce mouvement d’appareil. N’osant leur avouer la nouvelle, la grand-mère s’éclipse et s’engage dans un escalier en colimaçon alors que l’on entend en hors-champ les deux jeunes femmes qui apprennent la nouvelle. Comme elle descend, la grand-mère rencontre une de ses filles qui arrive un bouquet de fleurs à la main. Elle lui apprend la nouvelle et l’enjoint de courir prévenir ses oncles. La jeune femme abandonne le bouquet de fleurs à sa mère et fait aussitôt demi-tour. La caméra, toujours en plan rapproché, la suit alors dans ces escaliers dont la circularité s’accentue à mesure que l’on descend, préfigurant en quelque sorte la construction du film en boucle. Arrivée au rez-de-chaussée, la jeune femme laisse le hall d’entrée sur sa droite et s’élance, encore talonnée par la caméra, dans le couloir qui conduit à l’extérieur et dont la profondeur brise définitivement la circularité et du mouvement inaugural et du décor précédent. Avisant, près d’une cabine téléphonique, trois jeunes femmes dont les costumes gris bleu indiquent qu’elles sortent de prison, la jeune femme s’avance pour leur demander de la monnaie, sans succès. Comme elle sort du champ à droite, la caméra ne la suit pas et reste sur les trois jeunes femmes dont nous suivrons l’infortune jusqu’à ce que Narghess, la plus jeune d’entre elles, cède sa place à Pari, nouveau personnage féminin auquel le récit emboîtera alors le pas. Et ainsi de suite, de femme en femme, en un escalier d’intrigues jusqu’à la séquence finale dans la cellule de prison où nous conduit l’ultime et emblématique personnage que constitue, dans le contexte socio-politique du film, la prostituée.
11C’est en tout plus d’une dizaine de personnages féminins, pour la plupart traqués, en fuite, que le film s’attachera ainsi à suivre dans les rues de Téhéran du jour jusqu’à la nuit à la manière d’un « fondu enchaîné sur le visage d’une même femme à plusieurs âges de sa vie »15, confierait de façon très imagée le cinéaste. Cette structure narrative assez dynamique qui entraîne le récit sur le mode téléologique, apparaît comme une réponse évidente à la figure obsédante du cercle dont le film offre par ailleurs une matérialisation visuelle suggérant, là encore, l’enfermement physique et psychique des personnages. Outre les mouvements d’appareil circulaires des plans-séquences d’ouverture et de fermeture, notons les décors choisis que constitue par exemple l’architecture orbiculaire du bazar (Fig. 4) où Narghess attend son amie Arezoo (dont le film laisse d’ailleurs suggérer qu’elle est peut-être allée se vendre pour payer le billet d’autocar qui doit les ramener au village natal). De même, le hall circulaire de la gare routière (Fig. 5) d’où, terrorisée, Narghess, encore, observera la police qui vérifie les papiers des passagers de l’autocar qu’elle ne prendra jamais.


12Plus tard, relèvera-t-on aussi, dans l’esprit des mouvements d’appareil du début et de la fin, le panoramique circulaire très enfermant qui accompagne Pari, sans doute l’un des plus beaux personnages du film avec celui de la prostituée, lorsqu’elle rend visite à son amie Elham à l’hôpital en espérant que celle-ci l’aidera à avorter. Enfin, au regard de nos remarques liminaires mais dans un effet de retournement saisissant quant à la dimension psychique que prend soudain la figure du cercle sur la fin du film, la séquence de nuit où l’on voit cette mère cherchant à abandonner son enfant (une petite fille, évidemment) près d’un vieillard qui vend des ballons de baudruche dans une allusion évidente à M 16.
13Dans ce monde dont la représentation est profondément circulaire, chacun des personnages féminins semble constituer comme le maillon d’une chaîne de la solidarité. Le récit, constate-t-on, se déploie ici sur le modèle classique de « l’image-action » qui porte le devenir des personnages en les libérant, pour un temps au moins, de la pression qu’exerce sur eux la puissance du cercle. C’est sans doute là que réside toute la force du film. Dans cette tension que provoque l’irrépressible pulsion de vie de ces femmes auquel la structure du récit offre un prolongement dynamique indéniable, confrontée au caractère mortifère attaché à la figure du cercle. Cette tension, nous la percevons évidemment dans la marche en avant de ces femmes qui cherchent à s’extraire de tous ces mouvements d’appareil et de tous ces décors qui les encerclent, femmes bafouées, frappées (comme Narghess qui en porte la trace sur le visage) ou emprisonnées pour des raisons qui touchent le plus souvent à la question taboue et dangereuse que constitue, dans l’Iran islamique, leur sexualité17. Mais nous l’éprouvons aussi dans cette façon de les suivre à l’extérieur, de les exposer à la lumière de la rue, d’emboîter le pas de leur retour au monde du dehors, contre la tyrannie des intérieurs où ce régime humiliant habituellement les confine et les dissimule. Malgré les motifs circulaires qui le ceignent de toutes parts, le film en effet travaille à toujours plus pousser ces femmes hors des murs, hors des limites du cercle, selon une dialectique où la force libératoire du dehors le dispute à la réclusion du dedans. Nous voulons dire par là que le film s’attache, comme le remarque Yann Tobin, à « réfuter l’architecture dramatique trop parfaite du cercle »18. À l’instar du couloir sur la fin du plan-séquence d’ouverture déjà évoqué, ainsi les techniques de filmage comme le recours aux gros plans de face qui aident à briser les interdits en instaurant un rapport de frontalité assez violent avec les héroïnes, mode de représentation que ne goûte guère la réglementation cinématographique en vigueur. Ainsi que le déclarerait le cinéaste à la sortie du film, le cercle représente en effet « une limite [que chacune d’entre elles] s’efforce de repousser, voire de franchir »19 et dont la caméra recueille l’angoisse que sa vision suscite. De visage en visage, le film tisse ainsi le fil de la solidarité de ces femmes, de leur petites lâchetés aussi20, de leur profonde souffrance surtout, mais que le courage jamais ne quitte. À ce propos, parlant des héroïnes du Cercle, Jonathan Rosenbaum notait dans les dernières pages de son essai sur Kiarostami, auteur dont il s’étonnait, d’ailleurs, qu’il n’ait jamais réalisé un film aussi politique et radical que celui de Panahi21 :
The film lacks villains or heroes, because the protagonists all have their lifelike mixtures of strength and weakness. But it’s obvious from the outset that what these women have to put up with is intolerable, and Panahi refuses to allow us to say at any point, for any reason, that any of them is « getting what she deserves »22.
14Dans un saisissant effet de réel, et malgré les voiles noirs et les recoins où ils cherchent refuge, ces visages de femmes expriment en effet toute la force de ce cinéma qui s’attache à leur redonner une vie que cette société leur dénie. Car « filmer les femmes en dépit des interdits », comme le rappelle Agnès Devictor à propos du Cercle, « c’est toujours filmer des êtres humains et des corps »23. En les élevant au plan iconique et sans jamais les juger, comme le souligne Jonathan Rosenbaum, le cinéma ne leur offre-t-il pas en effet la possibilité de sortir de l’anonymat où les avait précisément retenues, jusque-là, la société iconophobe du cercle ?
15Si le film ne laisse pas de bousculer les limites que pose la figure oppressante du cercle, pour autant constate-t-il son impuissance à en inverser le mouvement centripète somme toute inéluctable. Au terme du récit, ainsi le film nous ramène-t-il à l’intérieur emblématique d’une cellule de prison où finit le personnage le plus rebelle, s’il en est, rencontré au cours de ce long périple : la prostituée. Dans le fourgon de police où nous situait la séquence précédente, on la voyait en effet allumer une cigarette à la barbe des policiers qui pourtant le lui interdisaient, plan extraordinaire d’intensité comme rarement y parvient le cinéma de par la durée audacieuse qu’il accorde déjà à ce visage de femme plongé dans l’obscurité d’une nuit que les lumières de la ville brisent par intermittence, et de par la gestuelle de la cigarette dont la portée tout autant subversive que sensuelle, voire sexuelle, n’échappe à personne24.
Dans la séquence qui suit, nous retrouvons donc la prostituée que le policier pousse à l’intérieur de la cellule. Comme il referme la porte, la prostituée le rappelle pour lui demander ses médicaments restés dans son sac. Celui-ci ouvre alors le judas et la rembarre. Nonchalante, la prostituée s’éloigne vers le fond de la pièce, accompagnée par un panoramique circulaire qui peu à peu dévoile un mur quadrillé de soupiraux éclairés depuis l’extérieur où la pluie a commencé de tomber. Comme la prostituée se sert un chewing-gum au distributeur automatique fixé au mur, la caméra l’abandonne en poursuivant son panoramique circulaire le long de la pièce où les soupiraux projettent maintenant leur ombre grillagée, attrapant dans son mouvement un premier puis un second groupe de trois détenues où nous reconnaissons, malgré l’obscurité ambiante, Pari, Narghess et Arezoo sur lesquelles le mouvement panoramique glisse d’ailleurs sans s’arrêter. Poursuivant sa rotation, la caméra s’avance alors en travelling avant jusqu’au judas resté ouvert qu’elle prend maintenant plein cadre. À l’arrière plan que la mise au point maintient dans le flou, un téléphone sonne. Le gardien vient répondre. Comme le lui réclame son supérieur à l’autre bout du fil, il s’avance alors jusqu’au judas pour demander s’il n’y a pas une certaine Solmaz Gholami parmi les détenues (Fig. 6). 
16Bredouille, le policier s’en retourne vers le téléphone, communique à son chef le résultat de sa réponse puis raccroche. Il sort alors du champ à gauche puis revient brusquement pour fermer le judas resté ouvert et dont le rideau métallique tombe de haut en bas avec la violence d’une guillotine. On reste un court instant sur le judas refermé avant qu’un fondu ne nous ramène dans l’obscurité du noir générique sur lequel continuent de courir des bruits de lourdes portes métalliques qui se referment.
17Il y a dans ce final comme la continuation évidente du plan d’ouverture. Ce récit en boucle n’a été qu’un sursis, et l’exploration du dehors un répit. Car le cercle toujours finit par se refermer, à l’instar du panoramique circulaire droite-gauche inaugural qui trouve dans le mouvement d’appareil final le prolongement dont le récit l’avait momentanément amputé. Tout comme le travelling avant final sur le judas écrase sans appel la percée du travelling avant initial qui avait provisoirement brisé la logique implacable du cercle. Dans ce voyage crépusculaire qui conduit ces héroïnes de la clarté à l’obscurité et que métaphorise ici la force centripète du cercle, il y a en filigrane, ainsi que nous le suggérions en ouverture, comme l’évocation évidente du voyage que fit le Prophète en songe. Mais ici, le cercle ne conduit pas aux lumières du Paradis, il plonge la femme, continuellement fautive de quelque chose, dans les tourments de l’infernus générique.
18 Parti de l’intérieur, le film en effet se referme sur l’intérieur dans la répétition non du même mais du pire : du judas de bois, blanc, au judas de métal, sombre ; de Narghess, Arezoo et Pari dehors, aux mêmes Narghess, Arezoo et Pari dedans, de Solmaz Gholami la mère à Solmaz Gholami la fugitive ; enfin de l’hôpital à la prison. Mais aussi du son le plus aigu au son le plus grave, de la naissance à la mort que suggère sans peine le bruit lourd des portes de prison qui se referment dans l’obscurité de la clausule. À l’instar de ce judas et bien qu’il se referme, le cinéma somme toute sort grandi d’une telle entreprise. Car n’est-ce pas en effet le cinéma lui-même qui, in fine, sauve Le Cercle de l’infernale figure de sa circularité ? Fenêtre ouverte, il aura montré toute sa puissance subversive et salvatrice comme art du regard et de l’écoute à dire le monde. Car, selon le mouvement qu’impose sa figure, Le Cercle est à la fois un cri et une plainte, doué d’une puissance solaire et d’une noirceur mortifère, une œuvre fermée, rentrante mais sauvagement ouverte et engageante. Dans ce battement initial et terminal du judas, le film ne se veut-il pas du reste à l’image de Solmaz Gholami maintenue dans l’ombre du début jusqu’à la fin et dont le nom métaphoriquement l’ouvre et le ferme ? Gholami, littéralement « un valet qui s’incline » comme on s’incline devant un héritage, devant un nom de famille, fermé, soumis et sans avenir, alors que Solmaz, son prénom, embaume, littéralement encore, comme « une fleur qui ne dépérit jamais », identité propre de l’être affranchi de ses attaches, femme fugitive mais résolument libre, ouverte et insaisissable dans l’épaisseur de la nuit.

