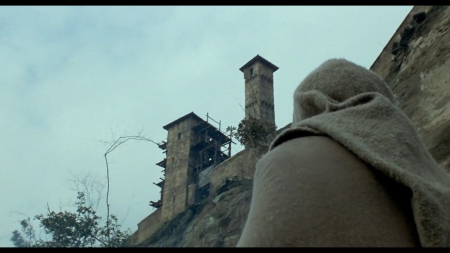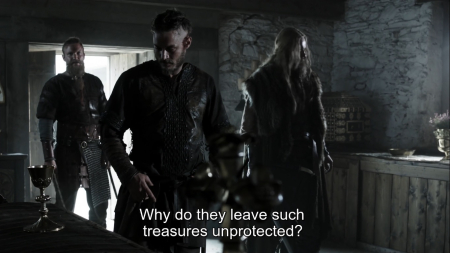« Hey, hey, we’re the monks! » Communautés religieuses monastiques dans le médiévalisme audiovisuel
1Les communautés religieuses font partie intégrante du personnel narratif médiévaliste1, qu’elles ne constituent qu’un élément de décor – comme dans Monty Python : Sacré Graal ! (1975) – ou, plus rarement, qu’elles soient les protagonistes de l’intrigue – comme dans Le Nom de la rose (1986). Parce que le clergé joue un rôle de premier plan dans les sociétés occidentales du Moyen Âge, les œuvres audiovisuelles qui recréent ou donnent à voir cette période lui accordent de même une place régulière, mais généralement secondaire : à l’exception de quelques inquisiteurs zélés ou de prêtres bons-vivants, tous perçus dans leur individualité, le clergé est pour ainsi dire absent de la plupart des productions médiévalistes, que ce soit dans des œuvres épiques ou dans des comédies, comme la trilogie Les Visiteurs de Jean-Marie Poiré (1993-2016). Si quelques religieux apparaissent bien ponctuellement dans les films et dans les séries, leur appartenance à une communauté monastique n’est que rarement représentée ou même simplement évoquée. Or, cette absence de représentation de groupes pourtant essentiels dans les sociétés médiévales n’est pas sans soulever un certain nombre de questions.
2Afin de circonscrire le champ de cette étude, l’analyse proposée dans cet article porte sur un corpus audiovisuel narratif, constitué de treize séries télévisées et de six longs-métrages occidentaux prenant pour cadre un Moyen Âge de fiction, qu’il soit présenté comme réaliste ou appartenant au genre de la fantasy. Le nombre croissant de ces productions d’imaginaire, où la magie joue un rôle important, dans le panorama médiévaliste invite en effet à tenir compte de ces représentations au même titre que les œuvres de reconstitution plus historique. Les productions du corpus ont été sélectionnées au sein du panorama médiévaliste occidental parce qu’elles font partie des rares œuvres à mettre en scène des communautés monastiques, majoritairement masculines, au-delà du simple aperçu anecdotique2. Par ailleurs, sont exclues de cette étude les figures d’ermites et de recluses3, par définition solitaires et n’appartenant pas à des communautés clairement définies, ainsi que les groupes religieux chevaleresques, tels que les Templiers (Aronstein et Torry, 2009, p. 225-245) : ceux-ci ne répondent pas à des vœux de réclusion et ils possèdent, traditionnellement, un rôle plus visible dans les sociétés médiévalistes représentées.
3De nombreuses productions mettent en scène des communautés religieuses chrétiennes, ou d’inspiration chrétienne et adaptée à un cadre de fantasy. Même lorsque ces groupes sont relégués à l’arrière-plan d’un point de vue narratif, ils entraînent avec eux tout un faisceau d’images fixes qui ponctuent le parcours des protagonistes et nourrissent ainsi le récit. Il s’agit dans cet article d’analyser les enjeux narratifs de la présence secondaire de ces groupes (Breton, 2023a, p. 111-128), en s’intéressant au décalage entre une narration audiovisuelle médiévaliste fondée sur l’action d’une part, et d’autre part les communautés religieuses considérées comme passives. La perspective adoptée dans ces œuvres oriente entièrement les caractéristiques attribuées aux communautés religieuses monastiques, lesquelles s’avèrent largement similaires dans toutes ces productions audiovisuelles, au point de constituer un stéréotype du médiévalisme audiovisuel. Cet article étudie ainsi dans un premier temps l’esthétique du paradoxe développée par ces représentations médiévalistes, avant d’interroger la façon dont, d’un point de vue narratologique, la focalisation extérieure adoptée dans les récits influe sur la fonction narrative des communautés religieuses monastiques.
Une série de paradoxes
4Dans le médiévalisme audiovisuel, les communautés religieuses sont mises en scène à travers une série de paradoxes, née de la difficulté de représenter la fixité dans un cadre par définition animé. L’audiovisuel repose en effet sur l’image en mouvement, et privilégie un principe de dynamisme. C’est le cas pour les films mais aussi pour les séries télévisées, qui adoptent un format à la fois plus court – à l’échelle de l’épisode – et plus long – à l’échelle de la saison. Cette fragmentation de la narration fait du rythme des séries un élément narratif essentiel. Par ailleurs, les récits médiévalistes, tous médias confondus, sont en grande majorité des récits d’action et d’aventure, multipliant les rebondissements, les péripéties et les déplacements des protagonistes. Un film ou une série médiévaliste tend ainsi à accorder une attention toute particulière au mouvement, caractéristique à la fois du médium et du genre.
5Mettre en scène une communauté religieuse implique alors d’effectuer une pause dans la narration : ces personnages se consacrent principalement à la prière et à la contemplation silencieuse, des activités a priori peu aptes à maintenir un rythme narratif soutenu4. Si des scènes de prières, collectives ou le plus souvent individuelles, sont régulièrement proposées, celles-ci sont surtout l’occasion de construire de belles images, reposant sur une esthétique de la fixité et de la contemplation, comme c’est fréquemment le cas dans la série The Last Kingdom (BBC Two et Netflix, 2015-2022). Ces passages constituent des arrêts sur image, nécessairement temporaires dans le récit filmique ou sériel fondé sur le mouvement (fig. 1).
Fig. 1 : The Last Kingdom (S02E06). Le roi Alfred en prière, dans une esthétique sobre et une composition symétrique.
6Ce décalage est renforcé par le choix d’une intrigue médiévaliste, traditionnellement centrée sur des protagonistes appartenant à une noblesse guerrière itinérante et active (Chanoir, 2020). L’immense majorité des personnages principaux sont en effet des rois, des chevaliers ou du moins des guerriers valorisés pour leur rôle actif. Le cinéma et la télévision médiévalistes suivent en ce sens une focalisation déjà opérée par la littérature du Moyen Âge, en particulier les chansons de geste et romans de chevalerie, où la noblesse occupe presque toujours le premier plan de la narration et où le déplacement est essentiel. Or, cette importance du mouvement s’accorde mal avec des personnages religieux intrinsèquement associés à l’idée de fixité.
7La difficile représentation des communautés religieuses dans un cadre médiévaliste tient également à la nature paradoxale du cénobitisme. Ces groupes sont composés de moniales ou, le plus souvent, de moines, qui vivent de façon recluse tout en restant en groupe. Ils partagent une vie ascétique et en grande partie solitaire, au sens où le repli sur soi apparaît privilégié, en particulier dans les contextes médiévalistes où le silence et l’isolement sont présentés comme des valeurs fondamentales de ces communautés. La représentation contemporaine de ces communautés tend à insister sur cette solitude : non seulement la communauté vit en retrait du « reste du monde », mais elle est par ailleurs formée de moines ou de moniales eux-mêmes très autonomes, bénéficiant de la protection de la communauté religieuse mais privilégiant toujours une quête personnelle de solitude. Le fait d’être situés « à l’écart » du monde laïc conditionne entièrement l’image que ces groupes renvoient : les productions médiévalistes tentent de concilier ces notions apparemment contradictoires, en représentant une communauté autonome – et donc apte à exister par elle-même – mais constituée en réalité d’une somme de solitudes individuelles.
8L’impression de solitude qui émane de ces communautés religieuses est souvent accentuée par l’insistance sur leurs conditions de vie ascétiques. Pour le spectateur contemporain, ce mode d’existence peut paraître excessif, voire absurde. Le médiévalisme repose justement sur cette confrontation temporelle du Moyen Âge et de la façon contemporaine de le concevoir : les pratiques des communautés religieuses s’en trouvent fréquemment noircies, dans une vision péjorative et réductrice de ce mode de vie, lequel est pensé comme incompatible avec le parcours du héros laïc – et, de fait, avec les pratiques du spectateur. La série animée et humoristique Désenchantée (Netflix, depuis 2018) s’amuse par exemple de cette vie ascétique en l’exagérant volontairement et en la nourrissant d’anachronismes plus éloquents pour le spectateur. Au cours d’un épisode, la princesse Tiabeanie, surnommée « Bean », est accueillie dans un couvent pour y être punie de la fête organisée sans l’autorisation de son père, le roi.
Mère supérieure : Sœur Tiabeanie, vous êtes encore en retard.
Bean : Désolée, Mère supérieure. Je n’ai pas beaucoup dormi, vu que mon lit est un bloc de granit.
Religieuse 1 : Granit ? Pourquoi c’est elle qui a le bon bloc ?
Religieuse 2 : Oh, ce sont toujours les princesses qui ont les meilleurs blocs. […]
Mère supérieure : Mes sœurs ! Ne vous laissez pas distraire par cette païenne. C’est l’heure du repas. Notre soupe du jour est de l’eau de cuisson de hot-dogs, et pour cela, réjouissons-nous.
Toutes, chantant : Je suis mauvaise et tu es mauvaise et nous sommes toutes mauvaises.
[Mère supérieure : Sister Tiabeanie, you’re late again.
Bean : Sorry, Mother superior. I didn’t get a lot of sleep an account of my bed being a granite slab.
Religieuse 1 : Granite ? Why does she get the good slab?
Religieuse 2 : Oh, princesses always get the best slabs. […]
Mère supérieure : Sisters! Do not be distracted by this heathen. It’s meal time. Our soup of the day is hotdog water, and for that, let us rejoice.
Toutes, chantant : I am bad, and you are bad, and we are bad together.] (Désenchantée, S01E05, ma traduction)
9Alors que Bean pense se plaindre de ses conditions de vie, sa situation est considérée par les religieuses comme un signe de luxe, réservé aux princesses. La privation de tout élément de confort est acceptée par les moniales au point que des aspects traditionnellement considérés comme horribles et punitifs – dormir sur de la pierre, se nourrir d’eau de cuisson de hot-dogs – sont perçus comme des réjouissances. La série s’appuie ici sur un comique de caractère, présentant les religieuses comme des êtres aigris et entièrement repliés sur leur propre monde, tout en réduisant à l’excès leurs conditions de vie et les enjeux de leurs vœux : la privation n’apparaît que pour elle-même et pour les excès qu’elle entraîne, sans éclairage spirituel mais uniquement pour constituer un décalage avec la vie d’adolescente que mène l’héroïne.
10Dans cette séquence, la vie ascétique est amplifiée à des fins humoristiques, mais correspond à une représentation fréquente des communautés religieuses : par leurs excès privatifs et par leur vie en autarcie, elles courent le risque de devenir aux yeux du héros et donc du spectateur, invité à adopter son point de vue, des groupes radicaux, étrangers à la société médiévaliste qui les voit naître et donc inaptes à véritablement y trouver leur place. Le refus de tout confort devient un signe d’inhumanité, accentuant – si ce n’est justifiant – le caractère séparé voire séparatiste de la communauté religieuse.
11La notion d’ « intérieur » renvoie à la communauté religieuse centrée sur elle-même. Cette réclusion naît, d’abord, de conditions pratiques : les moines et moniales ont besoin de calme pour se consacrer à la prière et travailler, et vivre à l’écart des laïcs contribue à réduire les tentations du monde extérieur. Toutefois, les représentations médiévalistes tendent à détourner cet isolement, en suggérant que les communautés religieuses refusent de s’ouvrir au monde. Toutes les œuvres qui mettent en scène l’intégration temporaire de figures extérieures dans des monastères font également apparaître les réticences de certains moines, préférant ne pas se mêler aux laïcs. Dans le film Le Nom de la rose, les religieux limitent au maximum leurs interactions avec l’extérieur, au point de paraître condescendants voire irrespectueux envers le reste des êtres humains : au lieu de sortir pour donner de la nourriture aux pauvres qui vivent près de leur monastère, ils aménagent une chute dans les murs de leur abbaye, d’où ils jettent leurs déchets, d’abord, puis les légumes et les restes alimentaires à destination des plus pauvres (fig. 2). L’enfermement des religieux entraîne ici un rejet du monde extérieur et de ses problématiques pourtant prégnantes.
Fig. 2 : Le Nom de la rose. Guillaume de Baskerville observe la trappe aménagée pour nourrir les plus pauvres à distance.
12L’ « extérieur » désigne le reste du personnel narratif séculier mis en scène, en-dehors de la communauté religieuse. Or, la narration médiévaliste étant presque exclusivement centrée sur ce monde laïc, et notamment guerrier, le récit n’a que rarement accès à l’intérieur de la communauté. Les groupes religieux adoptent non seulement un fonctionnement clos, mais possèdent également leurs propres règles et normes, qui les distinguent une nouvelle fois du reste du monde. De façon humoristique, la série musicale Galavant (ABC, 2015-2016) met en évidence ce décalage stéréotypé entre l’intérieur de la communauté et l’extérieur, en présentant la visite d’aventuriers dans le monastère fictionnel de « l’Ordre de Notre-Père du Refrain Éternel » :
Moine 1, chantant : Bienvenue dans notre abbaye, la meilleure du domaine. L’Ordre de Notre-Père du Refrain Éternel, et on est les moines !
Tous les moines, chantant : Hey, hey, on est les moines !
Galavant : Un contexte, s’il-te-plaît ?
Isabella : Les moines de Valencia observent tous un vœu de chant.
Sid : Oh bravo !
Galavant : J’en peux plus…
Moine 1, chantant : Entrez si vous êtes fatigués, on a de la nourriture si vous voulez dîner ; plus trente-et-une sortes de vin de messe ; et on est les moines !
Tous les moines, chantant : Hey, hey, on est les moines !
[Moine 1, chantant : Welcome to our abbey, the best of our domain. The Order of Our Father of Perpetual Refrain, and we’re the monks!
Tous les moines, chantant : Hey, hey, we’re the monks!
Galavant : Backstory, please?
Isabella : Valencian monks all take a vow of singing.
Sid : Oh bravo!
Galavant : Kill me…
Moine 1, chantant : Come in if you are weary, there’s food if you would dine ; plus thirty-one varieties of sacramental wine; and we’re the monks!
Tous les moines, chantant : Hey, hey, we’re the monks !] (Galavant, S01E05, ma traduction)
Fig. 3 : Galavant (S01E05). Les moines chantant, menés par Weird Al Yankovic.
13La séquence montre une incompréhension fondamentale entre le héros d’une part, le chevalier Galavant dont le nom même renvoie à l’idée de mouvement, et d’autre part la communauté religieuse, dictant et suivant ses propres règles jugées arbitraires et absurdes, détournées à partir d’une exagération volontaire de la place du chant dans la vie monastique. Le groupe religieux est perçu de l’extérieur, comme le souligne la demande du héros : « Un contexte, s’il-te-plaît ? [Backstory, please ?] ». Les observateurs extérieurs, dont Galavant qui se fait ici porte-parole du spectateur, ont besoin d’explications pour comprendre une organisation et des pratiques internes qui, autrement, leur resteraient volontairement hermétiques. Malgré tout, l’explication apportée demeure parcellaire : ni les protagonistes ni le spectateur n’en apprennent plus sur les raisons qui poussent la communauté religieuse à adopter cette règle musicale, si bien que l’explication demeure elle-même absurde (fig. 3). L’intrigue ne vise d’ailleurs pas à expliciter les enjeux de cette communauté si particulière, suggérant l’idée que les moines sont simplement « étranges » par nature, et doivent donc être fréquentés avec parcimonie.
14Le protagoniste reste toujours étranger, et donc extérieur, à cet espace clos. Les représentations médiévalistes soulignent bien le fait que cette opposition intérieur/extérieur émane d’un mouvement interne. L’ouverture des communautés religieuses est non seulement limitée, mais généralement refusée par les communautés elles-mêmes, qui règlementent, voire interdisent la communication avec le monde extérieur, selon le principe constitutif de la clôture monastique. Le film Les Bonnes Sœurs de Jeff Baena (2017), adapté du Décaméron de Boccace, illustre d’ailleurs bien cette difficulté d’échanger durablement avec le reste des protagonistes laïcs : les personnages doivent soit dissimuler leurs communications, soit ne se comprennent pas, soit sont en conflit permanent, si bien que les religieuses et les laïcs n’échangent jamais de façon fluide et sereine (fig. 4). Or, comme les récits médiévalistes sont en majeure partie consacrés à des personnages non-religieux, la fonction narrative attribuée aux communautés religieuses monastiques s’avère toujours soumise à une focalisation sur l’extérieur : outre de rares exemples, comme Le Nom de la Rose, la série Cadfael (ITV1, 1994-1998) ou dans une moindre mesure la série Inquisitio (France 2, 2012), les productions médiévalistes présentent toujours ces communautés telles qu’elles sont perçues par les héros laïcs, extérieurs à l’organisation religieuse et qui donc perçoivent son fonctionnement comme étranger – si ce n’est étrange. Et même dans ces programmes cités, où la communauté religieuse est pourtant centrale, l’essentiel de l’intrigue adopte le point de vue d’un personnage en partie extérieur, qui permet de faire se rencontrer la perspective laïque et les exigences de la vie monastique. Dans les deux adaptations du Nom de la rose, d’abord en film (1986) puis en mini-série (Rai 1 Sky Deutschland, 2019), l’intrigue suit Guillaume de Baskerville, un franciscain ouvert au monde qui mène l’enquête au sein d’une communauté bénédictine adepte des secrets ; dans Cadfael, le héros est non seulement un bénédictin mais aussi un ancien croisé et un grand voyageur ; et dans la série Inquisitio, l’étrangeté des pratiques de l’Église est soulignée par la confrontation des points de vue de Guillermo Barnal, le grand inquisiteur replié sur lui-même, et le médecin Samuel de Naples, qu’il accuse de meurtre.
Fig. 4 : Les Bonnes Sœurs. Le film illustre la difficile communication entre les religieuses et les laïcs.
Une fonction narrative dépendante de l’extérieur
15Parce qu’il se concentre sur des protagonistes laïcs, le médiévalisme audiovisuel met en scène des communautés religieuses surprenantes, regardées avec incrédulité ou méfiance. Leur rapport au reste du monde, représenté par les protagonistes, repose sur différents niveaux d’incompréhension : les productions audiovisuelles insistent sur l’étrangeté constante de ces groupes reclus, laquelle peut occuper différentes fonctions narratives.
16L’étrangeté des moines et moniales peut s’avérer entièrement vide de sens pour le protagoniste, qui demeure réduit à un rôle d’observateur extérieur. C’est par exemple le cas dans la première mise en scène des communautés chrétiennes dans la série Vikings (History, 2013-2020), et de leur confrontation avec les personnages vikings auxquels est consacrée la narration. Lorsqu’ils accostent en Angleterre, les pillards vikings ne comprennent pas pourquoi les églises qu’ils découvrent sont emplies de trésors non-gardés (S01E02) : crucifix, tabernacle, ciboire et autres bougeoirs d’or et d’argent sont rapidement dérobés, dans une joie teintée d’étonnement (fig. 5).
Fig. 5 : Vikings (S01E02). Les pratiques des moines paraissent étranges aux protagonistes vikings.
17De même, les vikings sont interloqués de voir des moines copistes prêts à sacrifier leur vie pour protéger leur livre saint. Cette séquence suppose qu’aucune interaction préalable n’ait jamais eu lieu entre vikings et chrétiens ; mais elle permet ainsi de mettre en évidence la difficulté de compréhension entre les deux cultures, en valorisant paradoxalement les figures de pillards et leur système de valeurs, plus ouvert et plus libre (Gautier, 2021). En effet, malgré leur violence, les personnages vikings, seuls représentés depuis le début de la série et que le spectateur est invité à apprécier, sont mis en scène comme des figures rationnelles voire rationalistes, s’opposant à l’idolâtrie apparemment absurde des moines.
18Lorsque la représentation médiévaliste adopte une tonalité plus légère, l’étrangeté des communautés religieuses monastiques est réduite à une forme de ridicule, source de comique. C’est l’interprétation privilégiée dans la série Miracle Workers (TBS, depuis 2019), dont seule la deuxième saison est médiévaliste. Au cours d’un bref échange, la jeune Alex tente de convaincre son amie Maggie, récemment entrée dans les ordres, de se rendre à un concert de troubadour, mais celle-ci a déjà d’autres obligations : « Je peux pas, j’ai du pain sur la planche. C’est quand on se frappe la tête avec une planche en bois. [I can’t, I have a board meeting. It’s when we hit ourselves in the head with a wooden board] » (Miracle Workers, S02E06, ma traduction5). La séquence s’achève sur une illustration de ce principe, lorsque Maggie profite d’une seconde de tranquillité pour se frapper avec une planche. Les religieuses font appel au lexique contemporain des « board meetings », des réunions de conseil d’administration, adaptées ici en rencontres où elles se frappent individuellement avec une planche de bois (nommée « board » en anglais). Ce procédé humoristique du « nonsense », reposant sur la confrontation du rationnel – les conseils d’administration – et de l’absurde – la violence auto-infligée –, renvoie directement à une autre représentation médiévaliste, sous la forme d’un emprunt fidèle à l’esthétique postmoderne : dans le film Monty Python : Sacré Graal ! de Terry Gilliam et Terry Jones (1975), les moines apparaissent en effet déjà en train de se frapper la tête avec une planche de bois, sans que cet acte soit justifié ni même commenté. Derrière le jeu de mot et la transposition de pratiques contemporaines au cadre médiévaliste par l’intermédiaire du clin d’œil humoristique, la séquence de Miracle Workers souligne toute l’absurdité des pratiques des religieuses, à la fois violentes, vides de sens et jamais questionnées par les personnages. L’absurde naît de l’étrangeté attendue des communautés religieuses monastiques, poussée à l’extrême et observée par des personnages laïcs qui demeurent extérieurs à leurs pratiques.
19Enfin, le médiévalisme audiovisuel accorde une dernière fonction à cette étrangeté : elle peut traduire une inquiétude vis-à-vis d’un extrémisme grandissant. C’est sur ce principe que repose la représentation des « moineaux » dans Game of Thrones (HBO, 2011-2019), un groupe religieux fictionnel suivant des principes radicaux de pauvreté. La série illustre une gradation dans l’inquiétude née de leurs pratiques. Ils sont d’abord présentés pour leur dénuement jugé excessif par leur entourage non-religieux, accentué par un effet de contraste avec la richesse habituelle des personnages mis en scène dans la série : le premier « moineau » sur lequel l’attention du spectateur est attirée, Lancel Lannister, apparaît au milieu de la cour royale particulièrement opulente, portant une robe de bure et se déplaçant pieds nus, signe traditionnel des ordres mendiants (S05E01). L’inquiétude suscitée grandit lorsque ces religieux attaquent ceux qu’ils jugent corrompus (S05E03) et se livrent à des scarifications volontaires particulièrement violentes (S05E04). Enfin, le groupe, ayant fait perdre toute individualité au personnage de Lancel, procède à une tentative de coup d’État en retenant prisonnières la reine (S05E06) et la reine-mère (S05E07), aboutissant à la torture et à l’humiliation publique de cette dernière (S05E10). Game of Thrones suggère à la fois une intensification et un élargissement de l’agressivité de la communauté religieuse. Ici, l’ouverture du groupe au monde extérieur existe, mais passe entièrement par la violence. Dans la diégèse, ce double processus d’ouverture et de radicalisation fait passer la communauté de l’individu au groupe, et de la périphérie au centre. Quand l’étrangeté devient une menace, tant sur les plans politique que social, le groupe religieux devient un organisme de premier ordre dans l’intrigue. L’étrangeté ne constitue plus un simple élément de décor : elle obtient par le prisme de la violence un rôle narratif central, qui ne s’achève que par l’éradication totale de la communauté (S06E10).
20Cette logique d’incompréhension vis-à-vis de l’étrangeté de la communauté religieuse dépend chaque fois du regard des personnages laïcs, auxquels le spectateur est invité à s’identifier. La perception de ces groupes est donc chaque fois extérieure et révèle leur inadéquation avec les protagonistes.
21Parce qu’ils vivent en retrait, les moines et moniales ne semblent pas pouvoir coexister avec des personnages principaux actifs et itinérants. Le médiévalisme audiovisuel adopte en ce sens une structure narrative proche de celle des romans de chevalerie, dans lesquels l’aventure du protagoniste ne se rencontre qu’à l’extérieur : le héros doit quitter le cadre protecteur du château pour accéder à l’aventure et mériter son titre de chevalier. Dans les films et séries médiévalistes, les protagonistes se trouvent confrontés à des communautés vivant parfois dans un retrait absolu, contrastant avec leur propre mouvement permanent. Dans la série L’Écuyer du roi (Netflix, 2020), les moines sont ainsi triplement séparés du monde : ils vivent dans un monastère situé en haut d’une montagne ; celui-ci est pris au cœur d’une tempête empêchant toute communication avec l’extérieur ; et tous les moines sont d’anciens criminels, principalement des voleurs et des meurtriers, dont certains ont sombré dans la folie. Au retrait géographique et social s’ajoute ainsi une forme de retrait moral, dans une accumulation qui inquiète les jeunes protagonistes.
22Une nette frontière est toujours maintenue entre les personnages actifs d’une part et d’autre part les communautés religieuses monastiques, maintenues à bonne distance tout au long de la narration. Les rencontres ne sont alors que passagères et se concluent par le départ du héros. Même lorsque les moines et moniales apportent aide et protection, leur intervention ne représente chaque fois qu’une étape transitoire, que le héros doit nécessairement dépasser pour poursuivre son aventure. Dans la série The Bastard Executioner (FX, 2015), le protagoniste Gawain Maddox est par exemple abandonné à la naissance par ses parents et élevé dans un monastère, qu’il abandonne lorsqu’il souhaite devenir chevalier. Cette étape de son parcours paraît d’ailleurs peu importante dans la structure de la série, puisque l’enfance du héros n’est pas mise en scène mais est simplement évoquée de façon analeptique. L’accueil de la communauté religieuse, pourtant décisif pour la survie et la formation subséquente de Gawain, n’est pas valorisé dans la narration, et est toujours présenté comme une situation transitoire. Le protagoniste trouve dans le monastère une protection certes efficace, mais qui n’est perçue de façon positive que tant qu’elle demeure temporaire : pour le héros, l’aide reçue ne doit jamais devenir une fuite ou un refus du monde extérieur.
23Le médiévalisme audiovisuel rappelle régulièrement que l’un des rôles de ces communautés religieuses consiste à protéger les personnes dans le besoin, recueillant et élevant par exemple les enfants abandonnés, comme le bébé de Tom dans Les Piliers de la Terre (Starz, 2010, S01E02), ou les orphelins dans la série animée Redwall (Teletoon, 1999-2002). Cependant, cet accueil se réduit le plus souvent à une ellipse, d’autant que les enfants constituent les grands absents du médiévalisme audiovisuel (Breton, 2023b), si bien que l’accueil et la protection fournis par la communauté religieuse sont plus évoqués que mis en scène. Les représentations soulignent d’ailleurs également la nature conditionnelle de l’aide apportée, selon une ambivalence majeure : parce que cette protection est synonyme d’enfermement, et parce que le récit médiévaliste est naturellement tourné vers le mouvement, l’aide offerte par les communautés religieuses ne peut qu’être temporaire. Le protagoniste est en effet appelé vers l’extérieur et doit quitter le monastère malgré la protection qu’il représente. Ainsi, dans Désenchantée, Bean n’est-elle accueillie au couvent que le temps d’un épisode, avant d’en être renvoyée parce qu’elle refuse d’appliquer les règles de retrait imposées par l’ordre religieux. La narration est chaque fois construite pour que le passage du héros auprès d’une communauté recluse ne soit qu’une étape intermédiaire dans son parcours.
24Cette transition systématique dans la narration s’appuie sur l’idée largement répandue que l’implication dans la vie monacale est définitive dès lors que l’on prononce ses vœux. Entrer dans la communauté religieuse implique donc un risque de ne jamais pouvoir en sortir, ce qui, dans le récit médiévaliste, signifierait la fin de l’aventure. En effet, les productions entretiennent également l’idée qu’une communauté religieuse ne constitue pas un espace d’aventure : les monastères ne sont pas présentés comme des lieux appropriés aux rebondissements narratifs, justement parce qu’ils impliquent une forme de passivité et d’observation silencieuse du monde. Bien que ces communautés aient pu avoir, au Moyen Âge, un rôle social et politique particulièrement dynamique (Matz et De Devins, 2010), cette idée n’est généralement pas prise en compte par les représentations médiévalistes. D’acteurs de l’évolution des sociétés, les groupes religieux deviennent ici de simples témoins partiels, invités à n’assister qu’à une brève étape dans le parcours d’un héros, seul véritable moteur de l’évolution sociale. Par conséquent, les communautés religieuses mises en scène restent le plus souvent limitées à un rôle secondaire, voire de simple décor, auquel le héros et le spectateur peinent à accéder.
25La représentation médiévaliste des communautés religieuses est étroitement associée à l’idée d’enfermement. Dès lors, même lorsque l’intrigue est spécifiquement consacrée à l’une d’entre elles, la narration opère systématiquement une focalisation plus précise sur un protagoniste, religieux certes, mais avant tout hors du commun. Il s’agit généralement d’un protagoniste qui, par son passé, a vécu en-dehors du monastère, et reste au moins partiellement attaché à sa vie séculière. Dans cette conception, l’ouverture au monde ne peut venir de la communauté religieuse, laquelle maintient au contraire un mouvement permanent de clôture et de retrait. Le récit se concentre alors sur un personnage d’entre-deux, membre de la communauté mais appelé vers l’extérieur par un esprit naturellement curieux et une attirance marquée pour les personnages laïcs qui l’entourent. C’est ainsi le cas pour Guillaume de Baskerville dans le film Le Nom de la rose de Jean-Jacques Annaud (1986), et dans la mini-série du même nom (Rai 1 Sky Deutschland, 2019), elle aussi adaptée de l’œuvre d’Umberto Eco (1980). De même la série Cadfael (ITV, 1994-1998), adaptée des romans d’Ellis Peters (1977-1994), repose sur cette valorisation d’un personnage de moine exceptionnel. Chaque fois dans ces récits d’enquête médiévalistes, le religieux se distingue de ses frères en faisant preuve d’une grande ouverture d’esprit et de connaissances issues du monde laïc, lui permettant de dénouer les mystérieuses intrigues à l’œuvre dans le monastère.
26Les stéréotypes des communautés religieuses sont respectés : il s’agit chaque fois de lieux volontairement clos, dont les membres valorisent le silence et la vie en retrait, et qui limitent au maximum les contacts avec l’extérieur – en refusant par exemple de se mêler aux conflits politiques et guerriers, dans la série Cadfael, ou en demeurant sourd aux demandes d’aides de populations affamées, dans la mini-série Le Nom de la rose. Le cadre monacal contribue d’ailleurs au genre de l’enquête privilégié ici : ces productions s’apparentent à des huis-clos, limités au seul monastère, et où les personnages cherchent naturellement à conserver le silence et à dissimuler des secrets. Les stéréotypes associés aux communautés religieuses du Moyen Âge deviennent des éléments-clé de la narration et justifient l’effort d’investigation. L’intrigue de ces productions médiévalistes repose alors sur un héros jouant le rôle d’élément perturbateur, qui face aux crimes et à l’injustice refuse la passivité du reste de la communauté. En menant son enquête et en mettant en lumière les différents secrets des moines, le protagoniste amorce ainsi une ouverture partielle de la communauté – du moins le temps de résoudre le mystère central.
27Il est à noter que ce schéma, valorisant le caractère exceptionnel d’un personnage religieux pour justifier sa démarche d’ouverture au monde, n’est pas exclusif aux représentations médiévalistes. Il est au contraire fréquent dans les mises en scène des communautés religieuses chrétiennes, systématiquement perçues comme des groupes clos, et ce quelle que soit l’époque représentée6. Ainsi dans la série Sœur Thérèse.com (TF1, 2002-2011), pour choisir un exemple français, l’héroïne est-elle une ancienne enquêtrice renommée : après avoir quitté son mari et la vie active pour entrer dans les ordres, elle s’échappe régulièrement du monastère pour aider la police dans ses enquêtes. Néanmoins, le choix d’un contexte médiévaliste renforce la focalisation opérée sur des personnages exceptionnels, plus à même de soutenir une intrigue au rythme soutenu. Dans la série Vikings, le moine Athelstan est par exemple tiré de son monastère anglais parce qu’il est le seul à parler la langue des vikings7, et qu’il peut donc jouer ce rôle d’intermédiaire entre la communauté religieuse et le monde extérieur – symbolisé ici par les guerriers vikings. En parallèle des voyages et conquêtes des héros, l’intrigue souligne le lent renoncement d’Athelstan à ses pratiques et croyances chrétiennes, tandis qu’il s’approprie peu à peu la culture viking. De façon intéressante, l’évolution du personnage n’est pas linéaire, et son hésitation entre deux mondes, deux fois et deux cultures contribue à relancer les tensions entre les protagonistes et à accentuer le dynamisme de l’intrigue. Toutefois, dès qu’Athelstan retrouve pleinement sa foi chrétienne, il est définitivement évincé de la narration : alors qu’il accède à une transe mystique par sa prière, l’ancien moine redevenu un fervent croyant est assassiné par l’un des vikings (S03E06). La série montre bien à quel point la prière chrétienne ne peut constituer qu’un élément de décor, temporaire et à l’arrière-plan, sans pouvoir devenir un sujet narratif à part entière dans le médiévalisme audiovisuel.
*
28Un tour d’horizon de ce corpus permet de faire apparaître un dernier paradoxe, selon lequel l’étrangeté des communautés religieuses monastiques constitue un élément traditionnel et systématique du médiévalisme audiovisuel. La représentation de ces groupes correspond à une forme de cliché, puisqu’elle est reproduite à l’identique, dans des objectifs figés, et ce dans de nombreuses productions occidentales. Chaque fois, ces communautés ne sont pas tant représentées pour elles-mêmes que pour ce qu’elles peuvent apporter aux protagonistes laïcs, et pour le mystère qu’elles font naître par leur caractère clos et secret. Qu’elles fassent rire, lorsqu’elles sont à la marge des sociétés médiévalistes représentées, ou qu’elles suscitent une certaine angoisse quand elles obtiennent un rôle de premier plan dans la narration, ces communautés religieuses demeurent des étapes transitoires dans le parcours des protagonistes : leur présence constitue un passage obligé mais sur lequel le spectateur n’est pas invité à s’arrêter davantage.