1J’écris parce que je ne veux pas raconter ma propre histoire, parce que j’ai besoin pour la dire de la diffracter en une multiplicité d’autres récits et d’autres voix. Nous abritons tous ce multiple et ces voix mais écrire, c’est leur faire droit, les laisser entrer dans la chambre calfeutrée où l’on croit pouvoir dire : « Ici, c’est chez moi. Ici, c’est moi ». Le lieu à soi depuis lequel on travaille n’est pas une chambre intime mais un espace du dedans, et cet intérieur déborde l’intime qui le cloisonne, il l’étire, le distend pour y loger des plantes, des bêtes et des dieux, des lointains, des confins. Des pièces y apparaissent qu’on ne connaissait pas la veille, des escaliers sans fin, un couloir sombre et sans porte surgi de nulle part sur le mur ouest. C’est un lieu mal isolé, on y découvre des fissures, des lézardes, et des immenses oculus à la Gordon Matta-Clark qui l’ouvrent aux quatre vents, si bien qu’on ne sait plus trop ce qui est dehors, ce qui est dedans. C’est un lieu fatigant, dit Barthes dans La Préparation du roman : « Au fond, ce qu’il y a de très difficile aujourd’hui, c’est de tenir un discours vrai, c’est-à-dire un discours qui reproduise clairement les différentes voix dont est fait un sujet, dont est fait le sujet qui parle. […] Je n’arrive pas à produire un discours dans lequel les autres entendent la pluralité des voix, parce que le pluriel est toujours la chose la plus fatigante du monde ». On peut se demander qui a encore envie de se déloger dans un endroit pareil plutôt que de rester chez soi, tranquillement confiné.
2De livre en livre, d’année en année, je dois de plus en plus souvent expliquer que l’histoire que je raconte n’est pas la mienne, que celle qui l’écrit n’est pas « moi » mais une décomposition/recomposition à laquelle ne correspondent ni pronom ni sujet, que le « je » qui les dit n’est pas non plus le mien, désolée. Et quand ce « je » est celui d’autres qui ont existé, je dois également préciser que je ne parle pas à leur place, que s’ils parlent dans mon silence je ne veux pas soumettre le leur à la question. Les lecteurs sont déçus, parfois. Ils préfèrent la sincérité au paradoxe du menteur, à la vérité. C’est émouvant, la sincérité. C’est émouvant, un écrivain qui chuchote très fort ses secrets ou se proclame porte-voix de ceux qui ne peuvent plus parler. À croire que lire devient aussi fatigant qu’écrire.
3Je ne joue pas ma vie en tentant de convaincre que les histoires que j’écris ne sont pas les miennes. Je ne joue pas ma vie, contrairement à ceux qui pour sauver la leur doivent prouver que l’histoire qu’ils confient est bien leur histoire, et la répéter, cette histoire, mille fois la répéter, sans se couper, sans se tromper, arracher des faits, des chiffres et des dates au trou noir foré par le trauma, raconter mille fois l’histoire qu’ils ont fuie jusqu’à ce qu’on leur accorde l’asile– ou pas. Rien à voir, donc. Pourtant je ne peux m’empêcher de penser que si l’on ne cherche pas dans la littérature une occasion de se déloger, que si l’on préfère, en lisant en écrivant, rester à la maison, il est peu probable qu’on laisse la porte ouverte. Ou encore, et pour le dire avec Rancière, je suis convaincue que si l’on ne voit pas dans la littérature un processus de désidentification, une « affaire de noms “impropres” qui articulent une faille », on se ferme une issue (elles ne sont pas si nombreuses) à la « logique policière » de l’assignation.
Dans La Folie Elisa, quatre filles font irruption dans une maison. Quatre filles qui se sauvent, et deux fois : qui prennent la fuite et dans cette fuite cherchent leur salut. On est entre janvier 2015 et janvier 2016, Emy Manifold, une rock star anglaise, a quitté la scène après les attentats du Bataclan, Irini Santoni, hantée par les corps qui s’échouent sur son île grecque, ne sculpte plus que des barbelés et du Vantablack, Sarah Zygalski, blessée, ne peut plus danser avec sa compagnie berlinoise, Ariane Sile, un soir de dernière à l’Odéon, alors qu’elle jouait enfin le rôle de sa vie, s’est interrompue pour apostropher le public par-delà « le quatrième mur ». Elles ne se connaissent pas, mais elles ont en commun de ne plus jouer, de ne plus vouloir, ne plus pouvoir jouer. Les réunit aussi une incapacité à dire « je suis » : le refus de faire bloc avec soi, une extrême porosité au monde, aux autres, aux hommes, une forme de dérèglement du rapport intérieur/extérieur. Ces filles en fuite sont des « petites folles », comme dit Duras de Lol V. Stein, elles sont borderline ou plutôt no border : très peu fortifiées, très peu barbelées. Elles ont démantelé en elles les murs qui se dressent partout ailleurs. Les réunit enfin un graff au lettrage incisif, un immense 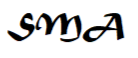 bombé de ville en ville.
bombé de ville en ville.
4Emy, Irini, Ariane et Sarah passent le seuil de « La Folie Elisa ». Le livre les saisit à leur point de chute, qui est aussi au point de refus : au moment où la porosité qui, parce qu’elle était la condition de leur art, faisait leur puissance, s’inverse en impuissance et en sidération. Il se construit par chambres, quatre chambres claires où résonnent leurs voix, une camera obscura où se découpent des extraits de la presse européenne de cette année-là, les pans de matière noire qui constituaient alors notre présent : les attentats, la montée de l’extrême droite, la mer devenue cimetière, les murs multipliés. Ce présent n’est pas passé, même si la pandémie, les confinements, l’ont encore obscurci et font aussi résonner autrement les deux parties, « Dedans » / « Dehors », qui structurent le roman. Inscrire la trace brute de ce présent sans l’écrire ni la raconter, c’était une façon de fixer le point de bascule sans l’accepter. L’archive réactive, quand le récit, lui, métabolise, change en nécessité les alternatives.
5Des récits, pourtant, il y en a beaucoup dans La Folie Elisa, qui font circuler la matière noire, la feuillettent, la transforment, au lieu de la redoubler comme le fait Irini avec son Vantablack. Avant d’écrire ce livre, ma question était la sienne, celle aussi d’Ariane, Emy et Sarah : comment continuer ? Et à quoi bon en temps de détresse ? J’ai perdu une maison à cette époque-là (voilà pour la petite affaire privée), une maison dont j’ai mille fois lu le nom sur la plaque à gauche du portail– « La Folie Elisa » – , avant de m’apercevoir, un jour, qu’« Elisa » était l’anagramme d’« asile », que j’avais séjourné des années dans l’asile de la folie, ou quelque chose comme ça, à ceci près que « Folie », on le sait, a également un sens architectural, du latin folia, feuille. Cette maison fermée a ouvert un livre. Il suffisait de lire son nom, de préférence à l’envers, de le décomposer-recomposer, d’en extraire les règles invisibles d’un jeu nouveau : quatre voix, plus celle de L., appelées par les lettres d’« Elisa », et avec le « A », Ariane soudain ressurgie de mon premier roman, avec le « S », Sarah revenue de Partages. La maison est devenue livre, le livre, maison, asile de feuilles où héberger mes « petites folles » le temps qu’elles recomposent les figures de leurs vies. Je leur ai ouvert la porte, j’ai recommencé à jouer.
6Elles ont fait mieux : elles sont sorties. Elles ont transformé leur puissance érotique en puissance collective, elles l’ont orientée vers le dehors. À la fin, à la toute fin, dans un temps d’apocalypse, elles ont repris la route, accompagnées par des foules innombrables, par ceux de Leros et de Calais, d’Idomeni et de Grande-Synthe, ceux de Kawergosk et de Zaatari, de Goma, Bidibidi et Nyarugusu, ceux de Beldangi et de Dharamsala, ceux de Dadaab et Kakuma, de Breidjing et de Burj el-Barajneh, ceux de Canaan. Elles sont allées vers l’hacienda et son règne sans sujets. J’ai refermé mon asile de feuilles pour en ouvrir d’autres, tout aussi précaires, tout aussi fragiles, c’est peu, mais il faut continuer, à défaut de pouvoir changer ce qui est faire exister ce qui n’est pas, peupler les espaces intérieurs, maintenir les possibles, punir les murs, comme disent les graffeurs.

