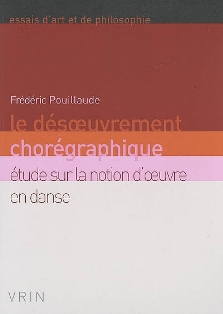
Le désoeuvrement chorégraphique - Etude sur la notion d'oeuvre en danse
Frédéric Pouillaude
Paru le : 11/05/2009
Editeur : Vrin
Collection : essais d'art et de philosophie
ISBN : 978-2-7116-2195-8
EAN : 9782711621958
Prix éditeur : 30,00€
Il n'y a pas de bibliothèque du mouvement, de lieu où les oeuvres chorégraphiques trouveraient à se conserver, identiques à elles-mêmes et offertes à tous. C'est un fait. Rien qu'un fait. Mais qui engage énormément.
En premier lieu : l'incapacité de la philosophie et de l'esthétique à penser les pratiques chorégraphiques selon le régime commun de l'oeuvre. C'est toujours d'un autre espace que la danse semble relever, à la fois plus frivole et plus fondamental, toujours en deçà ou au-delà du projet de l'oeuvre. Cette absence d'oeuvre, abstraitement mise au jour par la philosophie, nous tentons de l'analyser en une première partie.
De là, il s'agit d'articuler un autre concept, connexe mais différent : celui de désoeuvrement. Les écrits philosophiques sur la danse assignent la pratique du mouvement à une pure et simple absence de production, à l'expérience de la dépense et de l'auto-affection. Nous soutenons que ce philosophème (abstraitement nommé absence d'oeuvre) ne fait que réfléchir dans l'ordre du discours une fragilité interne et propre aux oeuvres chorégraphiques, fragilité que nous nommons : désoeuvrement
Après une formation en danse classique et contemporaine, Frédéric Pouillaude intègre l'Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm. Agrégé et docteur en philosophie, il est maître de conférences à l'Université Paris IV-Sorbonne
Sommaire :
introduction
remerciements
première partie : la philosophie de ladanse et l'absentement des oeuvres
chapitre premier : de l'absentement transcendantal
chapitre 2 : un temps sans dehors (Valéry et la jouissance)
chapitre 3 : un espace sans lieu (Straus et l'extase)
chapitre 4 : l'absence d'oeuvre : présence, dépense, auto-affection
seconde partie : l'oeuvre (1) : scène etsignification
chapitre premier : Mallarmé et le déchiffrement de la scène
l'empiricité des lieux et des noms
la politique et la religion de la scène
le rite (hors-jeu) de l'Idée
chapitre 2 : spectacle, rituel, divertissement (genèse et structure dela scène chorégraphique I)
le modèle grec : ritualité et choréia
l'âge classique : d'un divertissement l'autre
la modernité et l'espoir de nouveaux rituels
chapitre 3 : présence, idéalité, signification (genèse et structure dela scène chorégraphique II)
le temps du présent
les transcendances de la représentation
une double exclusion : Aristote et la tradition théâtrale
chapitre 4 : Artaud : la présence et le rituel
la dialectique de la présence
l'effectivité du rituel
l'(archi-)écriture hiéroglyphique
troisième partie : l'oeuvre (2) :l'immanence de l'idéalité
chapitre premier : d'une graphie qui ne dit rien
Feuillet : la figure et le caractère
Noverre : la lettre et la parole
Laban : le mouvement et l'effort
chapitre 2 : deux régimes d'identité
le modèle goodmanien : autographie et allographie
les apports de Gérard Genette : transcendance et performances
une allographie sans notation : la danse ?
chapitre 3 : les identités orales : passes et versions
le paradoxe du répertoire : l'oeuvre-cadre
les impasses de l'idiosyncrasie : l'oeuvre-corps
les mutations de l'oralité : l'oeuvre-passe
chapitre 4 : les secours de la trace : images et nombres
l'archéologie du remonteur : l'oeuvre-archive
les puissances du film : l'oeuvre-occurrence
le partitionnel, quand même : l'oeuvre-signe
quatrième partie : d'une technique sansobjet
chapitre premier : qu'est-ce qu'une technique de danse ?
chapitre 2 : technique ou langage : les impasses de l'analogie
chapitre 3 : le «sans outil» comme absence de mémoire ?
chapitre 4 : vouloir l'involontaire et répéter l'irrépétable
conclusion 1 : réfléchir et répéter
section première : scène et contemporanéité
section 2 : le travail réflexif de la performance
section 3 : le travail mémoriel de l'oeuvre
conclusion 2 : le geste et la trace
documents
bibliographie
index des oeuvres citées
index des noms
table des matières
* * *
Sur l'audioblog Aboutdesouffle (arteradio), on peut écouter un entretien avec l'auteur.
* * *
Dans Libération du 9/7/9, on pouvait lire un article sur cet ouvrage:
La philo ouvre la danse
Esthétique. De la difficulté à penser la chorégraphie comme art.
Par ROBERT MAGGIORI
Frédéric Pouillaude Le désoeuvrement chorégraphique. Etude sur la notion d'oeuvre en danse. Vrin, 274 pp., 30 euros.
Ladanse semble naître spontanée des trémoussements du bébé, des jeux, despirouettes et des rondes enfantines. Et l'homme, dès son origine, adansé, pour saluer les naissances et les morts, les mariages et lespartages de nourriture, pour faire tomber la pluie, chasser lessortilèges, parler avec les dieux. Aussi, qu'elle soit ludique,magique, érotique, sacrée, guerrière, la danse semble-t-elle moins unart qu'une matrice culturelle, d'où sourdent presque toutes lesexpressions de la vie. Pourtant, au cours de l'histoire, elle a subibien des discrédits, liés à l'abjection dont on entourera le«physique», le corps. Saint Augustin y voit une marque du diable, une «folie lascive».
Articulation. Sous les empereurs chrétiens, on nieles sacrements aux danseurs et aux comédiens, on excommunie ceux quiassistent à leurs exhibitions. Encore aujourd'hui, le mot «danseuse» nes'est pas tout à fait libéré de ses connotations négatives, où semêlent argent, moeurs faciles et plaisir. Alors que les dansespopulaires se perpétuent au fil des traditions, la danse théâtraleapparaît au XVIe siècle dans les cours d'Europe sous laforme classique du ballet, conçu et réalisé pour être présenté enpublic - avec ses pas, ses figures, ses modules de mouvements, satechnique, ses schémas chorégraphiques, sa scénographie. Dès lors, ellese pose certes en art à part entière, bien que sa finalité ne soitsouvent que le divertissement des princes. Mais son statut et sa placedemeurent ambigus. S'il n'y a de jeu que temporel et de figure quespatiale, la danse, définie comme «jeu des figures», ne peut être qu'«articulation de l'espace et du temps», entrecroisement de la plastique («art des figures dans l'espace») et de la musique («art du jeu des sensations dans le temps»).
C'est par l'analyse de la danse comme «espèce hybride» (donc «exclue des genres purs» ou absente pour ce qu'elle est en elle-même), que s'ouvre le Désoeuvrement chorégraphiquede Frédéric Pouillaude, une étude placée, quant à la méthode, sousl'égide de quelques maîtres (Canguilhem, Foucault, Desanti, Derrida)qui interroge «l'incapacité de la philosophie et de l'esthétique àpenser les pratiques chorégraphiques selon le régime commun del'oeuvre». Il n'y a guère de difficulté à parler d'oeuvre musicale,littéraire ou cinématographique. Mais qu'est-ce qu'uneoeuvreen danse ?Quel corpus consulter ? Quelle«bibliothèque du mouvement»visiter ? Quellieu fréquenter,«où les oeuvres chorégraphiques trouveraient à seconserver, identiques à elles-mêmes et offertes à tous»? Si la danserelève d'unautreespace,«à la fois plus frivole et plus fondamental»mais«toujours en deçà ou au-delà du projet de l'oeuvre», comment peut-on lapenser ?«Nous soutenons, écrit Frédéric Pouillaude,que ce philosophème(abstraitement nommé absence d'oeuvre) ne fait que réfléchir dansl'ordredu discours une fragilité interne et propre aux oeuvres chorégraphiques,fragilité que nous nommons :désoeuvrement.»
«Absentement». L'explicitation de cette notion de désoeuvrement (qui fait songer à la Communauté désoeuvréedont Jean-Luc Nancy parle dans le registre politique) exigera, àtravers les lectures de Valéry, Mallarmé, Artaud, Erwin Straus, RudolfLaban, Nelson Goodman, Genette… un long parcours, s'achevant sur «la puissance de l'impouvoir» propre à la danse. Mais l'essentiel tient à l'analyse des modes d'«absentement» de l'oeuvre chorégraphique. Cet absentement est d'abord un blanc, ou une rature. Au moment même, en effet, où se constitue un «nouveau genre de discours sur l'art et le beau», où naît donc l'esthétique, la danse est expulsée du système classique. Une quinzaine d'années seulement avant la Critique de la faculté de juger, la danse «fait encore figure d'objet théoriquement recevable». Mais, avec Kant, elle n'a droit qu'à une ou deux remarques. Hegel, dans les Leçons d'esthétique, et Schelling, dans la Philosophie de l'art, l'ignorent quasiment. L'architecture, la sculpture, la peinture, la musique et la poésie : voilà les arts véritables.
«Déjà-là». Mais peut-être la danse est-elle plus qu'un art ? C'est en effet en lui attribuant un régime spécial qu'on l'exile de nouveau. On l'élève au rang de «condition transcendantale», toujours «déjà-là», présente «avant toute séparation de domaine ou d'objet» - et, ainsi, on lui ôte «cequi fonde l'empiricité de tout art : des noms d'artistes, des titresd'oeuvres, des lieux et des dates, et de façon générale une histoire».«La danse n'est pas un art parce qu'elle est le signe de possibilité de l'art, telle qu'inscrite au corps», soutient Alain Badiou, indiquant par là que «le corps est capable d'art» sans qu'il y ait «un art du corps». Mais il est une autre façon, peut-être plus féconde, d'élever la danse au rang de «transcendantal» : en faire «une unité originaire du sentir et du se mouvoir», et, ainsi, la lire comme essence de l'art. Paul Valéry, dans sa Philosophie de la danse, l'écrivait sans ambages. La danse, un «art ornemental», un «futile divertissement» ? Mais non ! «Tout simplement une poésie générale de l'action des êtres vivants».