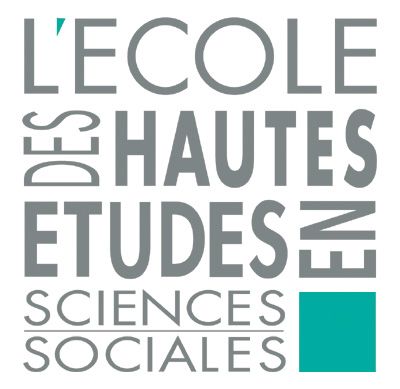
Des plantes, des animaux et des « guerres » - LAP | UMR 8177 CNRS-EHESS
Programme ouvert à toutes et tous sans inscription
Plusieurs cultures, différentes manières d’envisager le vivant
Le jeudi 3 avril, salle AS1_23 de 16h à 19h (EHESS, 54 bld. Raspail)
Séance animée par Mara Magda Maftéi
Invités :
Catherine Rémy (CEMS, CNRS-EHESS)
Alessandro Buccheri (UMR ANHIMA)
L’écrivain Wilfried N’Sondé
Résumé de l’intervention de Catherine Rémy :
Lors de cette intervention, je présenterai les résultats de recherche d’une double enquête, historique et ethnographique, que j’ai menée sur une innovation biomédicale, la xénogreffe, c’est-à-dire la tentative de transplantation d’organes entre l’animal et l’humain. Cette pratique et les nombreux débats qu’elle a suscités donnent à voir des conceptions plurielles de l’animalité et de l’humanité qui ont circulé depuis le XVIIe siècle jusqu’à aujourd’hui. L’enquête historique souligne notamment l’émergence au XIXe siècle d’une conception dualiste de l’échelle des êtres qui a façonné la mise en œuvre de l’expérimentation animale, dont la xénogreffe s’avère l’une des extensions, reposant sur l’affirmation d’une discontinuité entre humains et non-humains. Dans la seconde moitié du XXe siècle, un dispositif gradualiste voit le jour et remet en cause cette discontinuité en imposant une nouvelle conception de l’échelle des êtres. Si le gradualisme est partiellement actualisé dans la situation contemporaine, l’enquête ethnographique révèle également que les scientifiques engagés dans cette innovation s’appuient toujours sur des éléments de discours et des manières de s’engager auprès des animaux cobayes typiques de la conception dualiste. Ces résistances semblent liées aux rapports ambivalents que les expérimentateurs entretiennent aux cobayes, ceux-ci oscillant entre expressions de compassion et objectivation.
Résumé de l’intervention d’Alessandro Buccheri :
Situé à l’intersection de l’anthropologie historique, de la théorie cognitive de la métaphore et des humanités environnementales, Penser les humains à travers les plantes analyse le rôle des métaphores botaniques dans la poésie grecque des époques archaïque et classique. Cette étude reconstruit les savoirs botaniques propres aux traditions poétiques de l’époque (leur « botanique sauvage ») et la manière dont ces savoirs ont été utilisés pour construire des modèles – poétiques et culturels – du corps humain et de la parenté : le rôle des humeurs dans la vie des êtres humains, les modifications de l’aspect visible d’une personne, le surgissement des émotions, mais aussi les relations entre les enfants et leurs parents, entre les descendants d’un lignage et leurs ancêtres ou entre une société et le territoire qu’elle occupe. Attestés d’abord dans la poésie, de tels modèles botaniques du corps et de la parenté ont trouvé ensuite leur place en philosophie et en médecine, dans des représentations religieuses et des spéculations étymologiques, et ont même fourni le fil de récits répétés tout au long de l’Antiquité grecque et romaine.
Dialogue avec l’écrivain Wilfried N’Sondé, qui nous présentera, entre autres, son travail de terrain et ses enquêtes facilitées par la Fondation Tara Océan. Son immersion dans des problématiques contemporaines emprunte la voie d’un langage très poétique.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilfried_N%27Sond%C3%A9
Bibliographie :
Alessandro Buccheri, Penser les humains à travers les plantes, Jerôme Million, collection Horos, 2024
Catherine Rémy, Hybrides, transplanter des organes de l’animal à l’humain, CNRS, 2024.
Wilfried N’Sondé, Femme du ciel et des tempêtes, Éditions Actes Sud, 2021 ;
Wilfried N’Sondé, Héliosphéra, fille des abysses, Arles, France, Actes Sud, coll. « Mondes sauvages », 2022