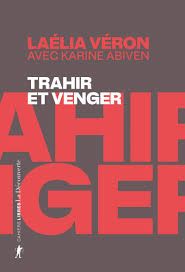
L'intime et le politique dans les récits de transfuges de classe. Avec Laélia Véron et Karine Abiven (Paris Nanterre)
L’intime et le politique dans les récits de transfuges de classe
Séance organisée par Ridha Boulaâbi & Jérémie Majorel
Mardi 1er avril 2025, 13h30-15h30, s. L419, bât. Ricœur,
Université Paris Nanterre (entrée libre)
avec Karine Abiven (Sorbonne, STIH) & Laélia Véron (Orléans, POLEN)
Dans Trahir et venger : paradoxes des récits de transfuges de classe (Paris, La Découverte, coll. « Cahiers libres », 2024), Laélia Véron et Karine Abiven croisent linguistique, stylistique et analyse du discours. Elles identifient un genre : le « récit de transfuge de classe ». Elles reviennent sur les dénominations alternatives de son protagoniste (« transclasse », « névrosé de classe » ou « migrant de classe »). Elles insistent sur l’ambiguïté axiologique de cette catégorie (stigmate et retournement du stigmate) et sur son hybridité disciplinaire (entre sociologie et littérature). Elles rassemblent un corpus français, qui inclut canon et best-sellers, écrivains, universitaires, activistes, journalistes et politiques, livres, réseaux sociaux et podcasts. Elles montrent comment des topoi prennent, circulent, varient, diffèrent d’un pôle du champ littéraire et médiatique à un autre : d’où le titre de leur essai, qui reprend des expressions – « trahir » ou « venger sa race/ sa classe » – quasi lexicalisées aujourd’hui (tout comme la « honte d’avoir eu honte »).
Le duo restitue également les polémiques ayant accompagné comme son ombre la progressive reconnaissance du récit de transfuge. Plutôt que prétendre clore les débats, il y contribue de façon inédite : en alternant d’un côté, lecture des textes, au plus près d’enjeux formels qui engagent leur sens, de l’autre, vue d’ensemble, qui envisage postures auctoriales, réception médiatique, contextes sociaux et perspectives historiques. Une telle approche rend attentif aux biais, aux impensés, aux contradictions, voire à une mythologie du récit de transfuge, avec laquelle il est peut-être temps d’établir une juste distance critique.
Dans le cadre du séminaire de l’OEC « L’intime et le politique dans la littérature contemporaine française et francophone », nous invitons les deux chercheuses à revenir plus particulièrement sur la manière dont elles transforment un slogan féministe des années 1960, the personal is political, souvent mobilisé par les récits de transfuge contemporains et par leurs exégètes, en un questionnement, « L’intime est-il (vraiment, toujours) politique ? », qui se prolonge jusque dans le dernier chapitre de leur essai : « Des récits politiques ? Pouvoir dire ‟nous” ».