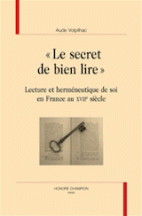
Le temps de la lecture : (se) lire au XVIIème siècle
Pourquoi lire des discours contre la lecture ?
1Nos ancêtres ne lisaient pas comme nous et nous ne partageons pas leurs conceptions de la lecture. Une telle affirmation relève assurément du truisme, mais il n’est pas mauvais de rappeler ce fait avant de plonger dans l’étude fouillée d’Aude Volpilhac1 qui, dans la continuité du livre de Laurent Thirouin, L’Aveuglement salutaire. Le réquisitoire contre le théâtre dans la France classique2, explore les discours parénétiques sur la lecture au xviie siècle. Si le terme parénétique « désigne stricto sensu un propos qui à la manière d’un sermon exhorte à la morale, un discours parénétique peut se définir de manière plus générale comme un discours “qui conseille”, “qui prescrit”, et dont l’objectif est la conduite de celui auquel il s’adresse » (p. 24). Le discours parénétique concerne donc, dans cette perspective, tout discours déclinant les moyens de bien lire et déterminant les mauvais usages de la lecture. Après le travail de L. Thirouin sur le théâtre, A. Volpilhac examine donc des modalités apparemment semblables : comment et pourquoi les augustiniens condamnent la lecture. Dans un premier temps, on peut donc se demander si une telle approche vient seulement élargir le propos de L. Thirouin : « le procès de la lecture romanesque ne serait‑il qu’une pâle copie du réquisitoire contre le théâtre ? » (p. 145). Si les arguments sont semblables, les approches des censeurs diffèrent cependant dans l’intention. D’autre part la lecture de roman n’est pas la seule convoquée dans cet essai, l’analyse de la lecture des ouvrages historiques au xviie siècle permet également de mesurer l’intérêt d’une dichotomie fondamentale entre ces deux pratiques. Car la lecture est bien au xviie siècle avant tout une pratique, circonscrite, définie, théorisée, et même fort souvent anathémisée par de nombreux penseurs, qu’ils soient érudits, philosophes ou encore rhétoriciens : « Le xviie siècle se fixe comme objet la réglementation des pratiques » (p. 652). L’objectif d’A. Volpilhac reste cependant d’étudier le discours sur la lecture, et non les pratiques de lecture elles-mêmes. Par‑là, il s’agit également de mesurer la place que l’on accorde au xviie siècle à la « responsabilité du lecteur » (p. 29) dans le processus altérant (ou altérisant, selon que la lecture soit bonne ou mauvaise) que constitue la lecture.
2L’intérêt de cet ouvrage réside également dans l’analyse du discours cartésien sur la lecture. En dehors de Descartes et de ses lecteurs, évidemment lus avec attention, deux personnages importants sont donc logiquement convoqués : Pierre Nicole pour les augustiniens, Bernard Lamy pour les cartésiens. En effet, « Nicole et Lamy ont tous deux la particularité d’être les auteurs Janus de ce corpus : certes, ils apparaissent comme de sévères contempteurs du roman mais, comme pédagogues amoureux d’humanités, ils réfléchissent aux moyens de sauver la littérature » (p. 43). Comment faire de la lecture une pratique bénéfique n’obérant pas le salut de l’Homme ? Telle est en effet la question majeure que se posent la plupart des auteurs du discours d’exhortation sur la lecture.
3Comme toujours, on peut discuter à perte de vue sur la périodisation, mais on remarquera la pertinence de celle proposée par A. Volpilhac, qui a choisi de « faire commencer cette période en 1626 avec le Tombeau des romans, attribué à Fancan, et de l’achever en 1685 avec le premier tome de la synthèse d’Adrien Baillet, Jugements des savants sur les principaux ouvrages des auteurs. Fancan, loin pourtant de s’intéresser au genre romanesque comme le suggère le titre de son œuvre, est le premier à mettre en place une réflexion approfondie sur les enjeux de la lecture des ouvrages de fiction en exposant, de manière symétrique, les arguments favorables ou hostiles à leur lecture […] L’ouvrage de Baillet, pour sa part, fait figure de conclusion » (p. 49), car il « constitue la première synthèse exhaustive moderne des vices de la lecture et des moyens de les réformer » (p. 50). L’ampleur du corpus traité est considérable. On peut s’en faire une idée en lisant ces lignes de la conclusion :
L’âge classique a vu en effet la multiplication des discours normatifs sur la lecture sous des formes extrêmement variées : manuels de civilité, romans, traités des études, manuels de dévotion, traités d’art oratoire, essais de morale, textes théoriques romanesques, ouvrages philosophiques, ouvrages polémiques, traités bibliographiques, etc. (p. 652)3
4Comment tracer un chemin au lecteur dans cet océan de textes ? A. Volpilhac relie tout d’abord ces ouvrages a priori très différents les uns des autres :
Notre corpus est pour une grande partie constitué de ce que nous pourrions appeler des « livres-outils » dont l’objectif est d’aider le lecteur à se repérer dans les méandres des bibliothèques et devant l’étal des libraires. (p. 433)
5Cette épineuse question est enfin résolue par le partage du geste critique proposé par L. Thirouin, son directeur de thèse, dans L’Aveuglement salutaire, geste consistant à épouser la logique de l’objet d’études, non afin de le défendre dans un but polémique, mais pour saisir pleinement sa logique et sa cohérence. Ainsi, évoquant l’oubli dans lequel les discours parénétiques du xviie siècle sont tombés, A. Volpilhac écrit que « les critiques adressées au discours moral du xviie siècle escamotent ses principes. Il demeure en effet entièrement fondé sur une approche religieuse, morale, spirituelle et anthropologique qui s’efforce de révéler les invariants de la nature humaine […] intenter aux dévots un procès de « non-lecture » — accusation qui invaliderait d’emblée leur démarche —, dans la mesure où de fait, ils n’ont pas lu les romans dont ils parlent, permet, certes, de dénoncer le caractère trop abstrait et souvent trop généralisant des analyses qu’ils proposent ; toutefois, cette accusation trouve sa limite dans l’approche anthropologique qui préside à la condamnation de la lecture de divertissement » (p. 164‑165). En restituant la continuité de cette pensée à l’aide d’une organisation rigoureuse voire téléologique de sa thèse, A. Volpilhac remet en lumière cette cohérence interne. L’ouvrage comporte en effet deux parties : « Des mauvais livres aux mauvais lecteurs » et « Former le jugement, construire le sujet : entre technique et éthique de la lecture ». A. Volpilhac note à ce sujet que « pour penser les conditions d’une réformation de la lecture, les auteurs du discours parénétique se fondent sur la notion d’ "usage" dont la fonction principale est d’articuler le procès des lectures mal conduites et la possibilité de leur réformation » (p. 52). À cet égard, « la notion d’usage constitue la clé de voûte de notre plan » (idem). Ce plan rend compte progressivement, patiemment, méthodiquement, en ayant constamment le soin de clarifier et de justifier sa démarche, de cette gradation du discours parénétique. A titre d’exemple, la deuxième partie nous fait passer du « Mal lire. Bien lire : la notion d’usage » (chapitre IV) à « Incorporer les nourritures spirituelles. Ambitions et limites du discours sur la lecture » (chapitre VII) en passant par « De la “capacité” à la “disposition” du lecteur : la querelle religieuse sur la lecture de la Bible » (chapitre V) et « Guider le lecteur » (chapitre VI). Une telle structure fait se répondre les arguments et les idées tout en tissant finement le fil de la pensée du discours parénétique : les typologies du « bien lire » et du « mal lire » invitent en effet à faire retour sur soi pour éviter l’écueil de la mauvaise lecture. De plus, « la question de la compétence demeure, à cette période, subordonnée à celle des dispositions morales du lecteur » (p. 655). Pour « bien lire », il faut donc questionner la capacité et la disposition du lecteur et, pour cela, le guider. Par ailleurs, une prudence critique accrue nous rappelle que l’unanimité des discours sur la lecture demeure un vœu pieux. Les jésuites notamment, ne conçoivent pas la lecture de la même manière que les augustiniens : « pour les premiers, le secret de bien lire repose sur la maîtrise des arcanes de l’œuvre d’art ; pour les seconds, il relève de la découverte de la « clé » de sa bibliothèque intérieure, dont le « chiffre » est l’anthropologie augustinienne. Pour les augustiniens, le moi se trouve donc au centre de la lecture : d’abord comme obstacle à la bonne manière de lire […] puis comme ce qu’il faut réduire au silence pour profiter des livres, enfin comme ce qu’il faut retrouver au terme d’un parcours spirituel (le moi misérable) mais pour mieux l’anéantir dans un mouvement ultime » (p. 656-657). Reste cependant que « quelle que soit l’approche choisie, l’on assiste au xviie siècle à la généralisation et à la promotion d’un paradigme particulier de lecture : le modèle méditatif » (p. 657)4. Ce modèle justifie le sous-titre de l’ouvrage et l’étroite ligature opérée entre l’herméneutique de soi et le discours prescriptif sur la lecture5.
6A. Volpilhac dévoile par ailleurs les arcanes du discours parénétique par le biais d’une archéologie du discours qui n’est pas sans rappeler la méthode foucaldienne6. En développant une riche étude lexicologique conjointement à une approche s’appuyant également sur des considérations stylistiques (invariants rhétoriques du discours parénétique), sociologiques (le champ littéraire de la lecture, sa signification politique), historiographiques (constitution de la réception de la lecture), anthropologiques et théologiques (anthropologie augustinienne donc, ou encore anthropologie cartésienne) ou relevant de l’histoire culturelle (statut du livre et de la lecture dans l’imaginaire culturel du temps), A. Volpilhac nous replace au cœur du vaste champ de force suscité par la problématique de la lecture au xviie siècle, qui témoigne avec force des ambiguïtés et des contradictions de cette époque.
Lire ou ne pas lire ?
7Dans 20 bonnes raisons d’arrêter de lire, Pierre Ménard rassemble humoristiquement les pièces d’un procès de la lecture. On apprend ainsi, entre autre, que « Lire est dangereux », ou que « Lire rend fou », voire que « Lire tue7 ». Les augustiniens en particulier, et plus généralement les auteurs du discours parénétique du xviie siècle croient en revanche sérieusement en ces arguments. Pierre Ménard reprend d’ailleurs certaines de leurs thèses dans un but parodique évident. Faut-il lire ou non ? Certains livres sont-ils moins nocifs que d’autres ? Qu’est-ce que mal lire et bien lire ? Selon A. Volpilhac, il est certain que « la lecture fait l’objet, au xviie siècle, d’un véritable désenchantement » (p. 309). Lire comporte un grand danger : s’éloigner de soi-même, c'est-à-dire de sa nature avant tout spirituelle, s’égarer à jamais dans les livres, dans la « libido legendi » (p. 125), assimilée à une pratique de curiosité néfaste au salut de l’Homme : « La lecture naît et se nourrit de la curiosité. La critique des méfaits de la “libido legendi” dépasse dont les catégories génériques, et vise indifféremment tous les types de livres » (p. 129). De fait, la libido legendi réunit en elle les trois « grandes » libido augustiniennes : libido sentiendi, libido sciendi et libido dominandi. Pascal Quignard va dans ce sens quand il écrit que « les craintes et les accusations des théologiens classiques ne sont […] pas si niaises, ni si bornées, ni si partiales qu’on les répute. Elles sont le fait de lecteurs qui sont remarquablement sensibles à la lecture. Les beaux récits sont plus irréligieux qu’on le suggère : loin de former le vœu de réparer jamais, ils flattent, excitent, alimentent autant qu’ils font semblant de remontrer ou de soustraire. Ils n’ont aucune honte […] ils défient la culpabilité dans la culpabilité8 ». Le xviiesiècle marque donc une « crise de la lecture au moment même où le livre amorce son règne “triomphant” » (p. 655). Un déplacement commence d’autre part à s’opérer, du mauvais livre au mauvais lecteur, qui devient responsable de son propre engagement dans la lecture : « Le xviie siècle marque ainsi un véritable tournant herméneutique : il ménage le passage d’une critique du livre à une critique du lecteur » (p. 100). Les figures du mauvais lecteur recouvrent aussi bien le pédant que Don Quichotte, le protestant (jugé hérétique car il dévoie les textes sacrés) et l’esprit fort9. De plus, « la rareté des bons lecteurs » (p. 43) est systématiquement mise en avant. En effet, si lire est une activité dangereuse, c’est aussi parce qu’elle fait intervenir l’inconscient du lecteur, travaillé et déterminé sans le savoir par les effets de réception de sa lecture. Car la lecture « est bien ce “je ne sais quoi” que tentent d’appréhender les prescripteurs tout en ayant conscience de la gageure qui consiste à vouloir saisir un objet aussi évanescent et fuyant » (p. 44)10. Le lire est bien un mystère, un secret quasiment occulte, qui peut, en particulier pour ce qui concerne le roman (en raison de son processus d’illusion référentielle)11 « modifier le paysage mental et les actes du lecteur parce qu’il agit directement sur son imagination » (p. 223).
8Il convient donc de se méfier de la lecture et de ses séduisants appâts extérieurs. Le bon usage des livres permet, selon les prescripteurs, de revenir à l’essentiel : la connaissance de soi, qui seule permet au lecteur de quitter le livre pour se lire soi-même selon un point de vue moral et religieux. Deux méthodes semblent se dégager : celle des jésuites, résultant d’un « travail sur le texte » (p. 426) et celle des augustiniens, relevant d’un « travail sur soi » (idem)12. On comprend donc que ces deux optiques majeures resituent la lecture au sein d’un discours ambigu : la lecture semble condamnable en elle-même, mais parce qu’elle peut contribuer à forger la conscience et la lucidité du moi, elle est réinvestie par les prescripteurs, qui y voient un moyen de former, voire de transformer l’être, de le convertir, c'est-à-dire de le faire retourner à la vérité. D’autre part, Descartes propose un rapport à la lecture singulier, qui offre la possibilité de mieux saisir, non seulement la pensée du philosophe, mais aussi le passage du modèle de la lecture érudite à un nouveau type de lecture.
Former ou transformer ? La « culture de l’impression »
Pour les uns, la lecture, parce qu’elle engage intensément le sujet, ne peut que contribuer à l’enrichir ou l’appauvrir en profondeur : bien menée, elle fait advenir l’âme à elle-même ; mal conduite, elle la décentre et lui fait perdre son assise. Pour les autres, la lecture est avant tout pensée comme un moyen permettant de se cultiver et, à ce titre, elle ne peut en aucun cas porter atteinte à l’intégrité du sujet ; par conséquent, une telle approche rend possible une lecture de divertissement, où jouir du texte ne peut pas entamer l’identité du lecteur. Dans les deux cas, la lecture est envisagée comme processus d’individualisation, mais dans le premier, la lecture transforme l’individu, dans le second, elle le forme. (p. 38‑39)
9Concernant l’individualisation par la lecture, peut-on parler de théories des genres dans l’acte de lire ? Il semble bien que oui : « les acteurs du réquisitoire anti-romanesque mettent en lumière les effets pervers propres à chaque genre : lire assidûment plusieurs ouvrages appartenant à un même genre entraînerait des habitudes de lecture spécifiques qui informeraient les schémas mentaux puis le comportement du lecteur » (p. 157). Ainsi, l’instance générique de lecture détermine la « manière de lire » (ibid) et provoque potentiellement le détachement du réel et la folie. Descartes ouvre quant à lui une troisième voie possible. A. Volpilhac consacre des pages très pénétrantes à Descartes :
Les premières pages du Discours de la méthode imposent donc comme réquisit à toute recherche de la vérité cette étape indispensable de désenchantement du monde des livres, moment de déconstruction nécessaire à la refondation de la méthode. Relégué au rang de simple instrument de travail, le livre perd définitivement sa valeur religieuse et l’aura majestueuse que lui avaient conférées les humanistes et, comble de l’ironie, se trouve supplanté — et non plus parachevé, comme il était d’usage à la Renaissance — par un autre livre, « le livre du monde ». (p. 263‑264)
10La nécéssité du voyage comme moyen optimal de connaissance de soi ordonnerait donc chez Descartes un détachement du monde des livres, désormais subordonné, comme chez Montaigne, à « la mise à l’essai de soi et du monde » (p. 265). Chez Descartes, « la lecture n’opère plus comme une invitation au voyage et à l’ouverture d’esprit, mais s’avère une véritable aliénation » (idem). La solitude est alors « le seul véritable lieu de la méditation et de l’essai de soi, pratiquée “loin du monde et loin du bruit” » (ibid). En situant Descartes comme point de rupture majeur dans l’épistémologie du geste de lecture, A. Volpilhac nous rend sensible le passage d’une lecture savante, humaniste, à une herméneutique du sujet. D’autre part, situer Descartes dans la mouvance du « discours de la retraite » au xviie siècle13 permet d’ancrer la pensée de la lecture parmi les questions lancinantes posées par l’époque : le désir ambigu de la solitude témoigne en effet d’un rapport au monde social et au moi problématique, dans la mesure où le lecteur de soi-même est écartelé entre l’éthique de la sociabilité et le refus des vaines apparences mondaines. Replacer Descartes et sa conception de la lecture dans ce contexte pourrait permettre de questionner de manière féconde le rôle de sa pensée dans le processus du « discours de la retraite ». De plus, A. Volpilhac explore, à travers le travail de Baillet sur Descartes, la mythographie de ce dernier comme lecteur ineffable :
Ses capacités extraordinaires de lecteur, d’ordre quasi surnaturel, en font, sous la plume de Baillet, le précurseur mythique d’un régime nouveau de lecture qui semble dépasser, sous l’égide de la raison et du jugement, les principes de l’humanisme dans une forme inédite de lecture autarcique. (p. 369)
11Le mythe de Descartes lecteur informe donc aussi le passage de témoin évoqué, et offre une possibilité d’interprétation du « bon usage » de la lecture comme source de l’avènement de la « Raison » au xviiie siècle. Le temps de la lecture, qui ne perd pas pour autant sa dimension d’exercice spirituel, s’en trouve aussi modifié : « le discours prescriptif a en effet toujours pour horizon les limites de la lecture, c'est-à-dire à la fois sa fin et ses insuffisances » (p. 658). Existe-t-il donc réellement deux tendances, l’une considérant que la lecture « affecte superficiellement » (p. 659) le lecteur, l’autre jugeant au contraire qu’elle le transforme en profondeur ? Quoi qu’il en soit, l’une des plus belles intuitions de cet ouvrage reste à notre sens la suivante :
Aussi, nous semble-t-il, pourrait-il être plus juste de parler, au lieu d’une culture de l’imprimé, d’une culture de l’impression, c'est-à-dire d’un moment de la pensée du texte qui fait la part belle aux effets du texte sur le lecteur, qui pense le texte en termes d’impression sur son cerveau, son imagination ou son jugement. La métaphore de l’impression, on l’a vu, est renouvelée par l’imaginaire nouveau de l’imprimerie et constitue, à nos yeux, une image plus exacte de la culture du xviie siècle dans la mesure où elle déplace le centre de gravité de cette période du texte vers l’effet du texte. (p. 311)
12À cet égard, « ces analyses, ces débats, ces querelles, ces convictions ne peuvent que résonner aujourd’hui fortement aux oreilles de ceux qui sont mêlés de près ou de loin à la question de l’enseignement de la littérature » (p. 659). On a en effet beaucoup tempêté au xxe siècle contre les lectures « impressionnistes », mais ne serait-il pas possible d’envisager, voire de poursuivre une réflexion pédagogique autour de cette question de la « culture de l’impression » ? On le voit, l’enjeu de cette thèse dépasse le cadre des études dix-septièmistes, ce dont l’on ne peut qu’être heureux.
(Re)lire le xviie siècle
13Toutes ces réflexions offrent quoi qu’il en soit la possibilité passionnante de (re)lire le xviie siècle sous l’angle de la lecture. Si « au fur et à mesure que le siècle avance, le roman menace de pénétrer dans l’espace sacré de la bibliothèque savante » (p. 103), il convient alors de distinguer « la réception passionnelle et collective du spectacle théâtral et […] la lecture solitaire et studieuse du texte » (idem). Si ces deux « paradigmes antithétiques » (ibid) coexistent au xviie siècle, c’est notamment en raison de l’appréhension du sacré, qui commence à se retirer du monde. On retrouve ici la question de la solitude et de la collectivité, qui oriente le siècle non pas d’une manière propédeutique, mais qui confirme bien plutôt que « le xviie siècle constitue un laboratoire de la réflexion sur les effets de la littérature » (p. 153). Effets de solitude ou effets de publics, la lecture permet donc bien d’appréhender les tendances anthropologiques et culturelles fondamentales du siècle, qui constitue aussi à plus d’un titre une passerelle entre plusieurs époques :
Véritable creuset de la tradition médicale humorale des maladies de l’âme élaborée dans l’Antiquité, de l’imaginaire philosophique et religieux des maladies contagieuses et des représentations romanesques plus récentes cristallisées autour du personnage de Don Quichotte, notre corpus propose une vaste synthèse de tous ces héritages, dont l’originalité est d’osciller entre le langage métaphorique dont elle hérite et qu’elle contribue à fixer et le discours préscientifique dont elle forme les prémices. (p. 160)
14A. Volpilhac nous propose donc un nouveau xviie siècle, dépouillé de certaines représentations archétypiques :
Au terme de cette étude s’éclaire de manière inattendue la face cachée de la période étudiée. Car c’est bien xviie siècle paradoxal, éloigné de la représentation habituelle que nous en avons, que dévoile ce corpus : celui que l’on désignera solennellement comme le Grand Siècle, celui qui sera rétrospectivement consacré, au xviiie siècle et au xixe siècles, comme le « siècle des classiques », demeure non seulement circonspect à l’égard des livres mais encore hanté par la crainte des dangers de la lecture. (p. 651)
15Le positionnement de la problématique de la lecture dans le cadre de la Querelle des Anciens et des Modernes pourrait également ouvrir de nouvelles approches quant aux questions d’héritage et de filiations14. De même, l’idée de « culture de l’impression » pourrait offrir une solution de retour sur la déclamation, voire même une certaine définition de cette pratique. En effet, la « culture de l’impression » est « plus à même, nous semble-t-il, de dépasser le dualisme de l’oral et de l’écrit mais aussi de mettre en évidence ce moment historique de l’imaginaire du texte élaboré en termes de communication orale » (p. 652). On pourrait citer d’autres pistes de travail ouvertes par cette étude, mais contentons-nous de noter que si la critique littéraire constitue avant tout une activité cherchant à marquer des articulations au cœur de différents champs de savoir, cet ouvrage en est un excellent exemple.
16Quel est donc ce « secret de bien lire » ? Aux dires d’A. Volpilhac, tous les prescripteurs reconnaissent l’« absence de “méthode universelle” » (p. 47). Le bien lire ne serait-il donc qu’un idéal, et sommes-nous condamnés à mal lire ? Sans doute — et heureusement — n’en est-il rien, car « le secret de bien lire peut être formulé de la façon suivante : pour bien lire un ouvrage, il faut d’abord vouloir en faire un bon usage ; pour en faire un bon usage, il faut s’y préparer ; pour s’y préparer, il faut se connaître soi-même, et apprendre à reconnaître ses limites, à prendre conscience de ses défauts, de ses préjugés et de ses mauvaises habitudes de lecture. Dès lors, le lecteur sera capable de lire les livres qui lui conviennent le mieux. Pour être réussie, la lecture doit être un rapport harmonieux et proportionné entre le livre et son lecteur : tel est bien l’idéal postulé par le discours normatif » (p. 656). Lire est bien un chemin de vie dont la clé ne réside pas dans une « méthode universelle », mais en nous-mêmes : « le secret de bien lire réside donc dans la nécessaire articulation de la connaissance de soi-même et de celle de l’œuvre » (idem). Cet idéal n’est évidemment pas partagé par tous les prescripteurs, puisque « toutefois, l’on peut déceler, au cours de notre période, deux orientations générales : tandis que les uns mettent l’accent sur la connaissance de l’œuvre, les autres privilégient la connaissance de soi comme étape préalable ou contemporaine de la lecture » (ibidem). Avec générosité, A. Volpilhac nous offre ici une synthèse de ces deux conceptions, pour que nous puissions les faire résonner en nous et réformer nos habitudes de lecture dans l’optique d’une éventuelle herméneutique de soi. À cet égard, la première de couverture, provenant d’un cliché de l’auteur, est révélatrice : ce montage représente une clé déposée sur la liasse « Vanité de l’homme » des Pensées de Pascal. On peut y voir l’indice synecdochique, au seuil du livre, de l’importance de Port-Royal dans la pensée sur la lecture, voire même une clé personnelle de l’auteur : Pascal comme guide dans le parcours d’herméneutique de soi que constitue la lecture. On peut aussi y voir la volonté de décrypter la vanité de la lecture, voire la vanité du discours parénétique sur la vanité de la lecture. Mais en dernière instance, ne s’agit-il pas tout compte fait de mettre en avant la vanité des clés de lecture, quand la seule clé de lecture est contenue dans la serrure de notre propre vanité ? Cette courte rêverie doit cependant être nuancée. Parlant du « tournant herméneutique » (p. 653) que constitue le xviie siècle, A. Volpilhac explique qu’il fait basculer « de proche en proche du secret des livres au secret de leur lecture. La “clé” désigne de moins en moins le ressort caché de l’œuvre qui, une fois découvert, la dévoilerait pleinement, mais rend compte de son usage par le lecteur » (idem). A nous donc de trouver la clé, l’articulation du savoir du texte et de la résonnance profonde qu’il trouvera en nous :
La littérature restera lettre morte si nous oublions qu’elle a quelque chose à nous dire sur nous‑mêmes et que, pour l’entendre, il nous faut faire l’effort de se mettre à son écoute. (p. 660)
17Nous fermerons provisoirement cet ouvrage en citant cette belle définition de la lecture même, qui n’est pas, croyons-nous, sans rappeler le parcours intime proposé à son lecteur par Pierre Reverdy au xxe siècle15, signe de l’authentique résonnance contemporaine de cette étude : « fermer un livre avec succès suppose d’en avoir retenu l’essentiel, d’en avoir assimilé les leçons et de s’être approprié les vérités qu’il contient au point peut-être de le rendre inutile » (p. 513).

