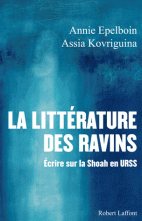
L’autre mémoire de la Shoah : témoigner en URSS
Ravin aux bords tordus, tu es la déchirure d’une plaie immense,
Tu es désert, sauvage, et seuls les vents grondent sur ta tête.
Tu noircis comme un gouffre quand, défonçant les ténèbres,
Les feux de la ville t’entourent comme un fauve qu’on capture.
[…]
Les sans-noms dorment dans tes tréfonds sombres comme l’iode.
Iouri Kaplan, « Babi Yar », 1959
1Les réflexions sur la littérature de la Shoah1 se sont multipliées suite aux premières parutions d’après-guerre, mais davantage encore depuis les années 1980 et surtout 1990, à mesure que l’événement s’éloignait dans le temps et permettait une saisie plus large des témoignages écrits pendant la guerre et dans le temps différé des survivants. Aussi précieuses qu’elles soient, ces investigations ont contribué malgré elles à restreindre la « bibliothèque de la Catastrophe juive2 » à la Shoah vue de l’Ouest, c’est-à-dire à l’extermination planifiée et mise en œuvre dans les camps. Les témoignages étudiés par les chercheurs restent encore largement ceux des survivants revenus des camps, et c’est à partir de ces textes que le paradigme du revenant rescapé des camps a été forgé. Les « œuvres-témoignages », pour reprendre l’expression de Claude Mouchard3, ont d’abord été perçues comme représentatives d’une certaine « littérature concentrationnaire » (ou « des camps ») dont Primo Levi et, dans une moindre mesure, David Rousset et Robert Antelme ont été malgré eux en France les initiateurs. Or, l’extermination des Juifs d’Europe s’est déployée aussi bien dans les camps que dans les ghettos à l’Est, mais aussi au bord des ravins, dans les territoires de l’ex-URSS. Ce qu’on nomme aujourd’hui la Shoah par balles, selon l’expression de Patrick Desbois, est une modalité de l’extermination aujourd’hui bien étudiée par les historiens, sans encore avoir véritablement suscité de la part des chercheurs un examen approfondi de sa littérature testimoniale.
2La Littérature des ravins. Écrire sur la Shoah en URSS d’Annie Épelboin et d’Assia Kovriguina prend cette lacune critique et méthodologique comme point de départ et initie, l’espère‑t‑on, un mouvement qui devra dorénavant inclure la littérature témoignant de la Shoah par balles. La réflexion décentrée que les deux auteurs proposent vient en effet compléter une face restée méconnue, et même occultée, de l’histoire de la Shoah : la mémoire littéraire de la Shoah en URSS. Les Juifs, mais aussi les partisans, prisonniers politiques, Tsiganes et malades mentaux disparaîtront durant la guerre dans les ravins, fusillés par milliers des journées entières sous les yeux des habitants épargnés. Certains d’entre eux mourront d’épuisement dans les camps de travail, ou encore de faim et des conditions de vie effroyables dans les nombreux ghettos créés par les nazis. Par son titre, La Littérature des ravins resserre son investigation sur les témoignages, essentiellement littéraires et poétiques, écrits au sujet des meurtres de masse commis dans les ravins. L’expression du titre, très éloquente, est d’A. Kovriguina, qui poursuit actuellement une thèse sur le sujet. Le titre désigne également cette part de l’Europe où les nazis ont procédé à l’anéantissement sur place, sans recourir à la déportation, devant d’innombrables témoins. Aussi l’expression englobe-t-elle les fossés creusés dans les forêts, les églises où l’on enfermait les victimes pour les brûler ainsi que les premiers camions de gazage. Il s’agit des territoires occupés et gouvernés pendant près de deux ans (1941 à 1943) par les nazis et qui se situent moins dans la Russie actuelle qu’en Ukraine, Moldavie, Biélorussie et Pays baltes. Si l’expression « littérature des ravins » ne peut manquer de qualifier les textes sous l’angle thématique, comme ce fut aussi le cas pour la littérature des camps et la poésie des ghettos, elle tire sa pertinence non seulement de l’histoire qu’elle relate (l’extermination sur place des victimes juives), mais aussi d’un large corpus qui distingue une autre figure du témoin que celle du survivant revenant de très loin. La mémoire littéraire de la Shoah en URSS fut en effet principalement écrite par ceux qui ne furent pas directement victimes de l’extermination, tout en étant ses témoins ou héritiers directs. Le mérite de l’ouvrage d’A. Épelboin et A. Kovriguina est ainsi d’élargir la réflexion sur la littérature dite de témoignage à d’autres modalités d’énonciation et aux poétiques trop peu analysées jusque-là du témoin oculaire, bystander et même du non-témoin.
La mémoire enfouie de la Shoah : des histoires plurielles, des mémoires en concurrence
3L’extermination des Juifs par les nazis, en se déroulant sous les yeux des populations soviétiques ou qui vont devenir soviétiques pendant la guerre, et parfois avec leur aide, notamment en Ukraine s’est soldée par un effacement complet de la mémoire de la Shoah en URSS. La première partie de l’ouvrage, intitulée « Le façonnement de la mémoire », replace les questions mémorielles dans le contexte historique de l’URSS et dans l’intrication des événements traumatiques qui se sont superposés sur ces territoires. Si l’on pouvait craindre que le choix d’une structure de l’ouvrage en deux parties, l’une davantage historique et contextualisante, l’autre littéraire, attachée à l’examen critique des textes en prose et en poésie, conduisît à des répétitions, l’écueil est pour une large part surmonté. Et le choix de cette réflexion bipartite se justifie au fond pleinement si l’on songe combien la littérature soviétique a eu partie liée avec l’État dès la première partie du xxe siècle avec la création de la fameuse Union des écrivains soviétiques en 1932 et de l’Institut littéraire, véritable moule de formation des futurs écrivains. La littérature, y compris celle portant sur un « interdit de mémoire » (p. 147) est pénétrée par les canons en vigueur, s’en nourrit, s’y soumet ou plus exactement arrive difficilement à s’y soustraire. On ne peut en saisir les implications qu’en considérant le rôle véritablement auctorial de la censure. Il faut aussi prendre en compte l’enchevêtrement des événements traumatiques eux aussi occultés et la mise en place de mythes (celui de la « Grande Guerre Patriotique4 ») à partir desquels a été forgée une histoire officielle qui a camouflé toutes les autres et produit une « fiction a-historique qui désinscrivait l’expérience du cadre du réel et de la mémoire individuelle » (p. 63). Il faut donc lire les témoignages que présentent et commentent A. Épelboin et A. Kovriguina en ayant tout d’abord à l’esprit cette constante articulation de la littérature et du politique dans le contexte soviétique.
4Pour comprendre l’occultation de la mémoire de la Shoah en URSS, il faut donc aussi en revenir à l’intrication serrée des histoires et mémoires tragiques qui se sont succédé dans les « terres de sang5 » de l’ex-URSS ainsi qu’à l’implication soviétique dans les combats. Si la mémoire de la Shoah a été et reste encore occultée, c’est d’abord en raison de mémoires concurrentes qui sont venues s’y greffer : l’histoire des combats et des désastres de la guerre elle-même, celle, refoulée, de la Terreur et des déportations dans les camps du Goulag, le souvenir de la collectivisation forcée et de la Grande Famine de 1932-1933. La mémoire de la Terreur et du Goulag a contribué, dès lors qu’elle a pu s’exprimer durant les années du Dégel, à recentrer l’histoire de l’URSS sur la tragédie concentrationnaire et sur une littérature elle-même concentrationnaire, comparable sur certains points à la littérature relatant les camps nazis. La Grande Famine liée à la collectivisation a, quant à elle, camouflé plus dramatiquement la mémoire de la Shoah dans la mesure où elle s’est déroulée sur les mêmes terres que la Shoah par balles. Le mythe de la « Grande Guerre patriotique », « véritable épopée nationale » (p. 62), avait cherché à exalter la cohésion du peuple soviétique et son héroïsme en gommant les conflits interethniques et la spécificité du génocide des Juifs. Or celui-ci avait pu être réalisé grâce au succès de la propagande nazie auprès des populations soviétiques, notamment ukrainiennes, appelées à lutter contre le « judéo-bolchévisme ». L’hostilité au régime soviétique occasionnée par la collectivisation avait permis de donner plus de poids aux discours antisémites des nazis, qui assimilaient antisoviétisme et antisémitisme.
5À partir de 1948, les Juifs sont désignés comme « sans patrie » et à ce titre nouveaux ennemis du peuple soviétique, et Staline s’emploiera à les persécuter en raison de leur supposé « cosmopolitisme ». On connaît le sinistre « complot des blouses blanches » ; il faut y ajouter l’interdiction du Livre noir codirigé par Ilya Ehrenbourg et Vassili Grossman, aidés de nombreux écrivains, ainsi que la « Nuit des poètes assassinés », le 12 août 1952, qui voit la dissolution du Comité antifasciste juif et le meurtre de grandes figures de la littérature yiddish (parmi elles Peretz Markish et David Bergelson) après celui du célèbre acteur et metteur en scène Mikhoels. Après les grands massacres commis par les nazis, la destruction du peuple juif et de sa culture se poursuit donc sous Staline, aboutissant, selon A. Épelboin et A. Kovriguina, à l’effacement de l’histoire de la Shoah.
Écrire contre & avec la censure
6La première partie de leur ouvrage fait saisir au lecteur occidental combien la censure contraignait et même informait la teneur de la littérature, y compris la « littérature des ravins ». Le commentateur est ainsi aux prises avec des textes au statut inédit puisque la censure et sa forme la plus aboutie, l’autocensure, exercent une autorité quasi auctoriale sur les témoignages. Le cas de Babi Yar, « roman-document6 » d’Anatoli Kouznetsov, est caractéristique d’un témoignage remodelé par la censure au point que son auteur ait choisir de fuir l’URSS en 1969 afin de sauver son livre en l’éditant à l’étranger, comme il le relate dans son avis aux lecteurs. Témoignage des massacres de Babi Yar (« le ravin des bonnes femmes » en russe) à Kiev, le texte édité fait en réalité apparaître trois couches de textes : la première en caractères ordinaires est la version censurée parue en 1966 dans la revue Iounost, la deuxième en italiques rétablit les mots et parties du texte que la censure avait gommés, et la troisième entre crochets est constituée des ajouts de l’édition du texte complet en 1970 à Londres. Le roman-document de Kouznetsov est donc autant un témoignage essentiel sur les massacres de Babi Yar, et plus largement sur les tueries commises par les Einsatzgruppen, qu’un témoignage en acte sur les pouvoirs et les visées idéologiques de la censure. Son statut générique trouble, entre fiction et témoignage brut, accueillant également en son sein le récit d’une rescapée réelle (Dina Mironovna Pronitcheva), a renforcé aux yeux du pouvoir sa portée subversive. Jouer avec les genres était une manière de réfléchir une catastrophe inouïe qui nécessitait une autre esthétique, née du chaos ; entremêler les genres était également une façon d’adjoindre les commentaires personnels de l’auteur aux paroles crues des personnages et aux souvenirs personnels tirés du journal de l’adolescent. L’entrelacement des discours laissait entendre les raisons qui avaient amené certains à collaborer avec les nazis et à persécuter les Juifs. Ces raisons écornaient sévèrement l’image du peuple soviétique soudé contre « l’ennemi fasciste », pour reprendre la phraséologie soviétique.
7L’histoire du manuscrit de Kouznetsov épouse une autre histoire qui révèle d’autant mieux l’articulation entre la littérature, la mémorialisation de l’histoire et le politique. Dans les décennies qui vont de la mort de Staline (en 1953) à la chute du régime, seule la période du Dégel favorisera l’émergence d’une mémoire authentique, rendant compte de vécus singuliers. Cette mémoire non travestie aurait pu être occasionnée par l’apparition de lieux de mémoire véritablement recontextualisés, non pas simplement adressées aux « citoyens civils soviétiques ». Mais, de même que le livre de Kouznetsov, le « ravin des bonnes femmes » a connu une histoire tragique. Révélée par la treizième symphonie de Chostakovitch, qui reprenait le poème d’Evgueni Evtouchenko, l’histoire du lieu Babi Yar, où fut perpétré le plus grand massacre de victimes juives les 29 et 30 septembre 1941, est révélatrice de la volonté des autorités d’effacer la mémoire du génocide même puisque le lieu a finalement été aménagé en parc de loisirs. Des stèles commémoratives, peu éclairantes sur la spécificité du génocide, ont été peu à peu disséminées dans le parc : « tout est égal, dans cet éparpillement des signes, où manque terriblement l’Histoire. » (p. 263) Comme le constate le poète Ritali Zaslavski, « [...] l’absence de monument / est sans doute un monument à quelque chose ». Dans la mesure où elle « récapitule l’expérience du découvreur de traces » (p. 212), la « littérature de ravins » est alors, selon les deux auteurs de l’ouvrage, l’espace d’inscription du lieu de la catastrophe, le ravin, et plus encore dans le cas de la poésie des héritiers :
La poésie des héritiers s’ancre dans la matérialité des lieux, elle est née du silence éloquent des ravins. Ceux qui ont grandi dans l’ignorance complète auscultent ces lieux-témoins, et ils les font parler. (p. 257)
Contrefaire le canon officiel
8Face à la concurrence d’autres mémoires et au mécanisme de la censure, face aussi à l’inflation de l’histoire officielle, véritable « mémoire de substitution », on comprend mieux qu’une « ère des témoins7 » telle qu’elle a pu se dessiner à partir de 1961 en Occident n’ait pas pu apparaître à l’Est. Le canon officiel du réalisme socialiste, caractérisé par sa fausse transparence et son optimisme, obligeait d’aller contre la volonté d’authenticité qui caractérise le témoignage. A. Épelboin et A. Kovriguina font ainsi état d’un écrivain apparemment extérieur au sujet, du moins peu concerné par la Shoah par balles dans la mesure où il était hongrois et avait été déporté à Auschwitz puis à Buchenwald : Imre Kertész. Il a pourtant mimé dans ses œuvres, en particulier dans Le Refus et dans Être sans destin, le canon réaliste socialiste qui avait été également imposé aux pays d’Europe de l’Est sous obédience soviétique. Son œuvre doit être lue selon une temporalité double, celle de la déportation pendant la guerre et celle de l’après, dans la Hongrie de Kádár.La situation de l’écrivain, à la périphérie de la censure soviétique8, lui laissait cette marge de manœuvre dont ne bénéficiaient pas les écrivains soviétiques : pour certains, dont Vassili Grossman, l’équilibre entre le style personnel et l’influence du canon réaliste socialiste était plus délicat. Or, ce canon devenu incontournable après la guerre réduisit considérablement la possibilité de témoigner d’une catastrophe qui, précisément, met en cause l’optimisme. La sidération produite par la découverte des ravins remplis de cadavres, parmi lesquels se trouvaient souvent les proches — les correspondants de guerre étaient d’abord dépêchés sur leur lieu natal —, déterminait un style soit volontairement neutre jusqu’à la sécheresse, soit heurté. Chez certains, il était maladroit, hésitant entre la déploration grandiloquente et la fidélité aux canons esthétiques de l’époque. L’ouvrage d’A. Épelboin et A. Kovriguina, lorsqu’il s’attache dans la seconde partie à analyser les « œuvres-témoignages », n’élude pas l’aspect contraint et parfois gauche de l’expression poétique chez certains témoins. Son ambition n’est pas d’attester de la nécessaire beauté de ces témoignages : après avoir déplié les logiques qui ont conduit à l’occultation de la mémoire littéraire de la Shoah en URSS, le livre conduit à s’interroger sur les poétiques qui peuvent naître d’une telle sidération, rendue d’autant plus forte chez les témoins par la proximité des massacres.
D’où & de quoi témoigner ?
9Précieuse par les textes, en particulier les poèmes qui ont été traduits le plus souvent pour la première fois par A. Epelboin, et que découvre le lecteur français non russophone, la seconde partie de l’ouvrage livre ainsi une analyse des poétiques de ces écrivains du présent de la Catastrophe et de l’après, qu’ils aient tardé à livrer leur expérience de l’anéantissement ou qu’ils soient des « enfants de Babi Yar », héritiers de parents et de grands-parents dont ils ne font qu’imaginer la trace dans les fosses. Ces écrivains des ravins sont regroupés selon qu’ils ont été témoins oculaires ou distants des événements, correspondants de guerre venant témoigner d’un après immédiat de la destruction, « restaurateurs de mémoire » (p. 241) lorsque l’exigence testimoniale vient, au cours des années 1960, se couler dans une prose déjouant la vérité officielle, ou encore héritiers de ce traumatisme (la « génération 1.5 » selon Susan Suleiman9, comme le rappellent les auteurs). À quelques rares exceptions (Ilya Ehrenbourg, Evgueni Evtouchenko, Vassili Grossman, Anatoli Kouznetsov, Andreï Platonov), les témoins révélés et considérés dans ce livre sont inconnus du public français : les poètes Lev Rojetskine, Alla Aizenscharf, Roman Levine, jeunes « rescapés » au destin littéraire brisé ou retardé, les poétesses Olga Ansteï et Ludmila Titova, témoins des massacres, la diariste Macha Rolnikaïté (la seule à avoir connu un succès fulgurant à la parution de son témoignage Je dois raconter10 en 1965), le poète Pavel Antokolski, également correspondant de guerre comme Ilya Selvinski, Lev Ozerov et Boris Sloutski, très frappé par l’ampleur du génocide et l’anéantissement de la culture yiddish11. On rencontre aussi dans ce livre les correspondants de guerre Vassili Grossman et Ilya Ehrenbourg (davantage connu pour Le Livre noir que pour ses poèmes marqués par le souvenir de ses vacances d’enfant à Kiev) ainsi que des écrivains bouleversés par la Catastrophe comme Andreï Platonov, le « Kafka russe », Valentin Kataïev, Anatoli Rybakov12 et le poète ouzbek Gafour Gouliam. Est aussi mentionnée la contribution d’Alexandre Galitch, « restaurateur de mémoire » qui trouva dans la chanson poétique ce que le théâtre lui interdisait, une parole pouvant habilement contourner la censure et qui le plaça du côté des dissidents. Enfin, la génération des héritiers d’une catastrophe à laquelle ils n’ont eux-mêmes pas assisté compte des poètes comme Naoum Korjavine, Ritali Zaslavski et Iouri Kaplan : leurs œuvres poétiques sont, comme celles des héritiers à l’Ouest, construites autour du vide de la mémoire, mais elles révèlent également de la part de leurs auteurs, « enfant[s] venu[s] du ravin » selon la bouleversante expression du deuxième, une forte conscience éthique, forgée par l’indignation devant le mensonge officiel.
L’espace du poème comme horizon du « je » testimonial
10Ce parcours dans la « littérature des ravins » est, on le voit, dominé par la forme poétique. En ce sens, il réinterroge de deux manières les critères occidentaux attribués à la littérature de témoignage relative à la Shoah. La littérature des camps s’est nourrie des nombreuses œuvres-témoignages des déportés juifs et politiques et a inscrit Auschwitz comme paradigme global de l’extermination. Le modèle du camp tenait lieu de représentation de l’Anéantissement et ne laissait pas de place pour la « littérature des ravins ». Le mérite de l’étude d’A. Épelboin et d’A. Kovriguina est d’amener à considérer un autre modèle, non pas concurrent mais auxiliaire à une juste compréhension de la Shoah et de la figure du témoin. La Littérature des ravins saisit la portée d’un geste testimonial largement mû par ceux qui n’ont pas été les victimes du génocide et, de plus, réfléchit les configurations génériques propres à la littérature de la Shoah en reconsidérant la portée du genre poétique, refuge d’un « je » qui ose témoigner en réaction à la pression du « nous » collectif imposé par l’idéologie officielle. À lire ce corpus issu d’archives encore difficilement accessibles en ex-URSS, on prend toute la mesure de l’ambition véridictionnelle et éthique de la poésie — ce que les travaux critiques n’ont pas toujours suffisamment mis en valeur13. Pour le témoin, parfois lui-même rescapé, la littérature, dans une culture slave férue de poésie, est l’espace d’inscription privilégié de la Catastrophe ; elle est même « un appel à restituer la pensée là où elle a été abolie » (p. 21). Par des réseaux d’images et une rythmique liée à une forme-sujet, la poésie creuse un tombeau pour les disparus sans sépultures ; elle contre le canon réaliste socialiste et réaffirme la portée autrement politique et engagée de la littérature.
11Malgré des formulations parfois étranges attestant de compromis avec la censure, malgré l’occultation des victimes juives derrière l’évocation du peuple soviétique dans son ensemble, les premiers essais d’une autre littérature de témoignage cherchaient leur voie entre l’affirmation d’un « je » (« J’AI VU CELA ! » écrit Selvinski) et la soumission aux impératifs du « nous » collectif calqué sur l’histoire officielle :
C’est le « nous » factice d’une communauté malmenée, privée du droit à la subjectivité, mais qui veut bien croire à sa gloire et à son unité, motifs soigneusement distillés par les médias et les livres courants. […] L’écrivain soviétique se doit de parler d’un autre « nous », glorieux et triomphant, masque d’une collectivité fantasmée inventée par l’État, dont il est à la fois l’expression et l’otage. (p. 169‑170)
Témoigner comme non-rescapé : un impératif éthique
12La grande préoccupation des années 1960, lorsqu’apparaît la majorité de ces témoignages poétiques, était de faire connaître malgré tout14 une vérité historique longtemps tue et atrophiée et de réveiller « la mémoire hébétée / recroquevillée au fond de l’âme / [et qui] dort » (Lev Rojetskine). La tonalité nerveuse de nombre des poèmes des ravins, même lorsqu’ils glissent vers le registre épique ou l’invocation pathétique, confirme une telle injonction éthique. Ainsi de ces vers martelés par Ludmila Titova qui obligent celui qui ne veut rien savoir des massacres à voir les images de la désolation :
Je vous les montrerai vivants,
Je montrerai les miséreux, les estropiés,
Les inconnus, ceux dont je savais les noms,
Tous ceux qui ont suivi le chemin des tourments
Jusqu’à la nuit, les balles les ont fauchés,
Pour recommencer dès le lendemain…
Sous le feu une vieille femme criait :
Messie, que tu tardes à venir !
Et un vieillard recouvrant d’un chiffon
Son âme qui tremblait au vent,
Voulut en mourant appeler Adonaï,
Mais n’eut que le temps de dire : « Écoute… »
13La syntaxe plus heurtée, le vers parfois libre (phénomène rare en Russie), l’énumération de plus en plus lapidaire de ce qui a disparu avec l’extermination, la crispation sur un passé révolu qui ne renaîtra plus, le constat d’une impossibilité de parler de ce qu’on n’a pas soi-même vécu : tout concourt dans cette poésie désarticulée et bégayante, vindicative par sursauts, à énoncer une catastrophe qui échappe à la formulation, à la nomination alors même qu’elle a eu lieu sous le regard des écrivains-témoins.
14La littérature des ravins a été essentiellement le fait de tiers (bystanders) chargés de parler pour les disparus jusqu’à l’identification déchirante car coupable au double assassiné : « Je suis recouvert par le sort des Juifs », avoue ainsi Naoum Korjavine, évacué à temps de Babi Yar à l’âge de quinze ans. À ce sentiment de culpabilité s’ajoute la conscience brutale de la faiblesse des mots à dire l’impensé, comme le constate Ilya Selvinski :
Mais je reste en silence au bord de la tombe effrayante.
Que peuvent ici les mots ? Ils tombent en poussière.
Il fut un temps où je chantais l’aimée,
Les trilles du rossignol.
15Le « je » poétique se retourne ici contre le lyrisme innocent et énonce la dissolution de la diction d’alors en même temps que sa propre vanité. Qu’il soit ou non d’origine juive, le témoin héritant d’un passé qui lui appartient sans qu’il en ait pourtant fait lui-même l’expérience destructrice articule une « parole nouée, exigée et interdite, parce que trop longtemps rentrée, arrêtée dans la gorge et qui vous fait étouffer, perdre la respiration, vous asphyxie, vous ôte la possibilité même de commencer15 », comme l’écrivait une autre héritière, Sarah Kofman, dans Paroles suffoquées en 1987. L’incapacité à témoigner dans un régime politique qui interdit et réécrit tout témoignage insoumis ajoute à l’impuissance du témoin absent : elle renouvelle le paradoxe d’une littérature de témoignage écrite par ceux qui n’ont justement été que les témoins ou ne l’ont pas même été16. Reste à celui encore en vie d’être
celui qui a les yeux ouverts en face de l’Histoire et se fonde en éternité pour élever, tout à la fois à travers son moi singulier et l’événement collectif, un chant qui tente de restituer l’homme au-delà de son malheur17.
16La singularité étranglée devant la masse anonyme reposant au fond des ravins définit une tonalité endeuillée, « le bourdon effroyable du désastre », comme sous la plume de Ludmila Titova :
Au-dessus des bonheurs vagues et des catastrophes,
Comme s’il était le signe de mon destin enragé,
Un point d’orgue soulève son sourcil étonné
Sur la note de la douleur.
Et le son en perdure et règne sur tout,
Un son unique, comme si désormais
N’existaient plus ni thèmes ni couleurs,
Mais seulement la douleur sans remède.
17Bien que l’accent du chagrin soit désormais monocorde, tel un cri reliant les engloutis et leurs échos-témoins, le chœur endeuillé est cet œil et cette voix qui résistent à la désespérance et au silence de l’oubli, celui du monde englouti « des nappes blanches et des verres du sabbat » (Boris Sloutski).
***
18Si l’ouvrage d’Annie Epelboin et Assia Kovriguina ne s’attarde pas sur l’aspect proprement théorique de la littérature de témoignage, l’approfondissement critique des textes qu’il exhume de l’oubli offre une réflexion dense sur l’interaction entre littérature et politique au cœur du xxe siècle dans le creuset du soviétisme. Le point de vue décentré qu’il propose au lecteur favorise une perception renouvelée de la littérature de la Shoah et du genre poétique en particulier. Les références critiques couvrent autant le champ strict de la littérature testimoniale (A. Dayan-Rosenman, L. Jurgenson, Ph. Mesnard, M. Nichanian) que l’exégèse d’un corpus plus large au moyen de renvois bienvenus à Jean Starobinski, Nicole Loraux ou Paul Ricœur. La compréhension de la « littérature des ravins » s’élargit en effet de ces références extérieures à l’objet historique : celles-ci réintègrent dans la littérature mondiale les textes des ravins, émouvants dans leur effort à crier ce qui est tu, beaux dans leurs esthétiques singulières qui reconfigurent à chaque fois ce qu’on a cru savoir de la catastrophe. En joignant la nécessité de considérations historiques à l’examen attentif et sensible des textes, cet essai à quatre mains, passionnant et fort bien écrit, ouvre enfin la voie à des compléments18 sur la littérature des ravins écrite en yiddish ou bien en russe, mais publiée en Israël.

