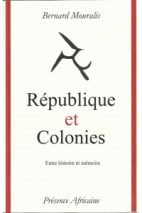
Une certaine idée de la République
1Bernard Mouralis réédite son ouvrage, République et Colonies. Entre histoire et mémoire, paru en 1999, qui traite de l’incidence du fait colonial sur la société française. Ce sujet a connu ces dernières années un regain d’intérêt tant scientifique que politique qui justifie amplement la « Préface à la deuxième édition » d’une vingtaine de pages (I‑XVII) qui accompagne cette livraison.
Une histoire africaine de la France ? L’idée républicaine en partage
2L’auteur de l’ouvrage — professeur émérite de l’université de Cergy-Pontoise — revient sur la situation des recherches consacrées dans l’Hexagone à l’histoire des relations franco‑africaines ou à l’histoire « africaine » de la France depuis la fin des années 90 — et la parution de son ouvrage — pour relever les deux grandes tendances qu’elles ont générées. D’un côté, une approche militante (disons « chaude ») de l’histoire. Les ouvrages, en nombre toujours croissant, construits autour des manifestations soutenues en général par des associations entendent restituer à la France oublieuse d’aujourd’hui, sa mémoire coloniale occultée. Fondées sur une lecture postcoloniale qui invite à porter un autre regard sur cette histoire et, au besoin, à l’assumer, ces recherches montrent les confusions créées autour de la notion de « Françafrique » traitée de façon d’autant plus passionnelle qu’y interfèrent des aspects politiques anciens et nouveaux, sans cesse incontrôlés, toujours incontrôlables, du déni et de la mauvaise foi sur le rôle de la France en Afrique. Cette « histoire engagée », où la fin semble fixée bien avant l’établissement des faits, l’acte d’accusation signé et le réquisitoire prononcé avant tout procès‑verbal, se justifie utilement d’autant qu’elle opère en même temps que se construisent des comportements politiques dits « décomplexés » comme la tentative de plusieurs parlementaires issus de la droite de faire droit, en 2005, au caractère positif de la colonisation, ou l’apparition dans la sphère politique et médiatique du refus de la repentance dont le point d’orgue est le fameux discours de Dakar de Nicolas Sarkozy en 2007 où il avait remarqué que l’une des raisons de l’absence de développement de l’Afrique était qu’elle n’était pas assez entrée dans l’histoire.
3De l’autre côté, une approche plus distanciée (disons « froide ») de l’histoire. Des ouvrages, moins médiatiques et en nombre plus restreint, tracent depuis longtemps les lignes de faits plutôt inconnus ou méconnus qu’occultés, en allant à l’encontre de la manière très française (c’est‑à‑dire longtemps jacobine) d’appréhender l’histoire. Ces travaux situent les relations franco‑africaines dans le domaine plus vaste de l’histoire de France (sur la longue durée). Ils s’intéressent aux personnages de cette histoire comme les tirailleurs sénégalais (Myron Echenberg, Colonial conscripts [Les tirailleurs sénégalais en Afrique occidentale française 1857‑1960]) ; aux conséquences de cette rencontre sur la naissance, l’évolution et les contours d’une « science coloniale » (Emmanuelle Sibeud, Une science impériale pour l’Afrique ? La construction des savoirs africanistes en France, 1878‑1930) ; à l’étude de certains phénomènes spécifiques comme les immigrations (Gérard Noiriel, Le Creuset français. Histoire de l’immigration (xixe‑xxe siècles) ou les minorités (Pap Ndiaye, La Condition noire. Essai sur une minorité française). À la différence de l’approche précédente dont le ressort a largement reposé, malgré tout, sur une certaine culpabilité de la France, celle‑ci vise à interroger les faits dans leur complexité et souligne que l’histoire franco‑africaine restera, au‑delà de tout, une histoire « partagée ». Les frontières entre l’ailleurs et l’ici, l’intérieur et l’extérieur, l’endogène et l’exogène, le Français et l’étranger (ou l’indigène) se brouillent sans cesse. Dans la société française contemporaine, on assiste à ce que Catherine Coquio appelle (sans doute en se référant au titre de l’ouvrage fondateur des études littéraires postcoloniales, The Empire Writes Back1), les « retours du colonial », avec toutes les conséquences, critique, symptomatique et politique qu’ils supposent : un mélange, parfois inextricable, d’idéaux perdus d’une colonisation non assumée et de revanche inassouvie d’une défaite coloniale non acceptée.
4Dans le débat auquel les spécialistes sont aujourd’hui familiers, l’essai de B. Mouralis qui se situe dans cette seconde veine est entièrement à part. Ouvrage d’histoire, République et Colonies est aussi une contribution à l’histoire littéraire contemporaine. Il montre une connaissance parfaite des détails les plus infimes de cette aventure franco‑africaine et réhabilite les figures intellectuelles et littéraires qui ont été, elles‑mêmes, comme l’histoire à laquelle elles se rapportent, négligées.
5B. Mouralis retrace la genèse et l’évolution de l’idée républicaine, entre les xixe et xxe siècles, plus précisément entre 1850 et 1960. Ce qui constitue, selon lui, l’unité de l’histoire franco‑africaine, c’est une certaine « prégnance de l’idée républicaine ». On la retrouve, dans le décret d’abolition de l’esclavage de 1848 initié par V. Schoelcher qui rejoue l’abolition décrétée sous la Convention en 1794 ; dans le décret de création de la compagnie des « tirailleurs sénégalais » signé par Napoléon III en juillet 1857 sous l’instigation de Faidherbe ; dans l’argument utilisé par certains explorateurs et conquérants de l’Afrique comme Savorgnan de Brazza pour placer les populations soumises en esclavage sous la bannière française afin de les protéger ; ou encore durant les conflits mondiaux, sous la IIIe comme sous la IVe République. B. Mouralis remarque, d’une part, que si l’histoire des relations franco‑africaines est faite de violences indéniables et inacceptables, elle est aussi portée par une « ambition politique » non moins indéniable. Il note, d’autre part, que c’est le refus de prendre régulièrement en compte le continuum de ladite ambition qui nourrit aujourd’hui certaines images fantasmatiques d’une Afrique que l’on dit incapable d’accéder à un idéal républicain.
Des figures franco‑africaines de renom : de l’engagement en politique et en littérature
6Pour asseoir sa démonstration, B. Mouralis choisit de s’appuyer sur trois grands exemples : celui d’un administrateur colonial de renom, Robert Delavignette ; celui d’un Nobel de littérature, Albert Camus, et celui, plus divers, d’écrivains et penseurs militaires. On notera combien l’écriture tient une place de choix dans cette vaste aventure de la France en Afrique ; signe que l’histoire des relations entre la France et l’Afrique est résolument inscrite dans la modernité de notre temps.
Lettres françaises et Lettres africaines
7Le parcours de l’administrateur colonial, Robert Delavignette, reflète la nécessité et les difficiles conditions de l’avènement d’un projet franco‑africain. Dès 1920, c’est‑à‑dire, dès la fin de la Première Guerre mondiale, où il prend contact avec l’Afrique noire, cet homme va occuper de nombreuses hautes fonctions publiques coloniales qui lui permettront de dévoiler sa sensibilité propre et son respect de l’idéal républicain. Tour à tour, commandant de cercle et chef de subdivision en A.‑O.F., Haut Commissaire en A.‑É.F. (au Cameroun), puis gouverneur général, il a aussi été directeur de l’ÉNFOM (École Nationale de la France d’Outre‑mer), école qui préfigure l’ÉNA (1’École Nationale d’Administration), avant d’y terminer sa carrière comme professeur de droit et de coutumes d’outre‑mer.
8Il a contribué à faire émerger un projet franco‑africain sur deux plans. Sur le plan juridique et politique, il propose d’adapter la situation coloniale à la réalité du terrain en tenant compte du fait que l’histoire africaine est en constante mutation et que les populations, ici, comme en métropole, ont soif de justice sociale. C’est le respect de cet idéal républicain qui l’amène à démissionner de ses fonctions de directeur des affaires administratives et juridiques du ministère de l’outre‑mer en désaccord avec la politique menée en Indochine ou encore de la commission d’enquête sur la situation algérienne créée par Guy Mollet en 1957 en désaccord, là encore, avec les objectifs politiques selon lui contestables qui lui étaient assignés.
9Sur le plan littéraire, il est ainsi connu comme un écrivain colonial prolixe. Son expérience de terrain nourrit ses œuvres. On lui doit : Les Paysans noirs, le procès‑verbal d’une année de commandement dans la vie d’un administrateur colonial en Afrique ; Soudan Paris Bourgogne, le récit autobiographique d’un enfant de la Bourgogne qui, après un passage par Paris découvre une Afrique soudanaise qui le révèle à lui‑même ; Les Vrais Chefs de l’empire qui honore la mémoire de ses administrateurs coloniaux et découvreurs d’Afrique qui y ont maintenu envers et contre tous un idéal républicain. Quant à La Paix nazaréenne, c’est le récit de la France (métropole et colonies confondues) dans la Grande Guerre. La fraternité qui unit les hommes morts dans ce combat pour la paix est aussi ce qui permet de comprendre l’entrée de ces peuples différents dans une histoire mutuelle ; de mesurer, de part et d’autre, les conséquences de celle‑ci sur le devenir des humanités.
10Au cœur de cette double préoccupation, se trouve l’administrateur des colonies à qui Robert Delavignette attribue un rôle de poids. Aiguillon d’une politique de justice sociale, il doit ordonner, orienter, construire, maintenir l’idéal républicain au nom duquel s’effectue la rencontre des peuples et des civilisations. C’est d’ailleurs en ce sens que Robert Delavignette concevra plus tard la fonction de la littérature. Celle‑ci doit montrer que l’Afrique n’est pas uniquement le lieu d’une archéologie mais l’espace d’une histoire dynamique. Après avoir institué l’enseignement des langues africaines à l’ÉNFOM, manière d’aider l’administrateur colonial au cours de sa formation à sa rencontre future avec les populations africaines, il soutiendra, en retour, l’entrée des Lettres africaines dans l’espace institutionnel littéraire français. Pour lui, les Lettres françaises de Métropole et les Lettres africaines forment un même ensemble franco‑africain.
11Cette vision politique et intellectuelle d’un espace franco‑africain l’amène à regretter les choix de la Ve République au moment de l’indépendance des anciennes colonies africaines, non pas tant dans l’idéal qu’elle porte en soi que dans la façon de décoloniser. Pour lui, celle‑ci s’apparente à une « décolonisation‑démission » parce qu’elle ne prend pas en compte la mesure de l’interdépendance des sociétés construites justement par le fait colonial ; interdépendance dont on ne se débarrasse pas d’un trait de loi — comme d’un trait de plume.
Les combats camusiens
12Après l’administrateur colonial, le pied‑noir d’Algérie. B. Mouralis décèle dans l’œuvre de Camus, prix Nobel de Littérature 1957, une certaine « nostalgie de l’espace républicain ». Celle‑ci repose, chez lui, sur le paradoxe entre l’idéal annoncé d’une « assimilation » des colonies aux valeurs de la République et l’absence de cette dernière à la réaliser pleinement, soit parce que les circonstances économiques ne s’y prêtent pas, soit parce que les conditions politiques ne la favorisent guère, soit parce que l’idéologie de l’exploitation humaine qui fonde la colonisation est la plus forte.
13Aux yeux de B. Mouralis, la situation de Camus est d’autant plus intéressante qu’il fait partie de la classe des petits blancs d’Algérie, qu’il a été élevé dans la conscience républicaine et qu’il s’est hissé dans la hiérarchie sociale grâce à l’école. Cette histoire individuelle nourrit le respect que Camus porte à la République et éclaire sur la difficulté du rapport critique qu’il va entretenir avec elle. République et colonies revient expressément sur le « mythe du silence » de Camus et rappelle que l’Algérie, sa terre natale, fut sans cesse pour lui une « hantise ». S’il n’en avait pas fait un sujet essentiel de ses premiers écrits — à l’image d’autres écrivains comme Mouloud Feraoun à la même époque d’ailleurs —, la question algérienne va s’imposer peu à peu ouvertement dans son œuvre au point de faire de Camus un « écrivain anticolonialiste ».
14Misère de la Kabylie apparaît de ce point de vue comme un texte fondateur. L’œuvre regroupe des textes publiés dans le journal Alger Républicain à la veille de la guerre (1939) où, à travers des reportages effectués dans cette région de l’Algérie, Camus fait le constat de la situation misérable dans laquelle sont tenues les populations arabes, dénonce les injustices produites par l’administration et surtout la confiscation des terres qui demeurera le véritable problème de l’Algérie rurale. Il se fait ensuite le porte‑parole des revendications des Kabyles qui ont soif d’égalité sociale, de développement économique et de démocratie locale. Un second texte, « Crise en Algérie », repris plus tard dans Actuelles III, comprend une série de reportages faits par Camus au cours de son voyage dans l’Est algérien en 1945 pour le compte du journal Combat. Il y dénonce la famine généralisée ; relève que le malaise politique vécu par les Algériens musulmans à la suite du refus des gouvernements successifs de leur accorder le droit de vote est si profond qu’ils ont cessé de croire aux vertus de la citoyenneté française. La position de Camus est courageuse, comme l’a noté M. Feraoun au moment de la publication de ce texte, parce que son cri pathétique est celui du traître à ses semblables ; un traître qui, de l’intérieur de la communauté des vainqueurs (les Blancs d’Algérie), use du langage des vaincus (les Arabes musulmans) pour dénoncer le déni de droit et appeler à des réformes aussi utiles que nécessaires à la survie des deux communautés.
15B. Mouralis relie explicitement le dernier roman de Camus à ces questions politiques. Publié à titre posthume par les soins de sa fille, Catherine, Le Premier Homme2 corrobore cette disposition générale de l’écrivain (la nostalgie) face à la question républicaine. Ce n’est plus seulement la situation des Arabes musulmans d’Algérie qui le préoccupe, mais bien celle de tous ceux qui ont vécu dans la colonie algérienne (petits blancs et arabes). Camus revient en effet sur le sens de la mort de ce père qu’il n’a pas connu, tué au cours de la Première Guerre mondiale et enterré à Saint‑Brieuc, en France. Il découvre, là, le premier homme, celui qui le précède dans le temps ; et le premier frère, celui qui reste, par l’âge au moins, son égal, au moment de sa disparition. B. Mouralis montre que Le Premier Homme est une réflexion sur le sort de l’Algérie tout entière où les justes, comme l’instituteur de Camus, M. Germain — dont une correspondance est annexée à l’œuvre —, n’ont pas eu la possibilité de contribuer à l’avènement d’une histoire plus juste de la République où les êtres différents seraient tous traités également. Dans un monde où des individus, comme son père, sont morts pour une idée à laquelle ils croyaient sans demander rétribution, il faut bien admettre que l’indépendance n’est pas une fin en soi si elle ne comporte, chevillée à l’idée, l’essentielle question citoyenne. Telle est, en définitive, la morale qui se dégage du Premier Homme. Le roman se donne à lire, la fois, comme une œuvre inachevée et comme un roman largement autobiographique. Mais il est surtout le roman qui honore l’homme premier : celui sans qui le fils ne peut avoir d’existence ; celui par qui l’acte du fils prend sens puisqu’il se situe dans la continuité de l’idée républicaine. Il montre surtout qu’il faut savoir quitter la mémoire (en l’occurrence ici, familiale) pour entrer dans l’histoire.
Des mots aux armes
16Le chapitre intitulé « La République, l’armée et les colonies », revient sur l’importance de la question militaire dans les relations franco‑africaines, sur les discours que lui consacrent les officiers de haut rang et les positions des politiques. L’action de Faidherbe marquée, comme on l’a déjà dit, par la création de la compagnie de « tirailleurs sénégalais », est en réalité guidée par sa volonté de concilier « l’assimilationnisme républicain » et la « politique indigéniste d’association ». Au même titre que l’école, l’armée doit servir de moyen de promotion sociale des indigènes en Afrique comme c’est le cas en France.
17Cette conscription des Africains fondée sur le volontariat va servir de modèle au futur général Mangin lorsqu’il imagine, au début du xxe siècle, sa « force noire ». Celle‑ci n’est pas exclusivement une force d’appoint à l’armée française confrontée déjà à la puissante armée prussienne depuis la guerre de 1870. Elle est une armée à part entière dont les règles doivent être en tous points celles de l’armée française. Comme Faidherbe, Mangin soutient qu’une telle conception suppose la révision de la doctrine coloniale, et la reconnaissance d’une mobilité indigène sur tous les plans, géographique et social, et, notamment, la possibilité d’une promotion au mérite égale pour tous. C’est d’ailleurs à cette pratique qu’il se conformera lui‑même lorsqu’il exercera sa mission coloniale en Afrique, en accordant des fonctions de commandement aux Africains, pour bien montrer que l’indigène comme l’Européen était capable de gouverner.
18C’est encore en ce sens qu’agiront Blaise Diagne, défendant au Parlement l’usage des tirailleurs sénégalais et de la loi du sang républicain répandu, et Clemenceau, défendant le rôle suprême de la République, face aux pouvoirs locaux et coloniaux. B. Mouralis insiste sur l’opposition entre les vues de Blaise Diagne et Clemenceau qui l’a nommé Commissaire de la République (un clin d’œil à la Révolution) avec pour mission de procéder, sur tout le continent noir français, au recrutement des soldats de l’Armée d’Afrique, et celles de Van Vollenhoven, gouverneur général de l’A.‑O.F., qui sera poussé à la démission parce qu’il a vu ses pouvoirs se réduire face aux exigences républicaines. C’est le triomphe de cette idée, républicaine, qu’on retrouve dans la mobilisation africaine contre le nazisme au cours de la Seconde Guerre mondiale comme en témoignent de nombreux députés des assemblées diverses constituées en France et dans les colonies au lendemain de 1939‑1945 tels Fily Dabo Sissoko.
Roman, nation et République aux colonies
19Des divers exemples choisis par B. Mouralis (de Robert Delavignette à Fily Dabo Sissoko), il appert que la colonisation a conduit à répandre l’idée républicaine plus que la nation française. Cette dernière, trop abstraite ou trop complexe, trop circonscrite ou trop restreinte (au choix), n’a pas fait l’objet d’un intérêt véritable chez tous ceux qui ont pensé les relations franco‑africaines. Au terme de l’ouvrage, l’idée républicaine repose sur un élément assez simple : une extension de l’éducation populaire, sans laquelle il n’y a pas de progrès social. Celle‑ci peut prendre la forme de l’école ou de l’armée. C’est par ces dernières, et par elles seules, que la République devient un modèle qui dépasse de loin les heurts de la colonisation et impose la France. C’est à cause d’elles encore, et d’elles seules, que l’égalitarisme peut se justifier sur toute l’étendue du territoire. Et c’est sans doute pour ne pas les avoir suffisamment maintenues que la France a pu commettre tout au long de son histoire coloniale des crimes contre la République, c’est‑à‑dire contre ses propres idéaux. Avec la Révolution, elle a inventé au XVIIIe siècle, une idée qu’elle n’a pas toujours su (ou pu) assumer, conduire à son terme ou lui donner une réalité concrète. C’est à la reconnaissance de cette histoire coloniale que cet ouvrage doit une partie de sa valeur.
20En refermant les dernières pages du livre, on peut néanmoins se demander si la réalisation de l’idée républicaine dans l’aventure franco‑africaine ne relève pas de la tragédie au cœur de laquelle celle‑ci s’est nouée. Les différents auteurs convoqués montrent que cette idée, séduisante durant plus d’un siècle, n’est possible qu’au prix de multiples efforts, de rappels constants au règlement ou à l’ordre et d’incessantes transgressions ou démissions. Dans le combat qui oppose la République aux colonies, l’échec semble avoir été plus assuré que le succès. Forte fut l’idée coloniale et très faible l’idée républicaine. Le triomphe de cette dernière nécessite toujours une sorte de « supplément d’âme » de tous ceux qui s’adonnent à la tâche. La notoriété des auteurs convoqués, la fortune de leurs œuvres, le rayonnement de leurs idées sont à ce prix. Ils sauvent l’idée républicaine de son échec face à la colonisation triomphante (malgré sa ruine) qui est, au bout du compte, l’expression exacte d’une certaine idée nationale. L’idée républicaine, sans cesse recherchée, difficilement réalisable, est cependant fascinante dès qu’elle s’accomplit. C’est sans doute la raison pour laquelle la fiction est son meilleur mode d’expression ; le roman un de ses moyens. Par leur pratique littéraire, les écrivains semblent tous adhérer à cette idée. Plutôt que d’un « supplément au roman national », comme l’ont affirmé récemment, sous la houlette d’un Jean‑Éric Boulin, certains jeunes auteurs qui écrivent « à partir » de la « banlieue » ou des « cités », cet essai affiche des suppléments au roman républicain. La capacité à produire de la fiction est signe de liberté et/ou de libération. En établissant une filiation entre Delavignette, Camus, Mangin, Clemenceau et Diagne, B. Mouralis tend subrepticement un fil qui relie ceux‑ci à Schœlcher. Après avoir libéré les esclaves, il leur avait fait don de sa bibliothèque personnelle afin qu’ils puissent s’en servir pour mépriser leurs oppresseurs. Il prépare également une pelote qui peut être déroulée jusqu’à la littérature francophone d’Afrique noire et des Antilles contemporaines où le roman n’a de valeur nationale que dans la mesure où il revendique son respect d’une certaine idée républicaine.
21L’essai de Bernard Mouralis établit en définitive entre l’idée républicaine et le roman un rapport de double bind : celui, en amont, du difficile accomplissement (sans l’abnégation littéraire nécessaire) de l’idéal républicain comme le suggèrent les œuvres des auteurs étudiés ; celui, en aval, de son accomplissement, au moyen d’une production littéraire, le roman, par où s’affichent nécessairement ses qualités morales et universelles. Le roman s’entend ici aussi bien dans sa forme « traditionnelle » comme on le voit chez Delavignette ou chez Camus, que dans ses formes plus diverses (qui comprennent l’essai) telles qu’elles apparaissent dans les écrits de Camus ou les œuvres de Mangin. Ces formes figurées de l’esprit humain n’ont de valeur qu’en ce qu’elles indiquent pour tous ceux qui les pratiquent, une manière libre de saisir le réel.

