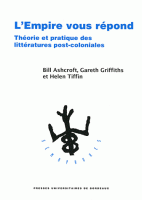
Fidèle au « post »
1Tandis que la France vit un rapport à son passé colonial chaque jour plus ambivalent, la traduction de l’un des ouvrages fondateurs des études post‑coloniales1, The Empire Writes Back, arrive à point nommé. Se voulant une entreprise commémorative des dix ans de la ré‑édition du livre (la version de référence aujourd’hui), il s’agit néanmoins de bien plus que cela : l’intégration d’un tel pilier de la pensée post‑coloniale à un paysage français encore en pleine expansion constitue, d’entrée de jeu, un acte discursif à part entière.
2L’ouvrage se distingue par sa capacité à appréhender les attentes d’un lectorat multiple, en parvenant à répondre à la fois à la concision d’un exercice universitaire2 et à une prétention — réussie — à l’exhaustivité. Il retrace les origines, l’état présent et l’avenir des littératures post‑coloniales dans la grammaire, l’université, le circuit éditorial et la réalité politique globale du monde anglophone. En cela l’ouvrage lui‑même fait mention de son objectif double :
[…] identifier la portée et la nature de ces textes post‑coloniaux, puis […] décrire les diverses théories qui sont apparues jusqu’à présent pour les expliquer. (p. 25)
3La traduction en français de The Empire Writes Back, publié en France vingt‑trois ans après la version originale, est l’occasion de penser l’état d’avancement du « post » dans le dialogue anglo‑francophone depuis l’émergence des premières théories post‑coloniales.
Le temps post‑colonial, une théorie du renouvellement
4Il semblerait que le maniement du concept de « nation » dans le champ de la recherche constitue une jauge du devenir post‑colonial du milieu dont il est issu ; en ce sens la publication de L’Empire vous répond constitue à la fois une confirmation de la position initiatrice des travaux post‑coloniaux dans le monde anglophone, et la suggestion d’une avancée dans le champ francophone.
5Trois temps distinctifs engagent L’Empire vous répond dans le débat post‑colonial contemporain : la première édition, la deuxième édition, puis la traduction. La première édition vit le jour en 1989, à l’aube de la prise de conscience d’un engagement artistique commun venant de pays anciennement colonisés et du besoin d’en délimiter les frontières. Un véritable effort de théorisation se mit alors en œuvre, culminant avec la parution des deux travaux communs d’Ashcroft, Griffiths et Tiffin : The Empire Strikes Back (1989) et The Post‑colonial Studies Reader (1995). Le second moment, celui de la ré‑édition, eut lieu en 2002, lorsque la pensée s’établit en tant que véritable champ (magnétique), produisant en réaction une division pro- et anti- études post‑coloniales, et un besoin incessant de recadrage3. Le dernier mais non le moindre, la traduction de 2012, permet à la théorie de se réinventer dans la différence et de s’introduire dans de nouveaux espaces — espaces qui, il convient de le dire, n’en sont pas toujours au même stade de leur devenir post‑colonial.
6Le retard pris par le champ postcolonial français sur le monde anglophone est un sujet récurrent dans les colloques4, et si quelques chercheurs, à l’instar de Jean‑Marc Moura, Dominique Combe ou encore Chantal Zabus, sont aujourd’hui en phase de création d’un socle des pensées post‑coloniales francophones, il n’en demeure pas moins que le monde universitaire anglophone est en avance. Cela se justifie, selon les auteurs de l’ouvrage, par la propension de la langue anglaise, plus encore qu’ailleurs, à faire interagir langue, littérature et nationalisme (« L’étude de l’anglais a toujours été un phénomène foncièrement politique et culturel, une pratique dans laquelle la langue et la littérature ont été instrumentalisés par un nationalisme profond et globalisateur », p. 14‑15), et surtout à questionner cette relation tripartite.
7La quasi‑inexistence de traduction d’ouvrages pourtant fondamentaux au développement de la théorie post‑coloniale est symptomatique dans le domaine francophone d’une communication difficile, au point qu’il semble légitime de penser que le dialogue trans‑atlantique ne s’est véritablement engagé qu’à partir de 2003, avec la traduction améliorée de Orientalism d’Edward Saïd5. La traduction de ce texte se veut donc une véritable passerelle, une quête de synchronisation entre deux mondes culturels pourtant proches, mais dont le rapport au passé colonial se vit de manière antagoniste. En cela, le choix de l’ouvrage est des plus avisés : ce dernier a en effet vocation à baliser le champ post‑colonial dans une optique inclusive6, pour ensuite poser des fondations solides adaptées au contexte7. L’ouvrage paraît pleinement conscient de sa propre utilité : poser les jalons de la théorie post‑coloniale telle qu’elle est pensée au début du xxie siècle dans les cercles universitaires anglophones, pour ensuite réfléchir à une définition plus sensible aux fluctuations historiques et artistiques d’un champ qui se construit par le texte. De fait, la définition initiale proposée de la post‑colonialité (« […] toute culture affectée par le processus impérial depuis le moment de la colonisation jusqu’à nos jours», p. 14) tend rapidement vers l’exploitation d’une tension nodale entre l’individu et son rapport à l’histoire, la langue, la culture, la nation.
8Écrit depuis un territoire lui‑même anciennement colonisé — le continent australien —, le livre revêt dans un premier moment le manteau théorique métropolitain, le temps de retracer les origines du post‑colonialisme dans l’histoire, dans les universités et dans le lexique de l’ancien pays colonisateur. De cette manière, le début de l’ouvrage situe le moment colonial dans l’histoire pré‑industrielle européenne, et revient ensuite sur l’intégration de l’idée d’une post‑colonialité dans la pensée universitaire, qui s’est d’abord faite sur un mode colonial avant d’être proprement post‑colonial8. Le lexique va de pair avec cette intégration universitaire : les termes désuets de littérature « du Commonwealth », « du Tiers‑Monde », « nouvelles littératures en anglais » ont finalement donné lieu à la dénomination « littératures post‑coloniales », mieux adaptée à une réalité en ce qu’elle
[…] ouvre la voie à une étude possible des effets du colonialisme sur/ entre des écrits en langue anglaise et des écrits en langue indigène dans les contextes africain et indien, ou même des textes écrits dans d’autres langues de diasporas (français, espagnol, portugais). (p. 37)
9La modélisation se poursuit lorsque l’ouvrage engage une topologie des littératures post‑coloniales : les modèles nationaux ou régionaux, les modèles de comparaison entre deux territoires ou plus (telle la diaspora noire), et les modèles comparatifs plus larges établissant des analogies thématiques telles que la (dé)colonisation d’une culture, la lutte pour l’indépendance, ou encore l’adéquation individu/ communauté. Ce dernier modèle, qui renvoie à un syncrétisme culturel, est l’occasion de prolonger la théorisation et de justifier pleinement le tiret du « post‑colonial » : s’il s’agit d’une manière de dépasser la simple optique chronologique (ce qui se passe après la décolonisation), il s’agit également de se démarquer des autres « post » (poststructuralisme, postmodernisme et autres diatribes) dont Bhabha redoute tant la dimension idéologique, et de « dégager un espace» (p. 232). Plus encore, le tiret trahit, et nous aurions aimé que cette idée soit menée à terme, ce « gouffre entre le produit local et les pratiques internationales de consommation du produit» (p. 238).
Le retour aux textes
10Après une première partie synthétique visant à introduire le post‑colonialisme par un biais pédagogique, les auteurs pétrissent la matière mise à disposition (les textes post‑coloniaux issus de leurs lectures) pour tenter de comprendre les critères qui définissent un texte post‑colonial. La première affirmation, de laquelle découlent toutes les autres, est l’idée d’une déconstruction des normes métropolitaines, qu’il s’agisse du canon littéraire, de la grammaire traditionnelle ou encore des canaux de communication, dans le processus de constitution du sujet.
11La rigueur avec laquelle les auteurs tentent de répondre à la problématique énoncée constitue une réplique aux détracteurs des théories post‑coloniales, qui voient dans la discipline un charlatanisme (Terry Eagleton parle de « anything‑goes‑ism9 »). Cette aspiration à la synthèse n’empêche pas toutefois une étude à la fois panoramique et approfondie de textes emblématiques d’un phénomène car, comme le rappellent les auteurs, le post‑colonial est avant tout « une stratégie de lecture» (p. 235) : « [l]a théorie post‑coloniale reste plus au service de la littérature et des autres productions culturelles qu’elle ne les domine. » (p. 247)
12C’est l’occasion ici de louer le travail des traducteurs, qui ont restitué avec virtuosité la littérarité du texte d’origine. Saisir la fusion syntaxique effectuée par des grands noms tels que Gabriel Okara, Derek Walcott ou Salman Rushdie avec autant de dextérité mérite la reconnaissance du lecteur non‑anglophone, qui parvient aisément, grâce à l’ingéniosité de la reproduction de jeux de mots, de transpositions culturelles ou de notes de bas de page explicatives, à mesurer l’importance de l’élasticité textuelle dans les stratégies discursives de toute entreprise post‑coloniale de qualité.
13Peu à peu, l’ouvrage pluralise « le » post‑colonial, en se tournant vers les particularismes locaux, empreints de traditions et d’influences propres à chaque héritage artistique. Cette stratégie énonciative est bénéfique dans la mesure où elle permet une dynamique binaire constante entre global/régional, théorie/texte, art/politique, généralité/particularisme, qui répond sans cesse à l’aspiration de l’ouvrage à la synthèse dans l’exhaustivité. En revanche, ce choix peut sembler par la même occasion contreproductif, en supprimant l’essence culturelle locale d’un dessein qui se veut transnational. Ainsi que le rappellent les auteurs, « [l]’altérité implique l’altération » (p. 47), tandis qu’un respect des valeurs locales enrichit le débat post‑colonial de considérations culturelles diverses. Il en découle peut‑être la limite principale de l’ouvrage, qui semble vouloir à tout prix « faire le tour » du « post », en parcourant un certain nombre d’œuvres tout en gardant à l’esprit un tableau d’ensemble de la pensée post‑coloniale. Cette confusion de perspective limite quelque peu la portée de certaines notions évoquées. En effet trop vouloir généraliser une tendance donne lieu à une assignation à résidence de certains écrivains, conséquence qui va à l’encontre du dessein projeté par les auteurs de l’ouvrage. Qui plus est, la synthèse d’une approche chronologique et thématique de la pensée post‑coloniale procède de la mise sur le même plan de mouvements de pensée restreints, tels que la Négritude africaine, et des thèmes fondamentaux aux pensées post‑coloniales telles que la créolisation ou la contre‑écriture, qui se distinguent par leur interactivité.
L’après‑colonialisme, une entreprise post- ou anti‑nationaliste ?
14Rappelons que le point de départ de cet ouvrage est la particularité de la littérature anglaise d’être modelée sur « un nationalisme profond et globalisateur » (p. 12) ; très vite ce lieu commun est dépassé, et surtout contredit. En effet ce qui se dégage à travers la lecture de L’Empire vous répond, c’est la capacité de la littérature à se dresser à l’encontre du cloisonnement territorial. Pour les auteurs en effet, l’une des plus grandes richesses des littératures post‑coloniales est de créer un espace — un tiers‑espace, pourrions‑nous ajouter, en référence à Bhabha. L’ouvrage se propose d’exposer les variantes de la contre‑écriture (le « writing back » de la version originale), qui prend plusieurs formes.
15La réplique peut dans une certaine mesure s’effectuer sous la forme d’un nationalisme artistique. Le nationalisme est une dimension incontournable dans toute approche post‑coloniale, car il y est à l’origine question d’invasion territoriale, de la domination de cultures, de langues et de systèmes de représentation indigènes par un code impérial unique. « La littérature devenait donc aussi fondamentale pour l’entreprise culturelle impériale que l’était la monarchie pour son organisation politique », nous rappellent les auteurs (p. 16). Mais pourquoi ce besoin, une fois l’indépendance acquise, de se lier à nouveau à l’expérience de l’Empire colonial ? demandent‑ils par la suite. Pourquoi est‑il si important que cette reconstruction nationale passe par la littérature ? La réponse évidente est que la culture constitue le terrain privilégié sur lequel toute machine dominante, que celle‑ci soit impérialiste ou nationaliste, cherche à asseoir son hégémonie, reléguant ainsi les cultures vernaculaires à un système marginal et déviant (p. 19). Selon cette perspective, les diverses formes artistiques se laissent ainsi englober dans ce qu’Althusser nommait les « appareils idéologiques d’État »10. Mais plus encore, l’ouvrage démontre l’importance du maintien de ce combat littéraire dans le monde de la recherche, au sein des universités notamment, car la normalisation du système néo‑colonial y est encore fortement implantée. Il convient donc de contrer cette discrimination en développant, à l’instar de Ngũgĩ wa Thiong’o, une littérature nationale canonique dont l’objet serait de redonner une centralité aux lettres autochtones.
16Or la revendication d’un nationalisme littéraire est rapidement dépassée. Les auteurs affirment :
La culture post‑coloniale ne peut être qu’un phénomène hybride impliquant un rapport dialectique entre la « greffe » des systèmes culturels européens et une réalité ontologique indigène qui incite à créer ou recréer une identité locale indépendante. (p. 257)
17Le nationalisme, système étanche et unilatéral au même titre que l’impérialisme, sera donc en permanence rongé de l’intérieur par des voix jusqu’alors opprimées, et dont les revendications sont trop multiples pour être confisquées. Ce que l’ouvrage cherche avant tout à mettre en avant, c’est donc la qualité régionale, le tiers‑espace, de l’écriture post‑coloniale. Cette littérature s’emploie avant tout à déconstruire l’idée de totalité par le biais de la dissolution dans l’espace. Ainsi les auteurs cherchent‑ils à mettre en avant la quête d’une « textualité indigène » alternative (p. 170), dans la mesure où « la conjonction langue/espace offre un terrain de conflit créatif pour les littératures des colonies de peuplement » (p. 167). Il s’agit pour ces auteurs de « dé‑nommer » (p. 168), de réinjecter de l’étrangeté dans le canon, de renverser les codes de manière à faire table rase d’une histoire coloniale dénaturée, en prônant une culture composée non pas de frontières communes, mais d’un passé commun.
18Cette littérature se traduit de diverses manières. Elle passe d’abord par l’écriture de silences (à l’instar du canadien Dennis Lee), trahissant la frustration de la condition post‑coloniale, qui engendre le silence plutôt que la parole, import du colonisateur. Mais elle peut également passer par l’affirmation, qu’il s’agisse de l’injection d’un certain Unheimlichkeit dans les canons littéraires impériaux (c’est le cas chez George Lamming), la création d’un langage, d’une esthétique indigène, faite d’« altérations et hybridations ayant affecté ces langues du fait de la présence de discours alternatifs [...] » (p. 174) (comme chez Ngũgĩ wa Thiong’o), ou encore de la célébration polyphonique d’une société hétérogène (celle entreprise par Wilson Harris, par exemple), voire de la quête d’une identité spécifiquement créole, composée de « la dynamique pragmatique de survie quotidienne » (ibid.) (à l’instar d’Edward Brathwaite). Chacun des écrivains cités dans l’ouvrage associe de près langue et littérature dans ce dessein régionaliste, puisque « la culture est un champ de bataille » (p. 197) et que « mots et concepts doivent être “libérés” pour s’associer selon des modes nouveaux » (p. 179).
Une littérature & une langue métonymique
19L’un des temps forts de l’ouvrage, et qui est au cœur de cette idée d’espace alternatif, est la suggestion que le propre de la littérature post‑coloniale est la métonymie, plus encore que la métaphore (qui revient à dire, comme l’avait fait Fredric Jameson, que toute écriture post‑coloniale traite nécessairement de la question nationale11). En effet l’histoire, les aïeux, le passé fournissent des points de référence essentiels à de nouvelles épistémologies. Bhabha a noté la collusion entre narration, histoire et mimétisme : les œuvres sont dangereusement interprétables comme socialement et historiquement mimétiques, car cela les réabsorberait dans la tradition de la métropole. Au contraire, les textes post‑coloniaux puisent leur richesse dans leur ancrage culturel, politique, géographique et écologique. La linéarité temporelle fait place à une pluralité spatiale ; puisque le présent s’efforce de sortir du passé, pour se construire un avenir, la langue n’existe que « dans l’actualisation elle‑même » (p. 60). Il s’agit avant tout de supplanter la centralité hégémonique véhiculée par l’idée de norme par le biais du langage12, théorie du renouvellement perpétuel permettant d’éviter l’écueil de l’idéologie unilatérale. Cette stratégie d’appropriation de la condition post‑coloniale permet de faire transparaitre toute la force sociale, culturelle et politique qui traverse les textes : « […] les mots incarnent en quelque sorte la culture dont ils procèdent » (p. 69). C’est précisément dans cette zone linguistique qu’est localisée « l’intersection de vastes réseaux de conditions culturelles », et que se rencontrent la « fonction » auteur et la « fonction » lecteur (p. 76), incandescence verbale qui donne lieu à la dimension éminemment politique de l’œuvre13.
20Cette idée de force dans la métonymie n’est qu’une piste dans l’ouvrage, et sera surtout le propre des théories post‑coloniales qui suivront la publication de 2002. En cela, nous serions presque tentés de souhaiter que le choix de la traduction se fût porté sur un ouvrage postérieur à cette première vague des théories post‑coloniales. En effet, malgré la dimension commémorative et fondamentale dont nous avons pleinement conscience, l’évolution du champ se fait avec une rapidité telle14, que des ouvrages plus contemporains aurait retenti avec plus de force encore dans l’avancée de la pensée en France. Toutefois, la solution évidente pour pallier ce manque renvoie à la nécessité de multiplier les traductions, ou mieux encore, de poursuivre la publication d’ouvrages théoriques issus de la pensée post‑coloniale proprement francophone.

