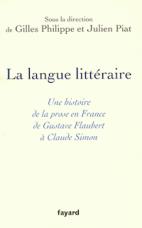
Les écrivains parlent-ils une langue étrangère ?
1En 1953, Roland Barthes posait la nécessité d’établir une « histoire du langage littéraire qui n’est ni l’histoire de la langue, ni celle des styles ». Ce langage littéraire, Barthes le nommait, on le sait, « écriture ». Mais il nous manquait toujours cette histoire de l’imaginaire esthétique du langage, tendue entre les contraintes collectives de la langue et les données individuelles du style. En rebaptisant « langue littéraire » la notion barthésienne d’écriture, c’est cet ambitieux programme que vient de réaliser l’ouvrage magistral dirigé par Gilles Philippe et Julien Piat. Comme l’indique son sous-titre, il se donne pour tâche de retracer l’histoire de la prose littéraire durant la grande période de son autonomisation (1850-2000), et ce par le prisme des faits de langue dominants.
2Il s’agit d’un point d’aboutissement pour les recherches des deux auteurs, respectivement sur le moment grammatical et le moment linguistique de la littérature française1 ; mais, la chose est suffisamment rare pour être soulignée, c’est aussi un volume collectif (auquel ont collaboré Stéphane Chaudier, Michel Murat, Christelle Reggiani et Stéphanie Smadja) guidé par une remarquable unité d’objectifs et de problématique.
3La passionnante introduction de Gilles Philippe retrace la genèse de l’autonomisation de la langue littéraire, qui se pense progressivement comme l’autre de la langue commune à partir de Flaubert. Elle obéit même à une double autonomisation : dans sa première acception, qui la définit comme modèle unifiant et norme haute de la langue, elle est peu à peu perçue comme langue morte, coupée des usages standard. Et dans son deuxième sens de « langue des écrivains », elle est l’objet d’un long débat au terme duquel le français, langue perçue comme sèche et surgrammaticalisée, se voit renier toute vertu esthétique : désormais, le souci de l’expressivité littéraire passera par l’invention d’une langue distincte des usages communs, une langue comme « étrangère »… Pour certains écrivains, cette émancipation consiste à revendiquer une langue toute classique dont la littérature se fait le conservatoire, tandis que d’autres promeuvent des pratiques de laboratoire plus expérimentales, qui cessent de garantir la norme grammaticale. Plusieurs causes à cette recherche d’une langue autre sont examinées : l’autonomisation du champ littéraire théorisée par Bourdieu, mais aussi la veine d’une conception non communicationnelle de la littérature développée à partir des années 1830, ou le courant « misologue » des années 1870-1930 qui referme la langue sur elle-même et lui dénie tout pouvoir de contact avec le réel. Enfin, l’enseignement scolaire a également joué son rôle — ou suivi le mouvement — en garantissant au français un statut de discipline autonome et en entretenant une définition formaliste de la littérature. Ce passage en revue est aussi l’occasion de poser la pertinence de la périodisation proposée : en effet, que ce soit dans les pratiques, les théories ou dans l’enseignement, divers symptômes montrent que la période d’autonomie de la langue littéraire, commencée avec Flaubert, semble se refermer progressivement depuis 1980.
4L’ouvrage peut ensuite explorer systématiquement les caractères formels de la langue littéraire selon deux ensembles successifs. Tandis que les sept premiers chapitres abordent synthétiquement de grandes questions transversales telles que l’oralité ou la phrase, les six suivants opèrent une série de « coupes générationnelles » pour montrer, autour d’un écrivain représentatif (Zola, Proust, Sartre…), comment se cristallisent ces problématiques dans tel « style » donné. A cet égard la structure du livre est à l’image de son objet même, tendu entre le collectif et le particulier.
***
5Le premier chapitre, « Langue littéraire et langue parlée » (G. Philippe) se penche sur l’un des problèmes essentiels de la période. Dès 1848, le contexte politique a créé les conditions d’une attention nouvelle aux sociolectes populaires, comme en attestent les préoccupations de Flaubert, des Goncourt ou, avec une visée différente, de Zola. Toutefois, il faudra attendre le début du xxe, et les années 1920 en particulier, pour que l’oralité quotidienne ne se cantonne plus aux seuls discours des personnages, mais irrigue l’ensemble de la langue littéraire ; avant le coup de tonnerre du Voyage au bout de la nuit, des auteurs souvent oubliés par l’histoire littéraire — Ramuz en particulier — voient leur rôle remis en valeur dans cette évolution d’un souci philologique vers une revendication esthétique plus globale. L’ouvrage propose en effet une distinction méthodologique extrêmement féconde entre, d’une part, « l’âge de l’oralité », qui vise à reproduire la langue telle qu’on l’entend, dans la variété de ses parlures, et d’autre part « l’âge de la vocalité », où avec Ramuz, Giono, Céline ou Queneau, la littérature cherche à faire entendre une voix dans la narration même, et donner au texte entier la présence du parlé. Les caractéristiques formelles, telles que sous- ou sur-ponctuation, représentation des ratés, phénomènes d’incidence syntaxique ou ruptures de la cohésion — qu’étudie au même moment la linguistique — sont alors mises en évidence dans leurs évolutions. Au terme du parcours, la langue littéraire réussit le pari de rejoindre la langue ordinaire : l’écart entre écrit et parlé est résorbé, signe que le concept séparé de langue littéraire ne s’impose sans doute plus aujourd’hui.
6Le deuxième chapitre, « La langue littéraire, le phénomène et la pensée » (G. Philippe) prolonge le premier dans sa ramification psychologique. La période 1850-2000 est en effet animée par une recherche de formes aptes à rendre fidèlement les phénomènes mentaux, recherche précisément indissociable d’un travail expérimental, le français commun étant senti comme impropre à l’expression de la subjectivité pensante. L’auteur montre que cette quête a connu trois périodes successives étudiées par le prisme des formes qu’elles ont vu naître. Le travail « impressionniste » des années 1850-1920 vise, sous l’influence en particulier des Goncourt, à représenter le percept par lui-même ; l’affaiblissement de la précision référentielle des noms au profit de leurs traits caractérisants, l’inversion de l’ordre caractérisé / caractérisant (« la transparence de l’air ») ou la recherche de détermination indéfinie en sont les signes dominants.
7La vogue « endophasique » des années 1920-1940 tend, en particulier à partir de la publication d’Ulysse en 1922, à créer un équivalent du langage intérieur grâce au monologue intérieur, renouvelé par une conception à présent non-communicationnelle de la littérature. Ce sont surtout des traits grammaticaux qui le caractérisent, phrases courtes thétiques, ou au contraire phrases longues, parfois déponctuées ; ces caractéristiques essaiment, à partir de 1940, dans l’ensemble des énoncés littéraires. Enfin, la lignée « phénoménologique » des années 1940-1980 déplace l’intérêt du phénomène seul vers sa conscience percevante, chez Sartre ou Sarraute entre autres. C’est alors le travail sur la prédication qui domine, donc sur la phrase.
8Le chapitre « Le texte romanesque : un laboratoire des voix » (Chr. Reggiani) constitue le pendant énonciatif des deux précédents ; il procède à l’exploration systématique des discours rapportés expérimentés au cours de la période. L’histoire commence avec le style indirect libre, « inventé » par Flaubert, aussi bien quantitativement que dans la mutation qualitative qu’il opère en l’utilisant pour retranscrire les pensées, mais aussi les paroles des personnages. Zola intègre dans la forme les caractéristiques lexicales du parler populaire. Mais l’intériorisation propre au roman moderne explique aussi l’apparition d’une autre forme qui explose dans le second après-guerre, celle du point de vue, représentation de subjectivité hors des formes du discours rapporté, qui met en œuvre un appareil formel spécifique (imparfait, démonstratifs mémoriels, prédilection pour les pronominaux neutres…). La forme du discours direct libre ne s’impose que tardivement, par exemple chez Aragon où elle envahit le récit. Enfin, la période actuelle correspond au « moment énonciatif » de la littérature française, défini par une discursivité massive au présent et à la première personne, et correspondant à ce qu’A. Banfield a appelé le skaz.
9« Le triomphe du nom et le recul du verbe » (S. Smadja et J. Piat) adopte un angle de vue plus lexical en se penchant sur la tendance à la substantivation apparue à partir de la fin du xixe siècle. Outre les tours phénoménistes du type « la transparence de l’air », le tour avec désadjectival + référent (« le soleil d’éblouissement ») s’impose dans les années 1920, avec des visées variées. En revanche, l’entre-deux-guerres est une période plus nettement adjectivale. L’affaiblissement sur le verbe est une constante depuis la fin du xixe siècle, sensible dans la prédilection pour les présentatifs et impersonnels, ou dans le recours aux verbes « incolores ». Il culmine dans la phrase sans verbe qui se spécialise dans plusieurs genres comme marqueur de subjectivité. Substantivations d’adjectifs comme recul du verbe sont en effet l’un des signes formels de la représentation de la subjectivité, enjeu primordial de la langue littéraire autonomisée.
10« La langue littéraire et la phrase » (J. Piat) aborde une caractéristique essentielle de la langue littéraire. Avec Flaubert, ensuite relayé par Albalat, Lanson ou Benda, la phrase a en effet dépassé son acception strictement grammaticale pour accéder au statut de caractéristique stylistique globale ; en tant que telle, elle donne lieu à un travail expérimental qui prend diverses formes. Les tenants du classicisme comme Gide ou Montherlant préservent l’idéal sobre d’une phrase moyenne ; mais la tradition de la phrase brève — qui remonte aux moralistes classiques — se décline aussi tout au long du xxe siècle, chez les classiques mais aussi chez bien d’autres, avec des visées tour à tour ironiques, objectives, mimétiques du percept ou du flux de conscience. L’idéal rhétorique de maîtrise originellement lié à la phrase brève cède le pas à l’expression d’une subjectivité brute. Cet oubli de la rhétorique est encore plus manifeste dans la pratique de la phrase longue. Celle-ci s’éloigne en effet, à partir de Flaubert, du modèle de la structure périodique ; sa clôture est attaquée par la droite, dans un mouvement d’amplification anarchique, par exemple chez Aragon. Dès lors elle devient le marqueur privilégiée d’une pensée en cours de formulation. L’évolution des ponctuants est enfin sensible sur toute la période ; la fortune des points de suspension, des parenthèses et tirets, et les pratiques de sur- ou sous-ponctuation sont étudiées de près. L’ensemble de ces évolutions syntaxiques a permis à la phrase de quitter sa valeur rhétorique pour servir les effets de voix et de point de vue.
11Le chapitre « Phrase lyrique, prose d’idée » (M. Murat) quitte le terrain privilégié du roman pour s’attacher aux genres qui, du Symbolisme à la seconde guerre mondiale, sont marqués par l’alliance de la poésie et de la pensée. Le démantèlement de la rhétorique et la redéfinition du partage entre prose et poésie au tournant du siècle ont en effet favorisé la littérarisation de la prose d’idées — au grand dam de Julien Benda. Plusieurs traits formels permettent de mettre au jour le patron de la nouvelle « phrase lyrique », tels l’éloignement du modèle périodique qui fait de la phrase une « aventure intellectuelle » chez Mallarmé ou Breton, ou les modalités de sur- ou sous-assertion qui réduisent les valeurs moyennes où l’énoncé se soumet à l’exigence rationnelle de la preuve. Ainsi les techniques de retrait caractérisent le « style NRF » ainsi que Valéry ou Paulhan, tandis qu’un usage plus autoritaire de la parole se pratique dans les avant-gardes. Enfin la pratique dominante des figures d’analogie, abordée à travers le style de Fargue, Colette ou Sartre, s’oriente tantôt vers l’écart absolu prôné par les surréalistes, tantôt au contraire vers une saisie phénoménale de la réalité sensible.
12Dans le chapitre « La référence classique dans la prose narrative », St. Chaudier revient sur le traitement de la langue littéraire comme « conservatoire » de formes héritées. Quels sont les écrivains concernés par ce choix et quelles formes revendiquent-ils quand ils se définissent comme « classiques » ? Le mythe de la langue classique, qui se développe au tournant du siècle et triomphe dans les années 1920, repose sur les notions d’ordre et de maîtrise — quand des phénoménistes comme les Goncourt, eux, prônent une langue affectée par la sensation. Mais cette prose classique du xxe siècle est en réalité une reconstruction qui cumule l’exigence de justesse lexicale de la « bonne prose » (Lanson) et l’idéal syntaxique des phrases claires et aisées. À cette synthèse originale, qui fixe les contours d’un génie français universel, apte à la fois à désigner justement le monde (par le lexique) et à transmettre des idées claires (par la syntaxe), s’ajoute parfois la valorisation des tours archaïsants — tant qu’ils ne sont pas obscurs. Les exemples de Bernanos, Bataille, Yourcenar ou Modiano permettent de cerner la variété des réalisations particulières du style classique. Quatre traits formels dominants se dégagent alors : la variété des schémas phrastiques, la précision du lexique, la mesure dans les images et les jeux énonciatifs, et la clarté de la référence.
13Après ce magistral parcours, s’ouvre le deuxième mouvement de l’ouvrage. L’enquête transversale fait place à une série de coupes générationnelles, centrées autour d’un auteur emblématique ; la méthodologie adoptée prend toujours soin de recontextualiser la notion de style d’auteur dans un ensemble de traits formels appartenant à un style d’époque — ce qui suppose en fait une véritable refonte de la méthode stylistique.
14« L’invention de la prose » (S. Smadja et G. Philippe) revient aux origines, la révolution de la prose advenue au cours des années 1850-1870 : celle-ci ne s’oppose plus à la poésie mais fait front, avec cette dernière, contre l’ensemble du discours non littéraire. Flaubert a dans ce drame le rôle principal, et son influence est immense. Pour lui la prose, perçue comme la synthèse de la poésie et de l’éloquence, doit se forger une phrase qui soit le pendant du vers poétique. L’étude revient sur la complexe notion d’invention avec toutes les nuances nécessaires : bien sûr, Flaubert n’a, à proprement parler, rien « inventé » — un écrivain n’invente jamais une langue ; mais il a rassemblé en faisceau cohérent, en « patron », des formes éparses avant lui.
15C’est sur Zola et ses contradictions que se penche ensuite G. Philippe. Rêvant d’une langue classique, mais renouvelant le rapport de la langue littéraire à la langue populaire, il se méfie comme Maupassant des excès « lexicomaniaques » de ses contemporains, Huysmans en première ligne. Il leur préfère la métaphore, figure pourtant décriée à l’époque. L’étude revient ensuite sur les procédés de l’écriture impressionniste vers 1880, pour les détailler avec précision.
16Chr. Reggiani étudie la génération 1900 en choisissant Péguy comme repère. Son parcours est emblématique d’un « dérhétorisation » de l’écriture survenue dans ces années à la suite de la suppression de la rhétorique dans l’enseignement ; sa phrase manifeste la recherche d’une oralité populaire littéraire, marquée entre autres par le rôle central de la ponctuation. A cette époque prend aussi place chez Lanson l’émergence de la notion individuelle de style, qui tend à remplacer l’émulation rhétorique.
17L’étude de la langue littéraire vers 1920 par St. Chaudier met Proust à l’honneur. Celui‑ci est contraint à l’invention d’un style, phénoménologique avant l’heure, afin de rédimer l’inadéquation de la langue commune à l’expression du sentiment. Ses spécificités sont étudiées de près ; outre la syntaxe particulière d’une phrase longue apte à dérouler le réel dans le temps, elles résident dans l’inventivité des images et le goût des énoncés plurivoques.
18La génération 1940, celle qui a le mieux saisi et catalysé les enjeux de l’histoire de la langue littéraire, est décrite autour de Sartre (G. Philippe). Celui-ci a pris acte de la crise du langage contemporaine, et partage en partie l’agacement de Paulhan contre une littérature qui s’est par trop éloignée de la langue commune. Lui-même n’a rien d’un expérimentateur, et son modèle de prose tend volontiers vers le purisme — dont Camus, au contraire, pastichera ironiquement la tendance des phrases à s’allonger par la gauche. Tout au plus peut-on noter sa tendance à une langue synthétique, apte à traduire par divers procédés l’exigence du tota simul. C’est en réalité dans l’essai, nouveau laboratoire, que se pose pour lui la question de la langue littéraire.
19Enfin, J. Piat choisit Barthes comme représentant du cataclysme langagier qui déferle entre 1950 et 1970 : le « moment grammatical » s’y radicalise en « moment linguistique » de la littérature française. Après le triomphe de la littérature engagée dans l’après-guerre, le souci de la forme passe au premier plan. Barthes valorise celle de « l’écriture blanche » — dont les caractères formels (présent, phrases brèves, adjectifs rares, verbes incolores…) sont analysés. Le souci de la « belle langue » se maintient pourtant, comme modèle ou contre-modèle. Une troisième voie, expérimentale, se dessine enfin, avec ses ratures exhibées, ses détours vers l’illisible et ses divers « gauchissements » de la syntaxe. Ces années sont enfin marquées par un tournant énonciatif qui fait de la prose littéraire ou essayistique le lieu d’inscription d’un sujet parlant — c’est l’un des indices que se termine aujourd’hui la période d’autonomie de la prose littéraire, hypothèse qui est fermement posée en guise de conclusion.
***
20L’ouvrage est appelé à faire date dans les études littéraires et stylistiques. D’un point de vue épistémologique, il réalise (sans le poser explicitement, car il semble éviter de se situer par rapport à la discipline) une historicisation de la stylistique, qui suppose d’intégrer l’histoire littéraire, mais aussi l’histoire de la critique et celle de la linguistique à la méthode stylistique.
21Poser la pertinence de la notion de langue littéraire mène à deux acquis théoriques et méthodologiques majeurs. Le premier est de reconsidérer la notion de style en prenant toute la mesure de l’apport de Barthes, qui rappelait déjà que « c’est sous la pression de l’Histoire et de la Tradition que s’établissent les écritures possibles d’un écrivain donné ». Le style d’auteur n’avait jamais vraiment, comme ici, été pleinement recontextualisé dans les contraintes du style d’époque. Dès lors, la méthode proposée permet de reléguer les interminables débats autour de l’individualité du style et leurs impasses.
22On ajoutera pour finir que le projet nous semble avoir pour horizon une recherche possible sur l’esthétisation de la langue littéraire à travers l’étude historicisée de leur réception. Cette dimension esthétique pourrait peut-être appeler à la reconsidération de la notion de manière, héritée de la théorie picturale et peut-être propre à prendre en compte la composante anthropologique de l’art, en même temps que la tension constitutive entre style individuel et style d’époque.

