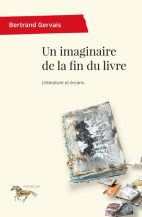
Raison graphique et raison numérique. Du dépassement du codex comme ressort de l’élan créatif en littérature
1Les recherches portant sur l’histoire du livre et l’édition ont débuté en France il y a trois quarts de siècle, notamment avec les sommes érudites de Lucien Febvre (1878-1956) puis de Robert Escarpit (1918-2000) et Henri-Jean Martin (1924-2007), qui suscitèrent des travaux d’une ampleur inégalée à partir des années soixante. Ces travaux se sont poursuivis dans la sphère universitaire grâce à la persévérance d’éminents chartistes, tels le lyonnais Roger Chartier (1945-) et le parisien Frédéric Barbier (1952-2023), tous deux contemporains ayant utilisé une approche interdisciplinaire mêlant l’histoire, la sociologie, la littérature et la linguistique permettant de mieux comprendre les itinéraires du livre et de la lecture. L’ouvrage de Bertrand Gervais1, Un imaginaire de la fin du livre, vient s’inscrire dans la lignée de ces réflexions sur les multiples facettes de l’évolution du livre.
2Cette continuité apparente peut néanmoins être interrogée lorsque l’on tient compte de la singularité de perspectives proposées par l’auteur. Car, si le livre occupe toujours une place prépondérante dans le dispositif d’analyse des évolutions de supports matériels vers des versions numériques, cet examen s’est enrichi de deux lignes directrices permettant de poser de nouveaux enjeux et de rendre la définition du livre plus complexe. La première consiste à dépasser la position du codex comme seul support éditorial légitime et à inscrire le livre dans un contexte plus large, qui est celui de projets artistiques permettant de mettre en quelque sorte en échec l’imaginaire de la fin du livre. La seconde s’attache à rendre visibles les liens étroits existants entre textes et écrans, tout en interrogeant la place privilégiée octroyée traditionnellement aux auteurs dans la hiérarchie de l’acte créatif. La succession de ces deux nouvelles approches nous invite à penser que le paradigme de la fin du livre a résolument évolué.
3Il convient de noter d’emblée que cet ouvrage résulte d’un cheminement dans la pensée de l’auteur. Celui-ci fait au demeurant régulièrement référence à ses propres articles au fil de ce nouvel essai — notamment, lorsqu’il propose en guise de repère bibliographique l’article paru dans Fabula-LhT qui est à la source de cette publication2. Cette écriture palimpseste n’est pas sans rappeler l’organisation de la pensée archéologique — à moins qu’elle ne témoigne d’un malaise plus profond de la recherche universitaire, qui concerne la crainte du plagiat. Dans tous les cas, on consultera avec profit ces précédents articles qui contribuent à mieux comprendre le raisonnement de l’auteur.
4Le propos liminaire de l’auteur tient, sans surprise, dans une réminiscence des annonces évocatrices de la disparition du livre avec l’avènement de son concurrent historique le support numérique. Ce discours défaitiste cède la place très tôt aux défenseurs de la singularité du livre comme élément pivot de la civilisation. Tantôt témoin de prouesses techniques depuis que le codex a remplacé le volumen, tantôt allégorie de notre humaine condition, en tant que support de pensée. Mais, alors que ses prédécesseurs semblaient placer la suprématie du livre au regard du texte numérique, notamment en opposant la raison graphique, telle qu’elle a pu être conceptualisée par Jacques Goody à la raison numérique, induite par le texte informatisé, Gervais résout les oppositions mises en évidence par le passé avec un parti pris simple et avisé qui consiste à reconnaître, d’une part, les tensions existantes entre les différents supports du livre (matériel et immatériel) et qui, en dépit des divergences, semblent coexister sans trop de heurts. Et, d’autre part, en dissociant le contenant de son contenu, autrement dit, en faisant une distinction claire et nette entre le texte et son support. À partir de là, la possibilité d’explorer « les variations de l’objet-livre » permet de dépasser les inquiétudes quant à sa disparition.
5Le lecteur remarquera, enfin, combien il est ironique de disserter sur la fin du livre par le biais d’un livre, bien que l’ouvrage soit paru en format papier et en version numérique. Tout aussi singulière est la nécessité de consulter toutes les illustrations mentionnées dans l’ouvrage (p. 211) pour être en mesure d’appréhender la complexité des innovations induites par le support numérique. Signe avant-coureur, peut-être, de ses qualités exploratoires.
Au-delà du codex, le livre comme support kaléidoscope : quelques exemples des créations dites illitéraires
6La première partie de l’ouvrage permet de brosser un panorama actualisé des expérimentations autour des pratiques dites illitéraires rendues possibles par l’environnement numérique. Il s’agit pour l’essentiel des exemples de pratiques qui s’affranchissent des conventions du livre que ce soit dans sa forme ou dans sa disposition suivant les principes de 7i (illégitimes, illégales, illisibles, illettristes, illimitables, illustratives, illogiques).
7Cette transposition est rendue manifeste à travers quelques exemples des arts plastiques comme le Livre-livre de Louise Paillé, qui impose le contact entre les œuvres en reliant l’écriture manuscrite à l’écriture imprimée. C’est le cas, également, du Décodeur de Guy Tournaye dont le principe repose sur un roman composé de citations de cent sept autres œuvres. Sa particularité étant de présenter un site web sous forme de roman à clés mais qui, au lieu de faire référence à des êtres réels, renvoie au lecteur un clin d’œil sur sa propre culture en reprenant des phrases des chefs-d’œuvre de la littérature et de la philosophie qui se chevauchent pêle-mêle dans le texte. Le point d’orgue de ces variations est l’application de la pratique du remix à l’œuvre où ce n’est pas tant la figure de l’écrivain qui est mise à l’honneur que celle du processus de création. De sorte que, au-delà de l’œuvre, c’est la plasticité du texte qui semble être mise en exergue par la raison numérique.
8Dans le second chapitre, l’auteur illustre cette désacralisation du livre en faisant appel à trois expériences d’altération du livre qu’il désigne comme des figures du livre et qui tendent à prioriser le caractère iconique du livre au détriment de sa lisibilité. Le premier est le projet artistique appelé A Humument, A Treated Victorian Novel de Tom Phillips, publié dans un premier temps sous forme numérique et qui se sert d’un document source : A Human document de W.H. Mallock, paru en 1892, comme point de départ de l’œuvre que l’artiste façonne à sa guise en récupérant des mots, ou des phrases de l’édition originale pour les investir d’une nouvelle signification. Le second projet est celui de Jochen Gerner, TNT en Amérique, paru en 2002 aux éditions de l’ampoule. Cette fois-ci c’est la bande dessinée Tintin en Amérique, publié par Hergé en 1932, qui est détournée. Le procédé est minimaliste, il s’agit d’effacer le contexte en noircissant la page pour donner du relief au discours en filigrane et, par la même occasion, de mettre en évidence la violence du propos initial. Le troisième projet est Tree of Codes de Jonathan Safran Foer, publié en 2010. Ce dernier utilise la technique du découpage d’une oeuvre source : The street of Cocodriles de Bruno Shultz, mais va plus loin que ces prédécesseurs en ce qu’il fait disparaître quasiment tout le texte, pour ne laisser que quelques vestiges de l’oeuvre originelle, comme les traces d’une existence antérieure devenue par la force du contexte une énigme à déchiffrer.
9Les chapitres suivants vont pousser l’expérience de remise en question de la forme du livre jusqu’au paroxysme. Dans le troisième chapitre, Gervais s’attache à décrire l’œuvre Principes de gravité, projet élaboré par Sébastien Cliché dans le cadre de sa résidence artistique au Québec en 2005. L’artiste a essayé, comme nombre de ses contemporains de reproduire la forme et l’agencement du livre avec les performances rendues possibles par l’usage du texte à l’écran, mais il inverse l’objectif d’assimilation initiale en le déconstruisant grâce au contre-emploi du contenu sémantique, et, en prenant appui sur une méthode d’écriture labyrinthique. Celle-ci est optimisée par l’usage récurrent des liens de rebonds. Or, en délaissant l’architecture traditionnelle du codex, le lecteur est invité à rejoindre l’expérience qui consiste à « lire un livre qui n’a pas été fait pour être lu », autrement dit : à observer le crépuscule de la forme traditionnelle du livre.
10Le quatrième chapitre, qui clôt la première partie, sert à illustrer deux expériences de transformation intégrale de la forme éditoriale traditionnelle du livre, le codex, pour l’adapter à l’accroissement exponentiel des textes de l’ère industrielle, pour pousser ensuite l’expérience de l’une d’elles jusqu’à sa transposition dans la culture de l’écran et l’émergence du phénomène de la production des textes en flux continu. Le chapitre débute par une réflexion sur le modèle économique du livre qui, dans un contexte de croissance, semble être en contradiction avec sa portée patrimoniale, et par voie de conséquence, qui paraît être en opposition avec l’idéal démocratique de l’égal accès aux savoirs et à l’éducation.
11La cohabitation du livre avec le texte à l’écran semble dès lors s’imposer comme nouveau paradigme. C’est alors, l’expérience de la lecture à l’écran qui est placée sous les feux de la rampe. La première expérience décrite est celle d’un nouvel outil de médiation permettant de favoriser la lecture accélérée par le biais d’un rouleau de texte en miniature, il s’agit de la machine The Readies que Robert Carlton Brown conçoit en 1930. Bertrand Gervais lui avait déjà consacré deux articles, l’un en 1992, l’autre, en 2018. La seconde machine à lire est celle de l’amiral Fiske qui propose de lire à partir des fiches comportant des textes en miniature permettant d’accélérer la lecture.
12Au-delà de la faible réussite commerciale de ces inventions, ayant par ailleurs été devancées, dès le tournant du xxe siècle, par l’usage des supports analogiques compacts tels que les microfilms et les microfiches dans les bibliothèques, l’intérêt de ces machines est de questionner l’acte de lecture dans un environnement distinct de celui du livre dans sa forme traditionnelle. Et, c’est cette approche qu’intéresse Craig Saper, qui propose une version numérique de la machine de Brown, tout en actualisant et en l’adaptant à un contexte contemporain, s’inspirant des nouvelles pratiques de lecture et d’écriture comme le scratch textuel qui vise à faire apparaître des nouvelles significations d’un texte à partir d’un matériau devenu malléable.
13C’est ainsi un véritable appel à la transdisciplinarité qui se dégage de ces expériences dites illitéraires. Car en dissociant le texte du codex, les créateurs peuvent puiser à l’infini des éléments permettant de faire émerger des nouvelles perspectives pour la création littéraire.
La création textuelle à l’écran ou l’émergence des nouveaux paradigmes en littérature
14Dans la seconde partie de l’ouvrage, l’auteur entend mettre en avant des pratiques littéraires issues des projets conçus dans un environnement numérique. En guise d’introduction, le cinquième chapitre permet d’illustrer les tensions entre une culture du texte à l’écran et ce qui est convenu d’appeler l’économie de l’attention. Pour ce faire, il reprend la déclaration de Patrick Le Lay, PDG de TF1 sur la télévision comme canal d’exploitation du « temps du cerveau humain disponible » pour donner des exemples de transpositions artistiques qui interrogent cette relation de la littérature à la télévision en l’investissant de nouveaux prolongements C’est le cas de l’association Ars industrialis du philosophe Bernard Stiegler, créée en 2005, mais également du roman Kafka-Cola d’Alessandro Mercuri paru en 2008 ou encore du roman de Christophe Tisson, Temps du cerveau humain disponible, publié en 2005. Ce dernier nous rappelle l’importance du contexte d’énonciation dans la portée de ce qui est dit, dans la capacité d’adhésion que peut atteindre un discours.
15Le chapitre suivant interroge de façon plus radicale la relation entre l’auteur et le texte à l’écran. Désormais, le projet littéraire repose sur la culture de l’écran informatique et dépasse les conventions du poste de télévision. Gervais s’intéresse alors aux modalités employées par les auteurs des fictions littéraires pour témoigner de la prégnance de ce nouveau paradigme qui est celui de la culture à l’écran. L’auteur y met en parallèle deux romans : As Francesca, de Martha Baer, publié en 1997 et De synthèse de Karoline Georges, dont la publication remonte à 2017. Cet exercice lui permet de démontrer à quel point la scission entre réel et virtuel devient progressivement obsolète pour laisser apparaître la réalité numérique.
16La mise en perspective de ces deux romans favorise également la compréhension de l’évolution du positionnement de la narratrice par rapport à l’environnement numérique. Cadre de vie qui ne devient plus une menace mais une opportunité d’appropriation d’une nouvelle identité, l’identité flux. Le texte à l’écran devient pour Karoline Georges un moyen de nourrir sa propre création avec les multiples dispositifs mis à sa disposition par le numérique, en s’appuyant notamment sur son avatar dans la plateforme Second Life, sur son activité de blogueuse ou des échanges qu’elle entretient via ses réseaux sociaux. La description textuelle s’incarne dans la réalisation visuelle et les échanges entre littérature et iconographie deviennent la source des nouveaux enrichissements. Le roman semble proposer ainsi de renouveler les liens entre raison graphique et raison numérique au service des arts littéraires.
17Le septième chapitre est consacré aux œuvres littéraires qui se sont affranchies du codex et qui sont, par conséquent, des œuvres littéraires électroniques. Ces œuvres relèvent de la troisième génération d’œuvres littéraires numériques, d’après le classement proposé par Leonardo Flores. Si la première génération visait à imiter le livre dans sa présentation et sa diffusion, et la seconde ciblait davantage la gratuité et l’interactivité, la troisième se donne pour objectif d’innover en matière de recyclage, affranchie des conventions littéraires classiques liées aux institutions ou aux circuits traditionnels de diffusion. De ce point de vue, elle est plus accessible et la plus protéiforme. L’un des exemples les plus percutants de ce type de projet de troisième génération est celui imaginé par Alexandra Saemmer intitulé Nouvelles de la Colonie, à l’instar des profils de fiction de Jean-Pierre Balpe, auteur d’Un monde incertain. Il s’agit pour Saemmer de détourner la création des profils sur Facebook en transfigurant la figure de l’auteur dans des profils de fictions à plusieurs voix, qui font songer aux jeux de rôles, Le projet a connu une version sous forme de livre, aux dires de l’auteur, sans renoncer à son caractère i-littéraire.
18Le dernier chapitre de ce panorama est consacré à la génération automatique des textes et à la dissolution de la figure de l’auteur. Les observations sur la génération des textes par des outils de médiation tels que ChatGPT-OpenAI sont suffisamment relayées dans la presse ou la littérature grise pour qu’on y revienne plus en détail. En revanche, ce dernier opus, permet à Gervais de présenter les travaux de deux auteurs indispensables aux spécialistes des arts littéraires en contexte numérique : Jean-Pierre Balpe, que l’on a déjà mentionné, auteur prolifique des fictions numériques, et Richard Powers, spécialiste des textes hybrides mettant en scène l’auteur face aux aléas de la création automatisée.
19Pour conclure, l’auteur fait une brève plaidoirie pour le développement des arts littéraires ayant dépassé le clivage historique entre codex et écriture à l’écran pour se centrer sur les pratiques innovantes permettant de renouer avec l’acte créateur.
20En définitive, tout en soulignant l’exceptionnel travail de repérage de ces nouvelles formes d’expression littéraire que nous livre l’auteur, nous aurions souhaité qu’il puisse développer davantage son appareil critique. Il est étonnant ainsi de ne pas avoir mentionné Paul Otlet (1868-1944), par exemple lorsqu’il passe en revue des machines permettant de rendre l’acte de lecture plus performant. S’agissant des créations littéraires en contexte numérique, quelques paragraphes sur les Escape Games auraient été intéressants, y compris dans les cas où l’auteur n’aurait pas considéré ces derniers comme relevant des arts littéraires, car, certains comportent bien des défis relevant de l’écriture des scénarios et des jeux des rôles et, il nous semble que l’on peut les considérer, à plusieurs égards, comme des dispositifs ayant nourri les méthodes de création actuelles.

