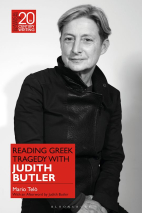
Contre la norme, la tragédie. Pour une lecture queer et décoloniale de la tragédie grecque, de Judith Butler à Mario Telò
1Dernier ouvrage en date de Mario Telò, professeur de littérature comparée et d’études grecques et latines à l’Université de Californie, Reading Greek Tragedy with Judith Butler est une discussion entre les deux penseur-se-s, qui invite à relire les tragédies grecques à l’aune du présent. Le chercheur interroge leur réception située et les fait dialoguer avec des philosophies, modes de pensées et théories critiques contemporaines, comme c’était le cas dans ses précédents ouvrages. Dans Greek Tragedy in a Global Crisis: Reading Through Pandemic Times1 écrit en 2020 et publié en 2023, il interroge le sens que peuvent prendre les tragédies grecques pendant une période aussi déstabilisante et « tragique2 », selon ses propres mots, que celle du confinement. À travers l’ouvrage Archive Feelings: A Theory of Greek Tragedy3, le chercheur repense les tragédies antiques à l’aune d’enjeux contemporains, en mobilisant la psychanalyse, la philosophie, les queer studies et les études décoloniales. Dans le sillage de ces deux essais, Reading Greek Tragedy with Judith Butler fait entrer en résonance les théories de l’auteur avec celles de Judith Butler sur la tragédie grecque. Mario Telò s’appuie sur Antigone’s Claims4, une étude politique et queer de l’Antigone de Sophocle, et des articles et conférences sur les Bacchantes d’Euripide5 et les Euménides d’Eschyle6. Judith Butler, philosophe et pionnier-ère des études de genre, s’appuie régulièrement sur ces trois tragédies pour développer ses théories sur les relations familiales et sociales et sur la violence systémique, et pour réfléchir aux questions de genre, de sexualité et de reconnaissance, notamment dans les luttes LGBTQIA+. Son travail sur les tragédies est philosophique et politique : la tragédie grecque lui donne un cadre discursif pour remettre en question des structures du pouvoir relationnel et politique, voire psychique, perçues comme naturelles, tout en lui permettant d’imaginer les nouvelles formes que peut prendre le lien social. L’approche philosophique se double d’une approche dramaturgique : Judith Butler lit les tragédies en praticien-ne du théâtre et a par ailleurs interprété Créon dans la réécriture d’Anne Carson, Antigonick, en 2012.
2À partir de ce qu’il nomme la « trilogie butlerienne », Mario Telò invite à déplacer notre regard sur les tragédies grecques en les lisant à partir d’un horizon contemporain. Sa lecture interroge la manière dont ces textes permettent de penser l’altérité — entendue ici comme l’ensemble des identités marginalisées par les normes hétéro-patriarcales blanches. Dans cette perspective, Mario Telò analyse la façon dont l’interprétation des tragédies grecques par Judith Butler est informée par sa pensée politique, notamment en ce qui concerne les questions de subjectivité, de vulnérabilité et de reconnaissance, tout en observant réciproquement comment les tragédies elles-mêmes affectent et orientent son regard critique sur le présent. La méthode de Mario Telò consiste ainsi à réfléchir avec et à « la manière » de Judith Butler, en adoptant sa démarche herméneutique pour remettre en question les certitudes et habitudes de pensées. Le chercheur ne se contente pas de développer certaines analyses philosophiques mais tente aussi de les dépasser, à partir de ses propres interrogations et hypothèses. Aussi féconde que soit cette démarche, elle entraîne un brouillage des deux voix : on ne sait pas toujours si la théorie expliquée est celle de Mario Telò à partir de celle de Judith Butler, celle de le-a philosophe sans développement, ou si elle est directement issue de sa lecture de la tragédie.
3Malgré l’intérêt certain des théories avancées par l’auteur, celles-ci ne sont pas toujours très abordables du fait de la densité conceptuelle de son essai. S’adressant à un lectorat familier des tragédies grecques, Mario Telò ne revient jamais ni sur leur contexte de création, ni sur leur auteur, leur structure, leur intrigue ou leurs personnages. Si les théories butlériennes sont plus explicitées pour être commentées, il est également préférable de les maîtriser et de bien connaître les concepts liés aux études de genre et décoloniales pour saisir la portée critique de l’ouvrage. En parallèle de longs passages conceptuels, le chercheur propose néanmoins des analyses fines et détaillées des tragédies : à plusieurs reprises, les théories reposent sur l’étude précise d’un ou deux vers et de leur structure, des sons produits par les termes grecs cités et dont l’auteur donne aussi sa traduction en anglais, ainsi que des imaginaires qu’ils ouvrent et des répercussions sur le souffle des interprètes — Mario Telò n’ignorant pas la dimension physique, corporelle, des textes tragiques.
4Les analyses du chercheur sont politiquement situées et ancrées dans le présent de l’écriture, dont le contexte est très régulièrement rappelé, avec des mentions à la pandémie de COVID-19 et à la situation politique des États-Unis en 2023. Les lecteurs et lectrices suivent le cheminement de pensées du chercheur dans l’ordre chronologique des écrits et conférences de Judith Butler, dans un plan à la fois thématique (chacun des trois chapitres consiste en l’étude d’une des trois tragédies : Antigone, les Bacchantes, les Euménides) et progressif puisque chaque partie s’appuie sur la précédente et suit l’évolution des théories butlériennes.
« Autigone » : l’autonomie radicale d’une Antigone neurodivergente
5Bien que l’on puisse regretter la persistance des théories freudiennes dans le chapitre consacré à Antigone et l’importance qui leur est accordée — ce qui s’explique en grande partie par leur influence dans la pensée de Judith Butler et dans son essai Antigone’s Claim — la caractérisation du personnage comme neuroatypique ou autiste constitue une perspective inattendue et stimulante. À partir d’une analyse lexicale des termes comportant le préfixe auto- (autonomos, auto-ktonounte, autourgos) (p. 57), ainsi que de « l’anagramme parfait » de « nomos » (loi) et « monos » (seul), Mario Telò explore l’idée d’une Antigone neurodivergente, qu’il renomme alors « Autigone », contraction d’« autistic » et « Antigone ». Selon lui, l’autos d’Antigone, qu’il associe au moi freudien à la suite de Judith Butler7, ressemble à une forme d’autisme, comprise non pas dans un sens pathologique mais comme une manière paradoxale d’être centré sur soi tout en étant sans ego, une alternative aux normes sociales qui définissent l’être par rapport aux autres. Suivant la définition de Melanie Yergeau8 de la neurodivergence comme une identité, une « neuroqueerness », Antigone dérange la norme. Dans Antigone’s Claim, Judith Butler développe l’idée que l’autonomie (autonomos, « se donner sa propre loi ») d’Antigone est une autonomie radicale9. Par son existence même, Antigone, qui est issue d’un inceste et qui n’assure pas le rôle genré qui est attendu d’elle, remet en question les lois et les normes ainsi que les institutions portant ces lois et organisant la vie sociale, de la famille à l’État. Cette autonomie n’est pas un repli individuel, mais un acte de résistance, un refus d’adhérer aux conventions sociales et légales. Antigone ne se contente pas de désobéir à la loi : elle la subvertit. En ce sens, elle n’est pas une figure solitaire qui ne suit pas la loi ou la norme, mais incarne un acte collectif radical, insurrectionnel, dont l’objectif est le bouleversement de l’ordre établi et de tout un système.
6L’Antigone d’Antigone’s Claim ne possède pas d’ego ou de « soi » complètement défini, car elle est constituée d’un « glissement d’identités » : elle devient un frère plutôt qu’une sœur après avoir touché le corps de Polynice (p. 40). Le personnage existe, selon le-a philosophe, dans la dissémination et l’interchangeabilité des liens familiaux, à travers une expérience de « désidentification spirale », une « hétérologie virale » (p. 44). Antigone illustre ainsi l’idée que « le “moi” est une combinaison fragile, toujours changeante, de parties multiples, ce qui fait qu’il n’est jamais pleinement individué10 » (p. 62).
7Mario Telò ajoute une dimension politique à cette perspective : la neurotypie, c’est-à-dire le fait d’être considéré comme « normal », par opposition à la neuroatypie (comprenant notamment le spectre de l’autisme, les TDAH, les troubles dits « dys- »)11, est une construction sociale et répond à une norme blanche, donc bâtie sur des biais racistes et coloniaux. Il développe une pensée décoloniale en convoquant notamment les écrits de Toni Morrison, de David Marriott ou encore de Fred Moten12, pour faire entrer en dialogue l’hétérologie radicale de l’Antigone de Judith Butler, qu’il considère comme « une interprétation éthico-politique de la pulsion de mort freudienne » (« an ethico-political take on the Freudian death drive », p. 50) avec les problématiques raciales. Dans le sillage de la pensée de Fred Moten, qui affirme que toute vie noire est une vie neurodiverse (« all black life is neurodiverse life », p. 56), nous pouvons envisager le tempérament héroïque d’Antigone comme une forme d’expression de sa neurodiversité : faire preuve d’héroïsme, c’est être hors de la norme.
8Ainsi « Infinite Heterology: Antigone », premier chapitre de Reading Greek Tragedy with Judith Butler, est emblématique de la méthodologie mise en place dans l’ensemble de l’ouvrage : Mario Telò lit Antigone en ayant en tête Antigone’s Claim, et crée un dialogue entre la tragédie de Sophocle, l’interprétation de Judith Butler et la sienne. Si la tragédie grecque est régulièrement convoquée et parfois analysée au sein de cette étude, elle n’est cependant jamais contextualisée et traitée pour elle-même : elle sert surtout de prétexte pour illustrer des problématiques sociales et politiques contemporaines telles que l’inclusion des personnes neuroatypiques dans un système pour l’instant excluant et le racisme systémique, grâce aux notions d’hétérologie et d’altérité.
Judith Butler e(s)t Dionysos
9Le deuxième chapitre, qui traite principalement des transparentalités et de l’avortement, est particulièrement convaincant et riche. Il s’ouvre sur une citation de Naomi Gordon-Loebl13 qui met en lumière le recul des droits et de la protection des enfants transgenres aux États-Unis dans le contexte du backlash actuel, et souligne la nécessité d’ouvrages tels que celui-ci pour faire face à la résurgence des idéologies fascistes. En s’appuyant sur les lectures des Bacchantes d’Euripide par Judith Butler et sur ses propres analyses, largement ouvertes sur l’actualité états-unienne de 2023, Mario Telò montre comment la pièce antique nous permet de penser aujourd’hui les parentalités en sortant des schémas de représentations traditionnelles des genres.
10En plus des théories butlériennes largement mobilisées, Mario Telò n’hésite pas à piocher dans la pensée de nombreux autres théoriciens, théoriciennes et artistes, et passe de Freud à l’œuvre censurée par l’extrême-droite italienne du street-artiste Kage exposant « un homme allaitant » (Uomo che allatta, Rimini, 202314). C’est à partir de l’exemple de la censure de cette œuvre que Mario Telò propose de voir les Bacchantes comme une « ironisation corrosive d’un cauchemar de droite, à savoir l’effondrement du monde précipité par le “non-sens libéral” de la transparentalité et la tolérance à l’égard du “démembrement” des fœtus15 » (p. 65). En effet, dans les Bacchantes, la « maternité » de Zeus qui a accouché de Dionysos, puis le démembrement de Penthée par sa propre mère Agavé, prise de folie à cause du dieu, permettent de réfléchir aux transparentalités et à l’avortement — ou du moins à la perception par les partis conservateurs de ce qu’est l’avortement, annoncé comme le démembrement des fœtus et révélant, pour Judith Butler, la peur de la destruction et l’origine de la transphobie (p. 84).
11Dans sa conférence « Breaks in the Bond. Reflections on Kinship Trouble », Judith Butler développe l’idée selon laquelle, pour repenser les parentalités, il faut d’abord comprendre ce qui rompt les parentalités traditionnelles et les reconfigure. Pour le-a philosophe, c’est précisément la rupture des liens de parentalité qui constitue le lien qui continue de nous relier (« that breakability is the bond16 »). À sa suite, Mario Telò utilise la décapitation de Penthée comme une image permettant d’illustrer le lien et sa rupture ainsi que le lien permis par la rupture. L’auteur suggère que la mention de la chevelure de Dionysos par Penthée (Bacchantes, v. 239-24117) annonce la rupture de sa propre intégrité physique (sa décapitation) car il voit dans le mouvement de cheveux un « lancé de la tête évoquant de manière troublante une impulsion vers l’auto-décapitation18 » (p. 83). À partir de l’analyse de ces trois vers, le chercheur estime que le geste de Dionysos est une forme de reconfiguration du corps, dans le sens où la chevelure — et par extension la tête — prend le dessus sur le reste. Cette dynamique corporelle, entre intégrité et fragmentation, fonctionnerait selon Mario Telò comme une référence à la grossesse de Zeus, rendue possible par le transfert de la gestation de Sémélé vers le dieu, qui implique deux ruptures corporelles : l’ouverture du ventre de Sémélé et l’incision de la cuisse de Zeus. Ces deux coupures créent un lien entre les corps et aboutissent à une reconfiguration trans du corps du dieu. Là encore, la démonstration s’éloigne considérablement du texte antique, qu’elle cite pourtant, en y surimposant une interprétation contemporaine.
12Dans le même chapitre, Mario Telò raconte, sous le format d’une anecdote, le mauvais accueil qu’a reçu Judith Butler au Brésil en 2017. Perçu-e comme un élément perturbateur, responsable de « l’épidémie » des réflexions sur le genre, en étant « l’intellectuel-le star qui, dans l’imaginaire de l’extrême-droite européenne et sud-américaine, a introduit l’épidémie de “l’idéologie du genre” avec Trouble dans le Genre19 » (p. 67-68), Judith Butler a été accueilli-e comme l’est Dionysos dans les Bacchantes — ce qu’iel est peut-être bien, en tant que personnalité publique qui remet en question les normes établies. La comparaison aurait de quoi surprendre celles et ceux qui connaissent l’intrigue des Bacchantes, qui met en scène un dieu tout-puissant faisant preuve de cruauté à l’encontre de celles et ceux qui douteraient de sa nature divine. Pour autant, elle a le mérite de mettre en évidence le danger que représenterait la notion même de genre pour les droites conservatrices — l’auteur n’allant pas jusqu’à suggérer que Judith Butler est une sorte de divinité non-reconnue. La notion de pandémie, associée à la peste dionysiaque (« Dionysian plague », p. 88) est alors utilisée aussi bien en référence à celle du COVID-19, sur laquelle les deux chercheur-se-s ont écrit20, qu’à celle fantasmée par les (extrêmes-)droites transphobes, la « pandémie transgenre ».
13Mario Telò, suivant le même chemin que Judith Butler, glisse ensuite vers le rapport à l’animalité, en s’appuyant sur la confusion d’Agavé qui, aveuglée par Dionysos, prend son fils pour un lionceau et le tue (p. 105-107). Cette réflexion s’inscrit dans le contexte politique actuel marqué par des tensions autour du genre, de la famille et de la biopolitique, et où des figures politiques comme Eugenia Roccella ou Vladimir Poutine instrumentalisent ces enjeux pour renforcer des politiques sécuritaires nationalistes et conservatrices. Mentionnant l’inquiétude de la ministre de la famille italienne face à l’attachement, voire à l’amour, que l’on éprouve aujourd’hui pour les animaux, le chercheur montre que les parentalités queer et non-humaines sont stigmatisées de la même façon : toutes deux exposent la possibilité d’une humanité différente et dérogent à la hiérarchie sociale plaçant l’humain, en tant qu’idéal normé, au sommet et au centre (p. 113). À travers leur lecture des Bacchantes, Judith Butler puis Mario Telò explorent ainsi les enjeux soulevés par les transparentalités mais aussi par une forme de trans-animalité, dans une perspective transversale de questionnement autour de la norme et de la frontière entre les catégories de l’humain et du non-humain, en plus des catégories de genres.
De la fureur des Érinyes à la nécessaire colère militante
14Le troisième et dernier chapitre repose quant à lui sur des analyses et commentaires des Euménides d’Eschyle. La question de la vengeance et de la fureur (rage, en anglais) est au cœur de cette section, et est souvent reliée aux thèmes évoqués dans le premier chapitre portant sur Antigone et le rapport à la justice. Grâce aux Euménides, la réflexion sur la justice va plus loin et permet de mieux comprendre le lien entre la tragédie antique et nos questionnements politiques contemporains — un lien parfois noyé ou caché derrière les nombreuses références à la psychanalyse dans le premier chapitre. En plus des Euménides, le chercheur s’appuie sur le commentaire de Judith Butler de l’analyse de Niobé par Walter Benjamin dans « Pour une critique de la violence21 ». Pour le-a philosophe, les Érinyes sont les représentantes d’une justice égalitaire dont le sentiment de fureur se manifeste face à l’injustice d’une loi au service des puissants. La violence à l’œuvre dans la tragédie se situerait ainsi dans le respect de lois injustes, une violence qui s’exerce alors contre les opprimé-es et les minorités. Selon Judith Butler, une lecture des Euménides qui repose sur ces postulats offre la possibilité d’une insurrection relationnelle (p. 122), une position que partage Mario Telò.
15Un apport intéressant de l’ouvrage sur le rapport à la justice se trouve dans la sous-partie « Buccal Exscriptions » (p. 133), terme emprunté à Jean-Luc Nancy22, qui traite des manifestations sonores et corporelles de la fureur et de la douleur : souffles, sifflements, crachats. Mario Telò explore ici la dimension symbolique des sécrétions du corps humain, des larmes de Niobé au souffle des Érinyes, devenant crachat de sang à travers la malédiction proférée par le fantôme de Clytemnestre : pour Mario Telò, « l’haleine sanglante » des Érinyes (αἱματηρὸν πνεῦμ᾽ ἐπουρίσασα, Euménides, v. 137) devient liquide lorsque le comédien salive excessivement en prononçant le terme κατισχναίνουσα du vers suivant (p. 133)23. Il développe l’idée que la buccalité est plus importante que l’oralité dans l’expression de la colère, sentiment viscéral qui s’exprime plus par des sons que par des mots, dans la tragédie comme dans le réel, et qui éclabousse les symboles de la loi et de la norme :
In their barren immanence, blood, saliva, and tears symbolically splattered onto the edifices of the law — the temples that Niobe disdained and the Areopagus, the courthouse founded by Athena — defile the facade of normativity. (p. 138)
Dans leur immanence stérile, le sang, la salive et les larmes, projetés symboliquement sur les édifices de la loi — les temples méprisés par Niobé, l’Aréopage, et le tribunal d’Athéna — souillent la façade de la normativité.
16Les lois ne sont alors plus intouchables : chacun peut y laisser sa marque — dans une image qui peut évoquer les murs tagués des édifices étatiques ou les jets de peinture rouge ou orange lancés sur des bâtiments et des œuvres par des associations écologistes, autant que les moyens de protestation des classes populaires et des communautés marginalisées.
17Dans la suite du chapitre, l’auteur se concentre sur la « black rage » et le mouvement Black Lives Matter. Dans la continuité des réflexions de Judith Butler et de Debra Thompson24, il établit une comparaison entre le traitement d’Oreste et des Érinyes avec celui des hommes blancs ou racisés aux États-Unis aujourd’hui. Chez Eschyle, la colère d’Oreste est justifiée par Apollon — parce que tous les deux sont des hommes et que le modèle de justice soutenu par Apollon et Athéna est patriarcal — tandis que celle des Érinyes et de Clytemnestre est condamnée car du côté du sentiment et allant à l’encontre de la hiérarchie patriarcale en place. À partir de cette considération, Mario Telò construit une analogie entre la pièce antique et le présent : la colère des Afro-Américains contre les violences policières est perçue comme dangereuse pour la démocratie, tandis que celle exprimée par des hommes blancs hétérosexuels est intégrée au discours politique (p. 148), comme en témoigne par exemple la campagne électorale de Donald Trump. Il y a donc un double standard raciste : la colère est tantôt incompatible avec la démocratie et le vivre-ensemble, et tantôt valorisée et normalisée. Dans les Euménides, Athéna insiste sur le caractère incompatible de la colère des Érinyes avec la notion même de justice, et les convainc ainsi de devenir les Euménides, c’est-à-dire de renoncer à la colère, de se figer, pour devenir les gardiennes de l’ordre démocratique et patriarcal. Or, pour Judith Butler, « refuser la colère, c’est répéter la violence contre laquelle elle s’élève25 » (p. 149), comme le souligne également Frantz Fanon26 (cité plus loin par Mario Telò) pour qui la colère et le sentiment d’injustice peuvent conduire à une prise de conscience politique. Mario Telò assimile le mouvement Black Lives Matter au soulèvement des Érinyes qui, selon sa relecture, refusent de se plier à la loi d’Apollon et d’Athéna, et manifestent pour préserver leur souffle et leur droit d’exister.
*
18Si l’Antiquité est souvent utilisée comme bouclier culturel par les extrêmes-droites et autres conservateurs partout dans le monde27, Judith Butler et Mario Telò à sa suite sont de parfaits exemples du mouvement inverse. L’ouvrage Reading Greek Tragedy with Judith Butler montre à quel point l’analyse des tragédies grecques est politique, et à quel point il est difficile de prétendre les étudier avec objectivité, mais aussi combien peut être enrichissant le fait d’assumer pleinement des analyses subjectives, orientées par une pensée politique. En nous appuyant sur la méthode de Judith Butler et de Mario Telò, qui consiste à partir du présent pour lire les tragédies du passé, nous trouvons chez Eschyle, Sophocle et Euripide des éléments pour répondre à des préoccupations contemporaines : questionner le genre et la norme, repenser les parentalités (transparentalités, homoparentalités) et l’avortement, mais aussi le lien entre humanité et animalité, et enfin, réfléchir au rôle de la colère et de la rage dans nos systèmes judiciaires et notre représentation de la justice en général, notamment dans les communautés marginalisées et violentées. Les réflexions sont profondément marquées par la reconnaissance de l’autodétermination de genre, des combats LGBTQIA+, par la pensée décoloniale, mais aussi par la pandémie du COVID-19 et les guerres et génocides en cours, notamment en Palestine — comme en témoigne la postface de Judith Butler, « Regarding Vengeance, Vulnerability, Grievability, and a Future for Israel-Palestine » (p. 159-169). L’ouvrage de Mario Telò prouve que la tragédie grecque peut nous inviter à penser d’autres formes possibles de socialisation pour faire communauté et être ensemble, avec nos différences et nos forces.

