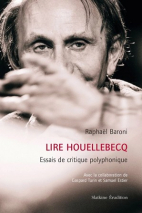
Les facteurs textuels et contextuels de la réception : le texte littéraire au prisme du lecteur
1Bien que le titre puisse faire penser à une étude consacrée à l’œuvre de Michel Houellebecq (lors d’une conférence à Saint-Etienne à laquelle j’ai assisté, l’auteur lui-même a d’ailleurs reconnu a posteriori — non sans une certaine ironie — que son choix de titre pourrait avoir orienté les lecteurs dans cette fausse direction), l’essai de Raphaël Baroni analyse plutôt les mécanismes qui sont à la base des jugements que les lecteurs formulent lors de la lecture des textes narratifs. Il s’agit en l’occurrence, pour le dire avec les termes que Baroni emprunte à Liesbeth Korthals Altes, de « passer d’une herméneutique à une méta-herméneutique », c’est-à-dire d’interpréter non pas les livres mais la façon dont les livres sont lus1. L’auteur, tout en adoptant comme point de départ la réception souvent problématique des œuvres de Houellebecq, se propose de « dégager les facteurs, aussi bien textuels que contextuels, qui conditionnent telle ou telle interprétation » (p. 10). Le texte a par ailleurs l’ambition de faire avancer la réflexion critique sur la question des valeurs littéraires, qui n’a été exploré que marginalement par la critique2.
2L’auteur s’inscrit dans la continuité du fameux essai de Roland Barthes sur « La Mort de l’auteur », où ce dernier posait la question « qui parle ainsi ? » à propos de certains énoncés de la nouvelle Sarrasine que le lecteur ne pouvait pas attribuer avec certitude ni à l’individu Balzac, ni à l’auteur Balzac, car à travers le texte pouvaient s’exprimer bien d’autres voix encore, par exemple celles de la doxa romantique ou de la « sagesse universelle ». Après Barthes, même si Raphaël Baroni ne le cite pas, Philippe Hamon dans son ouvrage Texte et idéologie (1984) s’était également interrogé sur l’effet-idéologie véhiculé par les textes littéraires, tout en se focalisant sur la présentation du héros en tant que catalyseur de ce phénomène. Plus précisément, dans le troisième chapitre, intitulé Personnage et évaluation, Hamon pointait du doigt les énoncés évaluatifs qui ne sont pas facilement attribuables à une source précise. Dans ces cas, à qui faut-il imputer les jugements présents dans les différents textes ? À l’auteur ? Au narrateur ? Au personnage ? À la doxa ?
3Mais si Barthes avait renoncé à « démêler les voix » (p. 35), tout en suivant l’argument selon lequel les énoncés fictionnels ne doivent pas être interprétés comme des énoncés « sérieux », Raphaël Baroni est convaincu qu’aujourd’hui on ne peut pas (voire plus) évacuer la question en invoquant la soi-disant « clôture textuelle » des œuvres (p. 35-36), qui parlent et agissent en dehors du texte. Il essaie donc de creuser cette question à travers une critique polyphonique (p. 12), c’est-à-dire à travers l’étude de l’hétérogénéité énonciative de la fiction, qui permet de « penser la multiplicité des rapports que nous sommes en mesure d’établir entre un texte littéraire et les sources qui en assument la responsabilité ou qui en garantissent la valeur véridictoire » (p. 31).
4Tout en réfléchissant sur le sujet, Raphaël Baroni a donc choisi de se pencher sur un cas que l’on pourrait qualifier de limite, c’est-à-dire sur les romans de Michel Houellebecq, lesquels conduisent « différents lecteurs à attribuer des valeurs contradictoires à un même texte » (p. 10). Mais quelles sont les raisons de cette production kaléidoscopique d’interprétations différentes ?
5Pour y répondre, Raphaël Baroni s’appuie tout particulièrement sur les travaux de Jérôme Meizoz et de Liesbeth Korthals Altes. Meizoz a souligné l’importance d’analyser la posture auctoriale afin de mieux interpréter les textes littéraires. Selon ce dernier, la manière dont un écrivain se met en scène, tant dans ses œuvres que dans l’espace public, influe directement sur la réception de ses textes3. Ce positionnement, qu’il soit explicite ou implicite, constitue un élément clé de la compréhension des œuvres et de leur impact sur les lecteurs. Savoir comment l’auteur se positionne face à son texte serait donc incontournable selon le critique « pour donner sens et forme à la lecture » (p. 37).
6Encore à propos de la posture auctoriale, avant de se pencher sur l’analyse des œuvres de Houellebecq, Raphaël Baroni compare le procès qui avait été intenté à Flaubert pour immoralité avec les accusations adressées à Houellebecq. Le critique, pour ce qui est du cas de Flaubert, mentionne la posture « réaliste » invoquée par son avocat, c’est-à-dire le fait que Flaubert soit un témoin neutre (et donc pas responsable) des cas qu’il présente. Si Flaubert se démarque des propos de son héroïne, il faut quand même avouer qu’il avait été accusé en raison d’une forme de discours (le « discours indirect libre ») que la critique littéraire n’avait pas encore identifié. Il s’agit d’une forme dans laquelle le lecteur doit décider lui-même « s’il lui faut prendre ce discours comme expression d’une vérité ou d’une opinion caractéristique du personnage4 », et donc précisément d’un cas où l’énonciation est ambiguë. Certes, comme Raphaël Baroni l’explique bien ensuite, Flaubert et Houellebecq diffèrent dans leurs stratégies. Si Flaubert s’était défendu en prétendant ne pas prendre en charge les propos de son héroïne, se limitant à décrire son comportement et ses pensées en tant que témoin externe, Houellebecq non seulement ne prend pas de recul par rapport à certains énoncés contraires à la « bien-pensance » que l’on trouve dans ses romans, mais il tend à brouiller les frontières entre ses opinions et celles énoncées par ses personnages lors d’entretiens et d’apparitions publiques. C’est cela qui fait dire à Jérôme Meizoz que les écrits et la posture de Houellebecq se donnent dès lors solidairement « comme une seule performance5 ».
7Certains propos houellebecquiens posent des problèmes d’interprétation car ils se présentent comme une « vérité indiscutable » (p. 40) alors que cette dernière n’est pas universellement partagée (des exemples de cela pourraient être le postulat de la non-existence de Dieu ou les propos à l’encontre de l’Islam ou du féminisme). Selon Raphaël Baroni, la posture auctoriale de Houellebecq se caractérise par la combinaison d’un point de vue ancré dans une expérience individuelle avec la prétention à une référentialité élargie (p. 42). Houellebecq réaliserait cela à travers des énoncés impersonnels prétendant se référer à des « vérités générales » (p. 45), tout en les associant au vécu de personnages ou de narrateurs possédant de nombreux points communs avec l’auteur.
8Comme le souligne Raphaël Baroni, dans le réalisme contemporain les écrivains admettent généralement leur incapacité à décrire des expériences humaines ou des sensations qu’ils ne connaissent pas personnellement. Cette limite devient problématique lorsque les textes mettent en scène des positions controversées. Houellebecq, quant à lui, rejette toute lecture autobiographique de son œuvre, tout en affirmant essayer d’exprimer une certaine « vérité humaine en générale » (p. 78), ce qui soulève les problèmes évoqués précédemment.
9Selon Pierre Jourde il existerait une troisième voie, c’est-à-dire le fait qu’un « personnage n’est pas son auteur, mais une figure possible de sa personnalité, une potentialité qu’il a plus ou moins développée dans la réalité. “Ce qu’on pourrait être et qu’on n’est pas”, dit justement Houellebecq dans Lire6 ». Houellebecq pourrait donc choisir de donner voix à une « part malsaine de lui-même », explorant celle-ci avec le regard analytique du romancier.
10Dans la cinquième section de son livre intitulée « Peut-on lire Houellebecq ? », Raphaël Baroni et Samuel Estier, qui corédige ce chapitre, s’interrogent sur ce qui a rendu illisible, pour certains lecteurs, Les Particules élémentaires, paru en 1998, à une époque où l’auteur n’était pas encore aussi connu. Il s’agit d’un roman qui avait choqué une partie du public en raison des thématiques traitées ainsi que de la discontinuité des registres (p. 92). Selon Korthals Altes, ce livre a eu le pouvoir de remettre en lumière la question de la position de l’auteur, une problématique que la critique avait auparavant évacuée7. Les jugements qui avaient été adressés aux Particules élémentaires se situent en effet souvent sur le plan éthique. En littérature, cela met en jeu la notion d’éthos, c’est-à-dire l’image que le lecteur se construit de l’écrivain, ce qui le conduit, par exemple, à le tenir pour responsable du contenu de son roman8. Ainsi, malgré le caractère fictionnel de l’œuvre, le lecteur perçoit une voix propre à l’auteur dans les propos énoncés dans les textes. Cet éthos se construit non seulement à partir du « texte » lui-même, mais aussi du « contexte », de la « posture publique » de l’auteur et de ses « interventions » sur la scène médiatique (p. 94). La prétention des romans de Houellebecq à parler de « vérités » humaines ou sociales serait donc à l’origine de son « accusation morale », car l’auteur aurait rendu poreuses les frontières entre ses discours et ceux tenus par ses personnages.
11Si la critique, à l’époque de la parution des Particules élémentaires, hésite encore sur le statut à donner à l’auteur (en 2010 Houllebecq se voit attribuer le prix Goncourt pour La Carte et le territoire, roman beaucoup plus « consensuel »), en 2015, lors de la parution de Soumission, tout « s’emballe ». Raphaël Baroni et Samuel Estier pointent du doigt deux facteurs qui contribuent à rendre « illisible » ce dernier texte. Le premier facteur est à attribuer à l’attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier, qui correspond également à la date de parution du livre. La réalité et la fiction semblent alors se rencontrer de manière violente. Le second facteur est à imputer au flux de commentaires qui accompagnèrent la sortie du livre, dans un contexte médiatique déjà marqué par la publication du livre de Zemmour, Le Suicide français. Comme cela transparait dans les discours des Internautes recueillis à ce moment charnière, l’illisibilité, dans le cas de Soumission, serait à attribuer tout particulièrement au thème de l’« islamisation de la société française », hautement sensible sur un plan social et politique (p. 98). On voit ainsi comment un contexte, plus ou moins accidentel, peut conditionner le cadrage interprétatif du roman et son évaluation.
12Dans la sixième section de son ouvrage, Comment débusquer la voix d’un auteur dans sa fiction ?, Raphaël Baroni analyse la rhétorique des énoncés houellebecquiens, en mettant en lumière les ambiguïtés énonciatives qui complexifient l’interprétation du texte. Si certaines déclarations, comme les propos racistes du personnage de Bruno dans Les Particules élémentaires, sont immédiatement discréditées par leur propre absurdité et par le manque de fiabilité du personnage, d’autres discours, notamment antiféministes, apparaissant de manière plus systématique et, étant prononcés par des personnages plus « fiables », ils posent davantage de problèmes. L’ambiguïté naît également du risque de confusion entre la voix impersonnelle du narrateur et celle de l’écrivain, déplaçant l’enjeu de la lecture vers des interprétations possiblement divergentes. Comme le souligne Langevin (2014), cette polyphonie éthique dépasse le cadre purement littéraire et artistique pour s’ancrer dans les valeurs du lecteur, transformant ainsi la réception du texte en un espace de débat qui excède le domaine de la fiction.
13Vers la fin de son essai, Raphaël Baroni, avec la collaboration de Gaspard Turin, se consacre également à l’analyse transmédiale d’un album réalisé en 2000, où Houellebecq chante ou déclame ses poèmes sur une musique composée par Bertrand Burgalat. Selon les deux auteurs, la fusion entre l’œuvre littéraire et la voix de Houellebecq « n’apparait nulle part plus évidente que dans l’album Présence humaine » (p. 130), étant donné que cette fusion se réalise sur un plan essentiellement prosodique, en rendant audible une certaine tonalité, « ironique, détachée, fragile, triviale » (p. 130). Cette présence charnelle de l’auteur s’opposerait à la confusion entretenue par les médias à propos de la persona de Houellebecq, comme si la voix, « très audible dans ses œuvres, devait se limiter à la (re)connaissance de ses opinions personnelles » (p. 130). Raphaël Baroni met par ailleurs en évidence le caractère « multi-générique » et « multi-médiatique » (p. 135) de l’œuvre de Houellebecq, qui la transforme en une véritable « narration transmédiatique », selon le sens qui en donne Jenkins d’une dispersion des éléments de la fiction à travers de multiples canaux de diffusion9. Houellebecq, tout en multipliant ses apparitions publiques mais également les images qu’il donne de lui, devient ainsi « un être à la fois proche et inaccessible » (p. 137).
14En s’appuyant sur le cas Houellebecq, Raphaël Baroni met en évidence une mutation majeure dans la réception des œuvres littéraires : l’illisibilité d’un texte ne dépend plus seulement de sa forme, mais avant tout de son contexte et de son contenu thématique. Pour certains lecteurs, l’œuvre de Houellebecq paraît illisible parce qu’elle soulève des questions sur la responsabilité morale de l’auteur et sur les relations complexes entre les romans et leur contexte médiatique ou politique. La frontière entre fiction et réalité s’amenuise, entraînant une perte d’autonomie des productions fictionnelles au profit d’une lecture de plus en plus ancrée dans le contexte biographique. Ainsi, l’auteur, loin d’être « mort », n’aurait jamais été aussi vivant ! Cette dynamique participe à la construction d’une figure de l’écrivain à la fois intime et intouchable, où le processus de starification transforme Houellebecq en une véritable « icône », objet d’un culte presque religieux. Lire Houellebecq analyse avec finesse cette tension entre l’auteur, son œuvre et son image publique, éclairant ainsi les enjeux contemporains de la réception littéraire.

