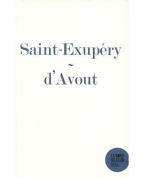
De l’aube à l’être, une aventure ardente
1Paru en février 2025 dans la collection « Études de style » aux éditions Le Bord de l’eau, l’ouvrage d’Aurélien d’Avout propose une plongée inspirante dans l’écriture et la morale exupéryennes, à partir de l’étude stylistique et littéraire du chapitre onze de Pilote de guerre publié en 1942, reproduit intégralement en ouverture du livre (p. 9-14).
2La fable est la suivante, simple, apparemment anecdotique, mais en réalité pleine d’enseignements comme le montre l’auteur : situé au tiers du livre, le chapitre onze de Pilote de guerre relate le rituel du lever du narrateur, entre « délassement du corps et vagabondage de l’esprit » (p. 67), quand il allume un feu dans sa chambre au réveil d’une nuit d’hiver passée dans une ferme où il est cantonné depuis l’hiver 1939 près de Saint-Dizier, dans le cadre d’une mission de reconnaissance aérienne réalisée le 23 mai 1940 d’Orly à Arras pour vérifier l’état d’avancement de l’ennemi allemand. Le narrateur, dont Antoine de Saint-Exupéry est le double biographique, transfigure ce feu allumé dans le froid de sa chambre en source de rêverie féconde et d’appel indirect à l’action.
3Ce « microrécit autonome » (p. 17) prend une valeur emblématique et devient le foyer incandescent des thèmes et des idées qui nourrissent l’écriture exupéryenne : cette « parenthèse enchantée de la rêverie nocturne » (p. 47) devient un « miroir de concentration » au sein du récit (p. 17) et revêt une portée herméneutique qui nous conduit, sous le guidage attentif et élégant d’Aurélien d’Avout, du feu de cheminée au feu de l’action, de la chaleur du bois à la chaleur de la vie, de la solitude à la communauté, en soulevant la question de fond qui est en fait la grande question de l’humanité : comment agir, et de quel lieu ? Cette « aube embrasée » veut faire se lever les soleils de l’action résistante et libératrice chez le peuple français ; pour nous, elle éclaire bien plus que le seul chapitre onze de Pilote de guerre, en construisant des ponts dans l’œuvre de Saint-Exupéry et en proposant des échos avec la littérature et la philosophie issues d’une navigation qui revisite de nombreux topoï et qui traverse les frontières du temps pour aller, par exemple, jusqu’à la chambre proustienne, au feu bachelardien, aux lettres des Poilus, à l’héroïsme épique ou encore aux valeurs humanistes universelles. L’approche stylistique s’y met au service d’un éclairage de la création exupéryenne qui, lui-même, met en lumière la morale et les valeurs qui animent l’œuvre et son auteur. En nous parlant du feu, il nous parle, en réalité, des fondements de l’humanité, ce qui fait résonner le sens métatextuel d’une phrase du chapitre : « Ça n’a l’air de rien, cette histoire. Or, c’était une grande aventure ».
4Cette grande aventure est celle d’une « aube embrasée », dont les lueurs peuvent être saisies grâce à une approche kaléidoscopique.
L’« aube embrasée », de la chaleur de la remémoration à l’éclat de la rêverie
5Le premier chapitre de l’ouvrage, « Autoportrait à l’édredon » (p. 7-17), présente les conditions de sa publication ainsi que les buts poursuivis par Antoine de Saint-Exupéry. D’emblée, la dimension politique est mise en avant par Aurélien d’Avout pour éclairer le contexte, mais aussi l’esprit de l’ouvrage. En effet, Pilote de guerre paraît en février 1942 aux États-Unis, puis en novembre 1942 en France durant l’exil américain de Saint-Exupéry ; ce « témoignage sensible et saisissant sur son expérience combattante » (p. 8) cherche à convaincre l’opinion américaine de soutenir les Alliés et de mettre à leur service leur force militaire et industrielle, ainsi que d’appeler les Français à la poursuite de la lutte contre le nazisme.
6Récit d’une mission de reconnaissance aérienne, Pilote de guerre mêle la narration, les souvenirs et la réflexion, tricotant les fils d’une histoire militaire et d’une conscience humaniste, de la réalité et du rêve, ce qu’Aurélien d’Avout aborde aussi d’un point de vue stylistique en le rattachant, dès le début de l’ouvrage, au mélange du présent d’énonciation, ancré dans la situation, et du passé, proche ou lointain, remontant jusqu’aux souvenirs d’enfance. D’emblée, le commentaire stylistique se fait le témoin et l’allié du décryptage littéraire du récit ; ainsi, l’étude des temps verbaux se dote d’une dimension tout à la fois pragmatique et métaphysique pour donner lieu à une « poétique de la remémoration » (p. 9) qui se niche dans la rêverie surgie d’un feu de cheminée à raviver au réveil d’une nuit, narrée dans le chapitre onze, et qui symbolise une vie à alimenter, un rite de passage vers une aventure à rêver, qui s’avère bien plus prometteuse, parce qu’elle augure une « aube embrasée », que la réalité de la guerre.
7Aurélien d’Avout explique le choix exupéryen de valoriser la rêverie plutôt que le combat héroïque par le refus du mal, l’union autour de valeurs fondatrices, l’inscription de l’individu dans une communauté et la valorisation du rite de passage sacrificiel. Pour autant, le chapitre onze de Pilote de guerre ne se départit pas d’un certain registre épique, défini comme l’expression d’une « lutte collective » (p. 15) et comme une réponse à une « vision du monde où les héros exceptionnels décident du sort des groupes qu’ils représentent1 » (p. 15). Aurélien d’Avout étudie l’inscription par Saint-Exupéry du topos du repos du guerrier dans une réflexion sur l’aliénation du corps en temps de guerre, à travers un récit, qui, tout en se donnant pour anecdotique, est en fait loin de l’être. En effet, le narrateur raconte ses déplacements, à trois reprises, de son lit à l’âtre pour allumer le feu, présentés comme une aventure, une traversée polaire et une traversée du désert, un surpassement héroïque de soi procurant une récompense inouïe, celle de la découverte d’un trésor inattendu offert par la saveur de la chaleur du feu. Mais l’épisode est en réalité empli d’une leçon de vie, avec l’espoir d’un nouveau commencement, malgré la clôture du chapitre sur une chute narrative présentée comme un retour à la réalité à travers le rappel à la mission aérienne ; ce désenchantement absolu replonge le narrateur dans la vraie vie, vide, technique et dangereuse, le contraire d’un rêve dont la beauté est ainsi, à rebours, mise en valeur.
8D’inspiration autobiographique, le second chapitre, « Une chambre à soi » (p. 19-27), se déploie entre rêverie et réalisme, tout en développant une tonalité merveilleuse, déjà inscrite dans le toponyme d’Orconte, village où l’auteur cantonne dans une ferme durant l’hiver 1939. Le sommeil et le rêve alternent avec la lumière et les éclairs dans une chambre stimulante pour l’imagination, qui rappelle celle de Combray chez Marcel Proust et qui alterne les renvois métaphoriques au ciel et à la terre dans un « va-et-vient typique de l’écriture exupéryenne, tendue entre l’appel des hauteurs et la terre des hommes » (p. 21), entre ouverture et clôture, entre richesse intérieure et dénuement mobilier. Ce « décor de sagesse » (p. 21) se situe dans un hors temps propice à l’évasion de l’esprit et au recentrement sur l’essentiel où le peu devient un « monde plein » (p. 23), apte à ouvrir sur un espace infini sous l’effet de la remémoration, encore comme chez Proust (p. 23). La chambre d’Orconte renvoie aussi à la chambre enfantine rassurante, à la cellule monacale, mais aussi à l’oikos (p. 26), notre maison-monde. Elle prend une dimension ontologique assise sur la valeur d’inaccompli et de duratif de l’imparfait de l’indicatif du premier verbe du chapitre, « j’habitais » : la remarque stylistique est propulsée avec bonheur vers une dimension spirituelle qui fait sens en renvoyant le lecteur, d’Antoine de Saint-Exupéry comme d’Aurélien d’Avout, à la question d’habiter le monde pour y trouver sa place tout en dépassant les frontières et les clôtures grâce à un ancrage solide dans un univers qui, lui, se défait pendant cette drôle de guerre.
9Les remarques stylistiques sont nourries de renvois aux lettres écrites par Antoine de Saint-Exupéry, à ses autres œuvres pour montrer en quoi Pilote de guerre est typique d’une écriture et en quoi ce chapitre onze est la marque d’une signature, mais encore à des œuvres d’autres auteurs comme Marcel Proust et sa chambre de Combray (p. 20, 23), René Descartes et son repli dans la solitude apaisante de sa chambre (p. 22), Gaston Bachelard et sa poétique de l’espace (p. 25). C’est l’occasion pour Aurélien d’Avout de croquer la figure de l’auteur près de son poêle, faisant émerger un nouveau topos très stimulant pour l’imaginaire du lecteur et permettant d’inscrire Saint-Exupéry dans une grande famille littéraire, laquelle s’approche grâce aux ressources d’une critique thématique qui pourrait faire écho aux démarches de Jean-Pierre Richard ou de Michel Collot. La chambre tisse des fils intra et extradiégétiques, « poupée gigogne » (p. 24), mais surtout véritable motif littéraire remis au jour par Aurélien d’Avout.
L’« aube embrasée », en compagnie des étoiles volées à la nuit
10Le rapport au corps en temps de guerre est évoqué dans le troisième chapitre, « Renouer ses morceaux » (p. 29-35), où le recours au topos du repos du guerrier permet de souligner l’état d’esprit serein, hédoniste et soucieux du moment à vivre pleinement dans un temps suspendu : déconnecté de la guerre, cet « instant volé » (p. 29) assure la complétude de l’être.
11Le lit douillet, présenté comme un cocon maternel dans cette chambre à réchauffer, offre un réveil matinal simple et joyeux — comme ailleurs chez Saint-Exupéry, par exemple dans Terre des hommes —, source d’une béatitude salvatrice. Le feu rallumé évoque aussi d’autres feux mentionnés dans des récits de guerre et des lettres de Poilus, promesses consolatrices de réconfort et de paisibles retrouvailles ; ici encore, Aurélien d’Avout se saisit de l’épisode factuel pour proposer un panorama synthétique de quelques apparitions de ce topos littéraire, et pour évoquer l’importance, dans Pilote de guerre, de l’opposition entre le froid et la chaleur, et entre la souffrance physique et la sérénité spirituelle. Le soldat étant dépossédé de son corps devenu l’image du pays défait et simple outil de guerre réclamé par le combat comme le souligne la métaphore filée de la dette et de l’huissier au chapitre onze de Pilote de guerre, le narrateur renoue avec lui dans le douillet cocon du lit qui le rend à nouveau amical et fraternel, à travers des métaphores et personnifications du corps, qui le font osciller, tantôt simple machine, tantôt cher ami, entre la réification et l’humanisation.
12Dans le chapitre quatre, « Structure d’un songe » (p. 37-45), le texte étudié est une nouvelle fois le foyer qui rassemble divers faisceaux de l’écriture exupéryenne. L’extrait fait rayonner les thèmes chers à l’auteur ainsi que les procédés récurrents de son écriture. L’étude d’Aurélien d’Avout éclaire donc bien au-delà du seul chapitre, et dresse des ponts avec le reste du récit, mais aussi des passerelles avec l’œuvre entière de Saint-Exupéry. En effet, la nuit, écrin de ce réveil, offre l’espace d’une « échappée hors des calculs techniques et des raisonnements liés à la guerre » (p. 37), lieu de rencontres entre les choses et les êtres, qui suscite de multiples associations d’images, nourries par les mentions des sens de la vue, l’odorat et l’ouïe, jusqu’à faire surgir la « magie du moment » (p. 39). Cette nuit offre à Aurélien d’Avout l’occasion d’analyser la présence d’allitérations et de rythmes syntaxiques qui accordent la langue à ce hors-temps harmonieux capable de faire surgir des échos phoniques réguliers et des structures ternaires équilibrées et majestueuses pour inscrire les sensations dans la matière même de la langue. Aussi le rythme ternaire syntaxique fait-il sens, car il est l’image dans la phrase de la composition ternaire de l’action racontée dans le chapitre : sortie du lit pour allumer le feu, retour dans la chaleur des draps, nouvelle sortie du lit vers le feu.
13Alors, Aurélien d’Avout met en lumière la transfiguration de l’anecdote en fantasme, voire en mythe. Pour cela, les déplacements du narrateur dans la chambre se transforment en épopée glaciaire ou désertique qui rappelle les romans de Jules Verne et les propres aventures d’Antoine de Saint-Exupéry. Faisant écho au topos pictural et littéraire des âges de la vie — Titien, Friedrich, Klimt, Leiris —, le moment raconté revêt une dimension paisible et lisse qui s’oppose aux soubresauts heurtés du temps de la guerre. Cette anecdote d’un passage répété du lit au feu dans la chambre tisse en réalité les fils de l’histoire de l’Homme et promet un épanouissement, comme si le narrateur se faisait voyant. Ce « pouvoir de relance spirituelle » (p. 43) rappelle d’ailleurs à Aurélien d’Avout le poète hugolien et sa faculté à dépasser l’apparence des choses, à travers une « élévation » (p. 43) favorisée par la répétition spiralaire du geste d’attiser le feu. Une herméneutique naît de cette approche empirique fournie par une rêverie typiquement bachelardienne, qui, parce qu’elle favorise les libres associations, témoigne de la « passion du lien qui anime Saint-Exupéry » (p. 45), dès lors s’inscrit aussi dans la lignée d’Arthur Rimbaud qui tend ses « chaînes d’or d’étoile à étoile2 ».
14Cependant, comme l’étudie le cinquième chapitre de l’ouvrage, « Dialectique de la mélancolie » (p. 47-53), ce « songe prometteur qui sonne désormais creux » (p. 47) est brutalement rompu par le retour à la réalité à la fin de l’extrait analysé, où le narrateur est appelé par son compagnon de vol. La dimension prométhéenne de l’extrait, alimentée par le feu de cheminée qui promettait une renaissance, se solde par une chute, amère et déceptive, qui inscrit la perte dans l’écriture. À rebours, l’épisode chimérique se transforme en « caverne de Platon » (p. 47) et rappelle la réalité de la prégnance de la guerre alentour. Ce retour à la réalité s’accompagne d’un changement de temps verbaux, puisque l’imparfait itératif est remplacé par un présent d’énonciation : « Mais il n’est plus de feu pour me faire croire à la tendresse », écrit Saint-Exupéry pour ouvrir le dernier paragraphe de ce chapitre. Comme la rêverie s’achève, la phrase se raccourcit, le souffle se raréfie, la joie laisse place à la mélancolie, la présence absolue est remplacée par le sentiment de la perte marqué par l’anaphore « Il n’est plus ». Le retour dysphorique à la réalité est une chute spirituelle dans le « spleen » (p. 49) causé par la vanité de la mission aérienne commandée dans cette période de drôle de guerre. Aurélien d’Avout voit dans cette chute dans la mélancolie un reflet autobiographique de l’état d’esprit de Saint-Exupéry exilé aux États-Unis de décembre 1940 à avril 1943, provoqué par l’« alignement des peines » (p. 51) engendré par les épisodes successifs de la disparition de son frère, de la Première Guerre mondiale, du sentiment d’être privé de la capacité d’agir, de la solitude éprouvée à New York où il ne se mêle pas aux autres exilés français en raison de ses opinions politiques. Mais, paradoxalement, cette dysphorie mélancolique ne contrevient toutefois pas à l’impression d’enthousiasme et de vitalité dégagée par le chapitre, et même le récit entier, car Pilote de guerre s’achève sur l’expression d’une confiance en l’avenir, portée par le souffle de l’enthousiasme et de l’espoir : l’idéal prime sur le spleen, la joie est en fin de compte appelée à vaincre.
L’« aube embrasée », dans les étincelles d’une langue résistante
15Le sixième chapitre de l’ouvrage, « L’ordre des mots » (p. 55-63), s’intéresse aux ressources d’un langage permettant de dépasser la perte de sens suscitée par l’inutilité de la mission aérienne (les informations récoltées ne seront pas transmises au commandement avec lequel les liens sont coupés). Solide « rempart » (p. 55) élevé contre le désordre de la guerre, la langue fait face à l’incohérence et à l’absurdité.
16Cette « impression de stabilité » (p. 56) offerte par Pilote de guerre se fonde sur une « homogénéité sémantique » (p. 56) suscitée par les répétitions lexicales, les polyptotes, les anaphores et les polysyndètes, dont les échos engendrent un « nouage du discours » (p. 56). Ce qu’Aurélien d’Avout appelle « rhétorique classique » (p. 57), nourrie de culture scolaire, crée une architecture qui transforme l’œuvre en une citadelle charpentée par des phrases régulièrement structurées et par des échos lexicaux solides. Outre les répétitions, des « chaînes métaphoriques » (p. 58), dont celles du chien de berger qui veille, de l’huissier qui surveille et de la graine qui va germer, renforcent la structure du récit.
17Toutefois, Aurélien d’Avout note que le chapitre onze se distingue du style général de Pilote de guerre en ce qu’il inscrit dans la langue la désagrégation liée à la guerre : négations, parataxe, brièveté des phrases grèvent, dans le chapitre, le souffle de l’héroïsme. Cependant, si le style y reste classique, comme pour « absorber l’onde de choc de la défaite » (p. 60), c’est à une « refondation du langage » (p. 60) que l’on assiste. Il s’agit en effet de restaurer le sens, d’user des mots selon un usage réglé et de rendre sa substance au langage, pour contredire la perte de signification engendrée par la drôle de guerre. Se préserver de l’emphase de propagande et de la gratuité des métaphores permet de rester juste et d’écarter les vertiges de l’illusion grâce à une langue simple qui sacrifie aux images seulement pour s’inscrire dans une tradition parlante et rassembleuse, comme celle de la graine.
18L’œuvre se construit, donc, en opposition au délitement engendré par la guerre : elle est « garant de l’ordre » (p. 62) contre le désordre de la guerre, grâce à une langue qui se veut résistante en restant classique.
L’« aube embrasée », ou la lumineuse promesse d’une morale et d’une civilisation
19C’est aussi parce qu’il diffuse la morale de l’engagement de Saint-Exupéry que le récit dépasse le statut de l’anecdote, comme le montre Aurélien d’Avout au chapitre sept, « Une morale de l’engagement » (p. 65-74). Sans toutefois transformer les pilotes en héros, le récit est un hommage à leur sens du sacrifice. En effet, le repos à la ferme raconté au chapitre onze de Pilote de guerre n’est ni un refuge dans la passivité ni un retrait du monde, mais plutôt l’occasion de la manifestation d’un stoïcisme propre à lancer une action engagée, jusqu’au sacrifice. Le lever matinal inaugure la mise en branle de la volonté de l’homme qui se projette dans le monde. Alors, alimenter le feu de la cheminée revient à alimenter le feu de l’action pour susciter des retrouvailles avec le dehors. Le sens du devoir de l’action et de l’engagement fonde l’autorité de l’homme ; et même plus, suivant le sens étymologique du nom « autorité », il l’augmente : tout en le confirmant dans son être et dans son essence, il le conduit à vivifier ses potentialités et le pousse à agir. Aurélien d’Avout rattache cela au « volontarisme » (p. 71) de Saint-Exupéry, et à sa détermination à participer à la communauté des hommes en exaltant sa foi en l’action. Ce n’est ni le désespoir ni l’honneur qui pousse le narrateur à s’inscrire dans l’engagement et à dépasser ses limites, mais plutôt le sens de la grandeur de l’homme qui se lit dans le don de soi, en vertu d’une raison supérieure. Il faut vivre cette aventure de l’esprit qui se veut universelle et portée par le souffle d’un humanisme confiant et responsable. « Défense et illustration du principe de civilisation » (p. 76), Pilote de guerre cherche à susciter l’engagement du peuple en lui faisant sentir la grandeur de la France, mais aussi de l’espèce humaine.
20Dans le huitième chapitre, intitulé « La civilisation du feu » (p. 75-81), Aurélien d’Avout interprète l’épisode du feu à rallumer au réveil comme la marque de la civilisation, de la communion et de l’accueil chaleureux et altruiste, promouvant « une éthique de l’accueil » (p. 77). Alors, est rendue possible, à travers une amitié authentique et profonde qui rappelle l’antique philia, une « communauté d’âmes » (p. 77), facteur de l’union dans le pays et dans le monde en ces temps de guerre, ce qui dénonce, en passant, la haine de l’autre qui embrase le pays. Outre l’hospitalité, le feu incarne le groupe et la faculté de rassemblement dans la tribu, ainsi que la réconciliation, à rebours de la dispersion du peuple dans la défaite de 1940. Foyer de l’énergie, le feu représente la concentration de l’action, antithèse d’un écoulement liquide qui symboliserait la perte et la dissolution, et symbole de la création qui donne vie et qui s’oppose à un feu barbare destructeur.
21Le feu vient infuser l’ouvrage, lui-même transformé en « parole ardente », — titre du chapitre 9, (p. 83-89) —, et qui est susceptible d’attiser la flamme de l’engagement, de réveiller la conscience et l’action libératrice chez le lecteur de 1940. C’est l’affirmation de l’énergie contre le poids de l’inertie, ce qui alimente, dans une perspective métatextuelle, la puissance rayonnante de la création, que l’on va retrouver dans Le Petit Prince chez l’allumeur de réverbères. C’est pourquoi ce chapitre onze de Pilote de guerre est un carrefour majeur du récit, en ce qu’il concentre la vitalité et l’espoir qui en animent l’ensemble. Comme Aurélien d’Avout le souligne, l’ouvrage a la chance de ne pas être censuré ; il devient dès sa sortie en France en novembre 1942 chez Gallimard un succès de librairie avant d’être retiré de la vente en février 1943 et de devoir rejoindre l’édition clandestine, abritant la graine de la résistance.
22Le chapitre onze de Pilote de guerre, « au carrefour du récit de guerre et de la méditation philosophique » (p. 91) concentre aussi de nombreux contrastes en alliant la vie et la mort, la nuit et la lumière, la mélancolie et l’espoir, comme le rappelle Aurélien d’Avout dans le chapitre « Une aube miniature » (p. 91-92). Dénonçant la guerre, il ne cesse pourtant d’appeler à s’y unir pour remporter la victoire. Pilote de guerre est une œuvre d’équilibre, qui fait se rejoindre, dans une « aube embrasée », un feu protecteur et un feu destructeur pour valoriser le lever de l’être en diffusant l’aspiration à l’union qui, seule, peut garantir de vivre une véritable et authentique aventure humaine. C’est bien ce qu’annonce déjà le narrateur dans la phrase précédant le début du chapitre onze : « Peut-être comprendrai-je plus tard que ma seule véritable aventure de guerre a été celle de ma chambre d’Orconte3 ».
*
23Avec L’Aube embrasée, Aurélien d’Avout nous permet de comprendre ce qui illumine l’écriture et l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry. Ce feu de chambre raconté au chapitre onze de Pilote de guerre recouvre une dimension littéraire et ontologique que l’approche stylistique met en valeur grâce à l’analyse des images et des topoï qui alimentent cette écriture hybride à la croisée du récit de guerre, de la remémoration et du flux de conscience. Comme le montre Aurélien d’Avout, ce qui se lève, avec l’« aube embrasée » ainsi racontée, c’est le goût de l’aventure humaine, la foi dans l’engagement, le pouvoir de résistance de la langue et la confiance dans le souffle de la création. Dans un singulier effet de mise en abyme, cela résonne d’ailleurs particulièrement avec la vitalité et les valeurs des éditions Le Bord de l’eau dirigées par Jean-Luc Veyssy, qui témoignent d’un profond attachement au sens, à l’éthique et à l’action collective4. Et cela fait aussi profondément écho à l’identité de la collection « Études de style » qui y est dirigée par Nicolas Martin et qui cherche à « déchiffrer l’énigme d’un style porté à incandescence5 ».
24Dans L’Aube embrasée, Aurélien d’Avout contextualise et élargit son étude en proposant de nombreuses références très éclairantes au corpus critique portant sur l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, mais aussi à d’autres œuvres relevant de la littérature de guerre. Ainsi, en étudiant les procédés stylistiques et textuels mis en œuvre dans le chapitre onze de Pilote de guerre, Aurélien d’Avout nous propose une promenade humaniste dans l’histoire des idées et réactive de nombreux souvenirs littéraires et philosophiques, dont on peut citer pêle-mêle Verne, Proust, Kessel, Éluard, Aragon et Gracq, ou encore Homère, Platon, Marc Aurèle, Pascal, Descartes et Bachelard. Il ne s’agit donc pas seulement d’un feu ni d’un chapitre de récit, mais bien de l’inscription d’une écriture dans une histoire de la pensée ainsi que du rôle fondateur de la création pour l’humanité, nous enseignant comment être de la terre des hommes.
« Ça n’a [vraiment pas] l’air de rien, cette histoire… »

