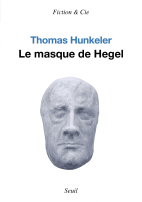
La véritable histoire d’un faux authentique
1« Larvatus prodeo » déclarait Descartes. Précisions toutefois, pour ne pas tromper notre lecteur, qu’il ne l’a jamais déclaré, puisqu’il ne publia pas ce texte de jeunesse de son vivant. « De même que les comédiens, attentifs à ne pas laisser voir la rougeur sur leur front, mettent un masque ; de même moi, au moment de monter sur le théâtre du monde, où je me suis tenu jusqu’ici en spectateur, je parais masqué1. » Caché, dissimulé, sous couvert. C’est en avançant masqué que Descartes construit sa posture ou son imposture sur la scène du monde : il deviendra donc personnage public, mais masqué. Et rappelons-le : il publiera le Discours et les Essais sans nom d’auteur2.
2Aussi le masque est-il le signe du secret, du mystère qui ne doit pas être regardé de face, mais toujours de manière oblique et avec discrétion. Le masque fonctionne comme un lien entre ce qu’il dévoile et ce qu’il éclipse. Selon Roland Barthes, il serait propre à la littérature d’occulter son caractère littéraire, tout en le montrant à travers le geste même de l’écriture : « Toute Littérature peut dire : “Larvatus prodeo”, je m’avance en désignant mon masque du doigt3. » Mais ce n’est pas la seule fois où Barthes s’approprie le syntagme cartésien, car c’est aussi sur le terrain de la passion amoureuse qu’il reprend cette devise latine : « Larvatus prodeo : […] je mets un masque sur ma passion, mais d’un doigt discret (et retors) je désigne ce masque4. » L’imposture s’installe à la fois dans le domaine de la littérature et de la passion amoureuse. L’écriture et la jouissance vont ensemble, tout comme « le goût de l’imposture » « a un contrecoup : l’enquête »5.
3Saisie de l’imposture et désir de l’enquête, ce sont les coordonnées qui articulent la démarche critique et historique de Thomas Hunkeler autour du masque mortuaire de Hegel. L’intérêt de l’auteur pour le masque est éveillé par la mention de cet objet particulier dans la correspondance d’André Breton avec Paul Éluard. Comme l’affirme Thomas Hunkeler lui-même, « l’apparition soudaine du masque de Hegel, deux ans seulement avant les commémorations du centenaire de sa mort, me parut bien curieuse » (p. 14). L’évocation du masque dans les échanges épistolaires surréalistes excite la volonté de savoir du chercheur. Son enquête ne se limite alors pas à un simple retour en arrière sur les conditions matérielles de la réalisation de ce masque : parcourant deux siècles, le xixe et le xxe siècle, sa démarche historique constitue, d’un côté, l’archéologie d’une pratique culturelle — la création de masques mortuaires — et, de l’autre, l’analyse des passions que le masque de Hegel a pu susciter, entre récupération politique et création poétique.
L’historien de la littérature en détectif
4Le point de départ de l’enquête se trouve dans la mention du masque mortuaire de Hegel dans une lettre qu’Éluard envoie à Breton en 1929, accompagnée de l’ouvrage Das ewige Antlitz. Eine Sammlung von Totenmasken (La Face éternelle. Une collection de masques mortuaires) de l’historien de l’art allemand Ernst Benkard. À sa grande surprise, lorsqu’il réussit à se procurer le livre en question chez un antiquaire, Thomas Hunkeler constate que le masque de Hegel y est absent. Il découvre rapidement que le masque n’a été ajouté qu’à partir de la troisième édition de l’ouvrage. Bien qu’un masque mortuaire attribué à Hegel soit aujourd’hui conservé aux Archives littéraires allemandes, à Marbach, la question de son authenticité se pose. Pour démêler les fils de cette intrigue, Thomas Hunkeler s’engage dans une démarche de détective qui l’invite à tenter de cerner le trouble d’identité qui se joue dans toute imposture : il visite des collections muséales, recherche d’éventuels héritiers du premier masque, fouille dans les archives. Et les indices ne tardent pas à apparaître : des témoignages contradictoires, comme ceux d’Ernst Benkard, convaincu de l’authenticité du masque, et de Walter Krieg, qui voit dans le masque un faux ; un faussaire qui fait surface en la personne d’Anton Antonopulo ; et nous pouvons même « assister » au procès intenté par le sculpteur viennois Ambros Bei contre Antonopulo au sujet des droits d’auteur.
5Je ne dévoilerai pas la décision de la justice dans ce cas, mais les indices que Thomas Hunkeler a recueillis au sujet du masque de Hegel « parlent clairement en faveur d’une forgerie » (p. 58). Le secret ainsi dévoilé permet au lecteur de jouir d’un plaisir semblable à la lecture d’un roman policier. Le discours critique tel que le pratique Thomas Hunkeler renoue avec « le paradigme de l’indice6 » : faisant preuve de vigilance, l’historien de la littérature peut « témoigner de la totalité du réel, révéler ce qui, en lui, est invisible7 ». Dans Le Masque de Hegel, sa posture est celle du détective qui cherche à dévoiler le mystère. Herméneute du réel, l’historien de la littérature pourrait ainsi s’inscrire dans une prestigieuse lignée de grands détectives comme Auguste Dupin, Sherlock Holmes ou Hercule Poirot.
Enquête sur une pratique culturelle
6L’enquête menée par Thomas Hunkeler pour déterminer l’authenticité du masque de Hegel ne se limite toutefois pas à l’histoire d’une contrefaçon, mais elle propose un retour en arrière sur la fortune et l’infortune des masques mortuaires. L’auteur entreprend l’archéologie d’une pratique culturelle : si l’usage de produire de tels masques est fort ancien,
c’est seulement dans le dernier quart du xviiie siècle que l’usage de produire des masques mortuaires commence à s’émanciper des pratiques funéraires d’une part, du simple rôle d’adjuvant sculptural de l’autre pour devenir un objet que l’on fabrique, conserve et collectionne pour lui-même. (p. 23)
7L’étude de Thomas Hunkeler bénéficie alors d’un regard croisé sur l’histoire des masques mortuaires en France et en Allemagne. Dans une démarche comparatiste, l’historien de la littérature met en relief les particularités de la création des masques mortuaires dans ces deux espaces géographiques qui, bien que relativement proches, témoignent d’un contexte historique bien différent à la fin du xviiie siècle : si, en France, le masque mortuaire gagne du terrain dans le sillage de la Révolution française, comme le raconte Marie Tussaud dans ses mémoires, en Allemagne et en Autriche, la mode du masque mortuaire doit beaucoup au culte du génie dans le contexte du Sturm und Drang.
8Comme dans un interrogatoire, cette enquête historique permet aussi à Thomas Hunkeler de donner la « parole » à Hegel en questionnant l’usage des masques mortuaires à la lumière de sa pensée. Quoique l’auteur ne découvre aucune mention du masque mortuaire dans la biographie de Hegel, il ne lui reste qu’à chercher l’opinion du philosophe au sujet de la physiognomonie et de la phrénologie telles qu’elles apparaissent dans la Phénoménologie de l’esprit, publiée en 1807. Le sujet des masques mortuaires n’est certes pas évoqué de manière explicite dans l’ouvrage de Hegel, Thomas Hunkeler réussit à tirer de sa lecture de fines déductions. Selon lui, tout comme Lichtenberg avait pris position contre les théories de Lavater dans son traité Sur la physiognomonie ; contre les physiognomonistes, Hegel « rejette l’idée qu’il y aurait une analogie naturelle entre la forme du visage et de l’esprit » (p. 28). Ce n’est pas un quelconque système de correspondances qui peut rendre compte de l’être humain, c’est seulement à travers son acte que l’homme peut être défini. Écoutons à notre tour Hegel : « L’être vrai (das wahre Sein) de l’homme est bien plutôt son acte ; c’est en cet acte que l’individualité est effective (wirklich) […] ; l’individualité se présente […] dans l’action comme l’essence négative qui n’est qu’en abolissant de l’être. » (cité p. 28) Une telle position oppose Hegel aux phrénologues de l’époque qui, à l’instar de Franz Joseph Gall ou de Carl Gustav Carus, tentent de légitimer une science du « langage des crânes ». La démarche de Thomas Hunkeler ne replace pas seulement la réalisation des masques mortuaires dans une histoire des pratiques artistiques au xviiie et xixe siècle, mais elle rend compte avec souplesse de la pensée hégélienne dans le contexte du développement des sciences au xixe siècle quand la physiognomie et la phrénologie trouveront leur application dans l’anthropologie, la médecine et la criminologie.
Récupérations de tous bords
9L’apparition du masque de Hegel n’entraîne pas seulement une enquête historique sur les origines d’une contrefaçon puisque Thomas Hunkeler met en lumière les passions qu’il suscite ainsi que les appropriations tant politiques qu’esthétiques dont il fait l’objet. Si le catalogue qu’Ernst Benkard publie en 1929 permet à un large public de découvrir les masques mortuaires de toute une série d’hommes célèbres, pendant les années 1930, les surréalistes n’étaient pas les seuls à s’intéresser au masque de Hegel. Lors d’une incursion dans les archives, Thomas Hunkeler découvre qu’en 1931, à l’occasion des commémorations du centenaire de la mort de Hegel, son masque mortuaire est repris sous la forme d’un dessin signé par un certain H. M. Wittig dans le Völkischer Beobachter, journal qui était depuis 1920 l’organe de presse du parti d’Adolf Hitler. Le dessin est accompagné d’un article de Max Wundt, historien de la philosophie à Tübingen, opposant de la république de Weimar et auteur d’une série d’ouvrages à caractère antisémite et nationaliste. La force de l’analyse de Thomas Hunkeler est de mettre au jour la manière dont Wundt propose une réinterprétation de la philosophie hégélienne à travers le prisme de la pensée « völkisch » ou « national-populaire », selon la traduction de l’auteur. L’historien de la littérature dévoile ainsi les omissions et les points aveugles d’une récupération politique au service d’une idéologie meurtrière.
La prolifique postérité d’un faux
10Revenons à présent aux surréalistes. Après son dernier ouvrage qui examinait les pulsions nationalistes dans les avant-gardes historiques entre 1909-1924, Thomas Hunkeler se penche cette fois-ci sur l’histoire du surréalisme. L’historien des avant-gardes note que « la fascination des surréalistes pour le masque en général précède leur découverte de masques mortuaires ; jusqu’à un certain point, elle l’explique sans doute aussi » (p. 95). Du catalogue qu’Éluard lui envoie, Breton cite trois masques : celui de Swift, de Hegel et de l’Inconnue de la Seine. Thomas Hunkeler éclaire les choix de Breton en relation avec la pensée surréaliste : Swift sera invoqué plus tard dans l’Anthologie de l’humour noir, l’Inconnue de la Seine s’intègre à l’imaginaire surréaliste du mystère féminin, et Hegel est représentatif pour l’évolution du surréalisme à l’époque de la publication du Second Manifeste du Surréalisme. L’étude nuancée de Thomas Hunkeler met au jour le dialogue qu’entretient Breton avec la pensée hégélienne dans le contexte de la politisation du mouvement surréaliste à la fin des années 1920. L’historien des avant-gardes revient à la fois sur les dissensions au sein du groupe surréaliste et sur les tensions qui s’installent entre la pensée surréaliste et la dialectique hégélienne.
11L’enquête historique de Thomas Hunkeler se transforme ainsi en une enquête poétique, interrogeant ce qu’il nomme « la dimension collective de la poétique du masque mortuaire » (p. 101). En effet, en 1929, La Révolution surréaliste publie un photomontage où seize membres du groupe surréaliste posent les yeux fermés à l’image des masques mortuaires. Thomas Hunkeler montre également comment la poétique des masques mortuaires reçoit une dimension personnelle, s’apparentant à un « pacte d’amitié » (p. 101) : Éluard et Breton décident d’immortaliser leurs visages dans du plâtre, et leurs masques, suspendus face à face dans l’atelier de Breton, seront immortalisés dans une photographie de Max Vaux ; plus tard, une autre image, prise par Valentine Hugo, montre les deux amis couchés côte à côte, les yeux fermés, entre les bras d’une ancre de bateau ; cette photographie sera reprise par Breton, en 1960, lors de la publication de son article « Phénix du masque ». L’ouvrage de Thomas Hunkeler rend donc compte d’une histoire connectée du fait littéraire à l’intersection avec les autres arts. Le Masque de Hegel met en dialogue l’histoire de la littérature, la création des masques mortuaires et la photographie. L’auteur fait ainsi le choix d’insérer, au cœur de l’ouvrage, une série de photographies reproduisant des images de masques mortuaires célèbres et leur appropriation par les surréalistes. À l’aide de la photographie, les masques prennent chair et accompagnent l’écriture, permettant aux lecteurs de suivre les transformations d’une pratique culturelle à travers le temps.
12*
13Lorsque l’enquête policière se transforme en une enquête poétique, le désir de vérité devient plaisir esthétique : l’ouvrage de Thomas Hunkeler relève d’un mouvement dialectique où la volonté de savoir rejoint la jouissance artistique. Le Masque de Hegel retrace l’histoire d’une forgerie : de sa création matérielle à l’invention de son mythe et à sa transformation en un élément de la poétique surréaliste. Le masque mortuaire de Hegel est le double de l’écriture, son altérité : c’est le masque qui devient visage. Mais la littérature, en se montrant du doigt, ne se dévoile pas seulement comme écriture, elle pointe aussi du doigt la mort qui « travaille le dedans de la parole comme sa trace, sa réserve, sa différance intérieure et extérieure : comme son supplément8 ».

