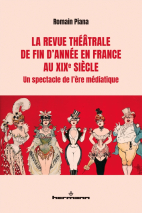
Ère médiatique et société du spectacle : les revues de fin d’année au XIXe siècle
1Dans leur introduction au dossier « En revenant à la revue », paru dans la Revue d’histoire du théâtre en 2015, Olivier Bara, Romain Piana et Jean-Claude Yon notaient que « la revue de fin d’année n’a pas encore suscité tous les travaux que son extraordinaire richesse semblerait autoriser1 ». Jalonnée par les travaux fondateurs de Paul Aron2 et de Christophe Charle3, l’étude de la revue de fin d’année est désormais largement complétée grâce à l’ouvrage de Romain Piana intitulé La Revue théâtrale de fin d’année en France au xixe siècle. Un spectacle de l’ère médiatique. Qu’est-ce qu’une revue de fin d’année ? Tous les hivers, des années 1830 à la fin du siècle, les théâtres de vaudevilles et de pièces comiques (le Vaudeville, les Folies-Marigny, les Délassements-Comiques, les Folies-Dramatiques, l’Athénée-Comique, les Menus-Plaisirs ou encore les Nouveautés) proposent, avec plus ou moins de régularité, des revues, « pièces à tiroirs dans lesquelles l’auteur fait défiler sous les yeux des spectateurs tous les événements un peu saillants qui ont marqué l’année qui vient de s’écouler4 ». Cet « olla podrida de l’art dramatique5 » (p. 11) consiste ainsi en un passage en revue des actualités saillantes de l’année, pièces à succès ou inventions nouvelles, le tout sous forme allégorique.
2L’approche déployée par Romain Piana est celle d’une « histoire globale » (p. 16) de la revue parisienne de fin d’année. L’enjeu est de multiplier les axes d’analyse de ce petit genre oublié, en insistant sur le lien qu’il entretient avec l’ère médiatique, telle qu’analysée par des chercheurs et chercheuses comme, entre autres, Marie-Ève Thérenty, Alain Vaillant et Dominique Kalifa6. « Genre intermédial » qui relaie et remâche une mémoire médiatique récente à l’aide de chansons connues et d’un ensemble d’invariants dramaturgiques et scéniques, la revue se caractérise par le « va-et-vient entre la médiatisation, le déjà-médiatisé, et l’immédiateté du spectacle » (p. 14).
Ritualisation et progrès
3Dans un premier chapitre, Romain Piana retrace l’émergence du genre, issu de la comédie-vaudeville de la Restauration et notamment du vaudeville matrimonial, où défile devant un père désireux de marier sa fille, un même prétendant qui prend chaque fois un rôle différent (un libraire, un parfumeur puis un usurier, etc.) — occasion d’un passage en revue de plusieurs types sociaux. C’est sous la monarchie de Juillet que naît la revue, qui s’imprègne de la féérie et s’affranchit de toute intrigue au profit d’un cadrage dramaturgique lâche. Les frères Cogniard donnent en 1841 une revue intitulée 1841 et 1941, qui inaugure le genre sous la forme qu’il connaîtra dans la deuxième moitié du siècle.
4En quelques années s’instaure un cadre dramaturgique qui fait tôt figure de tradition. Un personnage de niais, souvent un provincial benêt, est invité par un génie à se rendre à Paris où défileront devant lui, par l’intercession de ce génie cicérone, les actualités merveilleuses de l’année. Dès les années 1850, le couple niais-génie est remplacé par celui du compère et de la commère. Toujours vêtu d’un habit bleu, le compère est une « instance spectatrice » que guide la commère, « instance évocatrice » pourvue d’une baguette. Compère et commère se placent traditionnellement à l’avant-scène, chacun à une extrémité du plateau, encadrant physiquement les personnages qui se succèdent sous leurs yeux et sous ceux du public. De même, la séquence d’introduction où le compère et la commère se désignent et donnent un prétexte à la revue est désignée par Romain Piana comme une « structure contractuelle primordiale » (p. 102), par laquelle compère et commère s’instaurent comme tels.
5Omniprésente, la chanson participe pleinement de l’inscription de la revue dans une ritualité où mémoire chansonnière et mémoire médiatique interfèrent. Dans son cinquième chapitre, intitulé « La connivence et l’exhibition », Romain Piana consacre de longs développements très informés aux reprises d’airs connus et autres ponts-neufs dont usent et abusent les revues, alternant entre reprises et variations — selon une « dialectique […] de la reprise et de l’écart » (p. 266) qui est au cœur, selon le chercheur, du genre de la revue de fin d’année. À l’instar de nombreuses productions liées à l’ère médiatique, les revues se caractérisent par une forte réflexivité. Cette mise à distance ludique se traduit souvent par une lassitude feinte vis-à-vis du cadre générique. Le jeu sur la connivence qui en découle favorise la participation du public, au point que s’instaure, dans le pacte générique de la revue, une « scène dans la salle » fondée sur la métathéâtralité. « Entre vraie-fausse mise en abyme métathéâtrale et vrai-faux scandale dans la salle » (p. 288), cette « scène dans la salle » met souvent en scène des personnages de spectateurs irrités s’interpellant d’un bout à l’autre de la salle.
6À la codification poussée de la revue, s’ajoutant à la ritualisation calendaire d’un type de spectacle qui revient chaque année à la période des étrennes, répond une polarisation thématique sur une actualité récente que la revue a pour charge de reparcourir. Deux catégories sont convoquées : l’actualité des théâtres, en premier lieu, donne l’occasion de produire une chronique dramatique plus ou moins parodique au sein de laquelle les imitations prennent une place importante. Certains acteurs se spécialisent ainsi dans l’imitation de leurs confrères, comme Léon Fusier à la fin du siècle. En second lieu, la revue se fait l’écho des nouveautés en matière de produits et d’inventions industriels, s’inscrivant ainsi dans un discours du progrès de la nouvelle civilisation bourgeoise et de l’expansion du commerce international. Concrètement, des actrices incarnent, selon une logique allégorique omniprésente dans la revue, qui le briquet à pierre, qui le caoutchouc, qui la betterave sucrière, etc. Romain Piana souligne le caractère fantasmagorique d’une telle spectacularisation du progrès industriel, où « le merveilleux technologique fusionne avec la magie féérique » (p. 154). Mais la dimension commerciale n’en est pas pour autant absente, et nombreux sont les liens entre la revue et la naissante publicité.
Un spectacle de l’ère médiatique
7Les liens entre la revue et la presse, et les médias plus généralement, sont multiples. Romain Piana détaille avec rigueur et une grande clarté didactique les nombreuses configurations par lesquelles s’intriquent le monde des productions périodiques et ces spectacles de fin d’année. Outre la présence sur scène d’un kiosque à journaux comme élément de décor, il arrive que des revues se présentent comme « l’équivalent scénique d’une publication de presse » (p. 166), passant à la scène la structuration par rubriques du journal papier, ou faisant incarner tel ou tel titre par un acteur ou une actrice, voire par la commère elle-même : dans Panthéon charivarique (créé en 1845 aux Délassements-Comiques), Le Charivari fait office de génie qui guide le public à travers les portraits-charges de Benjamin Roubaud. La revue Grand journal, inspirée par la publication homonyme de Villemessant et fondée en 1864, fait défiler plusieurs personnages de « Chroniques », avant qu’au dernier tableau le journal ne s’imprime « dans une imprimerie féérique7 » (p. 173). Évoquons aussi l’insertion du support journalistique dans le décor — tel ce rideau-journal de La Foire aux idées (p. 175). Plus généralement, les revues sont dans une situation de dépendance vis-à-vis de la presse, et notamment de la petite presse satirique, dont elles tirent l’intégralité de leur matériau — au point que Gautier note en 1846 que « Gavarni, Daumier et les petits journaux sont les seuls auteurs des Revues, qui ne sont guère composées que de leurs caricatures et de leurs coups d’épingles mis en action8 ».
8Au-delà de la sphère des journaux, les revues s’emparent des images de presse, qu’elles citent sous la forme de décors ou de tableaux, vivants ou non. C’est particulièrement la caricature qui se retrouve transposée sur scène : ce peut être par le biais de transparents, à l’instar de ceux dessinés par Cham et projetés en 1846 pendant la revue des Variétés (p. 196-197). Il arrive aussi que la pratique du portrait-charge soit importée dans la revue, donnant lieu soit à la confection de masques de « grosses têtes » en carton-pâte portés par les comédiens, soit à l’imitation caricaturale des tics des acteurs et actrices célèbres : ce que le xixe siècle appelle « se faire la tête » d’un confrère. Les célébrités du jour sont donc régulièrement passées à la moulinette caricaturale de la revue, par le biais d’un « grimage biographique » (p. 203) plus ou moins crypté.
Spectaculaire et érotisme
9Après avoir analysé l’émergence et l’apogée de la revue d’actualités, Romain Piana s’interroge sur son devenir et ses métamorphoses. En premier lieu, c’est le caractère spectaculaire de la revue qui prend de plus en plus de place : « la mise en scène alla toujours prenant plus d’importance et occupant plus de place », écrit Francisque Sarcey9 (p. 306). Les revues de fin d’année, en concurrence les unes avec les autres, surenchérissent dans des effets de mise en scène et des clous toujours plus spectaculaires, de même que s’accroissent le personnel scénique et la magnificence des costumes. La contamination de la revue par la féérie conduit à la multiplication des scènes à effet marquées par le merveilleux technique. Romain Piana développe l’exemple de la course de chevaux dans Paris port de mer aux Variétés, en 1891 : trois véritables chevaux galopent sur des tapis roulants installés sur scène et recouverts de gazon, tandis que défile en fond de scène un panorama représentant l’hippodrome de Longchamp ! L’ouvrage énumère différents exemples de ces effets de mise en scène, dont le spectaculaire est renforcé par l’usage de l’électricité. Outre les scènes à effet, la place de la danse tend à s’accroître : après 1850, les revues font une large part aux intermèdes dansés et autres ballets, et s’achèvent sur un « immense cancan » général : « on danse depuis les premières places jusqu’à la toile de fond, depuis le sol jusqu’aux frises10 » (p. 325).
10L’exhibition, au principe de la revue selon Romain Piana, n’a pas qu’un sens spectaculaire : il s’agit aussi de montrer le corps érotisé des femmes. Les revues de fin d’année accordent une part de plus en plus importante à l’érotisme et à la monstration sexualisée du corps féminin (qui n’est à cette époque jamais entièrement dénudé). C’est donc à l’analyse des formes du male gaze spécifique aux revues de fin d’année que se livre Romain Piana dans la dernière partie de son livre. Les revues sont en effet des « pièces à femmes », qui embauchent un personnel féminin d’actrices à la lisière de l’amateurisme, parfois de la prostitution, engagées généralement seulement pour la revue : les « petites femmes », employées à la figuration allégorique et érotique des actualités. Se déploie dans les revues tout un éventail de techniques d’érotisation du spectacle : les costumes allégoriques sont souvent fondés sur l’exhibition charnelle, et jouent à l’occasion des connotations et des sous-entendus, à l’instar des costumes de crustacés. Romain Piana analyse l’alternance entre les effets de groupe et de troupe (soit des bataillons de jeunes femmes court-vêtues) et l’expérience du détail que les spectateurs, lorgnette en main, sont incités à faire par l’observation minutieuse de telle ou telle partie du corps féminin. La disposition des éléments du costume de Locomotive porté par Albany Debriège dans Paris-Cancans en 1888 n’a rien d’anodin : outre la nudité des épaules et de la gorge, les phares, par exemple, sont disposés sur la poitrine (fig. 49, p. 234). Quant aux dialogues, leurs « titillations » renforcent l’érotique des costumes en multipliant les allusions sexuelles plus ou moins explicites, qui jouent sur l’ambiguïté référentielle entre le personnage allégorique et l’actrice elle-même. Romain Piana donne l’exemple de Paris-Exposition, une revue de Monréal et Blondeau créée en 1889, où un personnage de Ballon invite le compère à « monter » (p. 376)… Au tournant du siècle, l’érotisme devient omniprésent : il sera au cœur des revues de café-concert, puis de music-hall, qui perdent de vue tout lien avec l’actualité.
*
11L’ouvrage de Romain Piana, qui se distingue par sa limpidité et son didactisme, ouvre des pistes passionnantes pour qui s’intéresse à la culture médiatique du xixe siècle. Les revues de fin d’année offrent un poste d’observation d’autant plus intéressant sur ces questionnements qu’elles ne sont, d’après Romain Piana, que « para-médiatiques » (p. 14). Elles permettent d’entrer par un sentier nouveau dans l’univers mental des hommes et des femmes du xixe siècle, et confirment que limiter les études médiatiques aux études de presse est un contresens méthodologique : le xixe siècle fait de la presse une composante parmi d’autres d’un ensemble de pratiques et de discours qui forment la naissante culture médiatique. Outre la réflexivité, trait définitoire des productions culturelles en régime médiatique, on retiendra particulièrement le caractère de secondarité de la revue : par rapport à l’actualité et par rapport au théâtre lui-même, la revue est un spectacle du second degré, qui recycle et métabolise des contenus médiatiques préexistants. À de très nombreux égards, la revue de fin d’année semble participer du sensationnalisme qu’un récent essai de Yoan Vérilhac a contribué à éclairer en le reliant au « bavardage médiatique », caractéristique des sociétés démocratiques selon le chercheur11. Sensationnalistes, les revues le sont par leur affranchissement vis-à-vis de l’intrigue et de la narration (une revue s’intitule Sans queue ni tête12), par leur fonction de commentaire de l’actualité et par le « paradigme culturel de l’attraction13 » qui les caractérise.

