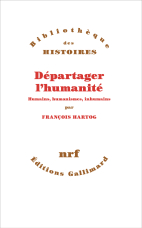
Deux mille ans d’humanité
1L’une des pires angoisses pour un chercheur ou une chercheuse est certainement de voir paraître, au terme d’un travail de longue haleine, un ouvrage susceptible de remettre en question la pertinence ou l’utilité de ses recherches en cours. Imaginez un doctorant en fin de thèse, qui a travaillé sur la notion d’homme à une époque où celle-ci est omniprésente mais employée avec beaucoup d’imprécision (l’entre-deux-guerres), et qui a consacré quatre ans à essayer de déterminer les différentes saisies du mot, à établir une classification des usages en distinguant ce qui relève de la philosophie, de la sociologie, de l’anthropologie… L’enquête lexicale a porté ses fruits : l’être n’est ni l’individu ni la personne ; l’humain est un animal sans être une bête ; le mâle exclut la femelle et l’enfant de l’espèce, comme le bourgeois exclut l’ouvrier et le blanc exclut le noir. Mais une fois le manuscrit rendu, un historien de renom, François Hartog, publie un ouvrage au titre accrocheur : Départager l’humanité. Humains, humanismes, inhumains. Avant même de le lire, survient successivement de l’enthousiasme : un tel livre sera nécessairement enrichissant ; de la frustration : ce livre m’aurait fait gagner du temps ; de l’inquiétude : sa typologie peut contredire la mienne ; du découragement enfin : quelle originalité et quelle pertinence reste-t-il à mes recherches ? Heureusement, on revient bientôt à la raison. On ouvre le livre, et commence alors le dialogue à une seule voix.
Homo humanus contre homo christianus
2François Hartog propose une impressionnante synthèse des partages qui ont permis de définir l’humanité depuis l’Antiquité grecque jusqu’à nos jours. Attention toutefois, voilà une œuvre d’historien et non de philosophe ; dès la première page, le lecteur est prévenu : il ne s’agit pas d’un traité de métaphysique mais d’une « enquête historique » (p. 11). Aucune réponse ne sera apportée sur l’essence ou la nature humaine, Départager l’humanité consiste en une mise au point très informée de relations qu’entretiennent les trois termes humains, humanismes, inhumains, qui ont solidairement servi à concevoir l’humanité depuis l’anthrôpos grec jusqu’à l’Anthropocène. Entre les deux, François Hartog identifie plusieurs homo qui se sont succédé : l’homo humanus, l’homo christianus et l’homo inhumanus, pour les principaux. François Hartog retrace ce cheminement en huit chapitres, qui suivent un ordre strictement chronologique.
3À l’origine, le premier partage, se trouve une opposition entre hommes et dieux. Les uns sont mortels, les autres non. Hésiode et Homère sont ici convoqués par l’historien pour témoigner d’une double compréhension de cette mortalité. Dans sa Théogonie et dans Les Travaux et les jours, Hésiode raconte l’origine de la misère humaine, notamment à travers le conflit entre Zeus et Prométhée. Pour punir Prométhée d’avoir volé le feu et de l’avoir donné aux hommes, Zeus condamne les hommes à vivre misérablement. Les conflits et la mort définissent désormais leur existence. Homère interprète différemment la mortalité des humains, en racontant la gloire à laquelle se hissent les héros, qui demeurent alors vivants dans la mémoire collective. La punition n’est pas tant de mourir, que de mourir anonyme. Un deuxième critère s’ajoute avec Protagoras (via Platon) puis Aristote, qui opère un partage entre hommes et bêtes : l’humain est un « animal politique » et « doué de raison », destiné à « vivre en cité » (p. 37). Le propre de l’homme n’est plus d’être mortel mais de pouvoir communiquer grâce au logos, qui permet de penser et de parler. D’ailleurs, il n’est pas dit que tout l’homme disparaisse : l’âme demeure peut-être. Il y aurait dans l’humanité une part d’immortalité.
4Cette idée se retrouve dans la conception de l’homo christianus, qui laisse espérer une résurrection et promet une vie après la mort. D’après François Hartog, la Genèse plonge l’humanité dans un nouvel univers temporel, touchant autant les dieux que l’humanité. Les dieux de l’Antiquité étaient des êtres immortels mais nés ; le Dieu de la Genèse est éternel, il existe en dehors du temps. Vivant sous cette autorité, l’humanité connaît trois âges : la Chute, l’Incarnation et le Jugement. Dans l’univers chrétien, l’homme est toujours mortel, mais ce n’est que par punition divine ; il a été créé immortel. En ayant foi, l’homme vit dans l’expectative d’un rachat de l’humanité, il vit à l’image du Christ ressuscité. En résulte une potentielle immortalité : la vie sur Terre est une punition qui précède la vie céleste. Il est donc non seulement possible d’échapper à la mort sur Terre mais également de survivre après le Jugement Dernier. La conception de l’humanité se stabilise alors. Il est admis pendant plusieurs siècles que l’homme est un « être créé », doté d’une âme et surplombant le règne animal (p. 76).
5Ce que ne dit pas François Hartog mais qu’on peut conclure de ces premières observations, c’est que les premiers partages opèrent une coupe verticale : les aèdes et les philosophes ne se contentent pas de classer les êtres vivants, ils les hiérarchisent. L’homme est supérieur aux bêtes et inférieur aux dieux ; il occupe ainsi une position intermédiaire mais surtout centrale dans la conception du monde. Se met en place un anthropocentrisme qui débouche dès l’époque romaine : est un homme celui qui est humain.
6Il n’y a toutefois pas de parfaite équivalence entre les deux mots, homme et humain. François Hartog l’explique :
On naît homme, et cela vaut pour tout être humain (quels que soient son origine ou son statut), mais on devient humanus, cela ne vaut ni pour les premiers hommes, ni même pour les ancêtres des Romains, ni pour tous les êtres humains. (p. 50)
7Le passage par le latin est pratique, il permet de distinguer être humain et être humanus. Pour le rendre en français, il faut troquer le verbe d’état pour le verbe d’action et distinguer être et devenir humain. Cependant, la précision ne suffit pas à lever l’ambiguïté que suscite cette autotélie. Même l’historien, pourtant d’une rigueur exemplaire, vacille quand il essaie de préciser la spécificité de la définition romaine : pour les Romains, la question ne concerne « pas l’homo, à savoir sa nature ou son essence, mais son humanitas, c’est-à-dire ce qui fait de lui un homo humanus : un être véritablement ou pleinement humain » (p. 50). D’un côté la nature et l’essence, disons la philosophie ; de l’autre l’humanitas définie par la quête de l’homo humanus, qui correspond uniquement à une acception axiologique de l’homme — on se situe dans le domaine de la morale. Le mot aurait mérité d’être posé car il aurait permis de mettre davantage en valeur l’historicité de cet homo humanus, dont la notion subsiste mais dont la définition dépend des époques. François Hartog le fait, mais de manière éparse et uniquement pour justifier certains silences… Nous y reviendrons.
8Les deux premiers chapitres sont peut-être les plus importants, dans la mesure où ils énoncent le fondement de l’homo humanus et de l’homo christianus. De la Renaissance à la fin du xviiie siècle, aucune nouvelle ligne de partage n’est formulée ; l’humanité reste tendue entre ces deux notions. Seule l’attention portée à la condition humaine change. Ainsi François Hartog conclut-il ses observations sur les xive et xve siècles italiens : « Si l’homo christianus demeure la règle de vie et l’horizon indépassable, le regard sur l’être humain s’est, lui, modifié » (p. 115). D’une condition misérable, on passe alors à une revendication de la dignité humaine. Au xvie siècle, Martin Luther veut « retrouver le véritable homo christianus » (p. 123‑126), et Ignace de Loyola entend mettre l’homo humanus « au service de l’homo christanus » (p. 126‑129) ; aux xviie et xviiie siècles, Pascal défend, contre Montaigne, l’« exaltation de l’homo christianus » (p. 137‑142), tandis que Voltaire s’en moque, renversant le divertissement pascalien par une valorisation de l’action (p. 142‑152).
9Le déclin de l’homo christianus au xviiie siècle laisse place à la revendication d’être un homme, selon le mot de Térence dont les Lumières font l’une de leurs devises : « homo sum, humani nihil a me alienum ». Dès lors, l’homme devient le point de départ de sa propre histoire : Dieu n’entre plus dans l’équation et la frontière avec les bêtes est raffermie ; la ligne de partage se pense désormais par rapport aux autres hommes, et notamment aux « Indiens » (d’Amérique) et aux Africains. Qu’importe l’avancée de leur civilisation, les hommes disposent d’intelligence, se sociabilisent et se développent. François Hartog considère qu’à ce point de l’histoire l’homo sum est « élargi et temporalisé », tenant compte des populations extra continentales et de l’état antérieur de l’humanité (p. 152‑157). La question qui se pose alors consiste à savoir dans quelle direction l’humanité évolue : s’éloigner de l’état de Nature, est-ce un progrès ou une dégénérescence ? L’homme est-il perfectible, comme le suggère Condorcet, ou parfait par Nature, comme le voudrait Rousseau ?
10L’histoire aurait pu s’arrêter là : au début du xixe siècle, commence une période de synthèse et de fixation du récit humain. En Allemagne, une série de philosophes et philologues (Niethammer, Voigt, Paulsen, Burckhardt) inventent le concept d’humanisme. Pour Niethammer, l’enjeu est pédagogique : il s’agit de savoir si l’éducation doit être utilitaire ou humaniste. L’élève doit devenir autonome, et c’est en revenant aux textes grecs qu’il pourra développer son esprit pour y parvenir. Voigt s’intéresse quant à lui à la Renaissance italienne et y voit la naissance de l’humanisme, tandis que Paulsen en dresse l’histoire depuis le Moyen Âge, jusqu’au Neuhumanismus, le néohumanisme de Niethammer. Buckhardt envisage le problème sous un angle différent : la Renaissance n’a pas effectué un retour aux Antiques pour en reprendre simplement la philosophie ; l’époque marque une rupture avec tout ce qui précède en inventant le concept de l’individu. Auparavant, l’homme « ne se connaissait que comme race, peuple, parti, corporation, famille, ou sous tout autre forme générale et collective » (Burckhardt, La Civilisation de la Renaissance en Italie, cité p. 182). Depuis, on a connu une « progression toujours croissante de l’individualisme » (ibid.). Un rapport d’analogie peut dès lors être posé, à l’échelle européenne, entre la Renaissance italienne et la Révolution française, les deux marquant une rupture vers davantage d’individualisme. Mais les enjeux diffèrent : aux xive et xve siècle, le risque réside dans un « excès d’individualisme » ; le xixe siècle connaît « un individualisme menacé par la montée des masses et du socialisme » (p. 184).
11En regard de cette synthèse, le procès de l’homo christianus s’achève avec Feuerbach, Marx et Nietzsche. Le lien entre leurs réflexions et le travail des philologues n’est pas explicité dans l’essai, François Hartog se contente d’un : « Voilà pour l’homo humanus », et d’un « Qu’en est-il de la convocation […] de l’homo christianus ? » (p. 184‑185). C’est dommage car ses observations appellent des hypothèses. Avec Feuerbach, Marx et Nietzsche, c’est le grand procès de Dieu qui s’ouvre : pour le premier, l’homme est un dieu pour l’homme ; pour le deuxième, l’idée même de religion devrait être abolie ; le troisième annonce la mort de Dieu et appelle l’homme à se surmonter. Le point de référence reste donc métaphysique mais la hiérarchie établie depuis le Moyen Âge se trouve bouleversée pour placer l’idée d’homme au rang de dieu. L’historien continue de parler de l’homo humanus, considérant que l’humanité reste définie par rapport à elle-même. Pourtant, le fait de penser une religion de l’homme, de philosopher sur l’homme réel ou d’imaginer un surhomme apporte une nuance importante : l’humanité elle-même se scinde entre une réalité concrète et un idéal abstrait. Pour respecter la nomenclature de François Hartog, on pourrait dire que l’homo humanus existe en regard d’un homo divinus, qui, à l’image des dieux, se conçoit comme une entité immortelle, traversant les générations de façon universelle. Avec l’humanisme, une nouvelle ligne de partage apparaît, séparant, dans l’humanité même, l’individu et l’homme, l’être temporel et la construction morale.
12Deux mille ans d’histoire synthétisés en deux cents pages : la lecture de Départager l’humanité impressionne. Ignorant mais curieux, je ne peux pourtant m’empêcher d’interroger le déséquilibre entre ces deux cents premières pages et les cent vingt qui restent pour couvrir à peine un peu plus d’un siècle de nouvelles évolutions… Les xxe et xxie siècles représentent-ils une période plus dense ou trop proche encore ? En se plongeant dans les siècles qui précèdent, trouverait-on la même diversité de vues sur l’humanité ? Difficile d’en douter, attendu que même le plus long développement de François Hartog sur le xxe siècle pourrait être complété.
Homo inhumanus ?
13Au xxe siècle, en Occident, on sent comme une accélération de l’histoire, les événements d’importance mondiale se succèdent, de nouvelles disciplines (psychanalyse et anthropologie, notamment) émergent en faisant table rase des anciennes conceptions du monde, les humanismes se multiplient et s’excèdent finalement en trans- et post-humanismes. D’après François Hartog, le xxe siècle s’ouvre sur la reconnaissance d’un homo inhumanus, révélé par la Première Guerre mondiale et achevé dans les camps nazis et bolcheviques (chapitre vi), suscitant après la Seconde Guerre mondiale la recherche d’un nouvel humanisme (chapitre vii), avant que le « crépuscule d’anthrôpos » ne commence (chapitre viii). La boucle est bouclée : anthrôpos a vécu, il meurt désormais. La démonstration est efficace ; elle n’est toutefois pas tout à fait convaincante. Plusieurs éléments, d’ordres différents, sont discutables.
14Les matériaux retenus pour la démonstration du chapitre vi (« L’époque de l’homo inhumanus », p. 204‑232) sont hétérogènes par rapport à tout ce qui précède. Jusqu’au chapitre vi, François Hartog s’intéresse moins aux événements qu’à la manière dont les humains les ont interprétés, et en ont tiré de nouvelles considérations sur l’humanité. Ainsi, tandis que pour les deux millénaires qui précèdent François Hartog n’envisage le partage de l’humanité qu’en fonction d’écrits, principalement philosophiques, les faits historiques s’imposent quand il s’agit du premier xxe siècle. Aristote, Voltaire et Marx laissent place à Auschwitz et au goulag. Il aurait évidemment été étrange d’ignorer les camps de la mort dans l’évolution du regard porté sur la nature humaine, tant les horreurs nazies, en Europe de l’Ouest, et soviétiques, en Europe de l’Est, ont participé à forger une culture commune, remplaçant ainsi dans la mémoire collective le rôle joué auparavant par la Révolution française1. En résulte un découpage historique qui situe l’inhumanité entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, et un renouveau de l’humanisme après-guerre. Or, au risque d’aller à l’encontre du partage historique opéré par François Hartog, il faut bien reconnaître que l’inhumanité des camps, en tant qu’objet de réflexion sur l’humanité, ne précède pas la recherche d’un nouvel humanisme, mais la concurrence, ou la justifie. C’est après-guerre seulement que les camps de la mort suscitent des témoignages et des réflexions sur l’inhumanité des hommes. Si c’est un homme de Primo Levi paraît en 1947, et Vie et destin de Vassili Grossmann en 1967. François Hartog ne l’ignore évidemment pas, et cite l’un comme l’autre. Les étudier en même temps que la Grande Guerre et les séparer chronologiquement des débats humanistes d’après-guerre apparaît alors tout aussi étrange, car cela réduit l’entre-deux-guerres à la guerre, recouvrant d’un voile inhumain une période qui a aussi été marquée par d’importantes luttes contre l’inhumanité des entreprises militaires et totalitaires.
15Pourquoi est-ce si important ? Parce que cette hétérogénéité participe à passer sous silence l’importance de la morale dans le partage de l’humanité. Des événements dans lesquels l’homo inhumanus s’est illustré se produisent depuis la nuit des temps. François Hartog le rappelle d’ailleurs brièvement en introduction du chapitre vi : l’homo inhumanus « a su se ménager une place, plus ou moins importante, dans chacun des chapitres qui scandent notre parcours » (p. 206). S’en suit un rappel de quelques actes à travers l’histoire : le traitement des vaincus dans les guerres depuis l’Antiquité ; la violence des Chrétiens envers les hérétiques ; le génocide des Premières Nations en Amérique ; l’esclavage… Mais, d’après François Hartog : « Si tout cela est connu et bien documenté, reste que la guerre de 14 a marqué un tournant : celui d’une brutalisation des sociétés engagées dans le conflit » (p. 207). Cet effort pour justifier son partage historique par des faits ne nous convainc pas entièrement, car la question posée au départ n’est pas de savoir si les actions des hommes à travers l’histoire sont plus ou moins acceptables ou horribles… Il s’agit d’identifier les lignes de partage que l’humanité a elle-même tracées pour penser sa singularité dans le vivant. Autrement dit, dans le cadre d’une telle étude, ce qui importe n’est pas tant la violence inédite et difficilement imaginable du goulag et des camps nazis, mais la condamnation massive de ces horreurs. On en revient ainsi à la critique formulée plus haut : l’homo inhumanus, comme l’homo humanus, se définit en fonction d’une morale. Si la colonisation, l’esclavagisme, et tout ce qui a précédé les camps n’ont pas imposé dans la conception de l’humanité l’idée d’un homo inhumanus, c’est, notamment, parce que ces entreprises ne remettaient pas en cause la morale des hommes. L’illusion d’agir dans son droit, voire de bien agir, primait sur la violence des actes.
16Peut-être aurait-il donc fallu assouplir le découpage chronologique pour accueillir le paradoxe, pas si étonnant d’ailleurs, d’une humanité tendue simultanément entre sa propre inhumanité et ses aspirations humanistes. Cela aurait certainement permis de rééquilibrer l’ensemble du récit en faisant de cette tension le point névralgique de l’ensemble du xxe siècle.
17François Hartog n’a pas tort de convoquer Freud et Malraux pour souligner le sentiment d’inhumanité qui émerge dès la fin de la Grande Guerre. Il oublie cependant l’influence nietzschéenne qui pèse sur les premiers romans de Malraux. Certes, Malraux annonce la mort de l’homme dans La Tentation de l’Occident : mais c’est l’idée qui meurt ; reste l’individu confronté à sa condition humaine. Et si celle-ci lui semble effectivement insupportable, au point que Tchen, dans La Condition humaine, décide de se tuer en tentant d’assassiner Tchang Kaï-Check, il faut se souvenir de la distinction qu’opère Perken dans La Voie royale entre « mourir » et « être tué »2. Ce qui est insupportable, c’est de se sentir vieillir et de devenir impuissant ; c’est d’être piégé dans ce processus irréversible que constitue le fait de mourir. Chacun doit alors effectivement agir seul, quitte à être tué, pour surmonter cette existence sans transcendance. Loin d’être désespéré, le personnage qui ose affronter sa mort se réalise en tant qu’homme, à l’échelle individuelle. Autrement dit, l’époque est inhumaine, pas l’homme. Malraux croit encore en l’homo humanus, seulement, il adapte à l’époque les moyens pour le réaliser. Le moyen change mais pas la fin : le développement de son humanité reste l’horizon à atteindre, il passe cependant par l’action.
18Cette recherche d’un nouvel humanisme pour répondre au monde inhumain s’étend bien au-delà de Malraux. Non seulement les auteurs les plus populaires de l’entre-deux-guerres demeurent ceux formés avant-guerre : Georges Duhamel, Jules Romains ou Roger Martin du Gard, qui continuent de promouvoir un humanisme positif ; mais les efforts pour renouveler cette lecture du monde sont nombreux. Outre les propositions individuelles et doctrinaires, des rencontres sont organisées pour réfléchir à la formation de l’homme ou à un nouvel humanisme. Prenons l’année 1937 : Jean Prévost le pacifiste publie La Chasse du matin3, roman moraliste qui prône un humanisme modeste, appelant l’homme à vivre à sa mesure ; Jean Fiolle publie La Crise de l’humanisme4, un essai qui porte principalement sur l’humanisme traditionnel, en analysant notamment les tensions entre humanisme, catholicisme, communisme et sciences ; paraissent les actes des rencontres de l’Institut international de coopération intellectuelle, qui réunissaient des intellectuels européens à Budapest pour discuter d’un « nouvel humanisme »5.
19Ce qu’identifie François Hartog après-guerre résulte donc directement des pistes lancées dans l’entre-deux-guerres. À ce titre, c’est tout le contraire d’un renouveau humaniste qui s’observe à partir de 1945. Ce qui était discuté dans l’entre-deux-guerres se cristallise, les débats se figent en discours idéologiques. Dans l’entre-deux-guerres, il s’agit de définir ce qui doit fonder et orienter l’humanité : quelle culture, entre l’antique et la scientifique, est la plus universelle ? L’État doit-il intervenir dans la formation de l’humanité à venir ? À partir de 1945, il s’agit de choisir sa chapelle entre les humanismes scientifique, communiste, catholique, existentialiste… Le mot humanisme devient un mot-plastique : une bannière et un élément de phraséologie partagés par tous ceux qui revendiquent une opposition forte aux violences nazies.
20Un autre parcours se dessine alors, moins unilinéaire. À la succession : homo inhumanus, nouveaux humanismes, crépuscule d’anthrôpos, je substituerais une tension entre culture, action (individuelle ou politique), science et croyance. La lutte pour savoir ce qui doit fonder l’homo humanus est une réponse à la fin du mythe de l’homme et au sentiment que l’humanité doit s’adapter au monde moderne devenu inhumain. Et la reconnaissance de l’homo inhumanus, de la Grande Guerre aux guerres décoloniales, en passant par les camps, fait table rase de l’optimisme humaniste, appelant une profonde révision de l’homo. Les deux tendances évoluent de manière concomitantes, s’influençant l’une l’autre. L’influence nietzschéenne et la volonté de faire advenir un homme nouveau a pu aboutir à des dérives virilistes et totalitaires ; la confrontation à des actes inhumains a provoqué un humanisme non-souverain, prônant la tolérance et l’empathie, non la domination de la nature mais son respect. Se développent donc, tout au long du siècle, des approches qui ne sont jamais tout à fait nouvelles mais qui apportent un autre regard sur l’humanité, par l’accroissement des connaissances (l’homme neuronal), par une recomposition de la morale (l’homo rattaché à l’humus) ou par un affaiblissement de ce que François Hartog appelle des partages secondaires, comme l’opposition masculin-féminin (la femme devient une question philosophique à part entière avec Le Deuxième Sexe).
21Mis à part les efforts humanistes de l’entre-deux-guerres, tous les éléments auxquels je renvoie se trouvent dans Départager l’humanité. La critique ne porte pas tant sur le contenu de l’essai que sur la manière dont l’histoire de cette dernière centaine année est agencée. L’historien est en fait pris au piège par son effort de séquençage. À force de séparer les événements et les tendances, il finit par masquer le désordre d’un siècle violent et trouble. Il convient peut-être de respecter ce désordre pour en faire émerger une autre logique que celle de la succession des événements. François Hartog en rend d’ailleurs lui-même compte, quand il rappelle que l’humanisme du xvie siècle s’est fixé en tant que tel au xixe siècle. L’histoire des idées ne suit pas toujours celle des événements… Surtout quand il s’agit de penser sa propre condition.
—
22Arrivé au terme de ma lecture, je retiens un intense dialogue avec les propositions de François Hartog. Départager l’humanité est riche d’enseignements : la nomenclature proposée par l’historien fonctionne bien et permet de mettre en valeur des tendances, à travers plusieurs millénaires d’histoire. Certains points peuvent bien sûr être discutés. J’ai essayé de le faire pour le xxe siècle, période que je connais le mieux, et il y a fort à parier que des spécialistes d’autres siècles avanceraient d’autres éléments. Il n’empêche : pour la centaine de pages discutées, il en reste deux cents qui posent des jalons et permettent, sinon d’épuiser la question, au moins de clarifier le débat, afin de mieux comprendre les grandes évolutions des différents partages.
23Entre les différentes réactions qui précédaient ma lecture, je me conforte finalement dans l’idée que cet essai m’aurait fait gagner du temps, qu’il s’agit d’une synthèse efficace et pleine de propositions, mais qui appelle cependant à être prolongée — et même contestée, puisque c’est la tâche même de l’humaniste, depuis Rabelais au moins, d’exercer son esprit critique.

