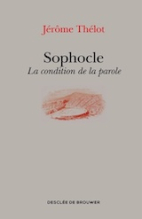
Poétique générale ou ethnopoétique ? À propos du Sophocle de Jérôme Thélot
L’audace de la transdisciplinarité
1Dans la logique académique, on tend volontiers à se cantonner dans son pré carré, en espérant un jour s’en affirmer comme l’expert incontesté. Le parcours de Jérôme Thélot contredit cependant ce principe. Connu et reconnu avant tout pour ses études sur la poésie moderne (de Baudelaire à Bonnefoy), l’auteur s’est également distingué par un essai sur L’Idiot de Dostoïevski, ainsi que par une traduction de Woyzeck de Büchner. On le sait en outre poète et amateur de photographie. Dans Sophocle. La condition de la parole, le titre l’indique, c’est sur la tragédie grecque qu’il porte son attention.
2Le projet mérite d’être salué, ne serait-ce que pour son audace. À la seule considération de l’index des noms d’auteurs, le lecteur est pris de tournis : Sophocle, Homère et Aristote y côtoient Apollinaire, Seamus Heaney et Wouajdi Mouawad. C’est un vent salubre que fait souffler J. Thélot sur les études classiques, souvent confinées. Et on soulignera que cette initiative s’accomplit dans un respect des sources antiques qui n’est pas toujours imité : les traductions sont récentes et de bon aloi ; différentes traductions sont mises en regard les unes des autres ; enfin les termes en grec ancien sont régulièrement mentionnés, où n’apparaissent que de rares coquilles.
Le levier de la poétique générale
3Si J. Thélot relève le défi de parler de Sophocle du haut d’une chaire de littérature française, si l’on peut dire, c’est qu’il postule, dans son avant-propos, que les tragédies de Sophocle sont « porteuses d’une poétique générale » (p. 10). En d’autres termes, elles comprendraient « une mise en image et une réflexion [des] fondements [de la parole] » (p. 11). La démarche de l’auteur se rattache à un projet plus vaste, celui de « la » poétique générale, dont « l’ambition (…) est de dessiner une idée de la structure intérieure à toutes les entreprises de poésie et à toutes les formes de la fonction poétique. » (p. 11).
4J. Thélot ne cache pas la haute estime qu’il se fait de cette mission, qui est, dit-il, celle de la lecture critique. Il lui donne pour but d’ « édifier la pensée de ses lecteurs par la vérité du texte », vérité destinée à « quiconque […] cherche de quoi élucider le sens de sa propre existence » (p. 13). Et sans doute parvient-il effectivement, au terme de cet ouvrage, à nous rendre Sophocle familier « à nous autres, ‘modernes’ » (p. 14) : Sophocle, comme on le verra, finit par trouver sa place dans la longue lignée des poètes plus ou moins maudits. Ce qui permet, selon le souhait de l’auteur, de « l’emporter dans notre destin propre ».
5Or, ce projet ambitieux, J. Thélot le situe en contrepoint des « sciences historiques, philologie, théorie du religieux, histoire sociale, archéologie, qui ne veulent que restituer les significations telles qu’elles étaient probablement entendues en ce ve siècle avant notre ère » (p. 13). C’est sur ce point que je me permettrai d’adresser quelques critiques à l’ouvrage, piqué peut-être par le fait que le travail des antiquisants se voie légèrement déprécié à travers ce propos. De fait, l’auteur de ces lignes se classe volontiers parmi les anthropologues du monde antique qui jugent indispensable d’appréhender les termes antiques en fonction du contexte qui les a générés, qu’il s’agisse du « tragique », du « mythe », du « sacrifice » ou de la « poésie ». J. Thélot ne méconnait pas ces penseurs : on retrouve dans sa bibliographie quelques-uns des plus illustres représentants de la discipline, tels Vernant, Vidal-Naquet, Loraux, Zeitlin ou Detienne. Mais il s’en démarque sous prétexte qu’ils sont « indifférents à l’invention de l’absolu » (p. 134). Et peut-être est-ce vrai, mais ce n’est pas sans raison. Car le goût de l’absolu et de la généralisation peuvent mener à des contre-sens, comme je tenterai de le montrer dans le cas de l’ouvrage en question1. Cependant, avant de formuler ces réserves, il convient de rendre compte brièvement de la thèse de l’auteur, telle qu’il l’applique à l’œuvre de Sophocle — à l’exclusion, il faut le signaler, des fragments et du drame satyrique des Limiers. Peut-être justement parce qu’ils s’accordent moins à la thèse principale.
Sophocle auteur de « tragédies du langage »
6Un petit film de présentation de J. Thélot résume de manière très claire le propos de son ouvrage2. On s’y référera avantageusement pour se faire une idée générale, ce d’autant plus que la prose de l’auteur — c’est notre humble avis — est relativement complexe, riche d’un abondant vocabulaire conceptuel et tissée d’antithèses qu’il n’est pas toujours aisé d’intégrer à la première lecture. Dans le film, il apparaît notamment que le mouvement initial de la recherche a été provoqué par une lecture de Philoctète de Sophocle, lecture inspirée elle-même par des considérations ou réécritures de poètes modernes. C’est à partir de cette pièce qu’a été étendue (aux sept tragédies de Sophocle conservées dans leur entièreté) la thèse selon laquelle « chacune des pièces de Sophocle est essentiellement une réflexion sur la tragédie du langage » (p. 17 ; comme par la suite les italiques sont de l’auteur).
7Le plan de l’ouvrage ne rend pas exactement compte de ce processus, puisqu’il place l’analyse de Philoctète à la fin de l’étude, dans un troisième volet indépendant et plus conséquent que les autres. L’ouvrage conserve quelques traces de ce renversement. Ainsi, la partie finale consacrée à Philoctète semble plus achevée. Comme le reconnaît l’auteur, elle est aussi très inspirée par les réflexions de René Girard sur la violence et le sacrifice. Le vocabulaire du « sacrifice » y tient une place cruciale, qui n’est pas aussi prégnante dans les autres volets. Ces derniers se concentrent expressément sur la question de la parole, ou alors ils évoquent la « logique sacrificielle » de cette dernière, dans une acception plutôt lâche.
8Autre séquelle du remaniement : les informations techniques relatives au cadre des représentations tragiques n’apparaissent que dans la partie finale. C’est le cas des « différents espaces que la scénographie découpe » décrits pour Philoctète (p. 214), seule pièce à bénéficier de ce type de considération. Il aurait été plus légitime d’aborder cette dimension au début de l’ouvrage, surtout s’il s’adresse à des non-spécialistes. Mais ce n’est qu’aux trois quarts de la recherche qu’est évoquée la réalité matérielle du théâtre antique, dans une perspective qui par ailleurs est relativement datée et ne rend pas compte des considérations récentes à ce sujet (architecture du théâtre, type de jeu des acteurs, interaction entre le chœur et les protagonistes…). Mais le plus grave est qu’il s’agit du seul moment où le théâtre de Sophocle est rappelé à ce qu’il est en réalité : un spectacle à voir autant qu’à entendre. Or David Seale, dans Vision and Stagecraft in Sophocles, l’un des rares ouvrages en langue étrangère à être cité dans la bibliographie, a montré de manière exemplaire combien l’art de Sophocle s’appuie sur la création scénique de tableaux et d’images fortes, qui renforcent et même déterminent les données textuelles. C’est une dimension qui, à notre sens, manque totalement dans l’analyse, indifférente à son tour aux apports récents de la théâtrologie.
9Mais c’est que le propos de J. Thélot est ailleurs. Comme il le précise d’entrée de jeu, sa recherche a d’autres ambitions que celle des sciences historiques. Appliquée à définir les contours et, plus encore, la « généalogie » d’une poétique générale, elle considère au premier chef la tragédie comme un drame de langage et du langage.
10À ce titre, la structure de l’ouvrage, outre qu’elle permet de respecter grosso modo la chronologie des représentations, vise à conférer un statut particulier à Philoctète, celui de « figuration de la poésie par elle-même, de sa généalogie et de sa structure dynamique » (p. 17). Et en amont de ce feu d’artifice final, l’auteur attribue à chaque pièce la vertu de refléter la thèse principale selon un angle différent, c’est-à-dire de constituer une « exposition des conditions du langage, exposition à chaque fois nouvelle et particulière » (p. 17). J. Thélot résume ces variations dans son film de présentation : Ajax renvoie au pouvoir d’« illusionnement » de la parole ; Les Trachiniennes au malheur de l’incommunication ; Électre à l’opposition entre discours fictionnel et présence véritable ; Antigone met en scène l’opposition de deux « négations discursives » ; Œdipe Roi la relativité, le « tourniquet » des interprétations subjectives ; Œdipe à Colone un dépassement par la piété de cette relativité. Et sans doute J. Thélot avance-t-il quelque chose de très juste lorsqu’il lie la tragédie à une réflexion sur la légitimité et la puissance du langage : la société grecque, et plus encore la démocratie athénienne, placent la parole publique au centre de toutes les institutions. La tragédie ne fait que refléter l’importance et les travers de la parole dans la cité. Mais la problématique est-elle moins prégnante dans l’œuvre d’Eschyle ou d’Euripide, voire dans celle d’Aristophane ? Une contre-épreuve serait nécessaire pour le prouver et valider la thèse de J. Thélot. Mais à vrai dire, on peut en douter.
11Quant au fait que la tragédie constitue un théâtre de langage, c’est un présupposé qui a marqué durablement l’approche des productions poétiques antiques et qui reflète une herméneutique datée. C’est contre elle que s’élève, depuis plus de cinquante ans, le courant des sciences sociales appliquées à l’antiquité.
L’alternative ethnopoétique
12« La tragédie attique est la dramatisation poétique, vocale, musicale et chorégraphique d’un épisode du passé héroïque panhellénique ou athénien3. » Telle est la définition de la tragédie que peut donner, aujourd’hui, un spécialiste de poésie antique cultivant une approche anthropologique comme Claude Calame. Ce n’est évidemment pas le lieu ici d’entrer dans le détail de sa réflexion. On se contentera de noter combien sa définition est aux antipodes de celle qui fonde la recherche de J. Thélot. Ce dernier aborde la tragédie antique, et son corollaire suranné, le « tragique », dans une perspective « ontologique » (le mot est récurrent) ; il entend ainsi « décider que [Sophocle] n’est pas exclusivement le contemporain des Athéniens du ve siècle ». Mais cette revendication, qui correspond à un geste d’appropriation et d’acculturation, se justifie mieux lorsqu’elle est le fait d’un poète ou d’un metteur en scène contemporain. Dans le cas présent, elle revient à refuser le fait la tragédie antique puisse relever d’une esthétique, d’une finalité et de valeurs toutes autres que les nôtres, ou que celles qu’on aimerait lui prêter. La chose se confirme lorsqu’on prétend accéder ainsi au « savoir fondamental » (p. 12), au « cœur de la pensée de Sophocle » (p. 152), à la « vérité ontologique du récit » (p. 239).
13En vérité, à l’idée qu’il existe une « poétique générale » s’oppose l’idée que le « fait poétique » constitue une donnée aussi relative qu’une autre. Pour l’appréhender, les anthropologues convoquent les ressources d’une « ethnopoétique », attentive à toutes les normes culturelles et formelles qui entourent les manifestations « poétiques » (c’est-à-dire, pour la Grèce, cultuelles, chantées, et dansées le plus souvent) et qui les motivent. Un ouvrage collectif consacré à la « voix actée » et revendiquant « une nouvelle ethnopétique »4, paru en 2010, montre combien l’oralité et le cadre d’énonciation sont fondamentaux pour la compréhension des œuvres poétiques traditionnelles, et notamment antiques. Le compte rendu paru à l’époque dans Acta fabula décrit bien les buts de cette ethnopoétique :
Cette science (si c’en est une, puisqu’elle se définit davantage comme un empirisme), disons plutôt ce courant de pensée, entend en finir avec le dictat de l’énoncé érigé en « texte » prétendument objectif et autonome, doué en lui-même d’un sens intangible. En fait, depuis longtemps, le sens présumé d’un texte n’est plus conçu par la critique comme un gisement qui s’y trouverait enfoui a priori, un filon qu’une herméneutique aurait à mettre au jour, mais comme une construction qui se fait à la réception (audition, lecture), ce qui laisse déjà un certain espace à la subjectivité5.
14Cette donnée oblige à rappeler avant toute analyse — ce que La Condition de la parole ne fait jamais explicitement — que la destination première de la tragédie est cultuelle ; qu’elle s’inscrit par ailleurs dans le cadre d’un concours ; que sa composante première est chorale, c’est-à-dire que le groupe des quinze citoyens qui forment le chœur constituent (le lexique grec en témoigne) le noyau du spectacle ; que le spectacle alterne parties parlées et chantées, enfin qu’il intègre musique et danse. Peut-on faire l’impasse sur ces données historiques, dont Sophocle était le premier à dépendre, lorsqu’on aborde son œuvre ? Bien sûr on le peut, on ne s’en est pas privé, parce que l’Antiquité a cette qualité — à la fois réelle et illusoire — d’appartenir à tout le monde. Mais c’est à nos yeux à un étrécissement plus qu’à l’avènement d’un absolu que mène la voie de l’acculturation. Une « tragédie » ne se limite jamais à un texte : ce que la tradition nous a légué, selon l’expression de Simon Goldhill, ce sont des « scripts for dramatic performance in the theatre »6, c’est-à-dire renvoyant fondamentalement, à travers la construction, les marques énonciatives, la langue ou encore la métrique, aux conditions du spectacle. Se fonder sur ces « rares ruines textuelles » (p. 130), comme les désigne l’auteur lui-même, pour « accéder à “l’essence de la tragédie” » ou « penser le tragique primordial » (p. 248), c’est risquer de n’y trouver que ce qu’on souhaite y trouver, c’est-à-dire soi-même.
15La perspective ethnopoétique invite au contraire à considérer le texte tragique, tout riche de significations et de subtilités qu’il peut être, comme un épiphénomène. Du moins à ne pas le sacraliser. On voit à ce titre combien elle s’accorde mal avec la démarche de J. Thélot. Mais on aurait tort d’attribuer aux historiens et anthropologues un dégoût de l’écrit ou une haine de l’absolu : Lévi-Strauss lui-même visait à identifier des universaux par-delà la diversité des constructions culturelles. Mais cette démarche implique en premier lieu de restaurer l’altérité, sans la réduire ou l’estomper — une démarche plus cruciale encore dans le cas des Grecs et des Latins, qui nous paraissent toujours faussement proches.
16La même prudence est de mise, on l’a dit, lorsqu’il s’agit d’établir des correspondances entre le lexique indigène et le nôtre. « Antigone est une artiste, non pas une sainte » (p. 90), affirme J. Thélot. Difficile pour l’helléniste de s’accorder à ce jugement, quand il ne trouve aucun correspondant pour ces deux concepts, « artiste » et « sainte », dans la langue qu’il étudie ! De même, J. Thélot insiste à plusieurs reprises sur le fait que « le tragique a un sens ». Un sens — ou des sens ? Je serai plutôt d’avis, avec Pierre Judet de la Combe notamment7, que si le mot « tragique » revêt un sens à nos oreilles, ce dernier diffère diamétralement de celui qu’il revêtait pour les Grecs. Comment croire alors en une « universalité du tragique » (p. 227) ? Il en va encore de même pour le terme « mythe » qui, on le sait, n’avait pas pour Sophocle et ses contemporains le sens qu’on lui prête aujourd’hui. Au ve siècle, les « mythes » ne sont rien d’autres que des récits traditionnels, qui appartiennent pleinement au réseau des croyances et fondent l’identité civique et religieuse des Grecs. Cette donnée contredit l’intuition de l’auteur selon laquelle la tragédie constitue une « démythification », c’est-à-dire une « réflexion critique […] sur le mythe qu’elle réécrit » (p. 42). Bien plutôt, la tragédie poursuit le travail interprétatif et exploratoire que favorisait les mythes, tout en ancrant ces récits dans un cadre cultuel.
17On pourrait multiplier les exemples, mais cela ne ferait que renforcer la dichotomie entre perspectives historique et littéraire. Ce n’est pas la voie la plus féconde.
Faire acte d’historien ou de poète
18À considérer la relativité du fait poétique, faut-il juger la thèse de J. Thélot illégitime ? Pas nécessairement. On doit être sensible au souhait qu’émet J. Thélot de trouver en Sophocle un contemporain. Pour être honnête, sa démarche me paraît même être la seule adéquate, qui vise à ramener à nous les Anciens. Il n’y a rien de plus vain qu’une recherche philologique qui ne trouve pas d’ancrage et de continuité dans le présent. Et après tout, les anthropologues ne font rien d’autre, lorsqu’ils cherchent à identifier en quoi les Grecs, leurs œuvres et leurs modes de pensée, diffèrent des nôtres : c’est aussi une manière de nous les rendre proches et, surtout, de nous observer nous-mêmes par le biais du « regard éloigné » cher à Lévi-Strauss.
19Simplement, J. Thélot suit le chemin inverse lorsqu’il tente de « déduire quels universaux soulèvent inactuellement [les textes], qui nous les rendent passionnants, présentement utiles et vrais » (p. 16). Il ramène Sophocle au « même » ; il l’inscrit dans la longue lignée des poètes rebelles, maudits et voyants — des images qui doivent tout à notre modernité et à peu près rien à l’Antiquité. Le volet final de l’ouvrage l’affirme de manière explicite : « Philoctète est une figure de poète et sa puanteur une symbolisation de son destin de poète » (p. 274). Et de fait Philoctète, « l’incarnation du poète selon Sophocle » (p. 288), est décrit comme un « suicidé de la société » (p. 276), contraint à passer sur son île « une saison en enfer » (p. 275). Assurément le lexique ici n’est pas grec. Et ces affirmations sonnent d’autant plus étrangement à l’oreille du philologue qu’il sait que le concept de « poète » dans l’Antiquité n’a rien de sulfureux ; que par ailleurs un poète tragique est plutôt désigné comme tragoidopoios, « faiseur de tragédies », et qu’Aristophane l’assimile à un didaskalos, c’est-à-dire à un « enseignant ». Et puis il sait aussi que Sophocle a occupé des postes officiels, servi comme stratège, comme prêtre, et qu’il a été élevé au rang de héros juste après sa mort. Pas tout à fait le destin d’un Lautréamont.
20Pour toutes ces raisons, La Condition de la parole apparaît plutôt comme un livre militant, une tentative d’arracher Sophocle au temps pour le rendre à ses héritiers. Rien ne le montre mieux que ce passage où J. Thélot décrit les épreuves de Philoctète comme un « portrait du poète en Philoctète » — un miroir donc — dans lequel « maints poètes modernes, de Laforge à Demangeot, ont reconnu leurs tourments et leur vocation » (p. 272). En somme, on peut dire que l’auteur a cherché à justifier leurs intuitions. La recherche ainsi appréhendée séduira sans doute les amateurs de littérature moderne, mais moins les antiquisants. C’est ce qui explique que l’ouvrage soit publié chez un éditeur plutôt centré sur la philosophie et la spiritualité.
21Quant aux historiens et aux anthropologues de l’antiquité, ce livre les invitera à réfléchir sur le besoin que nous avons, tenace et narcissique, de chercher notre propre reflet dans les sources antiques, de goûter l’identité et l’absolu plus que l’altérité. Ce serait presque motif à une enquête ethnopoétique… Mais peut-être sommes-nous sur ce point fidèles à l’esprit des Grecs, qui aimaient à réécrire sans cesse les récits mythiques en leur offrant de nouvelles interprétations. N’est-ce pas une nouvelle version du mythe de Philoctète qui voit ici le jour ? De ce point de vue, la démarche de J. Thélot se révèle elle-même « poétique », selon la définition d’Aristote, c’est-à-dire intéressée à l’exercice des possibles plutôt qu’à la chronique des faits. Et qui mieux qu’un poète saurait s’approprier les mythes, afin de les rendre « passionnants, présentement utiles et vrais » (p. 16) ?

