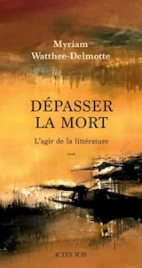
Car les poètes toujours comprendront les tombeaux…
1Sur la couverture, un détail d’un grand tableau de Zao Wou-Ki, 10.03.72 – En mémoire de May (1972) : de larges traces noires, qui barrent de leur désolation endeuillée un horizon de lumière qui semble hésiter entre le doré de la transfiguration et l’ocre de la terre et du sable, retiennent l’attention du lecteur et l’obligent à marquer d’emblée un arrêt méditatif au seuil du livre. Puis, le dispositif titulaire, à double détente : Dépasser la mort, magnifique formule d’une promesse fervente, suivi de L’agir de la littérature, où s’annonce une approche anthropologique de la littérature qui, dans la mouvance de Réparer le monde. La littérature française face au xxie siècle (2017) d’Alexandre Gefen par exemple, en ravive l’importance et l’éclat dans un monde où elle a pu paraître reculer face à la technologie et aux « sciences dures ». Myriam Watthee-Delmotte l’affirme avec force dans la conclusion de son ouvrage :
L’obsolescence programmée de la littérature que certains pensent inévitable n’est donc pas pour tout de suite : c’est souvent dans la confrontation à la mort que les plus insensibles, voire les plus réfractaires, se raccrochent aux poètes qui arrivent à exprimer si finement ce que l’homme ordinaire éprouve en aveugle. Alors oui, il existe bien une littérature qui […] accomplit […] les rites mortuaires qui font défaut quand l’indifférence ou l’inhumanité règnent. Et oui, la littérature peut être utile. (p. 250-251).
Sous le signe des rites
2L’essai, écrit après le choc du suicide d’un ami que M. Watthee-Delmotte évoque en ouverture du livre, se présente comme un élégant essai divisé en huit chapitres, eux-mêmes toujours divisés en trois sections. Chaque chapitre porte un titre à l’infinitif, marquant l’efficacité pragmatique de la littérature face à la mort, par exemple : « Faire face au choc », « Parler face à la tombe », « Effectuer le chemin du deuil », « Commémorer pour légitimer », etc. L’ouvrage se clôt sur une manière de conclusion intitulée significativement « Ne pas fuir la mort, l’apprivoiser ». C’est donc un parcours à travers différentes étapes du deuil ou divers rituels funéraires que propose l’auteure. L’ordonnancement équilibré, manifestement concerté (et on peut lire ce mot au sens musical, puisque, en accord avec le label Cypres, l’auteure propose également en fait d’ouvrage une playlist de dix plages musicales en accompagnement de la lecture), ne doit pas cependant faire croire à un système rigide, qui parcourrait la littérature selon un modèle théorique préétabli ; bien au contraire, le parcours sur la route de la mort est une invitation à la lecture, au gré des livres qui ont aidé l’auteure à surmonter l’épreuve du deuil : « Venez, je vous précède et je les suis » (p. 10) nous dit-elle simplement à propos des écrivains qu’elle va convoquer.
3Le livre, par bonheur, évite ainsi de déplorer simplement le déclin des rites funèbres communautaires (religieux ou laïcs) comme de se contenter de fustiger l’injonction de faire son deuil, d’accomplir un travail de deuil qu’une mauvaise vulgate freudienne invitant à guérir du deuil ferait aujourd’hui peser sur les individus. Avec plus de souplesse et d’intuition de la diversité des expériences humaines, M. Watthee-Delmotte s’attache plutôt à parcourir, sans tenter d’en dresser un tableau exhaustif ou explicatif, les différents modes de rapport à la mort que la littérature instaure, que ceux-ci participent à des institutions, tel l’éloge funèbre (p. 43-54) ou le discours de panthéonisation (p. 110-117), ou qu’ils relèvent du deuil privé voire intime, comme le poème quand l’auteur ne le publie qu’à son corps défendant (c’est le cas de Michaux avec Nous deux, p. 33-39), avec reprise et retard (telle Béatrice Bonhomme-Villani, p. 13-25), voire pas du tout (Mallarmé et son Pour un tombeau d’Anatole, p. 26-32). Dans cette exploration d’un domaine qu’elle sait illimité, M. Watthee-Delmotte procède par coups de sonde à travers la littérature française et francophone (la littérature belge, évidemment — l’auteure enseigne à l’Université catholique de Louvain —, mais aussi canadienne, avec Nancy Huston et Vickie Gendreau), et ne s’arrête pas aux frontières génériques, ni même, d’ailleurs, aux frontières de la littérature. La poésie est largement représentée, depuis Malherbe (la Consolation de M. Du Périer est lue dans toute la distance historique qui nous sépare des mentalités de la fin du xvie siècle, p. 59-63) jusqu’à des poètes contemporains (B. Bonhomme-Villani, déjà citée, ou F. Emmanuel et son magnifique Portement de ma mère publié en 2001), en passant par Lamartine. Le roman est également très présent, avec une orientation massivement contemporaine ; sont abordés avec finesse des auteurs aussi variés que Yannick Haenel dont le projet de commémoration a suscité une réception polémique (p. 118-128), Jérôme Ferrari qui reprend à nouveaux frais la question de la banalité du mal (p. 180-190), Sorj Chalandon et sa réécriture du mythe d’Antigone (p. 148-158), Édouard Levé et son évocation sans pathos du suicide d’un ami qui préfigure le sien (p. 202-208) ou la regrettée Yun Sun Limet qui lutte contre l’oubli (p. 131-135). De cet ensemble d’études subtiles quoique parfois frustrantes par leur brièveté, nous ne citons ici que quelques-unes des plus suggestives ; mais le point d’orgue en est sans nul doute le chapitre consacré à l’œuvre d’Henry Bauchau (p. 82-93), dont M. Watthee-Delmotte est une spécialiste reconnue, et qu’elle relit ici à partir de la « hantise » (p. 82) dont elle procède et qui permet à l’auteur de La Déchirure (1966) de mettre au jour dans toute son œuvre « le rôle d’initiateurs des mourants et des défunts » (p. 93). Par-delà la littérature institutionnalisée, outre le cas des éloges funèbres (dont celui de Johnny Hallyday par Emmanuel Macron…) et des discours officiels déjà mentionnés, M. Watthee-Delmotte s’intéresse à la chanson (Barbara, Stromae, p. 219-229), aux dispositifs numériques (J. Barber, F. Chambefort, p. 230-241) et au dialogue artistique d’Ernest Pignon-Ernest avec des disparus aussi prestigieux que Rimbaud, Artaud, Nerval et Desnos (p. 242-247).
4La littérature ainsi envisagée dans la manière dont elle permet de « dépasser la mort », de trouver des mots dans et pour le deuil, participe donc, comme M. Watthee-Delmotte le montre bien, à un ensemble d’actes qui, bien que certains relèvent effectivement de la ritualité funèbre (célébrer le mort par l’éloge, panthéoniser, construire un tombeau littéraire…), s’inscrivent bien plutôt dans la ritualisation du deuil qui caractérise la société contemporaine1.
La béquille & la bascule
5La question majeure qui se pose à la lecture de cet ouvrage stimulant engage in fine non seulement le rapport à la littérature qui se joue dans le deuil mais aussi le rapport de l’humanité à la mort, aux morts. Deux réflexions nous paraissent s’imposer à la lecture de l’ensemble des analyses proposées par M. Watthee-Delmotte.
6D’une part, la littérature est explicitement présentée comme une sorte de béquille. Elle permet d’abord de surmonter le mutisme du choc qui suit la mort d’un proche, comme l’auteure en témoigne elle-même quand elle raconte l’expérience qui l’a amenée à écrire ce livre : « C’est alors que les écrivains peuvent nous venir en aide, parce qu’ils inventent une langue dans laquelle nous pouvons retrouver nos affects » (p. 8). Mais en outre la littérature permet, selon M. Watthee-Delmotte, de pallier le défaut communautaire qui livre l’individu endeuillé à lui-même, en une époque où le lien social se distend et où les institutions qui jusqu’alors cadraient socialement le deuil dans une ritualité déterminée s’effacent. Par cette fonction de réinscription communautaire, la littérature accompagne et accomplit la résilience (si l’on veut employer un terme à la mode) de la personne endeuillée. Telle est du moins la thèse exposée dès le chapitre liminaire, qui explique à la fois que la langue que les écrivains inventent face à la mort permet aussi de « nous sentir unis dans la même souffrance, [d’]éprouver notre commune fragilité de mortels et notre besoin de faire sens ensemble pour que quelque chose soit sauvé du gouffre » (ibid.), et que la littérature s’immisce jusque dans les « cérémonies funèbres » « depuis l’abandon des références religieuses qui autrefois cadraient la mort » (p. 9).
7Mais ne s’agit-il vraiment que de cela ? Une telle thèse, peut-être un peu schématique et encore redevable à une conception du deuil comme dépression dont il faut sortir, ne rend pas pleinement compte des analyses critiques, plus subtiles, qui complexifient bien davantage les fonctions et les pouvoirs de la littérature en lisant, avec acuité, les œuvres abordées. Au vu de ces analyses, et en particulier celles qui portent sur l’œuvre d’Henry Bauchau ou sur les réécritures du mythe d’Antigone (chez S. Chalandon et chez A. Cronil), on est souvent tenté de penser que la littérature n’exerce pas véritablement une fonction supplétive ; plutôt que béquille, elle est bascule : elle ne soutient pas les endeuillés, elle les oblige à redéfinir, à reprendre, comme le suggère Vincent Delecroix2, leurs vies en y accueillant les défunts, en leur accordant une place qui nous oblige à inventer une nouvelle relation avec eux comme envers nous-mêmes. On ne sort peut-être jamais du deuil, et le processus de « travail de deuil » qu’on évoque souvent n’est peut-être qu’illusion ; ce que peut alors la littérature, c’est faire basculer notre vie endeuillée vers une nouvelle vie où la présence des morts compte différemment. C’est sans doute cela, « Ne pas fuir la mort, l’apprivoiser », pour infléchir légèrement le sens du beau titre de la conclusion de Myriam Watthee-Delmotte.

