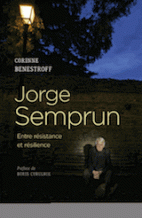
Un regard clinique sur la production de Jorge Semprún
1Dans son ouvrage Jorge Semprún, Entre résistance et résilience, Corinne Benestroff conjugue ses deux spécialités, la psychologie et la littérature, afin de proposer une lecture à la fois clinique, historique et culturelle de la vie et des stratégies d’écriture de Jorge Semprún. En psychologie, la résilience1 désigne la capacité d’un individu à se reconstruire suite à un traumatisme. Afin de comprendre la particularité de cet ouvrage, il convient d’abord de saisir le parcours unique de l’auteur étudié.
2Jeune Espagnol issu d’une famille d’aristocrates républicains, en exil depuis l’enfance, résistant, survivant de la Gestapo et de la déportation, militant communiste accomplissant des missions aussi périlleuses que clandestines dans l’Espagne franquiste d’après‑guerre, écrivain, essayiste et figure politique publique, Semprún constitue à lui seul un pan de l’histoire politique, sociale et culturelle du xxe siècle.
3À vingt ans, Semprún est envoyé à Buchenwald, en tant que Rot Spanier. Comme tous les survivants, son expérience concentrationnaire constitue un traumatisme qui ne disparaît pas à la libération. Il choisit alors le silence afin de se permettre de (re)vivre. Jusqu’en 1964, date de la publication de son premier roman, Le Grand Voyage, Semprún n’avait jusque‑là ni témoigné, ni fait reconnaître son statut d’ancien déporté. À ce titre, le choix de Boris Cyrulnik pour préfacer l’ouvrage est emblématique : enfant juif ayant réchappé de justesse à la rafle bordelaise de 1942, caché durant toute la durée de l’Occupation, le futur psychiatre décide également de se taire pendant plusieurs décennies2.
4Semprún est un cas particulier car il demeure un exilé, à la fois de son pays et de son identité. Fils de bourgeois mais doté d’idéaux marxistes, il occupe au camp une position plus favorable que la grande majorité de ses camarades espagnols, en travaillant à l’Arbeitsstatistik ; figure dominante du Parti communiste d’Espagne durant l’après‑guerre, il en est toutefois exclu en 1964 et se consacre alors à sa carrière d’écrivain et de figure intellectuelle publique. Bref, Semprún connaît plusieurs métamorphoses, aux transitions parfois ambiguës, dont il subit les critiques3. C. Benestroff choisit donc de présenter le parcours de l’homme et de son œuvre comme « une deuxième traversée du Styx initiant l’épopée de catabase : la descente aux enfers et sa remontée » (p. 276). En outre, en s’intéressant à Semprún, C. Benestroff opte pour la présentation de toute une génération marquée par la guerre, l’expérience concentrationnaire et l’engagement politique. Les recherches incluent des investigations parfois très poussées sur les compagnons de route de l’auteur, et laissent également un espace d’expression pour des témoins méconnus et leurs familles.
5Enfin, il est à remarquer la présence de « focales », c’est‑à‑dire d’arrêts sur images, où l’auteur étudie en profondeur une scène ou une procédure d’écriture particulière de la production semprunienne. Ces temps particuliers mettent en valeur un certain aspect pédagogique de l’ouvrage, et permettent une démonstration concrète des hypothèses formulées.
Une biographie à l’épreuve des traumatismes
La mort
6Les spécialistes de Semprún s’accordent pour affirmer que la mort de la mère de l’écrivain, Susana Maura y Gamazo survenue dans son enfance (1932), constitue un premier traumatisme4, dont les effets seront visibles tout au long de sa vie, que ce soit dans son écriture, ou dans ses relations avec les femmes : « L’avenir était probablement rempli de femmes aux yeux fermés5 ». Dans le roman L’Algarabie, Rafael Artigas, l’un des doubles de Semprun, évoque cette omniprésence du féminin :
Le parcours aboutit à la chambre close « dans le sein maternel de la mort ». Le couloir en L, « L majuscule L comme lilas litote ou lapis‑lazuli » se sur‑imprimera dans les prénoms des femmes des romans : Laurence, Lorène, « L comme Lilith, comme Lisbeth, comme Luciana ? » L, Elles, Elle, la mère, mais aussi, le lilas qui condense les images de retour de Buchenwald, la litote « qui en dit moins pour en dire plus », de l’expérience concentrationnaire emblématique dans l’œuvre, et jusqu’au L de François L., le jeune mourant dont Semprún a failli endosser l’identité au Revier de Buchenwald. (p. 44‑45)
7Le second mariage du père avec la gouvernante suissesse Annette Litschi choque durablement les enfants ; il est « ressenti comme une capitulation » (p. 43), une trahison face à l’idéal maternel.
8Dès lors, le deuil constitue un motif récurrent chez Semprún. Au camp, il doit affronter les disparitions tragiques de figures d’autorité telles son professeur Maurice Halbwachs, son chef de réseau Henri Frager, « libéré », ou encore le militant communiste Diego Morales. Cependant, certaines de ces morts prennent la forme de « pietàs » (p. 277), en particulier la découverte du Juif agonisant récitant son Kaddish. Les « pietàs » sont une manifestation de dévotion, de bonté envers des figures particulières ; en témoigne le parallèle de la gestuelle envers le survivant juif et le professeur agonisant :
Je me suis agenouillé à côté du survivant juif. Je ne sais que faire pour le garder en vie, mon Christ du Kaddish. Je lui parle doucement. Je finis par le prendre dans mes bras, le plus légèrement possible, de peur qu’il ne se brise entre mes doigts. […] Maurice Halbwachs aussi, je l’avais pris dans mes bras, le dernier dimanche. […] J’ai glissé mes bras sous ses épaules, je me suis penché sur son visage, pour lui parler au plus près, le plus doucement possible6.
9Dans l’horreur du camp, ces hommes sacrifiés mais entourés deviennent le symbole d’une « fraternité partageable », une « force combattante » (p. 277). Il est intéressant de noter que si la tristesse de perdre des camarades ou la rage de constater son impuissance à les sauver est bien présente chez Semprún (p. 362), le deuil en revanche ne s’accompagne pas de remords quant au hasard d’avoir survécu, comme c’est pourtant le cas chez Primo Levi ou Elie Wiesel. Ainsi, dans Quel beau dimanche !, le narrateur déclare :
Moi, je regardais la neige au‑dehors. Je savais qu’en penchant un peu la tête je verrais la cheminée du crématoire, sa fumée routinière. Mais je n’arrivais pas à me sentir coupable. Je ne dois pas être doué pour ce sentiment‑là7.
10En insistant sur ces destins anonymisés dans la machine concentrationnaire, et en magnifiant les moments passés à leur côté, Semprún leur rend une unicité particulière, et bouscule le lecteur : « notre propre rapport à la mort est convoqué, laissant surgir l’angoisse d’une dissolution dans la massa perdita, la figuration de notre assassinat. » (p. 297).
L’exil
11C’est paradoxalement en quittant l’Espagne que Semprún réalise pleinement son identité de « rouge espagnol ». Le départ, et particulièrement l’arrivée à Paris, constituent des moments difficiles. Le jeune Jorge doit affronter l’hostilité de certains habitants ; on songe notamment au mépris de la boulangère, ou à la confrontation avec le fonctionnaire xénophobe8. Boris Cyrulnik témoigne également de ce refus de l’autre, du fait de sa judéité9. Ce rejet reviendra par la suite lors du rapatriement, puisque le jeune Gérard n’a pas droit à la prime de rapatriement, contrairement à son camarade français Harroux10. Paradoxalement, ces comportements engendrent une réaction d’auto‑défense ; la fierté d’appartenir à un groupe discriminé ou admiré selon l’interlocuteur, la volonté de se démarquer notamment dans les études. Ils donnent lieu également à des choix radicaux, comme « la décision du boulevard Saint‑Michel » (p. 240), autrement dit la volonté de s’exprimer dans un français épuré de toute trace d’espagnol. Si la langue agit ici comme une « revanche sur l’adversité » (p. 347), le plurilinguisme définit par la suite l’identité de Semprún ; l’espagnol comme langue intime, poétique, l’allemand comme écho à l’enfance et arme de survie au camp, et le français comme langue officielle de l’étudiant puis de l’écrivain. Quant aux repères spatiaux, de l’appartement luxueux et animé du centre de Madrid, le jeune Semprún doit dorénavant s’habituer à une maison de campagne isolée et mal chauffée : « Le confort de la vie madrilène est bien loin, l’argent manque car les comptes du père sont bloqués. » (p. 52). Autre bouleversement : la chute de la figure paternelle, puisque le père n’est plus en mesure d’assurer financièrement son éducation — ce même père qui faisait sa culture au Prado. C’est alors un ami de la famille, Édouard‑Auguste Frick, qui prend le relais. Or, quoi de plus ironique que le « concepteur du passeport Nansen » (p. 52) pour s’occuper d’un jeune exilé ?
L’expérience de la torture
12Dans L’Évanouissement. Manuel présente sa confrontation avec la Gestapo comme une rencontre intime, presque métaphysique, avec la douleur. L’élément le plus insignifiant y est relié, comme en atteste la répétition du démonstratif ce :
ce même monde en train de devenir un bloc hostile et douloureux. Ce jardin de septembre […] Ce ciel bleu […] Ce geste d’un prisonnier inconnu […] ce ciel, ce jardin, ce sourire inconnu, mais fraternel11.
13Les détails, présentés sous forme de litanie, soulignent que ces moments n’ont pu être oubliés. Pire, liés pour toujours à l’expérience de la torture, ils sont amenés à réapparaître dans l’existence du narrateur comme synonyme de douleur. Par exemple, la chute depuis la plateforme du train réveille le souvenir des mauvais traitements endurés. La neige ou le blanc des murs de la clinique demeure définitivement associés aux appels sur la place centrale.
14Jean Améry12 estime que l’expérience de la torture constitue une « vérité morale », qui oblige à considérer, à juger, non seulement les tortionnaires — comme le fait Semprún avec ses bourreaux — mais l’ensemble de la société. Or, l’analyse d’Améry est foncièrement négative, puisque celui‑ci avoue avoir ressenti avant tout une « extrême solitude » ; a contrario, les interrogatoires de la Gestapo sont surmontés par Semprún qui se sent plus que jamais comme appartenant à une humanité fraternelle :
C’étaient les copains, ils étaient vivants, la vie était gaie. Il a eu envie de rire et la certitude lui était venu qu’aujourd’hui même les types de la Gestapo allaient capituler, qu’ils allaient désormais le laisser en paix, en attendant le conseil de guerre ou la déportation13.
Quels processus de deuil ?
L’action, ou les « activités sublimatoires » (p. 162)
15C. Benestroff montre que l’action comme cicatrisation du traumatisme constitue une « continuité tourbillonnante14 » chez Semprún. Cette action peut être menée à titre individuel ou au sein d’un collectif, comme ce fut particulièrement le cas à Buchenwald (p. 170). L’action de Semprún s’inscrit alors dans celle du comité, en tant que réponse d’un homme et d’une humanité meurtris cherchant à s’opposer aux maîtres SS. De manière générale, Semprún le « touche‑à‑tout » (p. 282) fait preuve d’une hyperactivité (militant, écrivain, ministre, scénariste, conférencier, etc.), qui viserait à dissimuler ses moments de fragilité aussi bien qu’à les surmonter.
16Dans un article annexe, C. Benestroff continue de s’interroger :
Nous savons que la résilience trouve son origine dans le travail de deuil. Peut‑on dire qu’il en va de même pour le fait résistant ? En considérant que l’armistice, l’occupation sont vécus comme un choc, un bouleversement profond, il est possible de décrypter les effets traumatiques de ces évènements15.
17L’entrée en résistance peut être considérée comme une attitude résiliente ; le traumatisme à nouveau vécu par Semprún — un pays occupé par une force répressive avec valeurs qui lui sont totalement étrangères — menace de dissoudre de nouveau son identité et les efforts accomplis. Le maquis apparaît comme une stratégie identitaire ; de plus, c’est à partir de là que naît l’idée d’une individualité complétée par la collectivité (les camarades du Tabou, puis plus tard les compagnons d’infortune de la prison d’Auxerre et du wagon, et les copains de Buchenwald).
18Les tuteurs de résilience de chair et d’os font leur apparition : ils peuvent être réels, tels Maurice Halbwachs, ou le chef de réseau Henri Frager. Ils sont aussi fictifs, comme l’Allemand Hans (L’Évanouissement) ou le gars de Semur (Le Grand Voyage). Les résistances dans le camp peuvent se percevoir comme des « sublimations de surinvestissement » (p. 164). La résilience ne peut ainsi se réaliser qu’à travers l’action : « Le fait résistant est à la foi le but et le moyen, il incarne en acte les valeurs idéales dans la durée. » (p. 373).
La politique
19La survie à Buchenwald a été rendue possible grâce à la résistance communiste clandestine. La libération du camp en avril 1945 peut s’interpréter comme une réappropriation de la dignité (p. 178). Toutefois, elle ne constitue en aucun cas une conclusion joyeuse, qui fermerait pour toujours la parenthèse de l’expérience concentrationnaire. La survie de Semprún passe par plusieurs stratégies : découvrir l’environnement pour mieux le comprendre et s’y adapter (Focale 5, « L’échappée belle », p. 179), que ce soit dans le cadre du camp ou lors du retour à la vie civile. Ensuite, se réduire au silence, puisqu’en 1945, les mots le mettent en danger de mort. Il s’agit enfin de s’impliquer de manière active et permanente, d’où l’entrée dans le Parti Communiste Espagnol et les missions clandestines en territoire franquiste.
20A contrario de ce qui est suggéré par C. Benestroff au chapitre 20, il apparaît difficile de considérer l’existence du stalinisme comme un nouveau traumatisme pour Semprún, puisque celui‑ci reconnaît s’être montré lui‑même dogmatique et autoritaire. De toute évidence, si l’on considère la position importante de Semprún au sein du PCE, il était en mesure de connaître la réalité de la société stalinienne (les purges, le Goulag), et en avait déjà été averti à Buchenwald, comme en témoigne plusieurs échanges16, et la culpabilité ressentie est exprimée avec modération dans des publications plutôt tardives. Force est de reconnaître que c’est davantage l’exclusion du PCE, et la condamnation émise par la Pasionaria (« intellectuels à tête de linotte ») qui le blessent. Tout comme Boris Cyrulnik, se taire permet « la restauration du moi blessé » (p. 232).
21Après le fait résistant vient donc le fait politique : « croire à un idéal révolutionnaire confirme l’existence de futurs magnifiés et à la possibilité d’une nouvelle entrée en Résistance » (p. 231). Cela constitue une alternative à l’écriture, pour le moment impossible, et conduit à une nouvelle forme de résilience. La revenance s’apparente alors à un « travail de retour ». Celui de Semprún s’accomplit en dehors des cadres associatifs, juridiques voire amicaux : C. Benestroff le compare à « un Don Quichotte sans Rossinante, totalement désœuvré, rêvant de moulins à vent à combattre » (p. 216). Là encore, l’action par le fait résistant constitue un réflexe de survie, et s’inscrit désormais comme une « partie intégrante de la personnalité même » (p. 216).
22L’engagement au PCE symbolise « le château où l’on retrouve sa noblesse » (p. 238). Le Parti permet une réappropriation de l’histoire familiale et de l’origine : il est « la métonymie magnifiée de l’Espagne et des images parentales » (p. 241). Néanmoins, cela s’effectue au détriment de l’identité singulière et engendre une situation freudienne : « l’abandon du moi à l’objet » (p. 242). En contrepartie, l’adhésion aveugle au Parti fonde un rempart sûr face aux fantômes du passé, en particulier ceux de Buchenwald. Cette tutelle s’achève lorsque l’exclusion de Semprún est prononcée par le comité de direction, et sévèrement approuvée par Dolorès Ibárruri en 1964. Cette mise à la marge réveille la mémoire concentrationnaire, d’où ce moment épiphanique caché dans l’appartement de Madrid17, préparé en amont par la cohabitation avec Manolo Azaustre, survivant de Mauthausen18. Elle décille l’individu rendu à sa singularité : « l’affaire de la cellule de la rue Saint‑Benoît, [l’]indifférence glacée face à Georges Skens […] l’exécution de Frank, secrétaire général du parti communiste tchèque » (p. 246). Paradoxalement, la mort symbolique du militant engendre la naissance de l’écrivain, puis du scénariste : « fermer les yeux sur le Parti, ouvrir les yeux sur le camp » (p. 247). Il faut bien réagir par rapport à ce nouveau traumatisme : la réponse est donc dans la création, elle‑même dans la continuité du fait résistant. Le succès, aussi bien institutionnel19 que dans la reconnaissance d’un lectorat‑tuteur nombreux20 (p. 345), valide cette dernière métamorphose et achève le processus de résilience (p. 255).
Les tuteurs de résilience
23Semprún a conscience de ses multiples fragilités, que ce soit dans le camp ou à sa libération. L’un des processus de résilience essentiel consiste en la présence de tuteurs sur lesquels s’appuyer et se confier. Dans le camp, ce sont ses professeurs comme Maurice Halbwachs et Henri Maspero21, ou son ami espagnol et militant anti‑fasciste Diego Morales ; or, tous décèdent, victimes du système concentrationnaire. De nouveaux tuteurs sont donc nécessaires, en particulier après la libération, lorsque personne ne peut ou ne veut écouter. C. Benestroff cite la critique littéraire Claude‑Edmonde Magny, qui l’héberge à plusieurs reprises, et qui écrira pour lui la Lettre sur le pouvoir d’écrire22. Semprún peut également compter sur son ami Pierre‑Aimé Touchard, présent lors de son arrivée à Paris en mai 1945 ; enfin, son camarade de déportation, l’artiste Boris Taslitzky. Ces tuteurs complémentaires constituent tour à tour un trio de figures maternelle, fraternelle et d’autorité. Ils peuvent être également fictifs : « le gars de Semur » du Grand Voyage, ce compagnon avec qui partager le trajet en wagon, la référence au personnage de Marcelino dans L’Espoir23 lors de l’agonie de François L.24 ou encore le résistant juif allemand Hans « von Freiberg zu Freiberg » dans L’Évanouissement. Le pouvoir de l’écrivain réside alors à réparer par l’invention ce qui n’a pu être fait dans les faits, et à reprendre le pouvoir sur son existence : « Mais c’est moi qui écris cette histoire et je fais comme je veux25. » Enfin, le tuteur peut être incarné par le collectif ; le nombre donne de la force à l’individu, transformant l’invivable en presque supportable : « À Auxerre, il y avait les copains de plusieurs mois, la prison en était devenue habitable. Mais à Compiègne on était des milliers, c’était une vraie pagaille, je ne connaissais personne26. ». Au sein d’une communauté, l’individu est capable de se transcender : « Mais dans les camps l’homme devient aussi cet être invincible capable de partager jusqu’à son dernier mégot, jusqu’à son dernier morceau de pain, jusqu’à son dernier souffle, pour soutenir les camarades27. » C. Benestroff estime à juste titre que c’est cette notion partagée de fraternité qui sauve littéralement Semprún — le détenu l’inscrivant comme Stukateur et non Student — et le pousse à préserver autrui — le Juif hongrois agonisant dans le second chapitre de L’Écriture ou la vie —.
24La culture incarne à elle seule un support important pour la résilience. Les lectures nombreuses et variées convoquent une armée de références. Développant dès son plus jeune âge une vaste culture européenne, Semprún s’initie à Henri IV à la philosophie, puis aux problématiques socio‑politiques de son temps. Durant la détention, Paul Valéry essaye de tromper la faim : « C’est que j’ai souvent récité Le Cimetière marin, dans cette cellule de la prison d’Auxerre, en face de Ramaillet28. ». Le voyage en wagon tente d’être supporté grâce au rempart proustien : « J’ai passé ma première nuit de voyage à reconstruire dans ma mémoire le côté de chez Swann et c’était un excellent exercice d’abstraction29. ». La musique atténue la froideur de l’hiver à Buchenwald « Arletty, de sa belle voix éraillée, aurait répondu à Barizon, à propos des beaux dimanches d’autrefois30. » et la poésie la proximité de la mort — la récitation de La Paloma, de Rimbaud ou de René Char. Plus tard, la culture constitue un pilier incontournable de l’écriture : « l’écrivain de la maturité en fait un des pans de ses écrits pour décrypter les mystères du monde et atteindre l’autre. » (p. 356).
Un temps particulier : la revenance
25Selon C. Benestroff, c’est la chute à Gros‑Noyer‑Saint‑Prix qui ramène Semprún à la demeure familiale, et met fin à son errance31. De cette pause trouble naît un retour des souvenirs d’enfance : « Madrid, la mère, le Parc du Retiro, la Bourgogne » (p. 211). Se redécouvrir avant le temps du camp, voilà le processus de résilience : « une auto‑thérapie en somme » (p. 212).
Le syndrome de Targowla
26C. Benestroff compare la revenance à l’arrivée au camp : c’est la même solitude, le même désarroi, qui anime le déporté (p. 191).Le retour apparaît alors comme le « monde du paradoxe » (p. 237). Il engendre des symptômes post‑traumatiques (p. 194‑196), comparables à ceux vécus par les vétérans des guerres (« comme les militaires rentrant du front », p. 197).
27L’auteur ne se contente pas de livrer un portrait psychique ; l’intelligence de l’ouvrage réside en ce qu’il présente chaque aspect de la situation traumatique, que ce soit l’aspect médical (description de syndromes, comportement hospitalier), que la réception du côté civil et familial.
28Il apparaît que Semprún souffre du syndrome de Targowla32, qui est une forme d’hypermnésie, mais concentrée sur un ou des évènements traumatiques à forte teneur émotionnelle. Ce syndrome s’observe notamment chez les survivants de camp (d’où une seconde appellation, le « KZ syndrome »), et peut s’installer durablement chez le sujet, si celui‑ci ne parvient pas à dominer la névrose. En outre, le syndrome de Targowla est fréquemment associé à d’autres troubles mentaux, dont la dépression et la décompensation. Par ailleurs, les symptômes du KZ syndrome sont doublés de l’expérience fraternelle vécue dans le camp ; le survivant n’est pas seul, il « traîne derrière lui la cohorte de ses frères d’ombre disparus dans la fumée » (p. 198).
29En parallèle, l’existence de Semprún est marquée par un silence professionnel, celui de l’homme voué aux missions secrètes et aux multiples identités, que ce soit en tant que résistant, déporté puis militant communiste. Le silence sert alors de couverture et préserve la clandestinité (p. 226). Cela dit, le silence peut être également imposé : « C’est donc un environnement ambivalent, marqué par le clivage et le déni, que les revenants rencontrent. Aussi sont‑ils contraints de guérir au plus vite et de se taire. » (p. 195). Boris Cyrulnik en témoigne également33. Dans le cas de Semprún, le silence est un choix conscient, décidé alors même que le jeune Gérard n’est pas encore revenu en France : « j’ai brusquement pris une décision » (p. 200). Le choix définitif du silence, aussi appelé « décision d’Ascona » par les critiques, souligne encore l’opposition de C. Benestroff aux détracteurs politiques de Semprún. En effet, elle y voit un processus de résilience, et non « une manœuvre visant une réhabilitation après l’aveuglement stalinien » (p. 215). C’est à la fois une décision identitaire, « entre[r] dans une nouvelle clandestinité qui durera jusqu’à la rédaction du Grand Voyage » (p. 217) mais qui va déterminer également l’écriture à venir, encore incertaine sur la « forme à donner au témoignage » (p. 218), et une stratégie littéralement médicale : « une fuite dans la guérison » (p. 217). À ce titre, et dans la continuité de l’analyse du syndrome de Targowla, l’évanouissement donne lieu à diverses lectures : fuite salutaire lors de la séance de torture chez le Dr. Haas, il apparaît dans l’ouvrage éponyme comme un symptôme, un potentiel « acte manqué » (p. 202), et dans le même temps, « la résurgence des souvenirs (p. 201). L’inversion entre rêve et réalité est fréquente à travers les ouvrages ; ce même phénomène est décrit par d’autres survivants, tels Jean Cayrol ou Primo Levi (p. 200). La vie après le camp ne serait en réalité qu’un songe.
Une écriture du va‑et‑vient
30L’expérience concentrationnaire constitue une situation extrême en ce sens que non seulement le dénouement est incertain (le déporté n’est plus maître de son quotidien ni même de sa propre mort), mais en outre le milieu particulier du camp efface toute notion de passé, de présent et de futur. Dans le même temps, l’écriture littéraire apparaît comme un contrepoids positif à l’écriture comptable de l’Arbeitsstatistik (p. 158). C. Benestroff ajoute : « Certains symptômes du mal des camps deviennent l’une des caractéristiques de son style. » (p. 313). Par conséquent, le récit emploie plusieurs techniques d’écriture, et n’hésite pas à mêler non seulement les langues (p. 349) mais également les genres, « des techniques propres au nouveau roman à une littérature plus populaire comme le roman policier ou d’espionnage » (p. 290). Une nouvelle « théorie du roman » (p. 331) naît.
31Tout d’abord, les récits sont marqués par l’analepse et la prolepse. Elles forment des brèches dans le texte (p. 198), des overlaps (p. 122). En tant que conséquences du traumatisme, elles sont amenées à resurgir de manière impromptue tout au long de l’existence, et donc des publications : « flash‑backs, cauchemars, angoisses, sensations de déréalisation, crainte d’une mort imminente » (p. 282). Elles représentent également des manœuvres de résilience : aller et revenir sur un sujet, afin de pouvoir l’aborder dans tous ses aspects. On songe notamment à la découverte du juif hongrois dans L’Écriture ou la vie ; cette scène est interrompue par des souvenirs personnels, d’avant le camp, qui aident à surmonter la peur d’écouter « la mort qui chantonnait » dans la baraque. Et pour cause, l’écriture semprunienne est reconnaissable par un « flux de conscience » omniprésent (p. 122). Elle n’hésite d’ailleurs pas à jouer sur les temps de la narration : « les jeux de l’écriture, chausse‑trappes, chassés‑croisés, ellipses, trompe‑l’œil » (p. 276). Cette rédaction menée par un « tourbillon mémoriel et actuel » (p. 122) est attestée par les spécialistes de Semprún, à commencer par Françoise Nicoladzé, dont les travaux de recherche reprennent cette thématique34. Les bouleversements de la pensée sont également présents visuellement : « absence de ponctuation, majuscules inopinées, phrases orphelines, blancs typographiques, etc. » (p. 285) ; ces trouées font écho aux éléments éphémères qui marquent la mémoire de l’écrivain : blanc de la neige, blanc du souvenir, fumée évanescente ou bien grise du crématoire.
32Par ailleurs, l’oxymore et les synesthésies servent à lier des évènements passés et présents ; ainsi le drapeau des Espagnols républicains s’associe à la défaite, celle vécue en Espagne puis en France (p. 193). Ils soulignent également la tension entre des valeurs contraires mais pourtant contraintes de cohabiter (p. 336). Ainsi, le projet d’évoquer Buchenwald « à l’envers », en commençant par la journée de repos hebdomadaire35, la présence de duos impossibles, tels Pola Negri et le Petit Camp36, Zarah Leander et le sous‑officier des SS37 ; enfin, le surgissement de la culture dans des espaces inattendus, comme Goethe à l’entrée du camp38, Rimbaud aux latrines39, « Les cadavres, contorsionnés comme les figures du Greco40 ». Parfois, l’association suscite une réelle polémique ; on songe au couple Beethoven/Ilse Koch, d’ailleurs critiqué par Imre Kertész lui‑même (Focale 11).
33« Jeux du Je » et « Je des jeux » (p. 369) : les je sont multipliés, d’où un « moi plastique » (p. 343) ; on note également certains basculements du je au il (p. 128). L’arrivée au camp fait disparaître le moi ; l’identité étant effacée, transformée en numéro, c’est logiquement le il qui prend le relais : « et Gérard saute sur le quai, dans la lumière aveuglante41. ». Dans Quel beau dimanche !, les narrateurs passés sont abordés avec distanciation : « Gérard, de toute façon, n’avait pas choisi ce prénom, autrefois » (p 436). Le je est tantôt intime, narré (p. 218), officiel ou officieux (p. 239). Activité militante et clandestine oblige, Semprún joue également avec les identités : le jardinier Gérard Sorel, le militant Federico Sanchez, Juan Larrea, le jeune Manuel dans L’Évanouissement (p. 203) ...
34Ce stream of consciousness permet la remémoration de nouveaux traumatismes ; il mène à la rédaction de l’ouvrage Le Mort qu’il faut (Focale 4), et notamment à cet autre destin qu’aurait pu vivre l’auteur : « Le deuxième double, François L, pourrait être son jumeau : même âge, étudiant parisien, arrivé aussi le 27 janvier 1944. » (p. 168). Le courant de conscience se traduit entre autres par des structures gigognes, qui brouillent les repères de narrateur et de narration classiques (Focale 9). Il permet également de revenir, voire de réécrire les biographèmes, c’est‑à‑dire des moments que l’auteur considère comme les plus marquants, structurants de sa mémoire (mort de la mère, visite du Prado, arrivée au Camp, Lorène, etc.), et ce parfois au détriment de l’intrigue en cours. À ces biographèmes sont associés des revenants (p. 314) : Maurice Halbwachs, le soldat allemand chantant la Paloma, et surtout les enfants juifs et le groupe survivant venu de Czestochowa, « installant la mémoire de la Shoah au fil des œuvres » (p. 317), et confirmant par là son rôle de témoin pour ceux qui ne sont plus. La réitération est à la fois traumatisante et thérapeutique (p. 321), d’où l’expression tout à fait pertinente de Benestroff d’ « écriture cicatricielle » (p. 355).
Dernière métamorphose : l’homme public
35La publication s’intensifie parallèlement au vieillissement du survivant, phénomène d’ailleurs courant chez les anciens déportés ; les nouvelles générations, et plus particulièrement la descendance — Jaime Semprún, mais surtout Thomas Landman et Cécilia, à qui il dédie L’Écriture ou la vie — sont perçus comme un public à part, destiné à prendre le relais : « J’ai posé une main sur l’épaule de Thomas, comme un passage à témoin42 ».
36La disparition des grandes figures de la déportation, en particulier Primo Levi, le 11 avril 1987, influence directement la rédaction de L’Écriture ou la vie. On songe également au suicide de Paul Celan en 1970, celui de Jean Améry en 1978, ou la fin du grand Varlam Chalamov en 1982. Or, tous ces auteurs ont été lus, cités ou étudiés par Semprún. Ces décès agissent comme une piqûre de rappel ; la mort a beau avoir été traversée à Buchenwald43, elle peut revenir à tout moment. À ce titre, l’activité politique est considérée par C. Benestroff comme un répit salvateur, qui permet d’appréhender cette nouvelle phase de l’écriture et de l’existence (notamment la figure de l’intellectuel, appelé à devenir ministre de la Culture sous Felipe Gonzales de 1988 à 1991). Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Semprún retourne pour la première fois à Buchenwald l’année suivant la fin de son exercice, en 1992.
37Semprún entame une dernière métamorphose, celle du témoin, dont l’ère a été décrite par Annette Wieviorka44. Toutefois, le témoignage passe dans son cas par la littérarisation (p. 374). La notion de « devoir de mémoire » (p. 272) s’est imposée dans l’opinion publique, marquée d’une part par plusieurs grands procès et scandales (affaires Touvier, Barbie, Papon) et le constat de la disparition inexorable des survivants, pour qui il faut désormais non seulement conserver la parole, mais également défendre la mémoire, menacée par l’essor du négationnisme. En fin de compte, « la mémoire ne vaut qu’en étant active au présent, elle est un moyen et non une fin » (p. 272). Le fait résistant se poursuit chez Semprún à travers la participation aux commémorations et à des conférences. Il permet dans le même temps de lutter contre « l’angoisse du témoignage » (p. 274) et la crainte d’ « être le dernier45 ». Il s’inscrit là encore dans un cadre collectif : s’adresser à un public, à un lectorat, au nom d’une communauté (les déportés et surtout les disparus). La réappropriation du passé est également une question de survie : « Vivencia : le revenant doit affronter la part morte de lui‑même pour nourrir la part vive » (p. 278).
38Enfin, complémentaire aux livres, le cinéma consacre la métamorphose de Semprún en intellectuel engagé. Il permet une nouvelle identité clandestine : « le scénariste ne se voit pas, sa vocation est de rester dans l’ombre » (p. 257). Il offre des rencontres qui apportent une forme de résilience : la figure paternelle d’Alain Resnais, et celle fraternelle d’Yves Montand46. L’auteur souligne l’influence de l’écrivain sur la scène artistique contemporaine « le plasticien Edward Hillel, les écrivains Fabrice Humbert et Toshiyuki Horie, le dramaturge Pascal Reverte » (p. 379), preuve de l’actualité de ses œuvres et des problématiques qu’elles soulèvent.
***
39L’ouvrage de Corinne Benestroff mérite définitivement de s’y arrêter, notamment pour deux raisons. D’une part, l’auteur s’éloigne des lectures politiques de la production semprunienne, telle celle de Marta Ruiz Galbete, afin de proposer une interprétation psychanalytique ; le phénomène de résilience est fréquemment abordé lorsqu’il concerne des individus traumatisés, mais s’arrêtait aux portes de l’analyse littéraire. Ce temps est désormais révolu. L’œuvre se perçoit comme une « carte intime » (p. 120). Ensuite, l’impressionnant corpus scientifique, humaniste, historique, de fiction, les témoignages et les archives rassemblés par l’auteur sont non seulement le gage d’une recherche en profondeur, mais constituent également un vaste champ d’études, lequel, à travers le prisme de la résilience, offre une nouvelle approche des littératures traumatisées. Ainsi, C. Benestroff critique la relecture de l’expérience concentrationnaire à travers le seul prisme de l’engagement communiste, comme c’est également le cas chez Catalina Sagarra Martin (Jorge Semprún : la Créance du témoignage, Université d’Ottawa, 2000) ou Alain Brossat (« Rhétorique de la sincérité et ‘‘mentir vrai’’ dans l’œuvre de Jorge Semprún », inédit). Outre le fait que ce type de lecture porterait atteinte à la véracité de l’expérience vécue par Semprún, C. Benestroff met en garde contre la tentation de hiérarchiser les œuvres issues des camps, ou de séparer les survivants : ceux qui font véritablement acte de témoignage, et ceux qui s’arrangeraient avec les faits (p. 188).
40Ces critiques permettent de mettre en évidence deux écoles de pensée dans l’appréhension de la production semprunienne. D’une part, les empathiques, dont font partie C. Benestroff et F. Nicoladzé : celles‑ci plaident pour une lecture nuancée par les émotions et les traumatismes de l’auteur. Elles refusent de voir Semprún comme un individu fait d’un seul bloc, mais davantage comme une succession de métamorphoses. À l’inverse, les sceptiques (Marta Ruiz Galbete, Alain Brossat), sont partisans d’une « réécriture idéologique » (p. 225), et convaincus que la production semprunienne a pour seul objectif de se « refaire une virginité » (p. 246). C. Benestroff conclut l’ouvrage en rappelant l’actualité du Serment de Buchenwald, et nous ne pouvons qu’aller dans son sens, en citant l’une des dernières lignes de cet engagement : « Notre idéal est la construction d’un monde nouveau dans la paix et la liberté47. »

