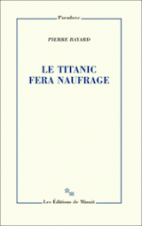
Discordance des temps : la littérature face à la catastrophe
1Quiconque a déjà lu Pierre Bayard sait qu’il ne faut jurer de rien. Ses essais polémistes bernent joyeusement tous les horizons d’attente, renversent les acquis les plus solides par l’étude mi‑amusée mi-‑sérieuse d’un paradoxe, en nous laissant finalement tout étourdis. Son dernier ouvrage en date, Le Titanic fera naufrage, au titre pourtant prometteur des surprises habituelles — le Titanic n’a‑t‑il pas déjà coulé, pourquoi ce futur, à quel retournement doit‑on s’attendre cette fois‑ci ? — laisse à la lecture une impression dérangeante de déjà‑vu. Pour cocasse que soit cette sensation dans un livre qui traite de l’anticipation — le déjà vu, en effet, est l’actualisation dans le présent d’une situation dont nous avons eu l’intuition dans le passé, donc une forme d’anticipation1 — il faut rappeler que Pierre Bayard clôt avec ce dernier volume une trilogie consacrée à l’inversion des temps et aux phénomènes d’anticipation littéraire. Dans Demain est écrit puis dans Le Plagiat par anticipation, l’essayiste cherchait déjà des éclats du futur dans le présent dans la vie des auteurs, capables selon lui d’anticiper leur avenir, et dans une histoire littéraire et artistique entièrement revisitée faisant, entre autres, se côtoyer au Panthéon Fra Angelico et Jackson Pollock, le premier ayant supposément plagié le second. Une fois remis en perspective, il faut bien avouer que le troisième volume, cadet dans la famille de l’anticipation, ne bénéficie donc pas de l’effet de surprise entourant habituellement la parution du « dernier Bayard ». L’essai ne manque pourtant pas d’audace, qui repose sur une galerie d’exemples tous plus réjouissants les uns que les autres : attentats, naufrage, réchauffement climatique, séisme et attentats encore. À l’heure où le dernier roman de Michel Houellebecq, Soumission, est entouré d’une réception frôlant l’hystérie et où le climat ambiant ne peut pas tout à fait se défaire de la peur latente du surgissement, l’essai de Pierre Bayard qui, pourtant, exploite l’actualité vive et pressante de la catastrophe, ne fait pas mouche. L’audace reste toute contextuelle et ne se transmet pas à l’ambition théorique de Bayard, entre autre alourdie d’effets de répétition. Serait‑ce que le filon de l’anticipation est à bout de souffle ?
Bayard a‑t‑il plagié Bayard ?
2Pour mimer d’emblée l’herméneutique que Bayard prescrit au lecteur attentif dans son essai — révèle donc le texte, lecteur, par une intertextualité à rebours, une chronologie littéraire inversée —, on peut dire que Le Titanic fera naufrage est présent en puissance dans Demain est écrit et surtout dans Le Plagiat par anticipation, sous la forme d’éclats ou encore de fragments qui attendaient d’être actualisés. C’est chose faite et Bayard pour la troisième fois cède à l’appel de la très séduisante et très en vogue déconstruction de la temporalité linéaire. D’autres avec lui — pensons aux travaux de Georges Didi‑Huberman ou à ceux de l’historien Patrick Boucheron2 — contribuent à valoriser un nouveau paradigme épistémologique fondé sur l’anachronisme, à proposer des modèles de temporalités a priori aberrants qui s’avèrent en fait des dispositifs esthétiques et théoriques féconds. Partout se conçoit l’éclatement d’une représentation classique du temps et sa réappropriation par une reconstruction incombant au créateur et au lecteur.
3 Qu’en est‑il cette fois‑ci des effets de discordance chronologique chez Bayard ? En toute simplicité l’argument est le suivant : il semble que certains créateurs — romanciers, cinéastes, peintres — aient une capacité à anticiper dans leurs œuvres des événements à venir. Comme avec le précédent tome de la trilogie, il s’agit donc de s’emparer d’un terme dans le champ littéraire, que ce soit une pratique comme le plagiat ou une catégorie générique comme l’anticipation, et de lui « tordre le cou » en renversant les usages habituels qui en sont faits, les significations familières qui lui sont attachées. L’anticipation n’a rien de nouveau dans le paysage littéraire ; il existe en effet un genre de l’anticipation, des romans d’anticipation. Quel retournement Bayard propose‑t‑il de lui faire subir ? Le Titanic fera naufrage opère un mouvement d’élargissement par une redéfinition du terme — un débordement sémantique —et par une réévaluation du potentiel de l’anticipation, d’un point de vue plus pragmatique. Le débordement sémantique conduit Bayard à introduire des nuances et des degrés dans l’anticipation en distinguant par exemple la « prédiction » (p. 40) (cas d’anticipation basés sur un raisonnement scientifique conscient et dont les prédictions sont en cela plausibles) de la « prémonition » (pressentiment beaucoup plus intuitif et diffus). Le débordement se fait également au niveau des catégories génériques puisque l’anticipation, communément affiliée à la science‑fiction, est appliquée par Bayard à la catégorie beaucoup plus vaste de la fiction, et à des genres divers (romans, poésie, arts plastiques…) — nous y reviendrons. L’anticipation telle que Bayard l’entend n’est pas une catégorie ferme mais une qualité littéraire potentielle, dormante, — une option ? — qui peut s’appliquer rétrospectivement, un jour ou l’autre, à toute œuvre quelle qu’elle soit. Car ce qui intéresse avant tout Bayard, c’est précisément cette actualisation dans et par le réel du potentiel dormant de l’anticipation. C’est sur ce point que son essai entend être surprenant : sur le pouvoir prétendument performatif des œuvres d’anticipation. C’est une chose que d’imaginer et d’écrire un futur potentiel, c’en est une autre que de le voir se réaliser, parfois sous vos yeux mêmes (le journaliste anglais Thomas Stead, figure très importante de l’essai, avait à plusieurs reprises imaginé dans des nouvelles et des articles de presse le naufrage d’un paquebot flambant neuf suite à une collision avec un iceberg. Il s’embarqua à bord du Titanic dans le but de vérifier ses prédictions…). La thèse paradoxale de Bayard est donc la suivante : le futur est enclos dans certaines œuvres de fiction avant même son surgissement dans le réel, il est en attente d’une actualisation, qui viendra ou ne viendra pas, mais dont la possibilité est contenue dans l’œuvre. Les créateurs possèdent une extra‑sensibilité qui leur permet de pressentir les secousses du futur dans le présent. La littérature, donc, peut dire l’avenir. On comprend vite pourquoi se dégage une impression de déjà‑vu à la lecture de cet essai. Tout comme le futur serait enclos dans le présent, les trois essais sont enclos les uns dans les autres. Malgré les apparences d’inouï à chaque nouveau dispositif imaginé par Bayard, les questionnements sont répétitifs comme d’ailleurs les éléments de réponse.
4On retrouve d’abord une identité de forme, ce qui en soit n’est pas condamnable, voire se justifie dans l’esprit d’un travail sérié. Mais il s’avère que la structure de l’essai, son organisation méthodique et soignée à laquelle Bayard est très attaché, a quelque chose d’usant. C’est d’abord parce qu’au lieu d’être discrète, elle s’exhibe. Bayard a cette habitude d’adopter une posture narrative très visible, frôlant le didactisme, mais qu’il présente plutôt comme une attitude de prudence. Devant l’ampleur généralement démesurée de sa tâche — et ici le prologue de l’essai ne manque pas de relever les « problèmes […] considérables » (p. 17) à l’horizon —, mieux vaut adopter une méthode rigoureuse et une structure efficace. Chaque fois on retrouve une modeste tripartition suivant un schéma déductif, qui encadre solidement le raisonnement et semble chercher à épuiser son sujet. Ainsi, chaque partie compte scrupuleusement quatre sous‑parties et multiplie les exemples, les occurrences, les études de cas, ce qui provoque chez le lecteur une sensation de lassitude. Dans Le Titanic fera naufrage, passé le premier effet de surprise que procure l’analyse très bien menée de l’œuvre de Jules Verne, anticipant entre autres événements le réchauffement climatique et le premier voyage vers la lune (!), une impression de redondance s’installe. Il semble que Bayard use jusqu’à la corde le même gimmick rhétorique : tel événement connu de tous (le premier voyage sur la lune, le réchauffement climatique, le tremblement de terre en Haïti en 2010, telle ou telle légende urbaine) a été, oh ! surprise !, anticipé dans la littérature. Les thèmes ont beau varier (catastrophes climatiques/humaines ; évolutions politiques/scientifiques), les logiques ont beau varier (distinction entre la prédiction et la prémonition), les genres ont beau varier (romans, poèmes, films et tableaux), reste que la masse des œuvres est trop imposante et que le raisonnement piétine par endroits parce qu’il se répète. Il est dommage que la force d’argumentation se dégageant du choc initial, percutant, perde en consistance sous le poids de la répétition. La multiplication des exemples met en échec l’effet recherché : au lieu de consolider la thèse de Bayard, elle produit une dissolution et une confusion. On retrouvait déjà cette manière de fonctionner dans les deux autres tomes de la trilogie et, on le répète, cette tendance que l’on pourrait voir comme « la méthode Bayard », une approche prudente et méthodique de son objet, ne serait pas gênante si un tel effet d’usure ne lui était attaché.
5En outre, il semble que ce cheminement commun aux trois œuvres emprunte chaque fois les mêmes détours et débouche en un endroit lui aussi similaire, ce qui est déjà plus gênant. On retrouve notamment entre Le Plagiat par anticipation et Le Titanic fera naufrage la même réflexion sur le fragment comme signe poétique d’une discordance des temps — le fragment désolidarisé du tout fait signe vers le plagiat ou bien se constitue comme une trace du futur dans le présent — et comme proposition herméneutique pour appréhender les œuvres, autrement dit une lecture capable de saisir le morcellement, de s’en emparer comme d’une richesse, enfin de se le réapproprier par un affranchissement des grandes logiques de signification dictée a priori par l’histoire littéraire telle que tout le monde l’entend et telle qu’elle a été — arbitrairement — instituée. Cette réflexion, certes très pertinente, mène enfin à une proposition théorique unique, celle de la déconstruction de la chronologie traditionnelle, de la révision de l’histoire littéraire et artistique dans le sens d’une prise en compte des phénomènes de discordances. L’ambition esthétique est donc la même dans les trois tomes, jusqu’à la formulation3, et à la lecture du Titanic fera naufrage, il semble que Bayard « recycle » d’une part la notion d’anticipation déjà abordée dans Demain est écrit mais aussi son entreprise théorique, qui n’a plus rien de surprenant et semblerait plutôt un plagiat.
Les potentiels du temps
6Ce qui retient néanmoins l’attention dans Le Titanic fera naufrage et qui fait sa singularité — en quoi l’ouvrage n’est pas pure et simple reproduction des deux précédents — serait à chercher du côté d’une représentation profondément inquiétante (ou inquiète) du temps. C’est là toute la nouveauté introduite par Bayard, et elle produit une impression inégale. Si la réflexion de fond est globalement la même dans toute la trilogie — discordance des temps, morcellement de la chronologie traditionnelle — il semble qu’elle soit lourde d’enjeux et de conséquences dans le dernier tome. Avec Le Titanic fera naufrage, l’inversion du temps traditionnel n’a pas une simple visée esthétique, les discordances ne sont pas le seul fait d’un acte souverain de lecture mais d’un arbitraire — les prédictions adviendront-elles ou non ? — assez effrayant. On quitte l’entre‑texte qui faisait le dispositif du Plagiat par anticipation pour entrer dans un face à face entre l’œuvre et la réalité, n’ayons pas peur des grands mots. Il y a une forme irrépressible d’angoisse à penser que, dans Le Plagiat par anticipation,les correspondances entre des morceaux de temps épars — un bout de Proust dans Maupassant — étaient faites par le lecteur qui décelait un texte sous un autre sans autre conséquence que de froisser la logique et éventuellement les puristes de l’histoire littéraire, tandis qu’il s’agit cette fois de considérer le pouvoir fascinant du temps à actualiser les données de la fiction en les faisant passer au statut d’événements concrets ; par exemple transformer l’histoire de Michel et Valérie dans Plateforme de Houellebecq (2001) en un attentat à Bali (2002) provoquant la mort de deux cent personnes au bas mot4. Avec le Titanic fera naufrage Bayard réfléchit aux possibles du temps dans une perspective catastrophiste. L’essai élabore ainsi une saisie de la temporalité à travers des paradigmes comme celui de l’urgence, de l’imminence, du sursis et se détache en cela du temps long de l’histoire littéraire et artistique. Bien plus précis et plus minutieux que « le temps » ou « la temporalité », l’essai de Bayard se penche cette fois sur « l’événement », unité de temps ramassée, aussi courte qu’intense. La catastrophe, type particulier d’événements qui intéresse ici, est saturée de signification au point qu’elle ne peut être contenue dans une tranche temporelle délimitée sans en déborder. La puissance de l’événement produit un éclatement temporel, des fragments de cet éclatement se retrouvant disséminés dans d’autres couches de temps : les éclats de temps, donc, qui contiennent en puissance la catastrophe à venir. Cette temporalité événementielle, si elle est l’objet d’une esthétique, est aussi associée au danger ; son écoulement contient des menaces.
[…] et rien de dit par exemple que la France ne connaîtra pas un jour une forme douce de gouvernance islamique comme l’annonce Soumission. (p. 77)
7Certes ce biais infligé à la réflexion sur le temps était déjà présent dans Demain est écrit puisque Bayard s’intéressait à certaines tragédies à venir dans la vie des auteurs (le suicide de Virginia Woolf par exemple), mais il est ici amplifié puisqu’il s’agit de catastrophes à grande échelle et non de tragédies personnelles, et qu’elles mettent en branle une destinée collective et non une vie singulière. L’anticipation n’existe d’ailleurs dans cet essai qu’en tant qu’elle prend les habits de la catastrophe, c’est‑à‑dire une situation majorée dans le sens du désastre. L’anticipation d’un monde en paix n’intéresse visiblement personne. On serait d’ailleurs tenté à certaines reprises au cours de la lecture de l’essai de tout simplifier par cette proposition très simple : l’homme est ad aeternam fasciné par le mal et envisage le pire sous toutes ses facettes. À ce compte‑là, il finit par avoir raison de temps en temps5. C’est d’ailleurs une hypothèse tout à fait sérieuse, l’une de celle que Bayard énumère dans la deuxième partie de son essai (« Hypothèses »), à savoir la loi de Murphy qui postule que « tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera inévitablement mal à un moment ou à un autre et il convient de se tenir toujours prêt aux éventualités les plus sombres » (p. 97). Or Bayard, s’il l’évoque, ne souscrit pas entièrement à la loi de Murphy, ou du moins il pousse la logique plus loin. Plutôt que de « se tenir prêt aux éventualités », passivement, il propose de devancer le problème, activement, en se rendant maître des potentiels du temps.
Péché d’hubris ?
8Dans une interview accordée au quotidien libanais L’Orient le Jour, Pierre Bayard dit à propos de son essai : « La lecture de ce livre peut vous sauver la vie6 ! ». Cette exclamation fait référence aux harangues constantes de l’essayiste qui ponctuent le livre, principalement adressées aux dirigeants politiques. On l’a dit, Pierre Bayard s’affranchit dans Le Titanic fera naufrage d’une perspective purement esthétique pour aborder les phénomènes de discordances des temps ; il propose une pragmatique de l’anticipation, visant à mettre en échec le fatalisme de la loi de Murphy. L’imminence d’une catastrophe, potentiel dont le temps est porteur, doit être déjouée par une prise de conscience de la part des dirigeants, auxquels Bayard dicte l’attitude à adopter : revaloriser les œuvres de fiction, leur attribuer le statut de « découverte scientifique à part entière » (p. 16), associer pleinement les créateurs à la gouvernance afin d’éviter que ne se produisent les catastrophes anticipées. C’est la proposition très sérieuse de Pierre Bayard dans cet essai. Loin de tenir cet axiome pour un idéal, l’essayiste fait de l’inclusion de la littérature à la gouvernance une obsession et pour ainsi dire la priorité, l’urgence même, des décisions politiques à prendre dans les plus brefs délais. Ainsi, chaque chapitre s’ouvre ou se clôt sur un sermon qui devient leitmotiv : « ceux qui nous gouvernent seraient bien inspirés de… ». Pour louable que soit la proposition, Bayard l’envisage de manière démesurée et peu convaincante. Il en fait un peu trop, excès dont on ne peut s’étonner venant de lui, mais en l’occurrence assez ironique dans un essai qui réfléchit longuement à la question de l’hubris.
9À l’ouverture du Titanic fera naufrage, un détail frappe : le roman qui fournit à Bayard le sujet de son essai est moins envisagé comme métaphore du pouvoir anticipateur de la littérature que comme métaphore de l’hubris de l’Homme. Si Morgan Robertson donne au navire de son roman, Futility, le nom de « Titan », c’est sans doute parce qu’il anticipe, quatorze ans avant, l’existence future du Titanic, mais surtout parce qu’il anticipe que le paquebot sera un symbole de « la folie de grandeur des êtres humains » (p. 15). À la manière dont les Titans ont défié les dieux, les constructeurs du paquebot défient les lois humaines et naturelles en l’imaginant insubmersible. Cette démesure originelle fascine Bayard. Tout au long de l’essai, il tente de la tenir à distance. D’abord en présentant son travail avec humilité, en prenant acte de l’ampleur de la tâche et en s’y attelant avec toute la prudence possible, on l’a dit. Le prologue tient à distance l’ombre portée du Titan par une rhétorique de l’humilité, le narrateur repentant par avance y fait voir les faiblesses qui entraveront sa démonstration. D’autre part, Bayard s’approprie les voix de deux créateurs — Morgan Robertson et Thomas Stead — qui apparaissent comme les figures tutélaires de l’essai. Tous deux ont anticipé le naufrage du Titanic par des voies antithétiques : Robertson est le grand représentant de la prédiction puisqu’il était fils de capitaine, lui‑même marin, tout à fait au courant des évolutions de la construction navale et donc à même d’imaginer une catastrophe dans ce registre ; Stead quant à lui était féru de parapsychologie, il s’était fait prédire par des médiums sa mort future sur un paquebot qui rencontrerait un iceberg. Ses anticipations sont à placer du côté de la prémonition. Leur présence à tous les deux hante l’essai, leurs voix sont disséminées comme autant de prosopopées dans des fragments de texte — en italiques pour Robertson, en gras pour Stead — au début et à la fin de chaque chapitre de l’essai. Bayard leur donne la parole avant même de la prendre lui‑même. Aussi antithétiques soient‑ils (Robertson s’opposant par le pragmatisme de ses descriptions techniques aux séances de spiritisme et de voyance de Stead), ils convergent dans la théorie de Bayard en un seul et même symbole : le créateur comme détenteur d’une sensibilité accrue, ni voyance ni fruit du hasard, qui lui octroie un accès privilégié vers l’avenir et dont l’Homme, dans sa folie orgueilleuse, ignore le message. Figures de sages, ils assument chez Bayard la fonction de négation de l’hubris.
Stead, semble‑t‑il, accueillit toutes ces prédictions [l’annonce de sa mort et du naufrage] avec philosophie, probablement persuadé qu’il est inutile, comme les Anciens nous l’enseignent, de tenter de dévier le cours du destin et qu’il est dès lors préférable, si l’on a en soi un peu de sagesse, de s’en accommoder. (p. 23)
10Ainsi placé sous la tutelle de la sagesse, l’essai de Bayard n’échappe pas pour autant à l’hubris. Refusant de s’astreindre à un régime raisonnable de l’exemplarité, l’essai noie son lecteur sous la masse des œuvres étudiées, comme on l’a vu. À vouloir trop en dire, il perd en efficacité et tombe dans la démesure qu’il craignait au début : « […] il n’est pas évident de repérer, dans l’immensité des productions écrites, celles qui possèdent une vertu annonciatrice » (p. 17). L’excès est aussi à chercher du côté de la surinterprétation. Dans certaines démonstrations, Bayard cède au catastrophisme et établit des correspondances qui paraissent abusives. On pense par exemple au roman de l’autrichien Franz Werfel, Les 40 jours du Musa Dagh (1933) qui revient sur le génocide arménien. Bayard voit dans ce roman la préfiguration de l’autre grand génocide du xxe siècle, la Shoah, et il n’est d’ailleurs pas le seul puisque c’est aussi l’argument du préfacier de Werfel, Elie Wiesel. Certes, la description de massacres peut faire songer à d’autres massacres, et peut‑être Frank Werfel a‑t‑il, comme le pense Bayard, « pressent[i] la réitération prochaine » (p. 94) d’un génocide. Néanmoins, la démonstration repose sur une manipulation de la lettre du texte assez déplaisante, et un peu « facile » : « On pourrait sans difficulté remplacer Arménien par Juif dans cet extrait » (p. 95). À ce compte‑là, on peut aussi le remplacer par « Tutsis » pour y voir une préfiguration du génocide rwandais. Il semble que Bayard illustre lui‑même une thèse qu’il entend récuser, celle du « biais de confirmation » (p. 85) que l’on doit à Gérald Bronner et qui explique les phénomènes d’anticipation par la tendance de l’esprit humain à « conférer un sens à toute sorte de combinaisons abstraites » (p. 85) et à établir a posteriori des significations peu tangibles a priori.
11Last but not least, Bayard oublie bien vite la sagesse de Stead et cherche constamment à « dévier le cours du destin » plutôt que s’en remettre à lui. La troisième et dernière partie (« Hypothèses ») donne à voir un modèle de société qu’il est tentant d’associer à une utopie, bâtir démesuré faisant écho à l’hubris des bâtisseurs du paquebot mythique. Si les harangues perpétuelles de Bayard ont le mérite d’attirer l’attention sur l’importance de la littérature comme moyen d’accès privilégié à la connaissance du monde, la troisième partie en revanche dénature cette ambition honnête en cherchant à faire surgir un aspect utilitaire de l’art avec une emphase que l’on est peu enclin à suivre. À la suite d’une analyse d’un roman de H. G. Wells et d’un film d’Akira Kurosawa, l’un anticipant l’arme nucléaire et la première guerre mondiale, l’autre l’explosion d’une centrale nucléaire au Japon, Bayard propose deux modèles de société utopiques, mythologie des temps modernes ayant pour ambition de réduire le risque de catastrophes. Le premier modèle est une République des Lettres dans laquelle le pouvoir serait confié aux créateurs tout autant qu’aux politiques ; des spécialistes passeraient les œuvres littéraires au peigne fin pour y déceler les anticipations susceptibles de se produire et dicteraient les décisions à déduire de ce constat. L’autre est la vision fugitive d’une utopie déjà morte : les scientifiques japonais de la centrale nucléaire de Fukushima auraient dû avoir obligation d’embaucher des créateurs, de leur « ouvr[ir] leurs laboratoires en se soumettant à leur regard, et même à leur contrôle » (p. 139) pour qu’ait été évitée l’une des plus grandes catastrophes industrielles de l’Histoire. Par le détour de l’utopie, on en revient en fait au mythe originel, le péché d’hubris des Titans. L’équilibre entre sérieux et légèreté qui caractérise depuis toujours l’écriture de Bayard est ici dans une impasse. La gravité du sujet — les catastrophes —, que Bayard a martelée tout au long de l’essai, supporte mal les propositions farfelues de cette dernière partie, qui jettent le discrédit sur les conclusions d’un essai ayant repoussé inlassablement le spectre de l’exagération. On reste froid et peu réceptif à la tentative de Bayard de dépasser son sujet par une transposition dans le domaine politique et ce d’autant plus que l’anticipation offre bien des façons, et plus plaisantes, d’élargir la réflexion.
L’anticipation, et après ?
12Malgré les sensations tenaces de déjà‑vu et d’excès, il faut reconnaître à l’essai de Bayard plusieurs mérites, qui lui donnent un peu de latitude, un second souffle, et affranchissent l’anticipation de la sclérose complète.
13D’abord, le raffinement. En dépit d’une certaine lourdeur formelle déjà évoquée, l’essai de Bayard est, comme souvent, truffé de trouvailles rhétoriques, stylistiques, et transpire le plaisir. Plaisir de la lecture ; plaisir double de la lecture. D’un côté, celui de Bayard lui‑même qui semble n’en avoir jamais fini de fréquenter les auteurs qu’il aime, de lire en tous sens leurs œuvres et d’y glaner une inépuisable nourriture pour l’esprit — peut‑être est‑elle là, la finalité de cet essai ? Dans le plaisir d’une relecture infinie des textes aimés. Ainsi on salue son analyse de la Recherche qui déniche chez Proust une inhabituelle réflexion sur l’avenir et sur « la présence active en nous d’événements et de sensations » (p. 129) appartenant au futur, et pas seulement au passé, nous détournant des analyses les plus connues sur le traitement de la temporalité chez Proust. Le plaisir pris à la fréquentation des textes est autant celui de l’habitude que celui de la nouveauté. Chez les plus grands auteurs, Bayard ne pioche pas les œuvres les plus connues. Les choix de « La Colonie pénitentiaire » plutôt que du Procès pour Kafka, de La Destruction libératrice plutôt que La Guerre des Mondes pour H.G Wells, du roman très peu connu de Jules Verne, Sans Dessus Dessous, permettent d’élargir l’horizon et encouragent à une fréquentation autre des auteurs classiques — démarche très en phase d’ailleurs avec la proposition de contourner les découpages de l’histoire littéraire officielle et de l’aborder par un biais transgressif — de même que le choix de best‑sellers internationaux, Dette d’honneur de Tom Clancy par exemple, tacle ceux qui seraient tentés par l’élitisme. Le chapitre consacré aux romans de Tom Clancy s’ouvre d’ailleurs par un exercice de style, véritable démonstration de force de la part de Bayard, qui semble inséré là pour montrer à quel point le choix d’un romancier main stream est un choix réfléchi et non le signe d’une fausse posture moderne de l’éclectisme. Le roman Dette d’honneur, ayant anticipé en quelque sorte les attentats du 11 septembre, inspire à Bayard l’écriture d’une petite saynète, morceau de fiction au cœur de l’essai, imaginant Ben Laden en train de lire le roman et d’expérimenter une épiphanie terrifiante :
Pour la troisième fois de la journée, Ben Laden tendit la main vers le livre et l’ouvrit aux pages qu’il avait cornées […] Il suffisait de suivre page après page toute la démarche imaginée par le romancier, éventuellement en utilisant cette fois plusieurs avions et non plus un seul, pour mettre sur pied une attaque qui sèmerait la terreur, non seulement aux États‑Unis mais dans l’ensemble du monde occidental. Et l’ironie du sort voulait qu’il doive cette idée à un romancier américain n’ayant jamais caché sa sympathie pour le camp républicain. Comment avait‑il pu ne pas y penser lui‑même ? (p. 80)
14Est‑on encore avec ce passage dans la perspective de plaisir ? Malgré le frisson, inévitable, ce morceau de bravoure est un indéniable tribut de Bayard au pouvoir évocateur de la littérature — et c’est en partie son sujet7 — et une manière d’attirer l’attention sur des ouvrages qui ne font pas a priori l’objet d’un intérêt de la part du milieu littéraire. « Telle est la puissance d’un roman comme celui-ci », semble dire Bayard entre les lignes de ce surprenant hapax.
15La jouissance associée à la fréquentation des textes littéraires transparaît donc dans l’écriture et devient plaisir, sur un autre plan, chez le lecteur de Bayard. L’essai regorge de trouvailles comme cette ouverture de chapitre ou encore comme le système d’abréviations mis en place par Bayard, qui transforme son texte en jeu de piste. À la familière « Liste des abréviations » qui figure parfois en tête des œuvres et contiennent les Op. cit, etc., Bayard s’amuse à ajouter un système d’initiales permettant de classer les œuvres étudiées sur l’échelle de l’anticipation. Au lecteur ensuite de retrouver en notes de bas de page les APJ (Anticipation partiellement juste) ou AF (Anticipation fausse) accompagné d’un + (degré élevé) ou d’un - - (degré très faible) accolés au titre de l’œuvre. Le plaisir de la lecture, enfin, s’accompagne d’une excitation frénétique répondant aux encouragements de Bayard à chercher dans les œuvres les AD, « anticipations dormantes » (p. 42), autrement dit les prédictions qui ne se sont pas encore réalisées mais seraient susceptibles de l’être. Le désir d’enquête créé ici n’est sans doute pas un hasard sous la plume d’un essayiste ayant résolu mieux que Poirot les mystères du meurtre de Roger Ackroyd8. Les paris sont ouverts.
16Au‑delà du jeu et au‑delà du principe de plaisir, l’essai de Bayard a aussi le mérite d’encourager une réflexion sur la définition et le statut de la fiction, ainsi que du créateur, et sur la hiérarchisation du savoir. En cela, Le Titanic fera naufrage s’inscrit dans des perspectives théoriques modernes, qui font la vivacité et l’actualité de plusieurs débats critiques. Bayard se rattache d’abord avec son essai à un courant de pensée qui réfléchit au statut épistémologique de la fiction, à son sérieux et à son lien a priori paradoxal avec la vérité. Ce débat, déjà bien engagé depuis quelques années — on peut penser à l’œuvre majeure de Jean-Marie Schaeffer, Pourquoi la fiction ?9 — est toujours très vivace comme en témoignent des publications récentes10. Certes, il y a des formes d’excès dans le « pouvoir » que Bayard attribue à la fiction, on les a signalées. Reste que Le Titanic fera naufrage inscrit en plein dans la modernité la question des rapports entre fiction et vérité en les abordant sous l’angle original de l’imminence de la catastrophe. Sans céder ni à l’hystérie ni à la paranoïa, il faut reconnaître qu’aujourd’hui notre temps se pense dans d’étroits rapports avec la menace, susceptible de surgir de toute part — mais peut‑être est‑ce un effet d’optique, peut‑être cela a‑t‑il toujours été le cas ? La question n’est pas tant de savoir si la fiction peut ou non prévenir de l’arrivée des catastrophes, ni d’ailleurs de savoir si elle peut les éviter — c’est selon nous la partie faible de l’essai — mais plutôt de considérer que la fiction est porteuse d’un savoir et d’une intelligence sur le monde qui justifie qu’elle se mêle, comme d’autres sciences, de cette eschatologie moderne en cherchant à la décrire. L’essai de Bayard montre bien que le discours de la fiction rejoint à certains égards celui de la science et permet ainsi une représentation des menaces du réel tout aussi pertinente. Entre autres exemples on peut penser au parallélisme établi par Bayard dans sa démonstration entre un article extrait d’une revue scientifique américaine (International Geographic Review) sur le réchauffement climatique et un passage du roman de Jules Verne, Sans Dessus Dessous. La question du statut de la fiction par rapport à la vérité est aussi celle de son positionnement par rapport aux sciences, comme le rappelle cet exemple. Les notions de frontière, de catégorie ou de limite sont largement relativisées dans l’essai par une pratique de la transgression. En assimilant très largement la fiction littéraire — comme d’ailleurs d’autres pratiques artistiques — aux sciences, Bayard décloisonne la répartition traditionnelle des connaissances — sciences humaines, sciences dures, arts —, les confondant toutes en un même discours de savoir sur le monde et en leur attribuant une même capacité à théoriser le réel. Kafka, par la fiction littéraire, théorise les totalitarismes du xxesiècle aussi pertinemment que saura le faire la philosophie/politologie plus tard, à travers la voix d’Hannah Arendt11. Pas non plus de cloisonnement des catégories génériques ; le discours sur le réel s’envisage selon les mêmes modalités dans le roman et dans la poésie. À peine Bayard adopte‑t‑il un lexique d’analyse spécifique aux arts visuels quand il se penche sur la peinture et le cinéma, encore que l’image puisse parfaitement être textuelle — la métaphore — et qu’elle ne soit pertinente qu’en cela qu’elle fait signe vers le fragment, une petite unité capable de mimer le morcellement du temps. Cette vision trans (transdisciplinaire, transhistorique, transculturelle, transartistique), Bayard l’a déjà étrennée dans d’autres de ces essais12, mais elle reste d’une grande actualité. Notons néanmoins que la théorie de Bayard, tout en revalorisant la place de la littérature et des arts aux côtés des sciences, retombe dans des logiques de hiérarchies et de rapports de domination puisqu’il attribue à la littérature et aux arts la primauté (« préscience », p. 16) ; ils disent le monde avant la science, et c’est tout l’enjeu, in fine, de son ouvrage. C’est aussi le point qui nous paraît le moins important et le moins convaincant, on l’aura compris. On peut quand même saluer l’originalité, là encore, — et l’ironie ? — du modèle choisi par Bayard pour penser la primauté de la littérature sur les autres modes d’accès à la vérité du monde. Ce modèle est théorisé au dernier chapitre de la première partie, « Des catastrophes naturelles », et assimile l’écriture à un « sismographe » (p. 58), capable d’une excessive sensibilité et percevant à l’avance les secousses à venir dans le monde ; en quelque sorte une boîte de résonnance des échos du monde. Assez ironiquement, Bayard fait appel à un dispositif scientifique pour penser la primauté de la littérature sur les sciences…
17Le modèle du sismographe permet de soulever un dernier aspect important, attenant à la réflexion sur l’anticipation dans cet essai. En effet ce modèle, inspiré de la science, attribue la capacité d’anticipation de la littérature à l’écriture. Clôturant la première partie et faisant la synthèse des différents exemples évoqués, il couronne une tentative soutenue pour éviter de faire reposer le cœur de la théorie sur la figure du créateur. Bayard le signale dès le départ :
La question n’est pas de savoir si les écrivains, tel Tirésias, voient l’avenir ou en annoncent les périls, mais si l’écriture peut se révéler dans certains cas […] un dispositif apte à saisir des signes que la pensée rationnelle consciente est incapable de percevoir. (p. 33)
18Le risque est celui d’une assimilation de l’écrivain à la figure du « mage », ou encore du « prophète », renouant avec des modèles de croyance archaïques et faisant alors basculer l’entreprise théorique de Bayard du côté obscur, dans le domaine du surnaturel. Cet écueil guette sans cesse l’essai, on s’en doute, avec un sujet comme l’anticipation. Le choix de se focaliser sur le versant de la création et non du créateur semble judicieux. On a vu néanmoins que Bayard ne s’appliquait pas toujours à lui‑même ses mises en garde. Comme pour l’hubris, il semble que la figure du créateur fascine Bayard, et qu’elle attire insensiblement à elle le raisonnement. Ainsi, les données biographiques propres à tel auteur voire certains portraits psychologiques (« Il est peu probable […] que Verne ait sérieusement pensé que […] Cela n’enlève rien au fait qu’il ait pu pressentir… », p. 40) sont au moins autant, voire davantage, analysés que les procédés poétiques propres à telle ou telle œuvre. La sensibilité du sismographe, permettant de saisir les secousses du monde, est avant tout la métaphore d’une sensibilité de l’homme. Cherchant à éviter l’écueil du mysticisme, Bayard ne peut entièrement se retenir de renouer avec une conception somme toute ancienne de l’écrivain comme démiurge, créateur investi de transcendance et de la main duquel émerge le monde. À ce titre, il est tout à fait significatif que le modèle du sismographe soit fourni à Bayard par l’exemple d’un poète — figure par excellence de l’élu, créateur dans le secret des Dieux — en l’occurrence Frankétienne, ayant miraculeusement échappé au séisme de janvier 2010 en Haïti. Tout autant que l’analyse de traits stylistiques dans l’œuvre Melovivi ou le piège qui anticiperait le séisme — la prose fragmentaire évoque les secousses du séisme et les destructions à venir — Bayard en passe par une analyse de l’homme‑poète. Contrairement aux autres auteurs, Frankétienne est lui‑même victime de la catastrophe qu’il a prédite13, ce qui fait de lui un porteur de voix, le symbole d’une destinée collective. Par ailleurs, Frankétienne salue la pratique du vaudou, partie intégrante de la culture haïtienne et, même s’il ne s’y associe pas, il explique son inspiration par « une petite voix à la fois énigmatique et familière qui m’a demandé d’écrire une nouvelle pièce de théâtre » (p. 55). Cette description ressemble étrangement à la définition d’un prophète et Bayard, étonnement, la cautionne, reconnaissant ici l’existence d’un « processus irrationnel » (p. 55) et d’un « accès mystérieux » vers l’avenir dont aurait bénéficié l’écrivain et qu’il transpose ensuite en un modèle scientifique, celui du sismographe. C’est donc bien ici la transcendance dont est investi un homme qui informe ensuite l’écriture dans le sens de telle ou telle poétique et dans le sens d’une sensibilité au monde. On ne peut s’empêcher de convoquer l’adage rimbaldien « le poète doit se faire voyant » et constater que, malgré l’apparente modernité de la conception de Bayard — le créateur comme nouveau dirigeant politique —, elle repose sur des représentations anciennes. Peut-être Rimbaud a‑t‑il anticipé Bayard ? À moins qu’il ne l’ait plagié…

