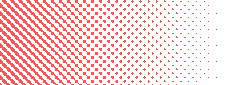Architecture du miracle : les chambres closes de John Dickson Carr
1« Nous sommes dans un roman policier1 ». C’est le docteur Fell qui l’affirme – Gideon Fell, le détective amateur, gargantuesque et brillant, créé par John Dickson Carr en 1933. « Inutile d’inventer des prétextes compliqués pour introduire un débat sur les romans policiers », ajoute-t-il, « glorifions-nous franchement de nous adonner à la plus noble des quêtes offertes à des personnages de roman2 ». Le voile de la vraisemblance est ainsi déchiré : le temps d’un chapitre que le lecteur peut « sauter3 », l’intrigue parait se suspendre, les personnages s’assument en tant que tels, le roman policier tient un discours sur lui-même. C’est le fameux chapitre 17 du roman Trois cercueils se refermeront publié en 1935, chapitre qui s’intitule : « L’exposé sur les chambres closes » (« The Locked-Room Lecture »).
Gideon Fell y présente dans le détail deux catégories de meurtres en chambre close : la chambre close sans criminel à l’intérieur d’une part, la chambre close fermée de l’extérieur d’autre part. Dans le premier cas, le crime a été « commis dans une pièce qui est réellement hermétiquement close, et dont aucun criminel ne s’est échappé parce qu’il n’y avait pas véritablement de criminel sur les lieux4 ». Selon le conférencier, cette catégorie connait sept variantes5 :
- le meurtre est en réalité un accident ;
- le meurtrier a poussé la victime à se donner elle-même la mort ;
- le meurtre a été provoqué par un dispositif mécanique préalablement installé dans la chambre close ;
- le meurtre est en réalité un suicide ;
- le meurtrier fait croire que la victime est encore vivante au moment de l’ouverture de la chambre close ;
- le meurtre a été commis à distance, depuis l’extérieur de la chambre close ;
- le meurtrier fait croire que la victime est déjà morte au moment de l’ouverture de la chambre close.
2La seconde catégorie de meurtres en chambre close rassemble les hypothèses où le criminel essaie de « faire croire qu’une porte est verrouillée de l’intérieur6 ». Il peut, de la sorte, faire tourner la clé depuis l’extérieur de la chambre, démonter la porte en enlevant les charnières, recourir à de la corde, à un loquet ou à une barre ; il peut aussi, tout simplement, verrouiller la porte de l’extérieur, puis mettre la clé à l’intérieur lorsqu’il pénètre dans la chambre close7.
3L’exposé du docteur Fell est impressionnant. Il témoigne d’un écrivain en pleine maîtrise de son art, alors même qu’en 1935, la carrière littéraire de John Dickson Carr n’en est qu’à ses débuts. Mais « l’énigme du crime en chambre close constitue l’un des thèmes obsessionnels8 » de son œuvre : au total, le romancier américain en proposera des variations dans vingt-cinq romans et onze nouvelles.
Ce faisant, Carr s’est imposé comme « le maître incontesté9 » de ce sous-genre du roman policier à énigme et le chapitre de l’exposé sur les chambres closes est devenu une référence intertextuelle en la matière. Il est notamment cité par Clayton Rawson dans son roman Miracles à vendre paru en 193810, par Anthony Boucher en 1940 dans Nine Times Nine 11, dans le roman Appelez le diable 12 de Derek Smith et dans la nouvelle « Le Nom sur la fenêtre »13 d’Edmund Crispin, publiés en 1953.
4La remarquable conférence de Gideon Fell condamne-t-elle à la redondance et à la vanité toute analyse du motif littéraire de la chambre close ? Sans doute pas – et pour deux raisons, au moins.
Tout d’abord, la taxinomie proposée dans Trois cercueils se refermeront n’est pas à l’abri de la critique. Il suffit de relever que la solution à l’énigme en chambre close de ce roman n’y figure pas pour se mettre à douter aussitôt de sa pertinence. En 1965 d’ailleurs, John Dickson Carr suggère une autre taxinomie. Dans Le Spectre au masque de soie, l’un des personnages explique en effet, de manière synthétique, que les mystères en chambre close peuvent se ramener à trois situations : « il y a une erreur dans le temps, une erreur dans l’espace ou la victime était seule14 ». Moins célèbre, cette seconde classification ouvre des perspectives théoriques plus intéressantes que la première, mais il reste encore à l’affiner et à l’approfondir.
Ensuite, parce que dans son exposé, le détective ne s’appesantit que sur les modalités de construction de la chambre close. C’est la question du « comment ? » qui est exclusivement traitée. Rien n’est dit sur le « pourquoi ? », c’est-à-dire sur l’effet recherché par le concepteur de pareille énigme. Or, le fait que certains événements de nature infractionnelle (meurtres le plus souvent, disparitions et vols parfois) aient lieu au sein d’un espace fermé est de nature à produire chez les personnages, mais aussi chez les lecteurs, des sentiments qui méritent examen.
Au-delà du jeu littéraire, l’énigme en chambre close revêt une dimension anthropologique qui transparaît dans les textes de Carr. Les trente-six récits qu’il a consacrés à ce thème constituent dès lors un excellent terrain d’observation topographique.
Il en ressort que les chambres closes de John Dickson Carr sont des espaces extraordinaires, à tous égards. En premier lieu, sous l’angle des techniques narratives de construction, ce sont des espaces scéniques où l’impossible semble devenir réalité. En second lieu, sous l’angle de leur « force perlocutoire 15 », elles peuvent être perçues comme des espaces sacrés où gît la violence.
L’espace scénique de l’impossible
5Une énigme en chambre close est le fruit d’une mise en scène – orchestrée, dans l’intrigue, par le criminel et au-delà, par l’auteur. Mise en scène singulière qui vise à la création d’une « situation impossible16 », pour reprendre l’expression de Sir Henry Merrivale, l’autre détective emblématique de John Dickson Carr. Quels sont les éléments de cette mise en scène ? Comment fonctionne-t-elle ?
Dans son exposé de 1935, Gideon Fell distingue deux catégories de meurtres en chambre close. Mais cette première classification n’est guère satisfaisante. En effet, en laissant de côté les hypothèses où la mort de la victime ne résulte pas d’un meurtre (accident, suicide), la plupart des situations évoquées sous les deux rubriques « chambre close sans criminel à l’intérieur » et « chambre close fermée de l’extérieur » peuvent être réunies sous la même bannière : il s’agit de manipulations sur le moment de l’acte homicide ou sur le moment de la fermeture de la chambre. À chaque fois, l’illusion est temporelle. Seul diffère le cas du meurtre commis à distance, depuis l’extérieur de la chambre close, car l’illusion est alors spatiale.
La deuxième classification proposée en 1965 va dans ce sens : soit le criminel provoque une erreur dans le temps, soit il suscite une erreur dans l’espace, soit la victime était seule. À la réflexion, cette troisième catégorie peut être subsumée sous les deux premières : le fait que la victime soit seule dans la chambre close peut être la conséquence d’un trucage sur le moment de sa mort ou découler de l’accomplissement à distance du geste homicide. En bref, l’illusion est soit temporelle, soit spatiale.
6L’analyse systématique des trente-six énigmes en chambre close élaborées par John Dickson Carr confirme ces premières conclusions17. Effectivement, deux types de situations impossibles alternent dans l’œuvre du maître : ou bien la « chambre close » est en réalité ouverte et l’illusion est spatiale ; ou bien la « chambre close » est vraiment fermée et l’illusion est temporelle. Gideon Fell n’a donc pas tort de comparer le concepteur d’une chambre close à un « illusionniste18 ».
Or, l’illusionniste est un homme de spectacle, de théâtre. Il en connait les conventions. Que cherche à faire croire le créateur d’une énigme en chambre close ? Qu’un événement particulier a eu lieu à un endroit précis, à un moment précis. Unité d’action, unité de lieu, unité de temps – comme dans le théâtre classique. Mais tandis que la règle des trois unités a initialement été conçue pour donner l’illusion du vraisemblable19, chez Carr, c’est l’inverse : l’apparent respect des trois unités rend le crime invraisemblable. C’est en gardant à l’esprit cette idée qu’il est permis d’explorer l’architecture de ses chambres closes.
L’illusion spatiale de la « chambre close » ouverte
7Soit la situation suivante : « quelqu’un a été assassiné dans un lieu apparemment hermétiquement clos et on ne trouve dans celui-ci aucune trace de l’assassin, qui n’a pas pu y entrer ou en sortir, suivant les cas20 ». Peuvent être assimilées à cette situation les hypothèses, développées par John Dickson Carr, de disparitions mystérieuses ou de déplacements étranges d’objets dans des espaces fermés. Tous ces événements sont matériellement impossibles. Pourtant, ils seront tous élucidés de façon prosaïque. L’énigme en chambre close est, en effet, un sous-genre du roman policier, et non du roman de science-fiction ou du roman fantastique. En d’autres termes, une telle énigme s’inscrit dans un courant littéraire réaliste : la solution à l’énigme ne peut pas résider dans le fait que le criminel dispose du pouvoir surnaturel de traverser les cloisons21. L’explication doit donc rester plausible.
Or, quelle est l’explication la plus plausible à des phénomènes mystérieux survenus dans un espace clos ? C’est que, justement, cet espace n’est pas clos. Le rasoir d’Ockham est souvent efficace dans la littérature policière.
8Ainsi, au cours de l’intrigue, le criminel fait croire aux autres protagonistes que la chambre de l’énigme est hermétiquement close. Dans le même mouvement, l’auteur conduit ses lecteurs à penser que ladite chambre est hermétiquement close. Mais ce n’est qu’une illusion – une déformation de la perception spatiale : il existe un trou, une faille, un défaut dans la clôture, qui ne sera exhibé que durant la phase de résolution de l’enquête. La « chambre close » était, contre toute attente, ouverte.
Laisser une ouverture dans la cloison du lieu du mystère revient à y installer un passage secret. À cet égard, il est intéressant de relever que dans sa fameuse conférence, le docteur Fell désapprouve le recours à ce procédé « tellement honni qu’un auteur qui se respecte n’a même pas besoin de spécifier l’inexistence d’un tel artifice22 ». Cet artifice honni est cependant utilisé par John Dickson Carr à de nombreuses reprises. Le passage secret peut prendre la forme :
- d’une porte dérobée à la vue d’éventuels témoins (Le Marié perd la tête 23) ;
- d’une fenêtre que tous pensaient refermée (« Le Mystère du compartiment quatre »24, La Maison de la peste 25, La police est invitée 26, Le Fantôme du cavalier 27, Le Spectre au masque de soie 28) ;
- du trou de la poignée de la porte – ce « judas » auquel nul ne songe (La Flèche peinte 29) ;
- de fissures dans le sol (Le Sphinx endormi 30) ;
- d’un trou déjà présent dans une vitre avant que celle-ci ne soit brisée (« L’aventure de la chambre hermétiquement close »31, Les Nouveaux Mystères d’Udolpho 32).
9Il faut se rendre à l’évidence : pour parfaire l’illusion spatiale, le narrateur dissimule tout ou partie de la vérité. Il ment aux lecteurs. Ou plutôt, il s’attache au point de vue de protagonistes qui ignorent les tenants et les aboutissants de la situation.
Par exemple, dans La Maison de la peste, un personnage demande à un autre s’il existe une « issue … secrète » dans la chambre close. « Aucune », répond son interlocuteur, « du moins, je ne le crois pas33 ». Le lecteur découvre, plus tard, que cette issue secrète existait bel et bien.
Dans La Flèche peinte, John Dickson Carr exprime, en usant du discours indirect libre, les pensées du principal suspect : « C’est très bien de parler de systèmes ingénieux grâce auxquels une porte peut être verrouillée de l’intérieur par quelqu’un qui est en dehors de la pièce… mais il avait vu la porte et savait que c’était impossible34 ». Au terme de l’enquête pourtant, le détective démontre qu’il était tout à fait possible de verrouiller la porte depuis l’extérieur. Dans Le Fantôme du cavalier, il est soutenu que des fenêtres sont « impossibles » à « forcer35 ». Erreur, encore une fois : il est techniquement envisageable d’en déplacer les vitres.
Ces divers accommodements avec la vérité ne sont pas étonnants. « Tout roman policier d’énigme », professe Pierre Bayard, « implique la mauvaise foi du narrateur36 ». Le lecteur est dès lors invité à se laisser bercer d’illusions, pour le « plaisir de l’enquête, du suspense et de la surprise37 ». Ces illusions ne sont pas que spatiales, elles sont également temporelles.
L’illusion temporelle de la « chambre close » fermée
10D’aucuns pourraient considérer que les « chambres closes » ouvertes ne sont pas d’authentiques chambres closes. La résolution d’énigmes en de pareils espaces n’est-elle pas trop simple ? De telles situations sont-elles réellement impossibles ? Aux amateurs de « chambres closes » scellées, hermétiques, étanches, John Dickson Carr offre des illusions autrement sophistiquées. La tromperie ne porte plus alors sur l’espace, mais sur le temps.
Deux cas de figure sont repérables dans son œuvre : soit l’acte homicide n’a pas été accompli au moment où le lecteur et les personnages le pensent, soit la fermeture de la chambre close est intervenue à un autre moment que celui estimé. Plus encore qu’en matière d’illusions spatiales, l’écrivain donne à voir sa virtuosité en déclinant, en de multiples variations, les illusions temporelles.
11Pour commencer, l’acte homicide peut se produire avant la fermeture de la chambre close. Dans ce cas, les témoins de la situation impossible ont été fourvoyés quant à l’heure réelle de la mort de la victime. Telle est la solution de l’énigme dans la nouvelle « Grand Guignol » (1929)38, transformée l’année suivante en roman : Le Marié perd la tête 39. Elle sera reprise peu après dans Les Meurtres de Bowstring (1934)40, puis en fin de carrière dans Patrick Butler à la barre (1956)41.
La mort de la victime peut, par ailleurs, se produire à retardement, à l’intérieur de la chambre close, en raison de l’usage de certains procédés létaux :
- poison préalablement appliqué (La Maison du bourreau 42) ;
- gaz discrètement ouvert à l’avance (« L’Homme qui expliquait les miracles »43) ;
- piège mécanique préinstallé (« L’À-côté de la question »44, Mort dans l’ascenseur 45) ;
- piège électrique préinstallé (Le Manoir de la mort 46) ;
- balle reçue antérieurement à l’entrée dans la chambre (Trois cercueils se refermeront 47, La Police est invitée 48).
12Autre variante : le meurtre survient après l’ouverture de la chambre close – laquelle était donc dépourvue de mystère jusqu’à cet instant. Deux nouvelles témoignent du procédé : « Le Quatrième Suspect » (1927)49 et « Le Bureau fermé » (1940)50. Variante de la variante : c’est parfois l’évacuation du cadavre d’une personne étrangement disparue qui se déroule postérieurement au descellement du lieu du meurtre (La Chambre ardente 51, « La Maison de Goblin Wood »52).
13Ensuite, la fermeture de la chambre close peut intervenir après la mort de la victime, grâce à un mécanisme, un procédé technique ingénieux, permettant au criminel de fermer la porte depuis l’extérieur.
La liste des procédés de fermeture frappe par sa diversité :
- fausse clé (Le Mort frappe à la porte 53) ;
- aspirateur (Il n’aurait pas tué Patience 54) ;
- lampe à souder (Le Fantôme du cavalier 55) ;
- canne à pêche (« Le Pentacle de diamants »56, Suicide à l’écossaise 57) ;
- punaise et ficelle (À la vie, à la mort 58).
14Toutes ces techniques supposent une grande dextérité de la part des meurtriers ou des voleurs concernés. Elles supposent également une forte suspension de l’incrédulité de la part du lecteur, qui doit accepter de jouer le jeu du roman policier à énigme.
15Finalement, par un magistral travail de brouillage des paramètres spatio-temporels de ses chambres closes, John Dickson Carr façonne des espaces littéraires sortant de l’ordinaire, car donnant l’illusion que l’invraisemblable est possible.
Mais ce n’est pas tout : les chambres closes de Carr sortent aussi de l’ordinaire parce qu’elles sont les avatars d’un espace sacré dominé par la violence.
L’espace sacré de la violence
16Quelle raison peut pousser un criminel à commettre une infraction dans des conditions aussi complexes que celles d’une chambre close ?
Sir Henry Merrivale l’explique avec clarté dans le roman La Police est invitée paru en 1937 :
« supposons […] que notre criminel puisse assassiner sa victime de telle façon que la police soit incapable de reconstituer avec certitude la scène du crime… une pièce sans issue, un cadavre abandonné sur la neige vierge de toute empreinte suspecte, que sais-je encore ? La police peut être certaine de sa culpabilité ; le meurtrier peut avoir les mains ensanglantées et le prix du sang dans sa poche lors de son arrestation ; le juge et les jurés peuvent être convaincus à leur tour de sa culpabilité, si les enquêteurs osent le faire comparaître devant eux… peu importe. L’acquittement est obligatoire si le ministère public est incapable de prouver les circonstances du crime59 ».
17En d’autres termes, sur le plan diégétique, la chambre close est construite par l’auteur de l’infraction afin de tromper les autres personnages, en particulier détectives amateurs et policiers professionnels. L’incompréhension du modus operandi complique l’identification du criminel et, par conséquent, lui confère une impunité.
18Cela étant, la particularité des énigmes en chambre close est de produire des effets au-delà des personnages, au-delà de l’intrigue. Sur le plan extradiégétique en effet, l’auteur du texte cherche à fasciner le lecteur en lui offrant un casse-tête intellectuel apparemment insoluble. C’est d’autant plus vrai lorsque la « formation » de la chambre close ne résulte pas de la volonté du criminel, mais d’un concours imprévu de circonstances60.
D’où vient ce pouvoir de fascination ? Pourquoi ce type d’énigmes – davantage peut-être que les autres – est-il susceptible de susciter « terreur » et « compassion61 » chez ses destinataires, à l’instar d’une tragédie grecque ? L’étude de la force perlocutoire des situations impossibles conçues par John Dickson Carr autorise à avancer une hypothèse : les chambres closes représentent des espaces sacrés. Dès lors, les sentiments qu’elles provoquent sont liés aux dimensions religieuses de tels espaces.
Les chambres closes sont des temples de papier – des temples très singuliers, fondés sur des actes de violence. Dans cette mesure, elles constituent le reflet inversé d’autres espaces clos, sacrés, symétriques : les salles de procès.
Les dimensions religieuses de la chambre close
19Selon les historiens des religions, plusieurs critères permettent d’attribuer la qualité de « sacré » à un espace.
En premier lieu, un espace sacré est un espace séparé du reste du monde. Selon Mircea Eliade, « pour l’homme religieux, l’espace n’est pas homogène, il présente des ruptures, des cassures : il y a des portions d’espace qualitativement différente des autres62 ». De la sorte, à l’espace sacré, « fort », « significatif », s’opposent « d’autres espaces, non-consacrés et partant sans structure ni consistance, pour tout dire : amorphes63 ». Or, par définition, une chambre close est un territoire structuré et consistant, hermétiquement isolé, distinct de l’univers qui l’entoure. C’est un « monde à part », comme tout monde sacré64.
Aux yeux de Roger Caillois d’ailleurs, la chambre close est une allégorie miniature du roman à énigme : « si la scène entière du roman policier forme déjà un monde fermé, la chambre fatidique délimite un compartiment étanche à la seconde puissance, une citadelle doublement inaccessible, la dernière enceinte au cœur du Saint des Saints65 ». Il est important de relever que John Dickson Carr emploie un vocabulaire religieux pour évoquer les énigmes en chambre close, désignées par le terme de « miracle » dans ses récits66. Quant à la chambre close elle-même, elle est expressément définie comme un « sanctuaire inviolable » (« locked sanctuary »)67 dans La Police est invitée.
20Au passage, le caractère sacré de la scène de crime justifie un rapprochement, établi par Carr, entre deux catégories de situations impossibles : le meurtre dans « la pièce sans issue » d’une part, « le cadavre abandonné sur la neige vierge de toute empreinte suspecte68 » d’autre part. Ce second type d’énigmes se manifeste dans un espace décrit comme inviolé, une zone vierge, sans aucune trace, voire sans aucun accès. Selon la fantaisie de l’écrivain, il peut s’agir :
- d’une surface couverte de neige (« Justice aveugle »69, La Mort dans le miroir 70) ;
- d’une « surface de boue absolument lisse 71» (Meurtre après la pluie) ;
- d’une plate-forme au sommet d’une tour (Celui qui murmure 72) ;
- d’un grand toit en terrasse (Le Squelette dans l’horloge 73) ;
- d’une zone de sable mouillé (« La Mort par des mains invisibles »74, La Sorcière du Jusant 75) ;
- d’un « tapis de coquilles d’huîtres 76» (Lune sombre).
21Tous ces espaces sont sacrés à leur façon. En effet, ce sont des espaces purs, qui s’opposent à l’espace profane, impur77. Chez John Dickson Carr, les cloisons des chambres closes sont donc parfois virtuelles.
22En second lieu, un espace sacré est un espace susceptible de provoquer des émotions caractéristiques. Selon Rudolf Otto, l’individu confronté au sacré fait face au « mysterium tremendum », au « mystère qui fait frissonner78 ». Ce mystère renvoie à « ce qui est caché, c’est-à-dire ce qui n’est pas manifeste, ce qui n’est ni conçu ni compris, l’extraordinaire et l’étrange79 ». Et cette étrangeté peut provoquer « chair de poule80 », « saisissement81 », « fascination82 ».
N’en est-il pas de même de l’énigme en chambre close ? Que ressentent les personnages lorsqu’ils pénètrent dans cet espace singulier ? Certains sont épouvantés et tremblent83 ou frissonnent84 ou tressaillent85. D’autres se sentent mal à l’aise86 ou sont choqués87, ils ont les mains moites88, sont pris de nausée89. Dans la bien nommée « aventure de la chambre hermétiquement close », la protagoniste avoue sans détour : « J’ai été saisie d’une terreur superstitieuse90 ».
Sans conteste, John Dickson Carr parsème ses descriptions de notations qui laissent entendre que les témoins de l’énigme en chambre close sont confrontés au « mysterium tremendum ». Il faudrait interroger les lecteurs pour déterminer si, eux aussi, à leur échelle, ils ressentent une fascination – craintive ou amusée – en pénétrant par l’esprit dans le temple de papier de la chambre close. Et sur cette lancée, il faudrait leur demander si leurs sentiments sont les mêmes lorsqu’ils entrent dans un palais de justice. De fait, Carr enseigne que scènes de crime et scènes d’audience sont symétriques.
Les temples symétriques
23L’ultime leçon de l’œuvre de John Dickson Carr est sans doute la plus édifiante : la scène de crime en chambre close est le reflet inversé de la salle d’audience du procès. La « locked room » et la « courtroom » sont des temples symétriques.
Effectivement, la salle d’audience présente, à son tour, une dimension sacrée. Il ne s’agit pas de n’importe quel lieu : elle appartient à l’espace judiciaire, lequel constitue une « sorte de monde temporaire au cœur du monde habituel, spécialement construit en vue de la fonction qui s’y accomplit91 ». C’est un « endroit consacré, comme retranché du monde usuel et délimité92 » – un espace sacré, au sens de Mircea Eliade93. À l’intérieur du tribunal, hors de la cité profane, les droits sont rétablis, les responsabilités sont reconnues, les torts sont redressés, selon un rituel qui distribue les rôles et règlemente les faits et gestes des acteurs. Ce rituel judiciaire rapproche le procès du domaine religieux, ce qui conforte l’idée selon laquelle « le procès et le sacré sont intimement liés94 ».
Cependant, alors que la scène de crime est construite autour d’un mystère, la salle d’audience est bâtie sur la recherche de la vérité. À la chambre close, temple de la violence, espace de l’ignorance et de la tension95, répond la chambre judiciaire, temple de la connaissance, espace de la décharge cathartique. Le procès s’est toujours vu reconnaître le pouvoir de purger les passions afin de parvenir à l’apaisement de tous ses acteurs96. Les « miracles d’audience » existent – ces « instants de grâce » durant lesquels la parole se libère, évacuant « le caractère pathogène des souffrances cachées97 ». « Miracle » : le mot est identique à celui utilisé par Carr pour désigner les énigmes qu’il fabrique.
24Toutefois, chez lui, comme chez les autres auteurs de romans policiers à énigme98, la vérité n’est pas révélée à l’occasion d’une audience en bonne et due forme. C’est le détective amateur qui dissipe le mystère. C’est lui qui démonte, pan par pan, les cloisons de la chambre. Rassemblant un petit groupe de personnes autour de lui, il restaure le passé en le racontant, il apporte la connaissance par son discours, il purifie son auditoire99. Comme dans un procès, tout compte fait100.
Dans certains récits, la scène finale de révélation se déroule à l’intérieur même de la chambre close101, de sorte que le temple de la violence est recouvert et remplacé par le temple de la connaissance. La scène de crime se transforme en scène d’audience.
Leur symétrie est confondante. Elle est effrayante, quelquefois. Nous sommes dans un roman policier, dans Trois cercueils se refermeront plus précisément. Le docteur Fell vient d’exhiber tous les ressorts de l’affaire. La complice du meurtrier se tient sur le seuil de la chambre close. Elle ne le franchira pas : brusquement, elle se donne la mort, après avoir entendu l’exposé du détective. Le roman s’achève sur cette sentence de Gideon Fell : « Je viens de commettre un nouveau crime […] J’ai encore une fois découvert la vérité102 ».