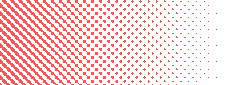La musique dans les confessions de Georges Martin
1La confession n’a rien d’un genre figé au xviie siècle. Elle prend volontiers différentes formes d’expression comme le récit de vie, conçu sur le modèle augustinien, mais aussi la lettre, les mémoires ou la poésie. Sa richesse tient également à la diversité des tons employés et à sa rhétorique foisonnante, calquée sur les modalités de la prière : la déploration et la pénitence mais aussi l’action de grâce. Cette variété est à l’image du genre : hybride et perméable à divers types d’écritures nourries par des expériences de vie singulières.
2Le Confiteor de l’infidele voyageur (1680) illustre parfaitement la singularité du genre1. Cette confession est composée par un prêtre de Rouen, Georges Martin. Sa vie demeure en grande partie méconnue même si les travaux de Stéphane Gomis ont permis de mieux connaître ses origines et son parcours (Gomis, 2017, p. 69-81). Dans l’adresse au lecteur, Martin présente le Confiteor comme la première partie d’un cycle ayant pour suites Le Pœnitet de l’enfant prodigue voyageur par l’Italie et Le Tædet de l’hermite mondain voyageur par la terre sainte, et autres lieux 2. Le projet demeura inachevé, faute de moyens ou de temps pour l’écrivain dont on perd toute trace après la publication du premier opus 3.
3Ce cycle inachevé s’ordonne autour de formules liturgiques relevant de pratiques pénitentielles. Son unité tient également au thème du voyage qui renvoie tout à la fois à un itinéraire de vie et à un cheminement spirituel, dans la lignée du Récit du pèlerin d’Ignace de Loyola. En l’occurrence, le Confiteor se focalise sur la jeunesse tumultueuse de Martin et le récit de ses pérégrinations à travers la France, émaillées d’abus et de scandales. La métaphore de l’homo viator forme de ce fait la trame narrative et spirituelle de cette confession qui fait du voyage une allégorie de la vie du narrateur.
4Un autre point remarquable tient à l’importance du motif musical dans le Confiteor. La confession se noue en effet autour de la carrière artistique de Martin, musicien itinérant dont les activités et les rencontres forment la trame du récit. La musique est également pour lui un moyen d’édifier le lecteur et de susciter la dévotion en louant la beauté de l’œuvre divine. C’est cette poétique musicale de la confession que nous nous proposons d’interroger, tout en réfléchissant à la fécondité littéraire du genre sous la plume de Martin.
Les dissonances d’une vie
5La musique est un leitmotiv qui éclaire la structure narrative du Confiteor. A priori, le récit suit un déroulement classique, analogue aux Confessions de saint Augustin, prises explicitement pour modèle littéraire et spirituel4. Martin relate en quelques pages sa jeunesse agitée à Rouen, théâtre de vols et de violences commis contre sa famille et ses camarades d’études5. Comme chez Augustin, cette période est présentée comme un moment de crise et l’origine d’une vie placée sous le signe de la débauche. Dans le Confiteor, l’épisode est également conçu comme un point de rupture marqué par le départ de Rouen et le début d’une vie d’errance morale et géographique, selon une logique qui évoque à la fois la parabole de l’enfant prodigue, le récit picaresque et ses avatars français6. À la différence du texte augustinien, cependant, l’itinéraire n’aboutit pas à une conversion dont l’événement est reporté dans la suite de l’œuvre, restée inachevée.
6L’autre originalité tient à la logique de la narration centrée sur les pérégrinations du personnage qui relate sa vie de musicien vicariant. Cette représentation fait écho à une réalité socioculturelle populaire au xviie siècle : celle d’artistes itinérants mettant leurs talents au service de paroisses ou de maîtrises, et dont l’œuvre épistolaire du compositeur Annibal Gantez, l’Entretien des musiciens (1643) est un témoignage illustre7. Sur le plan littéraire, ce type d’écriture compte sur la vogue du récit de voyage qui connaît une expansion à l’âge classique. Dans le cas de Martin, son texte renoue également avec la tradition des relations de voyages professionnels, genre bien identifié depuis la Renaissance, à l’image des Voyages d’Ambroise Paré8. Martin relate en détail ses activités de prêtre-musicien et ses déplacements en quête de nouveaux postes dans des centres religieux. Pour résumer, ce parcours mouvementé le conduit à quitter la Normandie pour la Bretagne, dont la ville de Lannion où il est recruté comme chantre dans une église (Martin, 1680, p. 102) ; par la suite, Martin reprend sa route vers Bordeaux, et Saint-Jean-de-Luz, puis il passe en Espagne, pour faire le pèlerinage de Compostelle ; sur place, il est engagé comme organiste au village de Salvatierra (Martin, 1680, p. 164) pour la Sainte-Cécile, mais il se fait voler et revient précipitamment en France ; de là, il va dans le Languedoc, à Toulouse, puis en Provence : à Marseille, à Draguignan, où il devient maître d’écriture, un emploi parfois pratiqué par les musiciens vicariants (Martin, 1680, p. 245-246) ; ensuite, il est recruté comme organiste à la collégiale Saint-Pierre de Cuers (Martin, 1680, p. 246-247)9, puis gagne Toulon, terminus de ce premier tome ; dans une partie détachée du récit, il évoque également un séjour à Paris, autre temps fort de l’itinéraire.
7Martin ne nomme pas de poste important comme la direction d’une psallette, ni d’activités de composition. Son parcours apparaît à cet égard bien plus modeste que celui d’Annibal Gantez, avec une situation précaire sur le plan artistique et financier. En outre, Martin évoque également des rencontres avec des musiciens, comme « monsieur De Luge, Anglois de Nation, Chanoine et sçavant Organiste de la Cathedrale de Bourdeaux » (Martin, 1680, p. 117), ou encore, à Marseille, avec « Mr. Raymond Breton » qui « avait êté Organiste de la Cathedrale de Mont-Pellier » (Martin, 1680, p. 218). Celles-ci peuvent être liées à un réseau professionnel que se serait constitué le musicien, ou à des maîtres auprès desquels il se serait formé, comme c’était parfois le cas des artistes vicariants10. De passage dans certaines villes, il donne aussi, comme à la cathédrale de Narbonne, les noms de musiciens locaux ainsi que le dispositif des orgues : « une tres belle Orgue dans le Cheur de 32 piez ouvert en monstre qui fut autrefois touchée par ce sçavant Espagnol Daranda ce Rossignol charmant dont Louis XIII faisoit tant d’estime » (Martin, 1680, p. 181). Martin fait référence à Luis de Aranda, célébré au même titre que Titelouze à Rouen, pour son jeu (Martin, 1680, p. 64 ; voir aussi p. 67). Le narrateur multiplie ce type de remarques qui rappelle le témoignage de voyageurs, comme Montaigne, sur les pratiques musicales observées sur leur route11.
8Ses déplacements sont donc déterminés (à côté de ses activités religieuses et de ses pèlerinages), par la recherche de contacts et de nouvelles charges dont la précarité le pousse à changer souvent de ville et d’employeur. Cette instabilité fait écho aux conditions des musiciens vicariants et rapproche ce récit du témoignage de Gantez qui relate dans L’Entretien ses pérégrinations qui l’ont conduit à Narbonne, Grenoble ou Auxerre12. Une telle situation éclaire l’itinéraire de Martin qui n’explicite pas toujours les causes de ses déplacements d’une ville à l’autre, comme à Paris, où il indique pourtant avoir vécu plusieurs années13. Il demeure par ailleurs évasif sur les postes occupés, somme toute peu nombreux, et il ne mentionne pas non plus de date14 ni la durée des séjours. Le récit connaît enfin des imprécisions quant à l’itinéraire suivi avec des descriptions parfois sommaires, des ellipses, et certains décrochages spectaculaires dans la chronologie, comme l’épisode de Paris15.
9Ce floutage narratif est lié à l’orientation religieuse du texte. Martin relit sa vie en pénitent, dans une démarche introspective qui se focalise sur l’analyse des fautes et les états d’âme du voyageur, comme avait pu le faire Augustin à travers le récit de ses voyages à Carthage et en Italie pour enseigner la rhétorique. Son parcours prend de ce fait une forme sinueuse, chaotique, qui reflète l’agitation intérieure du personnage et fait écho au précepte augustinien du inquietum est cor nostrum 16. Sur ce point, le travail de confession s’appuie sur plusieurs anecdotes ayant pour décor ses activités de musicien. C’est le cas à Lannion où Martin officie en qualité de chantre dans une église. Il rapporte l’incident suivant :
[…] j’y fus un peu de tems non pas sans dispute, car un jour êtant à l’Eglise avec quelques Ecclesiastiques, un entre autre constitué en dignité voulant me reprendre pour quelque chant mal entonné qu’il disoit n’être pas juste d’harmonie, et moy soutenant le contraire il ne s’en falut guere que je ne le frappé avec le baton de la Croix que javois de ja pris à la main, mais comme l’on dit communement qui quitte la partie la perd, j’aimé mieux me retirer sans dire mot que de causer un plus grand scandale. (Martin, 1680, p. 102)
10La confession prend une forme spectaculaire et teintée de burlesque. Ce mélange des genres fait du chantre impulsif un émule du picaro, modèle avec lequel Martin joue implicitement pour relever le récit17. L’anecdote s’inscrit également dans la lignée de témoignages comme celui de Gantez qui rapporte des disputes semblables avec le curé de l’église Saint-Paul de Paris où il officia18. Chez Martin, l’histoire a toutefois une valeur essentiellement édifiante puisqu’elle révèle son impiété et ses manquements qui ont conduit, semble-t-il, à son départ.
11Ce type d’anecdote n’est pas rare dans le Confiteor. Le parcours du musicien est prétexte à un examen de conscience et à un aveu général des fautes commises depuis son départ de Rouen. La pratique du chant d’Église et la participation aux offices sont le théâtre d’autres scandales19. La musique est également considérée comme une source de profit dont la pratique répond à des besoins avant tout matériels. C’est le cas lorsque Martin se rend dans la région de Saint-Jean-de-Luz, présentée comme le « Paradis des prêtres mercenaires » où « l’argent est là comme l’eau de la Fontaine » ; et le narrateur souligne les bénéfices pour un chantre : car « chanter une haute Messe » permet de « gagner facilement 30 solz par jour » (Martin, 1680, p. 133-134). C’est le cas aussi à Draguignan, où il exerce plusieurs métiers (enseignant, maître d’écriture) ; mais la précarité de ces postes le conduit à se faire recruter comme musicien à Cuers :
[…] Je joignis la plume avec la simphonie exerceant la fonction d’Organiste dans la Cathedrale de S. Pierre aux liens […] conditions qui me sembloient avec mes Messes beaucoup plus favorables que la premiere par l’esperance du gain que j’en pretendois reçevoir. (Martin, 1680, p. 246-247)
12La musique est considérée avant tout comme une activité lucrative, que le narrateur exerce à côté d’autres métiers, par opposition au statut du musicien d’Église, voué à Dieu et parfois élevé à la prêtrise, comme Martin20. Sa confession révèle ainsi l’image d’un religieux dévoyé et d’un artiste mercenaire, en recherche constante de nouvelles sources d’enrichissement, ce qui le rapproche là encore davantage du picaro ou de récits burlesques comme Les Avantures de Monsieur d’Assoucy 21.
13La musique est donc la source de dérives morales et un révélateur de la superbia vitæ qui conduit le prêtre à courir après la richesse et les gratifications. Elle n’est cependant qu’un aspect de la confession qui dessine à travers ce voyage une carte de Tendre des péchés du musicien. Martin éclaire son parcours à la lumière de la théologie augustinienne de la concupiscence, présente sous plusieurs formes dans le récit et résumée dans cette formule conclusive : « j’ay peché. […] Beaucoup par mes yeux superbes, tres souvent par mes oreilles curieuses, par mon odorat sensuel, par ma bouche mensongere, par mon goust voluptueux » (Martin, 1680, p. 253). Cette remarque fait écho aux considérations d’Augustin dans le Livre X des Confessions sur la concupiscence de l’ouïe et les dangers de la musique pour le chrétien22. Martin s’y réfère explicitement durant son trajet à travers la Normandie où il évoque son goût pour les chants profanes, entendus à l’occasion de haltes confortables :
[…] Faisant de mon ventre un Gardemanger où j’y retirois tant de vins et tant de viandes ; pendant que le pauvre Lazare mouroit de faim à ma porte : de la bonne chere je passé au plaisir extreme que je prenois à entendre les Concerts melodieux, de Violles et de Violons de Vaillant et Doudet, croiant n’être venu en ce Monde que pour vaquer à ces Cerenades et à ces Festins. (Martin, 1680, p. 96-97)
14La musique est l’un des nombreux symptômes de la maladie du pécheur. De façon plus générale, Martin passe en revue dans le récit toute la gamme des péchés véniels, mortels et capitaux, dont certains sont des travers communément prêtés aux musiciens, comme l’ivrognerie, souvent évoquée dans la littérature du temps, avec là encore pour double le modèle du picaro23.
15Sur un plan théologique, la musique manifeste également la condition du pécheur et sa privation de la grâce divine. Martin revient à plusieurs reprises sur ce thème au fil du voyage qui demeure marqué par l’absence de conversion, et la progression inexorable du prêtre dans l’impiété. Il l’exprime avec des images profanes, comme celle de la « Sirenne » qui « chantoi[t] […] pour tromper et deçevoir mes Amis » (Martin, 1680, p. 38). Ailleurs, Martin évoque les « tons discordans24 » de sa vie, qui dissone avec le chant de l’Église, comme celle du chantre à Lannion. Cette métaphore fait écho à une conception musicale de l’homme, définie par saint Augustin dans le De Musica où le péché est décrit comme une dysharmonie spirituelle25.
16C’est en ce sens qu’il faut comprendre les nombreuses références aux Écritures pour traduire l’éloignement de Dieu : « ne m’êtant pas contenté de chasser David de son trône, […] j’embouchois la Trompette et sonnois les Orgues en Hebron, et mêprisois Moïse et le reste des hommes, en chantant Absalon vivera à jamais » (Martin, 1680, p. 112)26. La lutte d’Absalom et de David est aussi celle du chantre de Dieu et de son fils rebelle. La référence illustre donc à double titre l’impiété du musicien, dont le chant discordant est à l’image de la vie. Ailleurs, Martin se réfère à la doctrine des sens spirituels et évoque sa surdité à l’appel de Dieu, à l’occasion de son passage à Tarascon :
Mais cela ne touchoit pas encore beaucoup mon cœur, la voix du Batelier qui m’appeloit avec impatience pour passer le Rosne me faisoit perdre le souvenir Salutaire de cette Sainte meditation, hodie si vocem ejus audieritis, nolite obdurare corda vestra Ps. 94. Si la voix de Dieu m’appelloit interieurement à Penitence ? pourquoy suivre plustost celle d’un miserable mortel, c’est ce que je faisois tous les jours avec Augustin, chantant comme le Corbeau, Cras, cras, demain, demain. (Martin, 1680, p. 196-197)27
17Martin se réfère au Commentaire du Psaume 102 où Augustin fait du corbeau l’image de l’impénitent, qui refuse de répondre à l’appel de Dieu28. De façon allusive, la citation renvoie également à l’épisode du jardin de Milan dans les Confessions, qui marque la conversion d’Augustin après avoir entendu le Tolle, lege, et où la même expression est reprise : « Quamdiu, quamdiu cras et cras 29 ». Cette référence marque de fait ironiquement la surdité spirituelle du musicien, tenu loin de la foi (fides ex auditu 30) dans sa vie de prêtre.
18De fait, le cheminement du musicien n’aboutit pas à un retour à Dieu : il est sans cesse repoussé en dépit des malheurs traversés sur sa route (les vols, la faim, la fatigue) mais aussi des rencontres plus heureuses, comme celles de religieux qui ont aidé le voyageur31. Le narrateur discerne a posteriori dans ces événements des signes de la providence divine : « on dit communement qu’un malheur est l’avant-coureur d’un bonheur » (Martin, 1680, p. 170) plus grand : comme une dissonance qui se résout dans l’harmonie du concert. Tout le Confiteor peut finalement se lire comme un cheminement vers la foi, qui trouve dans la musique son expression théologique la plus précise, comme chez saint Augustin32.
La liturgie du voyage
19Le voyage est occasion de pénitence mais il est aussi propice à l’instruction religieuse et à la dévotion. Martin enrichit en effet son récit de considérations spirituelles à la faveur des lieux parcourus et des sanctuaires visités33, dans le cadre de ses activités de prêtre-musicien. Au fil du parcours, le narrateur retrace ainsi l’histoire des églises, des couvents et des cathédrales ; il évoque également la vie des saints et le clergé local, ou encore des chrétiens illustres34. Ces commentaires forment des pauses dans le récit, nouées en contrepoint du parcours chaotique de Martin qui relit son itinéraire à la lumière de l’histoire religieuse. L’écriture de la confession se trouve ainsi ressaisie dans le cadre d’une entreprise spirituelle plus large, qui modifie à la fois le sens et la nature du texte.
20Le récit ne se donne plus seulement à lire comme le témoignage d’une vie d’errance morale et physique. Martin fait l’herméneutique religieuse de son voyage, rythmé par le souvenir de lieux sacrés et ce que Marie-Christine Gomez-Géraud nomme la « litanie des stations » (églises, sanctuaires, couvents ; Gomez-Géraud, [1999] 2022, p. 630-631) qui ponctuent l’itinéraire. Jadis profanés ou ignorés par le musicien, ces lieux sont désormais considérés avec l’œil du converti qui fait du voyage un temps de vénération. Une distorsion s’opère par conséquent entre les deux acteurs du récit : aux errances et à l’aveuglement spirituel du chantre s’oppose la foi retrouvée du narrateur qui infléchit a posteriori ses pérégrinations dans le sens d’un voyage religieux, recomposé à travers l’écriture35.
21De là une forme de dédoublement générique du texte : celui-ci est à la fois la confession d’un voyageur et un récit de pèlerinage, qui sacrifie aux codes du genre, cristallisés dans Le Pelerin de Lorete de Louis Richeome et, sous une forme plus ludique et mondaine, dans Le Voyageur inconnu de Jean-Pierre Camus36. Martin s’inscrit dans la même veine littéraire en retraçant la géographie religieuse de son parcours. La confession apparaît ainsi chez lui comme une forme hybride et malléable, à la croisée de plusieurs types d’écriture et de différentes pratiques spirituelles, ce que confirme du reste le projet annoncé dans le prélude du Confiteor de composer par la suite le récit d’un voyage en Italie (au sanctuaire de Lorette ?) et en Terre sainte.
22La musique est partie prenante de cette entreprise qui intègre les arts au tableau de la France chrétienne. Martin évoque la dévotion de saints comme lors de son passage à Bordeaux, lieu de mémoire de saint Paulin de Nole qui « passoit toutes les nuits en oraison ; disant que dans la priere et dans le Chant continuel des Pseaumes nous trouvons les Armes qui nous defendent » (Martin, 1680, p. 124) 37. Surtout, il donne des renseignements sur l’architecture des églises et les centres religieux, et il les décrit en recourant, comme Richeome, à la rhétorique des peintures. Le voyageur s’intéresse tout particulièrement aux orgues qui contribuent à la splendeur et au rayonnement des églises. Ceux-ci attirent le musicien, sensible à la renommée des instruments et des artistes. Mais leur évocation a également une valeur édifiante qui contribue à la splendeur des lieux.
23Tel est le cas lors du passage de Martin à la collégiale Saint-Pierre de Cuers : il indique que « l’orgue est neufve posée sur le Maître Autel faite par Rrouviere Flamand » (Martin, 1680, p. 247) : Charles Royer, un facteur renommé en Provence. À Marseille, il souligne que « dans l’Eglise des Acolles il y a une grand Orgue de Mr. Eustache que feu Mr. Mayen autrefois Organiste à Draguignan touchoit tres bien » (Martin, 1680, p. 218). Il en va de même à Narbonne où Martin décrit le grand orgue de la cathédrale, sur lequel joua Luis de Aranda, nous l’évoquions plus haut (Martin, 1680, p. 181)38. Parfois, Martin dépeint en détail la disposition du lieu, comme dans le couvent des Augustins de Rouen. Il indique que l’église est ornée par
[…] cête superbe entrée d’Architecture et cêt appariel magnifique en Marbre Noir et dorure, ayant à droit la Chapelle de la Vierge, ornée d’un excellent Tableau peint par le Sieur Le Tellier, joignant celuy où sont representez les Miracles de S. Mathurin ouvrage du Sieur Saquepée [sic], celle de S. Adrian Martyr representé sur son encleume ou la bonne Natalie sa Femme l’encourage à souffrir patiamment pour Jesus-Christ, peint par le Sieur Sacquepée, les Miracles de S. Thomas de Villeneuve aussi peint par le Sieur le Tellier, à coté de la grande Orgue digne d’un Evesque faite par Morlet, se voit un excelent Tableau du Jugement universel. (Martin, 1680, p. 58-59)39
24L’orgue est une œuvre d’art au milieu des peintures sacrées et de la splendeur du lieu. La description des orgues a bien souvent, comme ici, une fonction à la fois documentaire et apologétique, puisque le narrateur célèbre la beauté d’un instrument sacré par excellence, point sur lequel la littérature religieuse a insisté en faisant de l’orgue le symbole de la chrétienté40.
25Ce jeu de références est également pour Martin une façon de célébrer la gloire de musiciens et d’artisans qui œuvrent de concert au service de l’Église. C’est en ce sens qu’il faut comprendre l’hommage rendu à Guillaume Lanes, organiste de la cathédrale de Toulouse :
Mr. l’Asne […] scait si bien mêlanger les consonances avec les dissonances, les secondes avec les tierces majeures, les septiemes avec les octaves et les dixiemes, passer de B. mol en nature et de nature en B. carre, faisant garder le doux et l’aigre en même tems ; je luy pourois donner selon son nom la devise de l’Asne qui est parmy des Fleurs et des Chardons, pungant dum saturent, ne faisant pas comme l’Aragnée qui chatoüille avant que de picquer, la chromatique pique ce semble l’ouïe par ses Tons imparfait, la Diatonique les rend doux par sa charmante melodie et l’Enharmonique par ses cadences, mesures et ses modes, donne le dernier tremblement à cette aimable Cécile de l’empirée. (Martin, 1680, p. 179-180)
26Martin loue l’expressivité du style de Lanes et son goût pour la dissonance, avec des mots qui rappellent ceux de théoriciens comme Mersenne et Descartes41. Cet hommage souriant du critique musical renvoie à la dimension ludique du récit, dans un esprit proche du texte de Gantez, adepte lui aussi des jeux de mots. Mais il est aussi pour Martin l’occasion de célébrer des chrétiens célèbres comme Lanes. Ce type d’évocation concerne les artisans et les organistes, mais aussi les chantres, comme à la cathédrale de Toulouse « où l’on ne voit dans ce noble Clergé que des exemples de pieté et où l’on chante devotement les loüanges de Dieu » (Martin, 1680, p. 178).
27Le narrateur insiste d’ailleurs à plusieurs reprises sur la piété des musiciens rencontrés sur sa route, à l’opposé de celui qu’il était. Tel est le cas lorsqu’il fait la connaissance de Monsieur Raymond à Marseille : « il est presentement Organiste de S. Victor et Aumosnier de la Citadelle, il entend assez bien la Pharmasie et la composition des remedes qu’il distribue journellement aux Pauvres » (Martin, 1680, p. 218). Martin loue le musicien mais aussi l’homme de foi, dont la vie est une louange à Dieu. Ce type de portrait s’inscrit dans la lignée d’ouvrages comme l’Harmonie universelle où Marin Mersenne fait l’éloge de compositeurs catholiques, à l’image de Jacques Mauduit, présenté comme la figure par excellence du musicien dévot42.
28Dans le Confiteor, ces éloges s’ajoutent à ceux de savants, de poètes et d’artistes, mais aussi de religieux et de personnalités politiques qui entrent dans la composition du tableau de la France catholique. Martin célèbre l’Église et les saints, mais aussi ceux qui incarnent la foi des temps présents. Sa confession prend ainsi la forme d’un témoignage qui allie à la mémoire de l’histoire religieuse l’expérience et la culture du voyageur43. Le récit n’a, dans ce cadre, pas seulement pour but d’enseigner la topographie chrétienne, mais aussi de nourrir la piété du lecteur par la mise en présence des forces vives de l’Église. L’orientation spirituelle du Confiteor l’inscrit sur ce point dans la lignée d’ouvrages comme Le Pelerin de Lorete de Richeome qui conçoit son récit comme un livre de dévotion. Entreprise de pénitence, la confession est également envisagée par Martin comme un temps de louange et une profession de foi.
29Cette quête spirituelle s’étend également à la nature, omniprésente dans le récit. Martin livre au fil de l’histoire de nombreuses descriptions des campagnes, des montagnes et des rivières traversées sur sa route, ainsi que des villes et des cultures. Ces tableaux sont l’occasion de s’élever à Dieu en méditant sur les merveilles du monde, reflets de sa sagesse et d’un ordre cosmique dont la musique (comme science de l’harmonie) est la clef d’interprétation. Une telle pratique est commune aux textes cosmographiques et plus spécifiquement aux récits de pèlerinage où les auteurs méditent volontiers sur les merveilles de la création44. Martin exploite le procédé, comme lors de son arrivée à Brignole :
[…] Je vois d’un côté de villes Mazures, des Châteaux ruïnez, et la Cascade ingenieuse de Mr. Le Comte de Carce qui se fait voir dans le milieu d’une longue passée d’Arbres, comme un Miroir transparent, eaux coulantes sur le dos d’une montagne et se precipitant dans leur course avec une roideur admirable soûs un haut Pont de pierre ou mille canarts se jouent en chantant : Placent dum canunt, Roüen Roüen, Caën Caën. Au sortir du bois je fus à Brignolle Ville assez connuë pour ses prunes excellentes […] : au milieu de la prairie est bâty le joli Convent des Capucins environné d’un ruisseau qui va serpentant et gazoüillant à petit bruit parmy les petits cailloux, il y a d’excellents Poissons qui montrent leurs escails argentés et dorés à la lumiere naissante de l’Aurore45. (Martin, 1680, p. 224)
30La description fait voir et entendre l’harmonie du monde, reflet de la sagesse de Dieu. Là encore, ces épisodes renvoient au travail de relecture opéré par le narrateur qui rend au périple sa portée spirituelle. Tandis que le musicien vicariant considérait « avec plaisir les objets ravissants de la nature sans en remercier l’Autheur » (Martin, 1680, p. 187)46, Martin fait du voyage un itinéraire de l’âme, ponctué par la visite des sanctuaires et la méditation des merveilles de la création. Ce type de tableau s’inscrit, par sa familiarité et son éclat, dans le droit fil de L’Essai des merveilles de la nature et des arts d’Étienne Binet, et de tout un courant de l’humanisme dévot, marqué par le caractère religieux de la nature. Il fait également écho à une pratique bien présente dans les Confessions de saint Augustin, qui développe, dans les Livres XI à XIII, une méditation sur la création47. La louange devient donc partie prenante de l’exercice confessionnel qui ne se réduit pas à l’aveu des fautes, mais célèbre aussi la gloire de l’œuvre divine.
31Martin recourt souvent au procédé dans le Confiteor qui mêle les temps de pénitence et de déploration à des épisodes plus contemplatifs48. Parfois, il y associe également des poèmes qui soutiennent ces temps de prière. Certains sont consacrés à la description de villes (Rouen, Paris49) et de campagnes. D’autres relèvent de formes poétiques et de pratiques dévotionnelles variées : un sonnet et des litanies adressées à des saints50 et à la Sainte Vierge, vue significativement comme le « Centre des belles harmonies » (Martin, 1680, p. 272)51 ; une paraphrase du Psaume 139 (138) « Domine probasti me » (Martin, 1680, p. 1-8) en prélude à la confession, ou encore une « Description de la Sainte Baume » (Martin, 1680, p. 234-242) en dizains d’octosyllabes, lors du passage du voyageur dans la montagne de Marie-Madeleine. Ces poèmes ménagent des moments de respiration spirituelle dans le récit et prolongent l’acte de louange, dans le droit fil de la tradition chrétienne. Ils soulignent également des temps forts dans le voyage, ponctué par des exercices de dévotion et des stations lyriques qui invitent à prier et méditer. Considéré sous cet angle, le récit devient un espace liturgique ou, pour reprendre l’heureuse formule de Marie-Christine Gomez-Géraud, « la route n’est plus qu’un cloître où louer le Seigneur » (Gomez-Géraud, [1999] 2022, p. 154).
32La musique et la poésie deviennent ainsi les instruments de la confession de louange du narrateur. À la vie du musicien errant, remplie de dissonances, s’oppose une pratique dévote du chant, centrée sur Dieu et sa glorification. Celle-ci ne se réduit pas d’ailleurs à une expérience positive, mais elle est également liée aux gémissements et à la souffrance du narrateur pèlerin, tout au long du parcours. Dans cette perspective, c’est non seulement la poésie, mais aussi les passages consacrés à l’aveu des fautes, écrits dans un style volontiers expressif, qui participent à cet effort de louange52. Comme saint Augustin, Martin consacre toutes les ressources de la langue pour célébrer le Nom de Dieu, faisant de la musique la clef de voûte de sa confession.
33Le Confiteor apporte un éclairage remarquable sur la confession à l’âge classique. Sur le plan littéraire, l’ouvrage s’inscrit dans le sillon de l’œuvre augustinienne, constamment convoquée. Martin emprunte aux Confessions leur cadre narratif et il relit sa vie en pénitent qui sonde l’histoire de son âme et y éclaire chaque parcelle du péché. Cet examen de conscience s’inscrit cependant dans un itinéraire de vie singulier, marqué par l’expérience du prêtre-musicien qui sert de fil rouge à son autobiographie spirituelle. Le témoignage de Martin sur la réalité des musiciens vicariants a de ce point de vue un intérêt documentaire de premier ordre, qui connaît peu d’équivalents au xviie siècle, et qui gagnerait à être plus largement étudié par les musicologues. Cet intérêt se vérifie également au niveau de l’écriture des confessions. Martin confère à son histoire une dimension volontiers spectaculaire et cocasse, qui révèle l’influence de modèles littéraires comme le roman picaresque, l’histoire comique et le récit de voyage. Le travail introspectif donne également lieu à une forme de dédoublement de la trame narrative : le parcours dissonant du musicien est ressaisi dans le cadre d’une histoire religieuse des villes et des régions traversées. Le cheminement du voyageur se trouve de ce fait repensé dans le cadre d’un itinéraire spirituel qui fait écho à la littérature pérégrine. La musique constitue dans ce contexte une clef de lecture précieuse du texte : la confession du voyageur est aussi l’occasion de professer sa foi et de louer Dieu à chaque étape du parcours. La visite de sanctuaires, la rencontre de musiciens, la contemplation de la nature, sont autant d’événements propices à la prière et à la méditation, dans un esprit là encore typiquement augustinien. Ainsi pensé, le Confiteor offre une illustration éloquente de la richesse littéraire et poétique des confessions au xviie siècle.