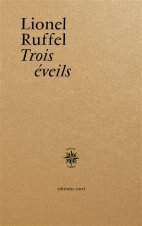
La littérature en éveil
1 À la suite de Trompe-la-mort, paru en 20191, livre déjà centré autour de trois objets politiques et artistiques (la figure de Shéhérazade, l’affaire Tarnac et le Décaméron), Lionel Ruffel poursuit dans un essai sous forme de triade sa réflexion sur les liens entre le politique et les formes artistiques, cette fois-ci à partir de situations, à la fois personnelles et universelles : celles de l’endormissement et du réveil, celles du songe et de la veille. Assez libre formellement — écriture à la première personne, absence de notes de bas de page, références bibliographiques à la fin de l’ouvrage2 —, Trois éveils est composé de trois chapitres de taille inégale (une vingtaine de page pour le premier, « Une nuit blanche » ; une petite centaine pour le deuxième, « En campagne » ; une dizaine pour le troisième, « Programme de grève »). Si ces chapitres ont chacun des objets distincts, ils sont liés par le je de l’auteur qui construit ainsi une trame narrative autour de ses endormissements et de ses réveils. Non seulement le discours tenu par l’auteur est-il explicitement situé, mais il est aussi fortement personnel et autobiographique.
Portrait du littéraire en insomniaque
2Que lire pour s’endormir ? La question, qui peut paraître a priori étonnante, est pourtant celle que se pose Lionel Ruffel à l’orée du livre. En partant de son propre rapport difficile à l’endormissement, l’auteur propose une répartition de la littérature en deux blocs : d’un côté les textes lus de jour, de l’autre ceux lus de nuit. Par-là, il s’agit alors de déconstruire des gestes habituels d’appréhension des textes, comme celui, consubstantiel de l’histoire littéraire, qui consiste à regrouper des textes en fonction de leur époque. Au contraire, les textes de Nathalie Quintane sont ici associés à ceux de Rabelais et de Sterne et sont rendus inéligibles à toute lecture nocturne, car « trop amusant[s] » ou « trop stimulant[s] » (p. 11). La question générique est, elle aussi, convoquée en fonction de cet impératif matériel. Ainsi, les essais ne pourraient être lus de nuit, car ils font « trop penser » (p. 11). Le genre est indissociable du rythme de vie du chercheur, ce que résume, par exemple, ce parallélisme asséné plus loin dans l’ouvrage : « la nuit du roman, le jour du journal » (p. 39).
3La relation au corpus littéraire ne relève pas d’une simple idiosyncrasie, dans la mesure où le rapport au sommeil est intrinsèquement dépendant d’une condition historique. En effet, en s’appuyant sur des travaux récents, Lionel Ruffel indique que le modèle actuel global du capitalisme néolibéral instaure un « éveil permanent », qui implique, par exemple, un besoin « insatiable » de « fictions nocturnes » (p. 25). La question du sommeil est indissociablement politique et artistique, ce que Baudelaire, le premier, aurait remarqué. Le poète — comme Victor Klemperer dans le deuxième chapitre et, dans le troisième, le personnage de Rose du film L’Époque de Matthieu Bareyre — agit comme un révélateur d’une condition d’éveil au monde, et l’objet même de l’éveil de l’auteur (et, à sa suite, du lecteur). Des plongées répétées dans les Petits Poèmes en prose permettent de saisir la lucidité baudelairienne quant au capitalisme, celui du xixe mais aussi celui du xxie siècle : « Il a compris que la voracité du capitalisme demande toujours plus de fictions pour simultanément maintenir en éveil et abrutir ses travailleurs » (p. 25).
4Si Lionel Ruffel établit des correspondances entre le Paris du xixe siècle parcouru par Baudelaire et les villes actuelles qui ne dorment jamais, c’est en vertu de la revendication forte et réitérée tout au long de l’ouvrage — et qui nous paraît en être l’axe majeur — d’une « désignation » (p. 70) dans laquelle il se reconnaît, celle de littéraire. Être littéraire implique un mode de travail, une méthode en forme d’anti-méthode, affirmé, par contraste avec d’autres méthodes disciplinaires instituées, dans les premières pages de l’essai :
Nous les littéraires, qui ne sommes ni historien.nes, ni philosophes, ni sociologues, ni vraiment écrivain.es, on ne fait que cela, écouter et voir les échos, et dire voir ceci, voir cela, voir le reste et ça ne s’arrête jamais. (p. 14)
5Cette déclaration d’intention est surtout une scénographie, au sens de Dominique Maingueneau3, en ceci que Lionel Ruffel justifie et légitime, tout au long de son discours, ce pourquoi ce même discours existe et se présente comme tel. Et si, en restant dans la perspective que propose Dominique Maingueneau, tout auteur se positionne par rapport à une archive, Lionel Ruffel se situe ici à la suite, non pas d’un littéraire, mais d’un philosophe, Gilles Deleuze. L’actuel professeur à l’université Paris-VIII avoue avoir « idôlatr[é] » celui qui fut une figure de Vincennes, et considère que ses écrits l’ont « constitué » (p. 13) et l’ont guidé tout au long de son activité intellectuelle :
Ce que j’ai appris de lui et d’eux est finalement assez simple : dans ce que nous percevons, dans ce dont nous faisons l’expérience, des choses se répètent, d’autres diffèrent. Faire ce relevé, le mettre en musique, c’est finalement ce à quoi j’ai jusqu’à maintenant consacré une partie de ma vie intellectuelle. Et si je me reconnais non pas un talent, mais une capacité, c’est celle-ci : j’entends et je vois des échos (p. 13).
Victor & Charlie & Noémi… : la contemporanéité des mineurs
6C’est dans le deuxième chapitre de l’ouvrage, significativement plus long que les deux autres, que cette « capacité » que se reconnait Lionel Ruffel se manifeste le plus ostensiblement. Ce chapitre est consacré au travail de Victor Klemperer, intellectuel juif allemand du xxe siècle, auteur d’un journal tenu tout au long de la dictature nazie, et surtout de LTI, la langue du Troisième Reich : carnets d’un philologue4, œuvre devenue incontournable dans le champ des études des langages totalitaires. La visée de Lionel Ruffel n’est pas tant d’étudier de près ce que Klemperer dit du langage nazi, comme d’autres l’ont fait avant lui5, que de s’intéresser à la « remontée à la surface » (p. 43) dans le contemporain d’un romaniste dont l’œuvre était, en son temps, considérée comme mineure, par rapport à celles des plus éminents représentants de cette discipline comme Erich Auerbach et Leo Spitzer. Or, c’est précisément le caractère mineur de Klemperer, dans sa conception deleuzo-guattarienne6, que Lionel Ruffel veut rendre dans son chapitre, et qui expliquerait tout l’intérêt que le philologue a suscité dans une frange de la littérature contemporaine. Car Lionel Ruffel le reconnait, son éveil à Klemperer a commencé en 2018 en se passionnant pour Poétique de l’emploi de Noémi Lefebvre7 (p. 45). Pour Lionel Ruffel, il y aurait ainsi « un moment Klemperer de la contemporanéité littéraire », qui correspondrait à « une lignée minoritaire consistant à rester dans le relativement informel » (p. 83), incarnée par des autrices telles que Noémi Lefebvre, Nathalie Quintane, Sandra Lucbert ou encore Emmanuelle Pireyre, qui toutes revendiquent explicitement l’influence de Klemperer.
7Mais en quoi consiste le caractère mineur de l’écriture de Victor Klemperer ? L’argument essentiel formulé par l’auteur est que les écrits de Klemperer sont — exactement comme ceux des autrices qui viennent d’être citées — dans leur forme même, antiautoritaires. Cette forme, c’est, dans le cas de Klemperer, celle du journal, qualifiée par l’essayiste de la « plus mineure des écritures personnelles ». En découle une écriture qui refuse toute systématisation, ce qui pousse Lionel Ruffel à qualifier Klemperer de « littéraire » (p. 70) plutôt que de « philologue » et sa LTI d’« ouvrage littéraire, et bizarre qui plus est » (p. 67). L’antiautoritarisme formel de Klemperer permet à Lionel Ruffel de repenser à nouveau frais la courante association de LTI et de 1984 de George Orwell dans une section intitulée « Victor & George ». En effet, d’un point de vue formel, les deux ouvrages sont très différents : le premier représentant la littérature mineure, là où le second est, au contraire, un modèle de littérature majeure : « L’un choisit le genré, le straight, le formé, pour peser sur le cours du monde, il en retire la gloire ; l’autre, l’oblique, le non-binaire, le foutraque, l’informel : il sera ignoré pendant un demi-siècle et finira par remonter à la surface » (p. 86). Et Lionel Ruffel d’aller plus loin en affirmant que le roman d’Orwell est « en un sens autoritaire, où l’autorité de l’auteur s’affirme tout straight, tout droit, loin du trouble » (p. 89). Paradoxalement, Orwell ne questionne pas vraiment le fait qu’un acte de parole puisse être autoritaire, à la différence de Klemperer, qui « triche avec l’autorité en permanence » (p. 60) ou de ces autrices qui font vivre « le moment Klemperer de la contemporanéité littéraire », lesquelles « rejettent une trop grande autorité sur leur texte » (p. 83). Le mise en lumière de cette littérature contemporaine minoritaire, éminemment politique, dans sa méfiance vis-à-vis de sa propre autorité, fait écho à la réflexion récente de Justine Huppe dans La Littérature embarquée sur cette littérature contemporaine consciente de ne plus disposer de condition d’extériorité vis-à-vis du modèle néolibéral, et qui, de ce fait, travaille la question politique à l’intérieur même de cette « situation d’embarcation8 ».
8Le lecteur attentif remarquera que Lionel Ruffel applique, implicitement, dans le désappariement d’Orwell et de Klemperer et, à l’inverse, dans l’appariement de ce dernier et de certains textes d’autrices françaises contemporaines, la méthode, rappelée au seuil du livre, qui consiste à relever les différences et les répétitions « dans ce dont nous faisons l’expérience » (p. 13). L’auteur nous propose ainsi d’autres rapprochements entre Klemperer et des figures artistiques ou intellectuelles du xxe siècle : Klemperer côtoie, dans la bibliothèque du professeur de l’université Paris-VIII, Kafka et Kertész, eux-aussi juifs et eux-aussi mineurs. Mais c’est surtout le Charlie Chaplin du Dictateur qui se trouve rapproché avec le plus de force de Klemperer, dans la section intitulée éloquemment « Frères mineurs ». L’un comme l’autre a compris et retranscrit en temps réel le nazisme dans sa réalisation linguistique et spectaculaire : « Chaplin s’attaque aux barnums, quand Klemperer s’attaque au livre. » (p. 105)
9L’éveil de Chaplin et de Klemperer au nazisme doit nous servir à veiller aux plus dangereuses des répétitions historiques : les « machines fascistes » (p. 105). Dès le début du chapitre, l’auteur indique qu’il écrit en pleine période des élections présidentielles de 2022, et donc sous la menace de l’accession au pouvoir de l’extrême-droite. Non sans rappeler les évidentes différences entre la situation allemande dans laquelle se trouve Klemperer et la situation française dans laquelle lui se trouve, l’auteur pointe des similarités, à commencer par la manière dont un « jargon » peut s’imposer au pouvoir ou encore la manière dont des mots deviennent des « trigger », des « mot[s]-gâchette[s] » ou « mot[s]-déclencheur[s] », à l’image de « République » ou de « Laïcité » (p. 113). De même, les discours idéologiques de l’extrême-droite française sont énoncés par des individus, ou plutôt par des groupes d’individus, qu’il est possible de comparer avec ceux qui promouvaient l’idéologie nazie au temps de Klemperer : une « élite précaire (pas économiquement, mais intellectuellement et symboliquement) d’éditocrates qui palabrent et palabrent en attente de leur maître qui viendra fixer leurs obsessions et leurs intérêts. » (p. 110) Si les considérations politiques sur les parallèles qui existent entre ces phénomènes sont peut-être plus attendues que l’exploration de l’œuvre de Klemperer en littéraire mineur, elles n’en sont pas moins justes et efficaces, au sens où l’auteur prend soin de ne jamais systématiser un propos politique, et que ces considérations politiques apparaissent dans le flux de son discours.
Le rêve, le cercle
10Le dernier chapitre de Trois éveils est à la fois le plus court et le plus dense des trois chapitres de l’ouvrage, dans la mesure où les douze pages qui le composent sont divisées en trois sections : deux sections rédigées en 2023 encadrent un texte écrit en 2019. L’auteur relate dans ce chapitre l’attachement qu’il a développé pour le personnage de Rose du documentaire de Matthieu Bareyre intitulé L’Époque, consacré à la vie nocturne parisienne entre 2015 et 2017. Cet attachement résulte avant tout d’une expérience politico-esthétique relative au visionnage répété du film, puisque Rose « crève littéralement l’écran » (p. 133) et qu’elle est une figure d’espoir, de lutte contre un « temps social complètement figé » (p. 132). Rose devient rapidement, sous la plume de Lionel Ruffel la représentation idéale et contemporaine de l’éveillée : « C’est Rose l’éveillée, qui ne dort jamais et qui, dans la rue, poétise et klemperise. » (p. 133) D’où l’insertion du texte élogieux, « lyrique comme jamais » (p. 133), écrit au moment même où le chercheur découvre pour la première fois le film, en 2019, et inséré au milieu de deux textes plus récents.
11Le lecteur est invité à lire dans l’éloge de Rose ce que l’auteur a tissé depuis le début de son essai, à savoir une saisie du réel dépendant d’un usage créatif et non instrumental de la langue :
Parler, écrire, tout se joue là, dans un même mouvement, pour la fille du feu Rose, car les filles du feu sont filles du langage, et c’est leur message : le langage est un feu qu’il convient de maîtriser, surtout lorsqu’il est écrit. Le langage, comme le feu, transforme et transfigure (p. 135).
12Comparée au Rimbaud de la Commune, Rose est surtout celle qui, comme le fait Klemperer dans ses écrits, refuse l’évidence autoritaire de la ligne droite, du straight, en lui opposant des courbes et des cercles :
[Les lignes] de la fille du feu sont courbes, répétitives, récursives, erratiques, elles résistent à la linéarité vectorisée, elles privilégient les cercles, les retours en arrière. Toujours on sent le geste et la trace qui ne les forment jamais droites (p. 138).
13Tout naturellement, Rose apparaît à l’auteur comme l’étudiante du master de création littéraire rêvée. Et alors le livre aurait pu, ou dû, se clore sur son entrée dans ce cursus universitaire.
14Mais la richesse de ce dernier chapitre réside dans le constat, fait dans la troisième section, qu’il ne s’agit que d’un rêve, qui se cogne à la réalité des conditions d’existence d’autrui. Si la Rose du film L’Époque correspond à un idéal auquel l’auteur tend dans son activité intellectuelle, une autre Rose existe, que Lionel Ruffel découvre dans un film plus récent de Matthieu Bareyre. Cette Rose apparaît en proie à ce à quoi l’auteur s’éveille, avec l’aide de ses étudiants et étudiantes : « la santé mentale » (p. 142). D’une certaine manière, Lionel Ruffel convie tacitement le lecteur à méditer de nouveau une affirmation figurant dans les premières pages de l’ouvrage : « j’ai compris que rien ne distinguait les fictions de la vie ; que rien de nos vies n’existait sans le filtre des fictions qui nous entourent et nous produisent » (p. 12). Certes, la fiction nous produit, mais elle peut courir le risque d’empiéter sur les autres et alors de réenclencher, bien qu’inconsciemment, une forme de domination sur autrui, qui va précisément à l’encontre d’une pratique non-verticale et antiautoritaire de la littérature que porte l’auteur. L’ultime référence à Deleuze, pour qui « [l]e rêve est une terrible volonté de puissance » qui se révèle « très dangereux » (cité p. 143) constitue en ce sens la véritable justification de ce que nous avons qualifié plus haut d’anti-méthode : une pratique de la pensée qui ne peut plus « aller tout droit » (p. 13).
*
15L’essai de Lionel Ruffel n’est pas un éloge de l’éveil — ni, au demeurant, du rêve — mais bien davantage un dévoilement de son caractère paradoxal. En effet, l’éveil désigne d’une part une condition imposée par le capitalisme néolibéral — l’éveil permanent — et d’autre part le nom que l’on peut donner à la prise en compte des logiques de domination de ce même capitalisme néolibéral. Le grand intérêt de Trois éveils est de travailler ce paradoxe en faisant jouer le mouvement circulaire et la pluralité (annoncée dans le titre de l’ouvrage) de l’éveil contre l’Un de l’éveil permanent. L’auteur propose ainsi plusieurs éveils à des œuvres (spéculatives, littéraires, cinématographiques, musicales…) en les rapprochant, selon une logique non construite au préalable. En ce sens, le lecteur est à son tour convié à s’éveiller à des œuvres et à y saisir des échos, comme pour mieux se repérer au milieu du brouhaha9 contemporain.

