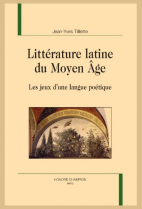
Défense et illustration de la littérature latine médiévale
1La Littérature latine du Moyen Âge. Les jeux d’une langue poétique est l’œuvre d’une carrière. L’ouvrage réunit près de seize contributions présentées comme des essais1 qui ont jalonné le parcours de Jean-Yves Tilliette, professeur de langue et littérature latines médiévales à l’Université de Genève, de 1990 à 2019. Le titre, en apparence simple, annonce en réalité la dimension polémique du projet : défendre l’idée d’une littérature latine médiévale face à la réticence encore observable de nos jours à inclure les écrits latins de l’époque dans le champ du littéraire. Si, comme Jean-Yves Tilliette le note, « nul ne dénie aux œuvres en langues vernaculaires composées entre le xe (Beowulf) et le xve siècles (François Villon) l’appartenance de plein droit à la Littérature, avec ou sans majuscule » (p. 9) depuis le xixe siècle, il semble encore difficile d’en dire de même des œuvres latines qui leur sont contemporaines.
2C’est donc la défense de la validité du syntagme « littérature latine médiévale » que l’auteur entend mener au travers des contributions qu’il a sélectionnées et réunies en trois parties : « Questions de méthode », « Dialogues avec l’Antiquité » et « Dialogues avec la littérature en langue vulgaire ».
3Ces trois parties sont encadrées par un avant-propos intitulé « Qu’est-ce que la littérature (latine médiévale) ? », dont l’usage des parenthèses dévoile les contours de la question, et par la dernière contribution, formant à elle seule une section intitulée « Finale », qui n’est autre que la leçon d’adieu prononcée par Jean-Yves Tilliette à l’Université de Genève en 2019.
4On notera également la présence d’une courte bibliographie, destinée à lister les principaux textes cités (p. 341-343), et deux index : l’un pour les auteurs anciens et œuvres anonymes (p. 345 sq), le second pour les auteurs modernes (p. 349 sq).
Existe-t-il une littérature latine médiévale ?
5Dans son avant-propos, Jean-Yves Tilliette affronte les objections à parler de littérature au sujet des écrits latins du Moyen Âge. Il rappelle notamment « l’inadéquation aux productions anciennes du terme de littérature dans ses acceptions modernes […] » (p. 9) et l’image d’un Moyen Âge « réfractaire au jugement esthétique » (p. 10) du point de vue de l’histoire littéraire scolaire. C’est que la littérature latine du Moyen Âge pâtit d’une lecture qui « brouille [s]a visibilité » (p. 11). Jusqu’au début du xxe siècle, le regard porté sur ces textes n’est pas littéraire2. Son « triple handicap » (être une langue artificielle, décadente et élitaire) ainsi que son lien avec le discours de l’Église ont constitué des facteurs aggravants. On a pu refuser aux auteurs médiolatins leur « ambition esthétique et l[eur] volonté de plaire et de toucher, même orientées par des fins extra-littéraires » (p. 12), le terme de littérature privilégiant, dans ses acceptions modernes, gratuité de l’écrit et caractère non utilitaire à côté de l’enjeu esthétique. Tel est le présupposé qui a marqué le début de la carrière de Jean-Yves Tilliette. La suite de l’avant-propos aborde la nécessité de croiser philologie et critique littéraire : le goût de la microlecture, hérité de Michel Riffaterre3, a partie liée avec l’objectivité des apports de la paléographie, de la codicologie et de l’ecdotique. C’est donc un protocole de lecture des textes médiolatins que propose le chercheur, permettant d’explorer avec justesse le « jeu des poètes avec la langue » (p. 16). Ce jeu est étroitement lié à la notion d’intertextualité, que Jean-Yves Tilliette place au centre des écrits littéraires médiolatins la littérature latine du Moyen Âge est dite « au second degré » (p. 17). En somme, l’avant-propos pose bel et bien l’existence d’une littérature médiolatine et déploie les outils nécessaires à son appréciation.
Quelles approches pour la littérature latine du Moyen Âge ?
6La première partie de l’ouvrage, « Questions de méthode », rassemble trois contributions dont l’objectif est de confronter les textes latins du Moyen Âge à des « grilles d’interprétations littéraires » (p. 12). Les essais abordent tour à tour l’approche littéraire, la critique littéraire et la stylistique.
7Dans « Pour une approche littéraire des textes latins du Moyen Âge », Jean-Yves Tilliette cherche à identifier « quelle est la voix que font retentir les textes médiolatins » (p. 24) compte tenu du risque de l’anachronisme lié aux méthodes modernes de la critique littéraire. Bien que la préoccupation esthétique ne soit pas au centre du projet des « maîtres de grammaire médiévaux » (p. 25) alors qu’elle constitue un pan de la définition du terme littéraire depuis le xviiie siècle, elle ne saurait pour autant être totalement absente chez les auteurs médiévaux. Pour Jean-Yves Tilliette, « ce n’est pas parce que la critique littéraire telle que nous la pratiquons aujourd’hui n’existait pas au Moyen Âge qu’elle n’est pas un instrument utile à la compréhension des œuvres médiévales » (p. 26). Voilà donc la critique littéraire et la philologie désormais « faites pour s’épauler mutuellement » (p. 26) et prêtes à faire surgir la voix des textes médiolatins ! La démonstration est menée à partir de trois cas : L’Alexandréide de Gautier de Châtillon, l’Historia Meriadoci et la Poetria nova de Geoffroy de Vinsauf. Elle permet de définir ce que Jean-Yves Tilliette appelle « approche littéraire », c’est-à-dire une approche qui s’attache à la littera du texte, au sensus et enfin à la sententia (p. 34), reprenant ainsi la typologie de l’explication de texte liée à la pratique de la lectio.
8Le second essai, « Poétique de la poésie : le latin médiéval et la critique littéraire », débute par un constat : selon l’auteur, « les conditions matérielles de la transmission de l’œuvre littéraire au Moyen Âge [sont] inséparables du sens que nous pouvons leur conférer » (p. 37), tant et si bien que « la rigueur philologique est une auxiliaire efficace du “plaisir du texte” ». (p. 37). L’article s’articule autour de « questions préalables » posées par l’auteur : « l’analyse littéraire des textes latins du Moyen Âge est-elle possible ? est-elle légitime ? est-elle valide ? » (p. 38). Chaque réponse est formulée à partir d’objections et de réponses suivant en cela une structure qui permet de faire entendre des arguments pro et contra. Cette série de questions est suivie d’une section « Méthodes de lecture » qui aborde l’intentio auctoris (à travers la génétique textuelle et l’esthétique de la réception), la materia operis (à travers le concept d’intertextualité), la qualitas carminis (à travers la stylistique) et l’utilitas legentis (à travers l’herméneutique). L’essai s’achève par une dernière section appelée « les limites de l’interprétation » qui prône un principe de cohérence comme « exigence ultime de l’analyse littéraire » (p. 63).
9Le troisième et dernier essai de cette partie, « Stylistique de la poésie médiolatine », pose la question suivante : « existe-t-il, en latin médiéval, un style poétique ? » (p. 65). Cette interrogation est née du statut particulier du latin qui, devenu une langue seconde, n’est plus « soumis aux exigences de simplicité et d’immédiateté qui sont celles de l’usage quotidien » et « peu[t] donner libre cours aux prestiges de l’invention » (p. 65). Cette langue peut donc jouir d’une « expression artificieuse » (p. 65), aussi bien artistique qu’artificielle. Jean-Yves Tilliette rappelle que le vers au Moyen Âge ne respecte pas les catégories modernes issues notamment de de l’Esthétique de Hegel et que, en fin de compte, il faut reconnaître « le caractère divers et ondoyant de la poésie médiolatine » (p. 67). L’étude s’intéresse tout d’abord à la versification : si les lettrés médiévaux ne perçoivent plus « ce qui soutient la musique du vers antique », ils continuent tout de même à « composer de la poésie métrique » (p. 68) avec Virgile, Lucain, Horace, Ovide ou encore Juvénal comme modèles. Jean-Yves Tilliette note aussi que « la poésie […] témoigne d’[une] récupération sélective des valeurs culturelles de l’Antiquité » au service de la foi (p. 69). Ce lien avec la poésie antique latine s’est perpétué grâce à « l’inertie de l’institution scolaire » (p. 69), qui a stabilisé les corpus d’études dans lesquels les poètes prédominaient, et, pour beaucoup, grâce à la pratique de l’imitation. La versification métrique cède le pas à une versification rythmique4, signe que la poésie médiévale n’a pas « déserté le domaine de la voix » (p. 77). La pratique de l’imitation ouvre la voie aux « jeux de l’intertextualité » (p. 77) que Jean-Yves Tilliette détaille en rappelant que la pratique de l’imitation littéraire ne cherche pas l’originalité comme « notre époque postromantique tend à [la] valoriser » (p. 79). Sont traités dans l’ordre la reprise de citations littéraires sans nom d’auteurs, le pastiche, la parodie, la réécriture et la transposition. Le cas de la Poetria nova de Geoffroy de Vinsauf est l’occasion d’évoquer « le tournant poétique de la première moitié du xiie siècle » (p. 83) à partir duquel la poésie expérimente de nouvelles formes d’écritures. On assiste ainsi à « l’éclosion d’une conscience poétique, et d’un amour de la littérature pour elle-même » (p. 94) au-delà de la question de l’utilitas propre à chaque œuvre.
« Se hisser sur les épaules des géants antiques » (p. 19)
10La seconde partie de l’ouvrage, « Dialogues avec l’Antiquité », comprend six contributions dont le point commun est d’envisager le jocus (jeu) comme un équivalent possible de la notion moderne de « littérature », à partir des « relations qu’entretiennent les œuvres médiolatines avec leurs modèles antiques » (p. 17). Elle aborde respectivement des récits de cauchemars d’auteurs des xe et xie siècles, de la statuaire antique chez les mêmes auteurs, des élégies romaines d’Hildebert de Lavardin, de la comédie, de l’Alexandréide de Gautier de Châtillon et du commentaire aux Fastes d’Arnoul d’Orléans.
11La première contribution explore le problème de la difficile conciliation entre la littérature chrétienne et les lettres et sciences païennes. Peut-on être à la fois « ovidien et chrétien » (p. 119) sans mettre en péril la foi ?
12La seconde contribution traite chez les mêmes auteurs du sort de l’art antique de la statutaire. Considéré par Tertullien comme « le pire péché du genre humain, le plus grave crime du monde » (p. 133), cet art rencontre une « attitude généralisée de prévention hostile » (p. 136). Mais la période 1050-1200 marque une « certaine évolution des attitudes morales et esthétiques des hommes du Moyen Âge vis-à-vis de la sculpture » (p. 137) à lire en rapport avec la naissance et le développement d’une culture profane dans tous les domaines. À partir du cas de Foulcoie de Beauvais, auteur d’une lettre en vers portant sur la découverte d’une tête sculptée à Meaux, Jean-Yves Tilliette note que « pour la première fois depuis de longs siècles, la beauté d’un objet sculpté est reconnue et appréciée indépendamment des valeurs qu’il incarne » (p. 142).
13La troisième contribution, centrée sur les poèmes Par tibi, Roma, nihil (c. 36) et de De Roma (c. 38) d’Hildebert de Lavardin, revient sur les grandes lignes des nombreux commentaires et interprétations donnés au couple que forment ces deux élégies romaines. L’étude montre que c’est en fait l’Incarnation qui est au cœur des élégies sur Rome de l’évêque du Mans.
14La quatrième contribution explore le problème du genre littéraire au Moyen Âge, en l’absence de poétiques, et notamment du genre comique. Jean-Yves Tilliette pose que les pièces de Vital de Blois relèvent bien de la comédie car l’auteur en a compris l’essence et la fonction.
15La cinquième contribution, portant sur l’Alexandréide de Gautier de Châtillon, étudie sa filiation avec l’Énéide de Virgile, « horizon d’attente de tout poète épique médiolatin » (p. 184). Au-delà des deux lectures traditionnelles de l’Alexandréide, historico-politique et rhétorico-philologique, Jean-Yves Tilliette propose une lecture littéraire du texte, qui permet de mettre en lumière une revisite de l’image d’Alexandre par l’intertexte de la Pharsale de Lucain. Incapable de déchiffrer les signes, « moins bon clerc que bon chevalier » (p. 189), Alexandre est celui qui n’a pas la capacité d’accéder au sensus.
16La dernière contribution de cette partie est consacrée au commentaire des Fastes d’Arnoul d’Orléans et s’ouvre sur le succès d’Ovide au Moyen Âge et son aetas5. Le commentaire d’Arnoul d’Orléans constitue le « premier grand commentaire des Fastes » (p. 200) conçu vers les années 1170. L’analyse du commentaire est menée à travers la question de l’utilitas « pour l’étudiant du xiie siècle » (p. 200) et dévoile l’intérêt du grammaticus pour les realia de la civilisation antique et son souci de les interpréter. L’exemple d’Arnoul d’Orléans, à l’instar des précédentes contributions de la partie, témoigne donc bien de dialogues entre la littérature médiolatine et l’Antiquité.
Langue mère et langues filles : des littératures en dialogue
17La troisième et dernière partie de l’ouvrage, « Dialogues avec la littérature en vernaculaire », interroge les interactions entre la littérature médiolatine et les littératures en vernaculaire. Son organisation n’est pas due au hasard : la première contribution, inédite, introduit le propos. Pour Jean-Yves Tilliette, les propriétés de la littérature latine du Moyen Âge ne se laissent bien définir qu’en relation avec celles des littératures en langues vulgaires. Pour lui, la littérature médiolatine est une « littérature palimpseste » du fait de sa langue, capable de « transmett[re] la mémoire longue litteris » (p. 217). La littérature médiolatine se distingue ainsi par « son aptitude à se prêter à une lecture de type herméneutique, et sa volonté de le faire » (p. 232). Elle se refuse à une lecture « au premier degré » (p. 233) et déjoue par là les critiques qui ont pu lui être adressées par sa capacité à user d’artifices littéraires et linguistiques.
18La seconde contribution pose la question suivante : « existe-il une poésie courtoise en latin ? ». Le concept de « courtoisie6 », forgé par Gaston Paris7 à propos du couple de Lancelot et Guenièvre chez Chrétien de Troyes, est mis à l’épreuve. Après avoir envisagé la courtoisie d’un point de vue historique, thématique et esthétique, Jean-Yves Tilliette conclut par la négative, en déclarant que « Gaston Paris avait bien raison d’inventer un syntagme inédit pour désigner cette nouveauté » (p. 255).
19La troisième contribution examine la dialectique entre amour et vision dans le Tractatus amoris d’André le Chapelain. La célèbre citation « amor est passio quaedam innata ex visione procedens8 » du traité rend compte du rôle de l’œil et du regard dans l’acte d’innamoramento. Le passage en revue des différents discours portant sur le Tractatus amoris montre que l’ouvrage a trop souvent été « tenu pour ce qu’il prétendait être, à savoir un ars […] » (p. 258). Jean-Yves Tilliette déclare sans ambages qu’« il n’y a pas dans le Tractatus amoris de théorie de la vision amoureuse » (p. 269) : il suit la position de Peter Dronke9 qui défend fermement une lecture parodique du Tractatus.
20La quatrième contribution traite de la poésie animalière. L’Ysengrimus, source des textes renardiens, donne la parole aux animaux, d’où la nécessité de s’interroger sur le sens de ce logos. Entre une lecture satirique et une lecture politique, dans le contexte lutte intestine dans la Flandre religieuse du milieu du xiie siècle, Jean-Yves Tilliette choisit quant à lui de se fonder sur le texte seul, en tirant parti du jeu10 qu’offrent ces deux lectures. La question de la peau du loup, sans cesse arrachée, est une occasion de « mettre à nu les artifices de la langue dans ses usages les plus solennels » (p. 286).
21La cinquième contribution déplace la problématique de la parole vers le silence. Il s’agit d’étudier le rôle de ce dernier dans des contes latins du xiie siècle. Le silence serait paradoxalement un moteur du récit et « conditionne l’avènement d’une parole de vérité » (p. 288). L’étude est menée à partir de l’Histoire de Mériadoc, du De nugis curialium et du Dolopathos.
22Enfin, la dernière contribution, en écho à celle qui portait sur les Fastes, explore les aspects de la réception de la poésie ovidienne dans la littérature française autour des années 1300, dépassant ainsi les bornes chronologiques posées par Ludwig Traube11 à propos de l’aetas ovidiana. Jean-Yves Tilliette cherche à comprendre, à travers les dynamiques d’usage des textes médiévaux, ce qu’est à la fois un auctor et ce qu’est l’autorité dans la période qu’il étudie.
23La leçon d’adieu sur le chant des oiseaux est la conclusion de l’ouvrage. Au Moyen Âge, les oiseaux parlent en latin, aussi bien en langue d’oc qu’en langue d’oïl. C’est que le latin dispose d’un vocabulaire apte à épouser les modulations de la voix contrairement à l’ancien français. Le chant des oiseaux dit, selon Jean-Yves Tilliette, « quelque chose de la vérité de la poésie médiévale » (p. 327).
*
24La Littérature latine du Moyen Âge intéressera autant les médiolatinistes que les médiévistes spécialistes des littératures vernaculaires. Le dialogue qu’il opère entre les deux faces du Moyen Âge littéraire, trop souvent dissociées dans les études universitaires, permet de (re)découvrir avec joie les dynamiques littéraires entre langue latine et langues vernaculaires. Mais ce qui frappe le plus à la lecture de l’ouvrage, c’est le souci d’expliquer et la prudence dans les analyses et les conclusions tirées. Les essais sont jalonnés de questions, de thèses et d’hypothèses qui organisent le discours et le rendent très compréhensible, même lorsque les corpus convoqués ne sont pas les plus connus. On notera d’ailleurs le souci didactique du chercheur, qui met à la disposition du lecteur une traduction des textes latins dans la plupart des cas et ce, afin d’en rendre accessible le contenu. Enfin, on ne peut que souligner l’intérêt d’une telle publication qui compile en un recueil la pensée et le projet de toute une carrière. L’ouvrage démontre avec brio que les écrits latins du Moyen Âge méritent qu’on les qualifie de littéraires.

