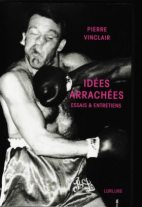
Arrachements
1Les Idées arrachées se présentent comme l’explicitation « à l’arrachée » des conditions (au sens badiousien) d’écriture du second cycle poétique de Pierre Vinclair, qu’il décrit lui-même comme mouvement d’une réorientation « vers la question du poème, en cherchant dans l’adresse d’une part, et le travail de la forme d’autre part, les ressorts d’une écriture à la fois sauvage et intéressante » (« Note d’intention », p. 9)1.
2Ces quatre pôles (adresse, forme, sauvagerie, intérêt), nous le verrons, constituent quatre concepts recteurs de la construction théorico-poétique de Pierre Vinclair. Il n’en reste pas moins qu’ils prolongent à certains égards les investigations du premier cycle : ce qui s’y concevait comme « formulation d’une philosophie du genre littéraire comme effort plutôt que comme collection de propriétés reproductibles » ainsi que comme « réflexion sur le modus operandi d’une littérature politique » (ibid.) semble pouvoir conduire naturellement à une interrogation sur l’adresse et l’intérêt, tandis que « la contribution épique à la lutte contre le saccage des écosystèmes » (ibid.) se redit logiquement comme méditation sur la sauvagerie et la forme.
3La traversée des sept chapitres de ce livre dense et débordant (« Gestes du poème », « Politique de la prose ? », « L’œuvre en question », « Philosophie des genres », « Face à la catastrophe », « Échafauder Babel », « Portrait du critique en arracheur de dents ») nous donnera l’occasion de tenter de reconstituer sous une modalité systématique l’une des propositions pensive et poétique les plus stimulantes du champ contemporain.
4Nous réduirons l’ensemble des développements de l’ouvrage à quatre thèses, inséparables de quatre gestes, qu’on peut être tenté, au prix sans doute d’un léger déplacement, de rapporter aux quatre pôles que nous identifions : 1. requalifier les formes comme des efforts (c’est la forme) ; 2. penser l’intention comme une adresse (c’est l’adresse) ; 3. considérer l’écriture comme une « forme de vie » (c’est la sauvagerie) ; 4. saisir le poème comme un drame (c’est l’intérêt). Nous verrons toutefois au fil de ce bref parcours que ces dimensions sont en réalité indémêlables et s’enveloppent selon la loi d’une tresse qui rapporte (par exemple) l’adresse à l’intérêt et la forme à la sauvagerie.
5L’ensemble de ces gestes peut à son tour se comprendre comme la tentative de reconduire le poème à sa « vie », selon l’impératif suggéré par le titre de la Vie du poème (2021) : à savoir que le poème soit essentiellement biographème au sens fort, c’est-à-dire tout à la fois écriture de la vie et vie d’écriture. D’où la révocation d’un certain nombre de « fétiches » qui appartiennent, selon Pierre Vinclair, à une tradition théorique structuraliste qui s’avère commandée en son fonds par un essentialisme inaperçu (p. 21) : « je ne crois pas avoir rencontré le “Langage”, les “Signes”, “l’angoisse du signifiant” dans la composition du drame qu’est un poème ». Pierre Vinclair oppose ainsi à la lecture de Roussel par Foucault, le constituant comme « l’inventeur d’un langage qui ne dit que soi, d’un langage absolument simple dans son être redoublé, d’un langage du langage, enfermant son propre soleil dans sa défaillance souveraine et centrale » (Raymond Roussel, p. 210), sa propre expérience herméneutique :
Quand je relis les Nouvelles Impressions d’Afrique, ce qui me frappe et m’émeut, c’est plutôt l’espèce de sensualité froide qui se dégage de cette danse que le poète offre au lecteur : de grands gestes, qu’on découvre baignés d’ironie ; des cabrioles, à la technicité généreuse ; des clins d’œil complices au fond du labyrinthe. (p. 21)
6Commentant le vers « Lire souvent égale être leurré », Pierre Vinclair suggère alors de s’intéresser aux italiques (p. 23) « par lesquelles Roussel semble suggérer (entre lire et leurre) un rapport étymologique fantasque […] mais néanmoins intéressant » car, il ne relève plus désormais « du vrai ni du faux ». Et Pierre Vinclair de conclure : « Voilà le drame du poème, ici, son action impertinente, son opération facétieuse ».
71. Une telle opération peut dès lors se penser comme effort : la théorie de l’effort, chez Pierre Vinclair, vise à déborder l’ordinaire de la catégorisation générique pour proposer une « énergétique » des textes (p. 239) : « au lieu d’arrêter la définition du genre à un relevé de propriétés phénotypiques […], on rapporte ces propriétés à l’effort “génotypique”, au programme profond que le texte essaie d’accomplir ». La note 84 de la page 226 précise à cet égard ce qu’il faut saisir sous cette notion :
par effort je n’entends ni la tentative, ni le projet de l’écrivain, mais l’acte, l’energeia de l’ergon, c’est-à-dire l’effet permis par la structure du dispositif, ou son effet optimal, tel que l’analyse de la structure du texte dans ses différentes dimensions — rhétorique, symbolique, idéologique — permet de le reconstituer.
8Cette proposition se fonde notamment sur une relecture de la tradition philosophique qui s’attache au concept de mimèsis : il s’agit alors pour Pierre Vinclair d’engager un « retour à Platon », qui se distraie de la vulgate fondée sur le livre X de la République où se prononce l’éviction du poète, pour interroger le Gorgias (p. 259) : la technè s’y distingue de l’empeira, en ce que la seconde « s’aveugle et s’épuise dans la satisfaction d’un but », tandis que la première « vise à rapprocher son récepteur du Bien » en s’appuyant « pour ce faire sur la connaissance des éléments qu’[elle] mobilise ». D’où la conclusion de Pierre Vinclair (ibid.) : « La littérature n’est pas un art, mais une empeira », c’est-à-dire une pratique efforcée vers un « but » en vertu de quoi, pour ainsi dire, tous les moyens — c’est-à-dire toutes les formes et manières, indépendamment de leur occurrence historique et générique — sont bons. Ce qui peut d’ailleurs supposer le recours à l’autre langue, et impliquer, ici ou là, l’exercice de la traduction : « …le poème faisant feu de tout bois » peut, « lorsque son effort le requiert, avoir recours à telle ou telle langue étrangère » (p. 217).
9Le poète est donc essentiellement bricoleur (p. 333) : « il a dans son garage certains instruments et des objets qu’on ne considérait pas jusque-là comme des outils, mais qu’il peut mobiliser s’il en a besoin ». Pierre Vinclair ajoute alors une précision importante, qui semble répondre d’avance à quelque objection : « parfois, [le poète] fabrique un outil : mais ce n’est pas pour opérer dans le monde du bricolage une révolution qui laisserait son voisin du côté des Anciens ». L’essentiel est donc de révoquer la croyance scolaire « que la poésie était formée d’une succession de courants séparés par des révolutions », conception « aussi absurde que si on définissait le bricolage par une succession dialectique et non réversible d’outils » (p. 332).
10L’alternative ainsi posée par Pierre Vinclair (entre successivité diachronique et uchronie instrumentale) mérite toutefois discussion. On peut bien considérer l’écriture comme un bricolage formel affranchi d’une stricte détermination historique, cela n’empêche pas de reconnaître que certains dispositifs « bricolés » instituent une irréversibilité instrumentale : non pas d’ailleurs en cela qu’ils acteraient la péremption de telle ou telle forme ancienne, mais bien plutôt car leur singularité s’impose elle-même comme non reproductible, sinon sous les aspects d’une imitation servile. C’est ainsi que l’originalité rimbaldienne peut en effet se concevoir comme un « bricolage » à partir d’un héritage baudelairien et symboliste, d’une matière « populaire », d’une prose vernaculaire, etc., mais il faut ajouter qu’elle finit par rendre méconnaissable les éléments formels hérités dont elle se compose voire, si l’on veut bien aller jusqu’à prendre en compte Une Saison en enfer, à en excéder l’horizon de prévisibilité : et ce n’est pas dès, lors, que la forme prosimétrique choisie dans la Saison ait « périmé » le poème en vers (par exemple), c’est qu’il apparaît désormais impossible de la reproduire en tant que telle. Pour le dire autrement, et rejoindre Pierre Vinclair à cet égard, le prosimètre de la Saison rejoint la réserve instrumentale des outils poétiques attestés par la tradition, et ne peut être repris que sous condition d’un nouveau bricolage singulier2.
112. Mais contrairement au bricoleur de Lévi-Strauss, dont « l’ensemble des moyens » n’est pas « définissable par un projet » mais se définit seulement « par son instrumentalité », le poète, comme l’ingénieur, subordonne ses tâches « à l’obtention de matières premières et d’outils, conçus et procurés à la mesure de son projet » (voir la p. 338 pour la référence à La Pensée sauvage). Or, le projet du poème, Pierre Vinclair le formule très nettement dans Vie du Poème : « Dire ce qui compte à ceux qui comptent ».
122.1. On y lit, premièrement, l’impératif de l’adresse (« à ceux qui comptent », p. 206) : ne plus faire de « la littérature » en parlant « à l’histoire des siècles », mais essayer de « comprendre ce qui nous arrive, de célébrer ce qui compte ou d’écrire à ses filles ». On ne cherchera donc pas à « faire une œuvre » destinée au « lecteur inconnu » (p. 194), mais à écrire « aux gens à qui » on a « quelque chose à dire » : enfants, amis, collègues, sous l’impératif d’une circonstance, d’un « moment important » (« lire un poème à un enterrement » ou à un pot de départ, ibid.). D’où l’adieu au roman, si on le comprend du moins selon l’institution méta-historique de son genre :
c’est à ce moment-là [2016] que j’ai commencé à trouver absurde de dépenser autant d’énergie […] à écrire une “œuvre” qui tombe dans un vide presque absolu, et que j’ai commencé à imaginer ce que pourrait être une écriture uniquement adressée à des gens. (p. 195)
13Il n’y a cependant, selon Pierre Vinclair, pas d’adresse sans captatio, c’est-à-dire sans ce qu’il désigne comme l’intérêt du poème, au sens du génitif objectif du poème intéressant. Il s’agit donc de refuser de se livrer « à une danse autistique censée valoir en soi » (p. 208) :
Même si l’écriture du poème répond souvent à la nécessité d’exprimer une idée ou une émotion, celle-ci doit encore être mise en scène. […] Aussi, ce n’est pas le lecteur qui doit interpréter le poème […], c’est au contraire le poème qui doit interpréter l’idée pour le lecteur — et c’est cela son spectacle.
14L’intérêt du poème enveloppe donc moins un génitif objectif (que le poème, dans son objectalité, puisse « attirer l’intérêt » d’un sujet) que subjectif : que le poème, donc, soit « sujet » de son propre intérêt, c’est-à-dire opérateur « machinal » ou vivant de sa propre opération. Ce que Pierre Vinclair explicite ainsi :
Le poème intéressant est une activité se présentant comme une chose : machine, ou organisme. Il a donc une forme qui est non seulement son apparence et un appui rhétorique (pour un lecteur), mais aussi le gage de son unité réelle de fonctionnement. Certaines formes sont reconnues classiques (sonnets, dizains, villanelles, rondeaux, ballades, etc.), d’autres d’invention plus récente (calligrammes, poèmes justifiés, poèmes-carrés, etc.)3.
15Où l’on retrouve le principe du bricolage formel, dont on comprend qu’il se subordonne en dernière instance au fonctionnement opératoire du poème : le dispositif bricolé n’a de légitimité, en ce sens, qu’à condition qu’il fonctionne. Nous verrons toutefois que cette opérativité fonctionnelle du poème se pensera elle-même plus volontiers du côté de l’organicité sauvage que de la mécanicité.
162.2. On y lit, deuxièmement, l’impératif de la circonstance (« ce qui compte »), par quoi se nouent les deux dimensions du motif de la sauvagerie, si la sauvagerie s’entend tout à la fois « comme un art poétique ne relevant pas de la “littérature” », et dès lors non domestiqué par telle ou telle tradition constituée, et comme enjeu réel de la « vie condamnée des êtres sauvages » (p. 211) : l’urgence d’écrire répond donc « au compte à rebours de la catastrophe, dont nous avons pris conscience très tard, contre laquelle il n’est plus de temps à perdre, et dont chaque délai rend la violence plus difficile à combattre » (p. 332).
17L’élection de « ce qui compte » dépendra toutefois d’une évaluation, dont le geste n’est pas thématisé comme tel dans la réflexion de Pierre Vinclair, sinon sous la forme d’une réversion « problématique » de la formule livrée dans un entretien accordé à Camille Sova :
Pour ma part, j’ai trouvé que ce projet s’incarnait dans cette formule « dire ce qui compte à ceux qui comptent », dont il faut bien voir que tous les termes sont en fait des questions (qu’est-ce que « dire » ? comment « dire » ? qu’est-ce qu’une parole pleine ? qu’est-ce qui compte ? l’eau, la nourriture, la santé, la paix, la richesse, l’amour, la poésie, la Terre ? ce qui compte précède-t-il le fait de le dire, ou dire doit-il révéler ce qui compte ? et qui sont ceux qui comptent ? ceux qui nous aiment, ceux qu’on aime ? ou tous les êtres humains, tous les vivants4 ?)
18On y reconnaîtra le motif nietzschéen de la valeur5, conçue comme conséquence d’une évaluation (Ainsi parlait Zarathoustra : « L’homme seulement mit dans les choses des valeurs, afin de se conserver — lui seulement créa pour les choses un sens, un sens humain ! Pour quoi il s’appelle “homme”, c’est-à-dire l’évalueur. // Évaluer, c’est créer : oyez, ô vous les créateurs6 ! »). Pierre Vinclair, on vient de le lire, en reprend la doublure en posant d’une part la question de la valeur (« qu’est-ce qui compte ? »), et d’autre part, celle de l’évaluation (« dire doit-il révéler ce qui compte ? »), dont l’articulation problématique a été élucidée par Deleuze lecteur de Nietzsche (Nietzsche et la philosophie) :
D’une part, les valeurs apparaissent ou se donnent comme des principes : une évaluation suppose des valeurs à partir desquelles elle apprécie les phénomènes. Mais, d’autre part et plus profondément, ce sont les valeurs qui supposent des évaluations, des « points de vue d’appréciation », dont dérive leur valeur elle-même. Le problème critique est : la valeur des valeurs, l’évaluation dont procède leur valeur, donc le problème de leur création7.
19Or si le poème peut avoir affaire avec « ce qui compte », ce doit être en effet en tant qu’il affronte la question de « la valeur des valeurs », c’est-à-dire en tant qu’il se constitue comme une création de valeur : ni seulement déclaration (c’est-à-dire discours « sur » la valeur), ni quantification (c’est-à-dire, et quelles qu’en soient les modalités, « calcul » de la valeur). De cette « formativité » de la valeur, Philippe Beck donne un excellent exemple en citant Hérodote, via Hegel :
Hegel reprend l’exemple fourni par Hérodote, i. e. l’inscription « Passant ! va dire à Sparte que nous sommes tous morts ici pour obéir à ses lois ! », qui célèbre l’héroïque sacrifice des Lacédémoniens à la bataille des Thermopyles, où l’armée perse de Xerxès a vaincu l’armée grecque, en 480 avant notre ère : « l’expression » d’un « contenu simple et sobre » devient poétique, « c’est-à-dire qu’elle veut se montrer comme poïein [opération] qui laisse » ce contenu « dans sa simplicité, mais donne intentionnellement une certaine forme à l’énonciation. La parole qui embrasse les représentations est à soi-même d’une telle dignité qu’elle cherche à se différencier de toute autre espèce de discours et se transforme en distique8. »
20Ce que Beck commente ainsi (ibid.) : « Le fait de se communiquer est tout de suite égal au fait de se livrer à l’opération poétique ou, pour le dire autrement : la première politique de la connaissance exige un “recueillement stylisé”, une réflexion rythmée ». La question est donc celle de l’intérêt formel du poème, c’est-à-dire de sa capacité formelle à « capter » formellement un corps lecteur9 : d’où la nécessité d’un nouage entre les deux premiers pôles (la forme, l’adresse) que nous évoquions.
212.3. On y lira, troisièmement, l’injonction du collectif, qui peut s’accomplir par la revue (p. 201 : « on a besoin de l’aide de ses camarades, à qui on fait lire des textes (voire à qui on adresse ses textes), demande des critiques, etc. Il y a donc des constellations, des nébuleuses d’auteurs, et une revue comme Catastrophes sert de garage, en somme ») ou par le livre (La Sauvagerie, dont il est notamment question p. 372) : « collectif, le poème a alors une chance d’avoir moins pour enjeu l’expression de ce qui compte pour l’un, que la mise en rapport avec ce qui vaut pour tous ».
22De la question du travail collectif, notamment élaborée dans Agir non agir (2020), retenons ici qu’elle engage un triple enjeu : premièrement, celui de la « déposition » d’une certaine souveraineté auctoriale, qui s’attache elle-même, quelles que soient les déclarations d’impersonnalité, à un certain essentialisme littéraire ; deuxièmement, celui d’une efficience pragmatique, à supposer du moins que l’engagement collectif démultiplie mécaniquement la force d’un travail, fût-il poétique ; troisièmement — et c’est sans doute le principal — celui du passage de « ce qui compte pour l’un » à « ce qui vaut pour tous », c’est-à-dire du particulier à l’universel de la valeur.
233. La loi de l’adresse suppose alors de considérer l’écriture comme une forme de vie, qui s’ajuste au double horizon d’une destination (nous venons de le voir) et d’une circonstance, comme le marquera d’ailleurs nettement le titre Vie du poème (p. 193). « Écrire n’est pas séparé de la vie, c’est une manière de vivre » : ce qui suppose, réciproquement, que l’écriture manière la vie, c’est-à-dire donne une forme singulière à l’existence dans laquelle elle s’inscrit.
24Il y a donc une « originarité » du poème en sa parole : non pas au sens métaphysique, mais au sens plus restrictivement pragmatique d’une performativité immanente à la vie (p. 201) : « Imaginez que vous êtes Dieu et que vous parlez pour la première fois. Voilà, c’est ça, pour moi, un poème. Vous faites advenir du sens, et un sens inédit, inouï, sur le chaos de la vie. » Ce qui se dit encore ainsi, un peu plus loin (p. 215) : « …le poème est l’héritier d’une très ancienne promesse — celle de la capacité performative de la langue et du pouvoir des formes à transformer la réalité », qui rapproche « les premiers vers de La Genèse de l’œuvre Ghérasim Luca, et les cantiques de Racine des visions des chamanes ».
25Par ces déclarations, Pierre Vinclair paraît s’inscrire dans la tradition récente ouverte par les propositions d’Henri Meschonnic, lui-même lecteur de Wittgenstein : à savoir que le poème puisse se concevoir comme la transformation d’une forme de vie par une forme de langage (Célébration de la poésie, p. 41-42) : « il me semble que la pensée poétique advient, imprévisiblement, quand et seulement quand une forme de vie transforme une forme de langage et quand une forme de langage transforme une forme de vie, les deux inséparablement ». L’originalité de la réflexion de Vinclair semble tenir à cet égard dans sa manière de requalifier l’une et l’autre forme comme sauvages, comme on le lit dans l’entretien que nous citions :
Il me semble que si la poésie peut faire quoi que ce soit dans l’écocide en cours, c’est d’une part figurer, par ses ressources expressives, les êtres qui disparaissent dans l’indifférence ; et ce faisant, vivifier, contre la langue et la rationalité techniciennes du capitalisme prédateur, le caractère sauvage de notre rapport linguistique au monde, donc notre proximité à ces êtres. Le poème est alors la preuve que les êtres sauvages sont nos frères : il fait venir l’animal dans la langue. Il se comporte comme un être vivant autonome, avec son propre mode de développement et de reproduction. Vie du poème essaie d’en produire la biographie10.
26Sauvagerie, premièrement, des « êtres sauvages » ; sauvagerie, deuxièmement, du poème lui-même, « être vivant autonome » ; sauvagerie, troisièmement, « de notre rapport linguistique au monde ». N’est-ce pas là précisément le lieu de nouage que nous appelions de nos vœux, entre la forme même du poème et l’horizon de son « intéressement » adressé-adressant au monde ? La forme de langage (poétique) se dit alors comme une forme de vie (sauvage), dans ce qui apparaît aussi comme un dépassement de la métaphore du bricolage, au nom d’une certaine « pensée magique », si « le poème se trouve justement être ce qui nous reste du langage chamanique » (p. 373) : « La pensée magique, c’est d’abord le refus de la justification purement instrumentale de la présence d’une chose ou d’un être » (p. 339).
274. Le poème apparaît alors en dernière instance comme un drame factitif :
284.1. Un drame, car il excède la règle de la représentation pour « acter » la question qu’il soulève, ou, plus exactement, qu’il incarne (p. 215) :
L’engagement ne consiste donc pas simplement à dire « je suis contre la déforestation » : tout le poème est tendu par un effort pour faire. Quand, dans la deuxième partie [de la Sauvagerie], j’essaie de faire de chaque dizain un refuge pour protéger telle ou telle espèce menacée, un poème se met, pour accueillir le manakin du Brésil, à parler portugais, et essaie de leurrer les touristes en dissimulant l’oiseau derrière des mots d’argot.
29Dès lors, à qui se pose encore la question du nouage entre la forme et l’adresse, nous dirons que c’est le drame qui l’accomplit : le drame, comme forme sauvage, constitue l’assomption organique et « vivante » (c’est-à-dire aussi bien, comme le montre Pierre Vinclair en analysant sa réécriture de « L’Albatros », p. 330) de la question qui fait la nécessité du poème ou du livre.
304.2. Mais un drame factitif, car sa « praxéonomie » (p. 244, « étude de la manière dont les genres pensent la praxis »), dit Pierre Vinclair, « a une dimension pragmatique : le texte fait, et faire faire quelque chose à son lecteur » : c’est là, au-delà même du performatif (c’est-à-dire de l’horizon du faire), l’enjeu de ce que Marielle Macé désigne comme le factitif. Le poème, donc, ne se contente pas de dire, il fait (i.e. il dramatise) ; et il ne se contente pas de faire, il fait faire (i.e. il intéresse).
31D’où (par exemple) la subversion « pornographique » de « L’Albatros » baudelairien, qui se fonde sur la métaphore sexuelle — en argot américain — de la position homonyme pour dramatiser l’enjeu écologique du « massacre d’une espèce » (p. 330) : l’inscription en anglais de la définition de ladite posture (« the female proceeds to receive / anal, while jacking off sb with both hands »), elle-même toutefois soumise à l’interruption du vers, et plus largement, à la formalité du dizain, apparaît comme l’incision formelle supposée susciter l’intérêt : énigme, peut-être, et provocation qui sont l’une comme l’autre convocation sauvage d’un corps (poétique) à l’adresse, désespérée mais farouche, d’un autre corps soudain à son tour « acoré ». Dans la ponctualité de ce geste de « traduction » (voir notre note supra concernant Terrorisme et alchimie) se rejouent les quatre « faits » du poème comme poème : la forme (le bilinguisme) y est effort (suscitation d’un effet plutôt qu’exhibition d’une prouesse esthétique) ; l’intention y est d’adresse (au lecteur contemporain qui peut consulter tel Urban dictionary recensant les postures sexuelles) ; l’écriture s’y ensauvage de la double référence à l’animal et, par métaphore, à la sexualité ; le poème enfin, de toutes ces façons, s’y fait drame : du désir catastrophé d’un corps face à la langue.

