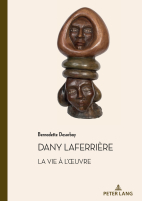
Une énigme géniale nommée Laferrière
1L’essai monumental publié par Bernadette Desorbay, que nous connaissions déjà, notamment pour L’Excédent de la formation romanesque. L’Emprise du Mot sur le Moi à l’exemple de Pierre Mertens (paru dans la collection « Europe » de cette même maison Peter Lang en 2008), se lit comme une quête du désir vitaliste nourrissant l’œuvre, de ce désir de vivre et de revivre, par l’œuvre, la vie — vécue ou rêvée — qui nourrit incessamment l’esthétique jubilatoire de D. Laferrière. Cette ambition emprunte des chemins différents, inédits, car en effet l’ouvrage ne pratique pas le jargon académique, laissant place au frémissement de l’écriture et à travers elle, à la voix même de l’écrivain haïtien, à ce qui sourd d’abord obscurément, et dont la formulation non explicite est parfois laissée au lecteur.
Identité(s)
2Lectrice subtile, B. Desorbay annonce la couleur de cette quête dans les trois épigraphes ouvrant l’essai, dont l’une invite à penser la filiation spirituelle avec Césaire — « Montréal au bout du petit matin » —, tandis que les deux autres, d’Henry Miller et Mongo Beti, ouvrent cette filiation aux eaux nourricières des affinités électives. Structuré en trois volets dont chacun explore une composante capitale de la poétique de D. Laferrière, l’ouvrage propose en premier lieu d’examiner la « Réversibilité du cours intergénérationnel. La question de la jouissance ». B. Desorbay y interroge, patiemment, avec de nombreux textes du corpus à l’appui, la question des origines, le difficile rapport au père, l’ombre du Maître. Partant de ce que le « Nom propre » induit, de ce qu’il recèle, l’autrice suit le cours d’une écriture qui conjure les démons de ce que l’on pourrait appeler, chez D. Laferrière, la rétrocession identitaire, tant est puissante chez le grand romancier haïtien‑québécois, l’inclination à la fabrique de sa propre source, par la mise à distance de l’assignation raciale et du préjugé — à commencer par la révocation de la lignée patriarcale au profit d’un hommage souverain à la lignée des femmes : « Aux hommes de ma lignée : […] Pardonnez‑moi de le dire ici : seules les femmes ont compté pour moi ». Cette « déhontologie » — « j’appelle dé‑hontologique la démarche qui porte Dany Laferrière à guérir les blessures par l’écriture », mot‑valise forgé par l’essayiste, sied à la désignation d’une démarche d’auto‑psychanalyse par laquelle l’exilé haïtien doit évacuer le sentiment de honte, ou du moins ce malaise existentiel qui le saisit lorsqu’il doute que son exil en soit vraiment un, et qu’il s’agirait plutôt, peut‑être, d’une fuite, pour échapper au meurtre qui l’attend en tant que journaliste opposant à la dictature : « Je pars, et eux, ils doivent rester ». À l’instar de Rimbaud qui dénigrait son « Mauvais sang », D. Laferrière compose la matière de sa poétique avec cette « transmission intergénérationnelle non désirée », en cultivant l’impertinence, l’humour qui l’aide à affronter cette « honte‑haine‑de‑soi ». Il faut le dire : B. Desorbay nous ouvre les feuillets d’une immense documentation, entrecroise d’innombrables références de lecture qui non seulement ont façonné les contours de l’esthétique de D. Laferrière, mais permettent également de l’apprécier au prisme de cette boulimie d’altérités, de Flaubert à de Certeau, de Faulkner à Miller et Bukowski, de Jacques Roumain à Cyrulnik, de Freud à Senghor. Des extraits d’interviews, des micro‑récits fictionnels parodient des chroniques réelles, tout un peuple d’écrivains, d’essayistes, de compères immigrés en rade, et au bout de la perspective, cette dotation revendiquée, impossible à occulter, du mot Nègre. Car l’essai est charpenté par une solide armature d’histoire politique et sociale, et B. Desorbay relit Laferrière à la lumière de la pensée postcoloniale mais aussi des études de « race ». Elle met en lumière une esthétique dense, qui nomme la difficulté, la rencontre souvent difficile avec l’autre, cet Autre narcissique — dont les codes culturels demeurent parfois hermétiques — « […] je n’ai pas de problèmes majeurs avec les Français, sauf quand ils parlent de leur culture. J’ai de la difficulté à comprendre qu’on puisse s’aimer à ce point. On est ici en présence d’un vrai cas clinique ». Dans l’espace‑temps de la migration, l’œuvre alors se nourrit de la rudesse de la vie, de ses accidents. Celui pour qui « la vie est devenue une fiction », et dont la consistance de l’écriture puise dans la « science du quotidien » mais aussi dans sa disgrâce, déploie une dramaturgie du vivre, d’île en continent, une dramaturgie qui, au fond, s’obstine à jouer la partition d’une rencontre interraciale désirante avec le monde. Au‑delà des spécularités, des mises en abyme du récit, B. Desorbay fait talentueusement ressortir le refoulé qui court sous les lignes et montre que le vertige de la titraille n’est qu’une prophylaxie aux pulsions de mort qui menacent toutes les histoires de ces républiques rebelles dont est issu le journaliste haïtien qui, à 23 ans, quitte son pays natal parce qu’il « refuse que sa vie soit "dictée" par le dictateur ». Aussi bien la violence du sexe — avec cette foi de Laferrière dans le « potentiel révolutionnaire du désir féminin » — que la question des origines participe de cette reconquête symbolique de l’espace de pouvoir, mais une reconquête qui est toujours sous‑tendue par le désir de l’Autre — premier ferment de la démarche comparatiste. Affûtant sa lecture aux outils de la psychanalyse, concluant cependant que « Laferrière n’a pas lu Freud », B. Desorbay parvient à nous donner une interprétation psychanalytique profonde des œuvres majeures — et même de celles qui sont moins connues — de l’écrivain haïtien, rompant avec les traditionnelles interprétations canoniques, souvent folkloriques ou simplement superficielles. Au détour des analyses, l’essai résonne avec une acuité particulière lorsqu’il souligne l’extraordinaire liberté de Laferrière, sa distanciation à l’égard des identités figées : « "Va‑t‑on passer notre vie à scander des slogans du genre : notre identité ne changera pas, nos valeurs ne bougeront pas, nos principes ne sont pas négociables. Tout ça nous définit. C’est notre culture. Mais en prenant un pareil chemin on risque de ne plus croiser l’art". Et l’auteur de conclure que "l’art n’arrive que si on met sa culture en danger" ».
Les mondes en jeu
3La Deuxième partie de l’essai se concentre sur une double problématique, subtilement articulée entre « Le Flottement du réel » et « La question de l’au‑delà ». Au gré de ces romans qui en disent long sur la manière dont Laferrière, « le sexe dans l’encrier », investit l’espace de vérité que lui ouvre la littérature, c’est le rapport aux morts qui est analysé, dans son intime intrication avec le monde surnaturel, les fantômes et le merveilleux, la magie… Le cliché de l’imago est mis à l’épreuve de la figure du zombi, ce mort inaccompli — figure qui n’est pas exclusivement haïtienne mais existe déjà, selon Laferrière, dans la Bible à travers l’épisode de Lazare, le ressuscité. B. Desorbay passe ces figures d’élucidation de la poétique de Laferrière au crible de la relation mère‑fils, distanciée mais très étroite, flottant sur toute la construction de l’œuvre. L’histoire de Haïti, des relations américano‑haïtiennes et de la presse est parcourue dans ses moindres détails, et cette prégnance de l’historique et du politique acte la dimension biographique, au sens le plus empirique, de l’œuvre du grand écrivain haïtien : une vie à l’œuvre, réellement, les passerelles suggérant l’impossible séparation des deux niveaux. Ce faisant, l’essai opère des digressions qui, loin de perturber le cours de l’analyse, en renforcent la pertinence, comme lorsque B. Desorbay rappelle le monde d’Alice au pays des merveilles en rendant visibles les analogies entre « les distorsions subies par l’être‑au‑monde haïtien » et le travail de la fable, avec les transgressions qui s’y jouent. Car au fond, Alice devenue reine dans le conte de Carroll traverse le ruisseau de la même manière que Vieux Os quitte l’île pour aller à Montréal et, en lisant l’essai dans les détails, le lecteur découvre une mine d’informations sur la nébuleuse d’écrivains, tutélaires, parodiques, distanciés ou adulés qui dynamisent l’aire haïtienne et en font un spectaculaire microcosme du monde — paradis tropical et enfer social, matrice convulsive et lieu de perdition, épicentre des récits magiques et de mythes originaires surgis sous le volcan des misères, des marasmes climatiques et politiques, simultanément en mort imminente et en perpétuelle gestation. C’est sans doute à cette variabilité constante que puise l’esthétique de Laferrière, permettant à l’autrice de pointer la puissance d’irruption de l’inconscient : l’écrivain doit sortir les lettres des mots de la machine à écrire, évacuer le refoulé — mais cela est aussi une question de style.
"J’écris comme je vis"
4C’est cette question précise que la dernière section de l’essai soulève — « Ma vérité se trouve d’abord dans le style » confie Laferrière dans J’écris comme je vis. Le saisissement de la langue, gauche et totalement étranger à tout réflexe de corporatisme francophone — ce qui résonne d’ailleurs particulièrement avec le titre de la collection dans laquelle s’insère l’essai, et entérine le caractère problématique de la dénomination… — est toutefois canonisé par l’accession à l’Académie française, qui astreint à quelque bienséance mais sans promettre — loin s’en faut — un quelconque alignement sur les ors du bel usage. Dany Laferrière, écrivain aux livres courts, « n’a jamais été dupe du Surmoi linguistique qui pèse sur tout Haïtien : "Dans ce pays, on tient la grammaire en haute estime. Un ministre peut perdre son poste à cause d’une faute de grammaire qui s’est glissée dans son discours" » (Le Cri des oiseaux fous). Cette épée de Damoclès est vite levée par l’insolence et la liberté de ton, lesquels puisent dans le corpus de philosophes des Lumières comme Diderot ou Montesquieu, dont l’œuvre, et plus exactement certains de ses fragments, sont sujets à caution, et en tout cas pris à partie dans le débat sur l’histoire de la Traite et des représentations du Noir. Alors, l’ironie, le pouvoir de la blague, l’humour prennent le dessus, autorisant que l’identité même subisse le contrecoup bienfaisant, affranchissant, de cette libération — Je suis un écrivain japonais. Cosignataire du Manifeste pour une littérature‑monde en français, D. Laferrière est foncièrement engagé dans la remise en question des stéréotypes figeant son territoire culturel d’origine :
Je la mène [la bataille] toujours contre moi‑même, c’est‑à‑dire contre ma propre culture. Je suis même en rupture avec la vision littéraire, esthétique de cette culture qui m’a fait. On conteste toujours sa propre culture.
5C’est de fait cette résilience interne, en quelque sorte, qui décentre le conflit traditionnel opposant la langue du colonisé et celle du colonisateur et, dès lors, révoque les postures de « nationalismes culturels ». Dans sa mise à distance de la névrose coloniale et son refus du culte du ressentiment, D. Laferrière casse les codes d’identification de l’écrivain noir hypersexué, autrement dit de sa catégorisation raciale, sexuelle et politique. B. Desorbay le met en perspective du contexte littéraire et politique, en le situant par rapport à Sony Labou Tansi, par exemple, et de sa fronde : « […] je ris de Sartre qui parla d’existentialisme dans un monde où la moitié des humains n’existent pas » ("Lettre à Françoise Ligier du 8 février 1978") ». Le sentiment de précarité, le rire qui fait voler en éclats le trop sérieux mythe sont autant de marqueurs d’une poétique profondément critique mais non moins inscrite dans un rapport de séduction avec la langue française, entre haine et désir. Entre « le style de Céline »— dont il n’adopte jamais les thèses — et « le ton de Gombrowicz », l’œuvre de cet « homme engageant » qu’est Dany Laferrière est décidément inspirée par l’irrévérence et l’audace. B. Desorbay reconstitue ainsi une constellation d’auteurs cosmopolites plurilingues autour de l’écrivain haïtien et l’affranchit d’une gravitation trop étroite. Le Chapitre médian de cette section finale, sur « Les Ténèbres », nous introduit au cœur des « ombres au tableau du XVIIIème » — à celles des Lumières. L’épée d’académicien, « qui symbolise le membre conducteur avec lequel il écrit », en éclatante réponse aux « velléités castratrices du Maître », est certes au service du tribal — et du tripal — mais elle fouaille aussi dans les champs des arts : la peinture d’Henri Matisse, « l’audacieuse chimère » du surréaliste haïtien Magloire Saint‑Aude, Baldwin et Faulkner comme écrivains du vertige de la Race, Sophocle et l’humour de Borges, et jusqu’à cette anabase en Afrique du nord, avec Saint‑Augustin — « fils de Monique, qui est sainte elle‑même » — et ses Confessions, dont D. Laferrière avouera qu’elles sont « un livre très important pour lui ». L’extraordinaire boulimie, l’empathie critique embrasse Laclos et l’art de l’emprise, Condorcet et ses atermoiements d’humaniste pourtant favorable à l’Abolition. Ne reste plus alors que l’appétit furieux de faire corps, avec soi‑même déjà, et à cet égard, B. Desorbay nous rappelle que ce sont des écrivains japonais, Tanizaki et Mishima, qui ont médité la « relation entre la pensée et la préoccupation sexuelle » et qu’à ce titre D. Laferrière est en dialogue avec eux, parce que l’alliance de l’érotisme, du grotesque et de l’absurde interpelle significativement l’auteur haïtien. Les perversions converties en stylisations réalistes, les mythologies à ébranler autour d’une « insularité commune », la beauté ramassée du haïku, porté en particulier par Bashō, mais aussi l’attrait jouissif du roman de D. H. Lawrence, L’Amant de Lady Chatterley, sont autant de contrées constitutives de cette sentimenthèque de D. Laferrière, où le Verbe, machine désirante, s’est fait chair afin de permettre à cet auteur haïtien titanesque « de faire de sa jouissance œuvre de culture ».
***
6Affermissant cet essai qui fera date et constitue une borne incontournable pour tout chercheur qui souhaite s’aventurer dans l’archipel Dany Laferrière, deux parmi les trois annexes adjointes viennent affiner l’élucidation de cette poétique si complexe : un Entretien réalisé par Bernadette Desorbay avec Dany Laferrière, et un débat d’écrivains haïtiens — extrait du « blogue de Thelison Orelien (18 décembre 2013) » — autour de l’élection à l’Académie française, annexe où B. Desorbay laisse la parole au cercle des poètes présents : une brochette constituée, entre autres, de Louis‑Philippe Dalembert, Kettly Mars, Rodney Saint‑Eloi, Yanick Lahens, Edwige Danticat, Gary Victor, James Noël, Thélyson Orélien lui‑même et tant d’autres, en hommage à cette poétique où l’émotion, le sens critique, l’autodérision nomment le chiffre d’une énigme géniale nommée Laferrière.

