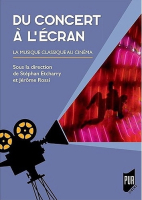
2019, odyssée d’un espace de réflexion : musique classique & cinéma
1Si le dialogue de la musique et du cinéma a déjà suscité l’intérêt de spécialistes d’horizons variés et donné lieu à de nombreuses publications, événements scientifiques ou grand public — parmi lesquels l’exposition mémorable « Musique et cinéma : le mariage du siècle ? » en 2013 à la Cité de la musique —, le présent ouvrage adopte une perspective résolument centrée sur la musique classique. Il ne s’agit là, à l’évidence, que d’une restriction de champ toute relative, le terme « musique classique » désignant comme on le sait une vaste nébuleuse dont les approches conceptuelles sont nombreuses et dont les directeurs de l’ouvrage s’attachent à cerner les contours dans leur très riche et dense introduction. L’acception privilégiée, délibérément englobante, est celle qui a été proposée par Michel Sineux de « concept plus flou, celui de “musique sérieuse occidentale” ou “grande musique”, comme on disait naguère, avant que les autres musiques ne gagnent leurs lettres de noblesse dans les panthéons de la culture1 ».
2Ce premier jalon transhistorique étant posé, Stéphan Etcharry et Jérôme Rossi soulignent d’emblée la persistance mais aussi le caractère éminemment modélisant du répertoire classique ainsi défini dans la musique de film. Ils évoquent ainsi, à l’aide d’exemples variés, ses fonctions de renforcement diégétique et d’ancrage historique, de citation et d’intertexte, d’effacement des bruits diégétiques pour y substituer des « univers émotionnels parallèles » (p. 30) tendant à la reconstruction d’un imaginaire individuel ou à la convocation des souvenirs et charges affectives intimes de celui que Michel Chion a désigné du nom éloquent d’« audio‑spectateur2 ». Le traitement spécifique dont Stanley Kubrick fait l’objet dans la dernière partie de cette introduction, y apparaissant tout autant comme outsider que comme fédérateur des différentes dimensions évoquées, ne surprendra ni le spécialiste ni l’habitué des salles obscures rompu aux modes de stimulation musicale aussi divers qu’inédits pratiqués tout au long de sa carrière par le cinéaste. L’une des caractéristiques majeures de son œuvre est en effet son entreprise systématique de revalorisation de la musique comme le montre Benjamin Lassauzet dans son article « 2001 : l’odyssée du spectre » (p. 373) où sont successivement mises en lumière la propension du cinéaste, dans le film concerné, à structurer son propos autour d’une « intensité sonore décroissante » (p. 373) ainsi que son aptitude à utiliser avec discernement le spectre harmonique en relation avec la thématique du Surhomme (p. 376). L’ouvrage pluridisciplinaire consacré, en 2012, à l’emploi de la musique dans les films de Kubrick3, avait déjà valu à celui‑ci, sous la plume de certains spécialistes, les étiquettes éloquentes de « cinéaste compositeur4 », de « poète musical et visuel avant tout5 », voire de « re‑compositeur6 » en raison de sa propension à jouer sans limites des virtualités des paysages sonores déployés entre étrangeté, inattendu, défamiliarisation et brouillages perceptifs. À tout seigneur tout honneur, c’est d’ailleurs à lui, pionnier et inspirateur, passé maître dans l’art multiforme de la citation musicale, que St. Etcharry et J. Rossi font un ultime retour au début de leur conclusion. Cette dernière, loin d’être une simple récapitulation, ouvre de riches perspectives autant musicologiques qu’interartistiques, postulant la nécessité de concevoir les différents contextes filmiques d’apparition d’une musique donnée comme « autant d’analyses de type structurel, narratif, voire émotionnel de cette musique » (p. 422). Ce postulat est d’autant plus intéressant et informé qu’il vient clôturer un ouvrage faisant référence aussi bien à des cinéastes dont le tropisme musical est célèbre, voire confine à l’obsession, qu’à des cinéastes, sans doute plus rares, chez lesquels l’irruption de la musique fait événement, tel Pialat, connu pour son « usage parcimonieux de la bande musicale » comme le souligne Grégoire Tosser dans son article « Vicissitudes cinématographiques du Cold Song de Purcell » (p. 107).
3En quinze chapitres regroupés en cinq parties d’une régularité métronomique — forme de rappel discret mais éloquent du rôle éminemment structurant de la musique attesté par les différents auteurs ? —, l’ouvrage se donne avant tout comme une série minutieusement orchestrée d’études de cas. Ces derniers constituent autant d’illustrations — parsemées de nombreux échos d’un chapitre à l’autre — de ces modalités d’intervention de la musique classique dans un film selon le principe de synergie énoncé il y a plusieurs décennies par Nicolas Ruwet à propos des relations entre la musique et le texte littéraire : « ensemble ils engendrent une totalité plus vaste, dont le sens est à son tour autre7 ». À cette formule déjà ancienne vient faire écho la notion de « processus créatif global » développée par Sergio Lasuén Hernandez en 2012 et rappelée ici par St. Etcharry et J. Rossi (p. 34), tout comme celle de « valeur ajoutée », définie par M. Chion au fil de ses ouvrages fondateurs8, revient régulièrement occuper, de manière plus ou moins explicite, le devant de la scène. La transmutation opérée par l’apport de la musique, qui se fait tout à la fois réactivation et engendrement de signifiés, est envisagée à travers un examen particulièrement attentif, au fil des chapitres, de la mise en résonance des différents éléments qui participent de l’énonciation filmique, ce qui requiert l’empan et l’acuité d’un regard interdisciplinaire. Autant de qualités que l’on trouve pleinement à l’œuvre ici, les auteurs — en majorité musicologues mais au nombre desquels figurent également un comparatiste, un historien de la culture et un spécialiste de cinéma — n’ayant aucun mal à franchir les frontières de leurs champs disciplinaires respectifs ainsi que, bien souvent, des genres cinématographiques et des périodes historiques évoquées.
4Au nombre de ces franchissements figurent les invitations aux voyages, d’un horizon filmique à un autre, d’œuvres musicales canonisées par la postérité, et parfois des instruments ou des lieux qui leur sont associés (tels que l’opéra dont les apparitions régulières au cinéma comme lieu emblématique sont autant de marqueurs culturels que de révélations de ce qui s’agite ou se trame dans les consciences des spectateurs, comme l’illustre Delphine Vincent). Autre exemple de ce voyage transgénérique, la Chevauchée des Walkyries s’inscrit dans le paysage cinématographique comme une « musique polymorphe » (Gérard Dastugue, p. 97) dont certaines reprises peuvent atténuer la fonction première de « galvanisation des passions » (p. 91) en se chargeant d’ambivalence, voire d’ironie dévastatrice. Ce trait est également relevé, en contrepoint, par Laurence Le Diagon‑Jacquin dans l’utilisation du Prélude de Lohengrin chez Chaplin où sa désacralisation est patente (p. 310), entre autres devenirs contrastés de ce qui a valeur, à l’instar de la Chevauchée, de « tube » wagnérien. La « position iconique référentielle » qu’occupe Cold Song aux yeux de Grégoire Tosser (p. 119) confère à l’air de Purcell un rôle de renfort ou de transition diégétique dans diverses fictions où se disent l’instabilité et la vulnérabilité, tandis que l’étrangeté de la voix de Klaus Nomi qui lui a servi de véhicule auprès du grand public se fraie un chemin dans les situations de bascule et de distorsion (l’exemple cité à cet effet étant The Wolf of Wall Street de Scorcese). Enfin, les itinéraires empruntés par la Toccata et fugue de Bach via l’orgue qui en est le support font immanquablement résonner, selon Laurent Olivier Marty, une forme de « défi de la démesure » (p. 283) installant de manière durable, dans l’imaginaire des spectateurs, la figure d’un Bach en majesté, à la fois révéré et redouté, divin et diabolique, comme l’attestent certaines études récentes qui font la part belle à ce que l’on peut percevoir comme la « noirceur » bachienne9.
5La toute‑puissance narrative et structurante de la rhétorique musicale s’affirme invariablement à travers son aptitude à creuser l’image, les personnages et paysages culturels et affectifs auxquels elle s’attache, se liant à eux de manière inextricable et conditionnant leur perception par l’« audio‑spectateur » au moyen d’un système de correspondances sensorielles et cognitives très riche. Si la musique « épouse le cheminement intérieur » des personnages (p. 182) en endossant un rôle métaphorique jusqu’à se faire, dans certains cas, mode d’articulation de l’épiphanie et du désir (p. 216) comme le démontrent Bertrand Porot et Lionel Pons dans leurs études respectives de Tous les matins du monde et de A Room with a View, elle peut également se charger d’une valeur d’adéquation à l’Histoire qui fluidifie les articulations diégétiques et renforce l’adhésion du spectateur ou, à l’inverse, instaurer un décalage qui se fait partie prenante d’un « projet artistique » (p. 144) spécifique, comme l’illustrent Thierry Grandemange et Isabelle Ragnard. Répétitive, elle s’associe volontiers à la folie et aux « dérèglements » de tous ordres, martelant à l’occasion la « perte des repères temporels » (p. 268) et générant un authentique « impact physique » (p. 244‑245) selon des processus décrits successivement par Jérôme Rossi et par Chloé Huvet, que l’on peut apparenter à la gamme des pouvoirs expressifs de l’ostinato évoqués par Laure Schnapper dans l’ouvrage qu’elle lui a consacré10.
6Le réseau de réminiscences sur lequel repose la construction du pouvoir de la musique trouve un moyen d’expression privilégié dans les rapports subtilement instaurés, dans le cadre de certains films, avec certains objets ou univers musicaux préexistants et inscrits de manière durable dans la mémoire du spectateur. C’est, chacun à sa manière, à l’univers de l’enfance et à ses résurgences que s’attachent St. Etcharry et Florian Guilloux. Le premier fait émerger du silence relatif de la critique la musique de Britten telle que Wes Anderson l’utilise dans Moonrise Kingdom, ressuscitant le lien privilégié que Britten a toujours affiché avec l’enfance, ses enchantements et ses vulnérabilités (de son adaptation opératique du Tour d’écrou au rôle éminent et poignant qu’il a donné au chœur d’enfants dans le War Requiem). Florian Guilloux, quant à lui, élucide la démarche de « renouvellement musical permanent » (p. 405) dont participent les réorchestrations et réagencements — réenchantements ? — de la partition originelle de Sleeping Beauty sous la baguette hollywoodienne de George Bruns. C’est la fonction de marquage identitaire et de passerelle entre deux univers emmêlant leurs racines qui est également mise à l’honneur, sous un jour différent, dans l’étude qu’Amal Guermazi propose de la fonction allégorique du personnage de Carmen dans les comédies musicales (p. 322) ainsi que, corrélativement, du rôle unificateur joué par le flamenco, pont jeté entre deux rives culturelles distinctes.
7Ce défilé d’études aux allures d’arrêts sur image et sur le son — ou le silence — qui lui est associé est tout aussi ordonné que foisonnant et généreux. Un défilé ordonné car, outre sa structure d’ensemble suivant un mode exploratoire rigoureux, il accueille également, au fil des pages, des exposés de principes généraux égrenés de manière tout aussi modeste que convaincante par leurs auteurs : il en est ainsi de l’inventaire détaillé des six raisons avancées par Jérôme Rossi pour l’utilisation de musiques déjà existantes (p. 261), mais aussi de la caractérisation – en six points là encore – des fonctions du Beau Danuble Bleu dans 2001 à laquelle Benjamin Lassauzet s’adonne de manière fort habile dans son article. Un défilé foisonnant et généreux parce que, à côté des grands classiques du répertoire cinématographique occidental, les productions de ces dernières années trouvent tout naturellement leur place (Shutter Island, Moonrise Kingdom, Alexandrie... New York, Io sono l’Amore, pour n’en citer que quelques‑uns), appelées peut‑être un jour à devenir eux aussi des jalons, des points de référence en matière de construction musicale de l’étrangeté, de la défamiliarisation, de l’empathie, de renfort des associations entre image et dialogue. L’enseignement majeur délivré par cet ouvrage réside dans son invitation à des lectures renouvelées et approfondies de ce qui, dans chaque film, échappe à toute prescription en y installant pourtant, à chaque fois, une dimension essentielle, celle de l’in‑ouï, du subreptice : celle de la musique qui s’obstine en produisant ces « scénarios énergétiques11 » qui entraînent, captivent...et font eux aussi le cinéma.

