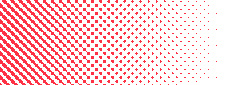Politique du corps romanesque : le cas Germinie Lacerteux
1La figuration du corps souffrant dans le roman naturaliste de la seconde moitié du xixe siècle a principalement fait l’objet d’une double lecture, à la croisée de l’histoire et de la littérature. D’un côté, la représentation des corps abîmés de l’ouvrier, de la prostituée, de l’alcoolique ou des noyés anonymes de la Morgue sont pris dans une lecture sociale, faite par l’histoire culturelle comme par la critique littéraire, qui font remonter l’émergence de ces corps dans les textes à l’expérience de l’industrialisation et de la croissance des grandes métropoles au xixe siècle (Corbin, [1978] 2015 et [1982] 2016 ; Demartini et Kalifa, 2005). De l’autre, les pathologies qui affectent les corps, qu’elles soient cliniquement identifiables (délires, maladies vénériennes) ou qu’elles héritent indirectement des représentations médicales de l’époque (hystérie) sont rattachées à l’évolution du vocabulaire médical et au développement de la médecine expérimentale, pour justifier l’émergence dans le texte littéraire d’une nouvelle grammaire du corps (Cabanès, 1991 ; Edelman, 2003 ; Rigoli, 2001).
2Entre cette lecture sociale et cette lecture médicale, peu de place est faite à un questionnement de la part politique de ces corps, sinon pour poser, comme un cadre très général à l’étude, que les personnages dont les corps souffrent sont victimes d’un système économico-politique inégalitaire et patriarcal (Schor, 1985).
3Nous voudrions faire l’hypothèse d’une lecture politique des corps souffrants du roman naturaliste, non pas en tant qu’ils exprimeraient allégoriquement un discours idéologique ou qu’ils seraient réductibles à la manifestation d’une forme d’oppression, mais en tant qu’ils font apparaître dans le texte la trace d’une expérience collective et historique, déposée dans ces corps (dé)figurés par l’écriture1. Pour cela, nous voudrions prendre Germinie Lacerteux des frères Goncourt, dont la préface a servi de manifeste à l’esthétique naturaliste, comme un cas d’enquête.
Corps sans histoire ?
4Le désir de faire avec Germinie Lacerteux un « roman vrai » est, dès la préface, rattaché à une situation sociale et politique plus large, qu’on peut globalement rattacher à la période post-révolutionnaire :
Vivant au xixe siècle, dans un temps de suffrage universel, de démocratie, de libéralisme, nous nous sommes demandés si ce qu’on appelle « les basses classes » n’avaient pas droit au Roman. (Goncourt, [1865] 1990, p. 552).
5Il s’agirait alors de voir si, à l’ère de l’égalité politique, « les larmes qu’on pleure en bas pourraient faire pleurer comme celles qu’on pleure en haut » (p. 56).
6Cette affirmation peut s’entendre de deux façons. Ou bien la démocratie, en rendant « égaux » tous les personnages, éloigne le roman de la sphère restreinte du pouvoir. Écrire la vie de n’importe qui voudrait alors dire s’intéresser à des phénomènes sociaux, économiques ou anthropologiques au moins autant que politiques. Ou bien l’ère démocratique rebat les cartes et donne l’opportunité à des anonymes d’entrer dans l’histoire collective, fût-ce en tant qu’anonymes. Soit le roman est « dépolitiqué3 », soit il est surinvesti par un rapport au politique qui donne à chaque personnage un pouvoir d’action et de questionnement sur la société, corrélat des droits qu’un régime démocratique véritablement universel (ce que la France n’a encore jamais connu en 1864) lui octroierait. Dans un cas comme dans l’autre, la corrélation entre cette plongée dans le bas de la société et une nouvelle ère politique, recèle une certaine ambiguïté, qui peut ressurgir ensuite sur le traitement des corps dans le roman.
7Le cas de Germinie Lacerteux ne fait qu’accentuer cette question, en ce que le tableau de sa vie qu’imaginent les frères Goncourt est bien celui d’une vie « comme une autre », qu’on pourrait prêter à d’autres individus issus des « basses classes […], ce monde sous un monde » (GL, p. 55). Née dans une famille pauvre, battue par son père, orpheline jeune, réduite à travailler pour gagner de l’argent pour ses sœurs, victime d’un viol qu’elle n’ose avouer et qui aboutit à une fausse couche dans des conditions de dénuement extrême, devenant par la suite alcoolique, perdant un enfant en bas-âge et faisant une seconde fausse couche, le personnage de Germinie Lacerteux offre un condensé des misères sociales et sexuelles qui peuplent la grande ville du milieu du xixe siècle4, conformément à la vision de certains enquêteurs sociaux de l’époque5. A priori, son existence corporelle est le reflet de ces déterminations socio-économiques. Comme l’écrit Émile Zola dans son compte rendu du 23 janvier 1865 dans Le Salut public, « l’histoire de cette fille est simple et peut se lire couramment » (Zola, 2012, p. 95). Les frères Goncourt n’ont, pour l’imaginer, pas besoin de recourir à une explication d’ordre historico-politique. Il leur suffit de s’inspirer des découvertes qu’ils font avec stupeur sur la double vie de leur gouvernante Rose Malingre après sa mort en 1862, tout en s’adossant aux nombreuses enquêtes physiologiques et sociales produites à cette époque6 pour étayer la vraisemblance de leur intrigue.
8On pourrait conclure à une frontière étanche entre la causalité historico-politique, qui nous occupe dans cette étude, et les raisons du martyre corporel que vit Germinie tout au long de sa vie. Cependant, par plusieurs aspects, la figuration romanesque du corps de Germinie Lacerteux nous ramène, de façon silencieuse et indirecte, à des références d’ordre historique et politique. L’exploration de ces ramifications discrètes nous permet de lire sous une lumière nouvelle les corps sans histoire du roman naturaliste et d’apporter un angle neuf à la question, déjà mentionnée, de savoir quelle devient la place du politique dans le roman « dans un temps de suffrage universel ».
9Si l’on peut parler à propos de Germinie d’un corps sans histoire, ce n’est pas parce qu’il serait invisible ou qu’il ne lui arriverait, à proprement parler, rien. Il est au contraire omniprésent et fait l’objet de violences répétées : viol, fausses couches, vomissements, toux, crises hystériques… L’expression désigne donc plutôt la façon dont toutes ces blessures qui jalonnent la biographie de Germinie ne sont jamais ouvertement décrites, mais toujours désignées comme des violences silencieuses, demeurant inavouées et n’étant pas reconnues par les autres personnages.
10Ce jugement se vérifie à l’échelle du roman : l’ensemble du drame de Germinie reste inconnu de Mlle de Varandeuil jusqu’à la mort de sa domestique. La mort de Germinie elle-même accrédite l’idée d’une vie qui n’aura pas laissé de traces. À rebours du mouvement d’individualisation de la mort qui a vu se multiplier les sépultures nominatives au long du xixe siècle7, l’héroïne est inhumée dans la fosse commune du cimetière Montmartre, à un emplacement lui-même indéterminé : « Ce qui devait rester de Germinie devait être à peu près là. » (GL, p. 262) L’hyper-modalisation par le double semi-auxiliaire (devait… devait…), la locution indéfinie (à peu près là) et la désignation impersonnelle (Ce qui devait rester de Germinie) pousse à son paroxysme la dépersonnalisation du personnage. » Sa tombe vague était ce terrain vague » (GL, p. 262), ajoute le narrateur. L’approximation redoublée devient l’emblème d’une existence elle-même vague, déjà prête à être oubliée.
11Le complexe diagnostic social – péripéties romanesques semble fonctionner de façon autonome, sans qu’il soit a priori besoin d’introduire une causalité historico-politique codée ou invisible. Nous n’entendrons pas révéler un tel sens caché qui prétendrait subsumer tous les autres. Toutefois, plusieurs éléments invitent à nuancer ce premier jugement et à se pencher sur la façon singulière qu’ont les Goncourt de créer des échos entre la violence infligée au corps de Germinie et l’histoire collective, comme pour animer l’une dans les plis de l’autre.
L’histoire dans les recoins
12Remarquons premièrement que tous les épisodes violents liés à l’intimité corporelle de Germinie contiennent à un moment une référence rapide au contexte historico-politique, qui ne sonne pas comme une allusion déguisée, mais plutôt comme un marqueur chronologique ou un signal ironique. Les premières trahisons de Jupillon auxquelles assiste Germinie se déroulent sur l’air de La Casquette du Père Bugeaud (GL, p. 125). Bien que cette chanson se soit popularisée depuis la fin de la Monarchie de Juillet, il s’agit à l’origine d’un chant militaire de l’Armée d’Afrique, dédié au maréchal colonisateur de l’Algérie, dont la casquette, dit la chanson, est faite » avec du poil de chameau ».
13De la même façon, le contexte politico-militaire refait surface lors de la dernière trahison de Jupillon, qui causera la seconde fausse couche de Germinie. Jupillon la séduit pour la rançonner une fois de plus afin qu’elle lui avance l’argent nécessaire à l’achat d’un remplaçant à l’armée : » Il faut plus de deux mille francs pour un homme cette année… On dit qu’il va y avoir la guerre » (GL, p. 163). Le système de la conscription par tirage au sort, dont le cadre général était fixé par la loi Gouvion-Saint-Cyr du 10 mars 1818, était assorti de la possibilité de se faire remplacer moyennant une transaction. Le prix annuel du remplaçant résulte d’un marché d’assurance qui s’est créé au long du xixe siècle par l’intermédiaire des marchands d’hommes (Bozon, 1987, p. 291-301). Le risque de guerre faisait mécaniquement hausser les prix, comme il précipite ici la chute de Germinie.
14Cette dernière scène a lieu vers 1849-50, ce qui nous pousse à considérer maintenant la chronologie relative que le récit permet d’établir, et de voir les effets que l’on peut tirer de la superposition silencieuse de ces deux histoires, l’une collective, publique et absente de la vie de Germinie, l’autre individuelle et invisible au grand public, notamment si l’on considère le passage silencieux de l’année 1848 au milieu de la diégèse. C’est ce que propose d’analyser Éléonore Reverzy (2021) :
1848 est passé par là, silencieusement. Pourtant, si la liaison avec Jupillon dure depuis trois ans et a été marquée par plusieurs étapes importantes, installation de l’amant dans la boutique de gantier d’un côté, maternité de l’autre, on peut tenter de reconstituer, à partir de la vie privée des personnages, une histoire personnelle qui chemine au revers de l’histoire collective. Ainsi les premières trahisons de Jupillon se déroulent sur l’air de La Casquette du père Bugeaud, chant de 1846 qui servira d’hymne aux zouaves ; puis son établissement comme gantier — installation qui dépouille Germinie mais stabilise temporairement le jeune homme —, conduit à la grossesse et à la joie de cette maternité, que l’accouchement à la Bourbe et les dangers encourus par la domestique n’entament pas. On est tenté de placer le temps de cette liaison heureuse entre 1847 et 1848, la naissance de l’enfant survenant juste après les Rois (6 janvier) début 48 et sa mort au mois d’août ou de septembre : fin de l’espoir pour Germinie qui engage alors sa dégringolade, dont plus tard une fausse-couche qui clôt ses amours avec le fils de la crémière. On est bien sûr tenté de voir dans la mort de cette petite fille celle de la République. Cependant, août-septembre n’est pas juin. (§12)
15La mort de l’enfant pourrait être une allégorie discrète de celle de la République. Pourtant, « août-septembre n’est pas juin » comme le rappelle Éléonore Reverzy. Le cadre allégorique se dérobe toujours. Une autre coupure se cache derrière cette date : la mort de la mère d’Edmond et Jules de Goncourt, le 5 septembre 1848 (Reverzy, 2021, §13). Ainsi, la vie des deux frères elle-même semble parfois constituer « une histoire personnelle qui chemine au revers de l’histoire collective ». On comprend alors que cette superposition sans cause apparente d’une chronologie intime et d’une chronologie publique, dans le cas de Germinie, est aussi un moyen de figurer ce dont les Goncourt ont fait l’expérience dans leur propre vie. Cette conjonction sans cause visible de l’événement intime et de l’événement public accentue l’invisibilisation du premier sous la rumeur bruyante du second. La chronologie politique n’est pas la cause secrète, cryptée, des malheurs de Germinie, mais l’emblème même de ce qui les rend invisibles et inaudibles.
16De façon similaire à la mention de La Casquette du père Bugeaud et au passage silencieux de la révolution de 1848 dans les malheurs de Germinie, cette dernière raconte au début du roman à Mlle de Varandeuil que son dernier souvenir de sa mère, avant que celle-ci ne meure alors que Germinie n’a que cinq ans, est à la messe du 21 janvier, où on lisait « le testament du roi » (GL, p. 61). La date anniversaire de l’exécution de Louis XVI est un jour de deuil national sous la Restauration dans une « France des larmes » en proie aux conflits mémoriels (Fureix, 2009). En apparaissant furtivement au détour de la confession de Germinie, le 21 janvier vient marquer d’un sceau officiel la chronologie intime et tragique de son existence.
Le viol de Germinie
17Un autre motif du roman peut servir de laboratoire à ce déplacement du regard. Celui-ci trouve son point de départ dans le récit du viol que subit Germinie à quinze ans, par le vieux Joseph qui travaille avec elle dans le café où ses sœurs l’ont placée à son arrivée à Paris. Dans le contexte du milieu du XIXe siècle, la question du viol et des violences sexuelles ne peut être posée en termes politiques, comme les avancées théoriques et militantes des années 1970 nous le permettent désormais8. Au xixe siècle, lorsqu’elles ne sont pas tout simplement passées sous silence – indicibles car inaudibles –, les violences sexuelles font l’objet d’un diagnostic apolitique, énoncé soit en termes médicaux, soit en termes moraux, soit en termes juridiques9. La question de la violence sexuelle et conjugale dépasse rarement la sphère privée, et n’entre pas de plein droit dans les discours politiques. Le lexique qui a servi depuis à politiser ces questions – oppression, domination masculine, patriarcat, culture du viol… – est alors absent du débat. Ce préalable méthodologique à une approche historienne de la représentation du viol dans le roman naturaliste n’empêche pas cependant de se demander de quelle façon, dans la manière même d’articuler le phénomène de la violence sexuelle à d’autres motifs romanesques, le récit littéraire est capable de flouter la frontière qui sépare les sphères privée et publique. Ce faisant, il touche à ce que Jacques Rancière (2000) nomme le partage du sensible, provoquant « une reconfiguration du paysage du visible, un rapport entre le faire, l’être, le voir et le dire » (p. 72-73). Cette approche ouvre la voie à une réflexion sur la dimension politique du corps de Germinie, non pas en tant qu’il serait un emblème de l’oppression sociale, mais en tant qu’il travaillerait de l’intérieur cet ordre social implicite. C’est à cet exercice de décloisonnement par l’étude de la portée sensible et réflexive du motif intime que nous voudrions ici nous livrer, à partir du cas particulier de Germinie Lacerteux.
18Il faut tout d’abord prêter attention à la temporalité dans laquelle se produit le viol. Celui-ci intervient, nous dit le texte, alors que Germinie et Joseph sont seuls dans le café dont tous les garçons ont eu congé car « il y avait une grande revue au Champ-de-Mars » (GL, p. 86). Or, les revues royales de la garde nationale étaient un moment clé du cérémonial de la monarchie de Juillet, qui en organisa douze à la suite de la revue fondatrice du 29 août 1830, lors de laquelle Louis-Philippe remit à la Garde nationale les drapeaux tricolores que la Restauration lui avait ôtés. Dans le spectacle qu’offre de lui-même le régime parlementaire issu de la révolution de 1830, la revue tient une place déterminante, proposant une allégorie vivante du rapport entre le roi et les Français, avec la garde nationale comme intermédiaire. Contrairement aux revues militaires traditionnelles, qui présentent au souverain ou au chef des armées un corps militaire, ici, « c’est une partie du peuple qui était présentée au roi, mais aussi au peuple lui-même » (Larrère, 1997, p. 10). La revue du Champ-de-Mars est donc un objet de bout en bout symbolique et politique à la fois. Il n’est donc pas anodin que ce soit pendant un tel moment qu’intervienne le viol de Germinie. Celui-ci a lieu à l’ombre du faste politique de la monarchie de Juillet, à l’autre bout de Paris – Germinie est violée dans « un petit café du boulevard » (GL, p. 84). Le viol est le contrepoint silencieux de la parade nationale, deux événements qui n’ont aucun rapport causal mais qui ont lieu exactement en même temps, selon une configuration qui fait de la violence intime l’envers symbolique de l’événement politique.
19La tragédie intime de Germinie, que cette coïncidence entre le crime sexuel et la revue royale exhibe comme l’exact contrepoint de l’histoire officielle et connue, restera inaudible tout au long de la vie de l’héroïne et du roman, sans cesser pour autant de faire entendre ses répercussions.
20Alors que le récit s’ouvre sur un embryon de confession de Germinie, dès le second chapitre celle-ci cesse de parler pour respecter le silence méditatif de sa maîtresse : « La parole de la bonne s’arrêta, et le reste de sa vie, qui était sur ses lèvres ce soir-là, rentra dans son cœur. » (GL, p. 84) En taisant sa douleur, Germinie réitère le geste qui a rendu invisible la blessure corporelle fondatrice : le viol par le vieux Joseph vers ses quinze ans. Face à ses sœurs qui lui demandent si sa grossesse est le fruit d’une violence, elle préfère garder le silence plutôt que « d’étaler sa honte », perdue dans « la vague espérance qu’on la tuerait » (p. 87). Ce schéma se reproduit au moment où Jupillon, obligeant une dernière fois Germinie à aggraver ses dettes pour payer son rachat de l’armée, consent à redevenir son amant pour quelques jours : « je t’aurai au moins laissé sur un bon souvenir de moi… » (p. 165), déclare-t-il. La formulation résonne avec une ironie tragique quand on sait que ce « souvenir » sera une nouvelle fausse couche de Germinie quelques semaines plus tard10. Cette scène est elle-même enchâssée dans un décor sordide, au sein duquel une présence corporelle dégoûtante forme comme une tache vive et obsédante :
L’air humide et chargé qu’ils respiraient sentait le sucre, le suif et la charogne. Par moments, il leur passait comme un flamboiement devant les yeux : c’était une tapissière dont la lanterne donnait sur des bestiaux éventrés et des carrés de viande saignante jetés sur la croupe d’un cheval blanc : ce feu sur des chairs, dans l’obscurité, ruisselait en incendie pourpre, en fournaise de sang. (p. 163-164)
21Couleur (le rouge sang sur la croupe blanche), odeur (la charogne, le suif issu d’une graisse animale), sensation de brûlure (incendie, fournaise) : ces trois perceptions sensorielles provoquées par l’irruption violente de l’image corporelle servent à dire, par un carambolage symbolique, la tragédie secrète que couve la scène.
22Les souffrances, les privations et les meurtrissures qui sont infligées à Germinie le sont donc en silence, à l’insu des personnes qui les causent (Joseph, Jupillon) ou qui pourraient l’aider (mademoiselle de Varandeuil). La dimension inaudible de la violence infligée à Germinie favorise aussi sa résurgence sous des formes indirectes et parfois aggravées. Avant même son décès en bas-âge, la naissance de l’enfant de Germinie et Jupillon est déjà teintée de mort. La maternité où il naît est en effet infestée par une « de ces terribles épidémies puerpérales » qui font mourir les mères dans de grandes manifestations de douleur :
C’était tout autour de Germinie […] des morts telle qu’en fait la fièvre de lait, des morts qui semblaient violer la nature, des morts tourmentées, furieuses de cris, troublées d’hallucination et de délire, des agonies auxquelles il fallait mettre la camisole de force de la folie […]. La vie s’en allait là comme arrachée du corps. (GL, p. 139)
23L’expression « des morts qui semblaient violer la nature » réintroduit discrètement l’image de la violence sexuelle dans un contexte qui ne l’appelle pas a priori. Les conséquences premières du viol se trouvent elles aussi rappelées : cette scène d’accouchement est une lointaine réminiscence de la fausse couche qui suit le viol de Germinie, et semble faire remonter à la surface du roman toute la violence corporelle contenue dans ce premier épisode. Naissance et mort sont rendues indissociables dans une chaîne d’images qui inclut également l’acte sexuel lui-même, l’ensemble étant placé sous le signe, non de l’union ou du repos, mais de la déchirure : « La vie s’en allait là comme arrachée du corps. »
24On trouve un autre exemple éloquent de cette résurgence de la violence sous des motifs déjà convoqués dans la liaison de Germinie avec le peintre Médéric Gautruche, placée sous le signe de l’alcool et d’une sexualité violente et autodestructrice :
Et c’étaient, entre ces deux êtres, des amours terribles, acharnées et funèbres, des ardeurs et des assouvissements sauvages, des voluptés furieuses, des caresses qui avaient les brutalités et les colères du vin, des baisers qui semblaient chercher le sang sous la peau comme la langue d’une bête féroce, des anéantissements qui les engloutissaient et ne leur laissaient que le cadavre de leurs corps.
À cette débauche, Germinie apportait je ne sais quoi de fou, de délirant, de désespéré, une sorte de frénésie suprême. Ses sens exaspérés se retournaient contre eux-mêmes, et, sortant des appétits de leur nature, ils se poussaient à souffrir. La satiété les usait, sans les éteindre ; et dépassant l’excès, ils se forçaient jusqu’au déchirement. Dans le paroxysme d’excitation où était la malheureuse créature, sa tête, ses nerfs, l’imagination de son corps enragé, ne cherchaient plus même le plaisir dans le plaisir, mais quelque chose au-delà de plus âpre, de plus poignant, de plus cuisant : la douleur dans la volupté. (GL, p. 220)
25Ici encore, l’acte sexuel est associé à une mort violente (funèbres, sauvages, brutalités, chercher le sang sous la peau, bête féroce, cadavre, déchirement), toujours sous le signe de la déchirure sanglante, selon une image qui rappelle en filigrane le souvenir premier du viol. Mario Praz a montré combien cette conception du dérèglement passionnel de la sexualité était cohérente avec un goût, instauré par le romantisme et qui se prolonge dans sa mutation décadente, pour la « beauté méduséenne, imprégnée de douleur, de corruption et de mort » (Praz, 1998, p. 6511). Ici, la relation sado-masochiste ajoute à la fuite en avant dans l’alcoolisme et la misère de l’héroïne le motif d’une dégradation intime, corporelle, et d’une déviance sexuelle. Cette « douleur dans la volupté » est présentée comme l’horizon secret, inassouvi de tout un itinéraire d’auto-mutilation, auquel il manque encore « quelque chose de plus âpre, de plus poignant, de plus cuisant ». Cette fuite en avant soutenue par la soif d’un surcroît de violence est le résultat symptomatique du souvenir à la fois traumatique et étouffé du viol initial, dont on a vu qu’il se jouait explicitement dans l’envers silencieux de l’histoire officielle.
L’histoire en miroir : Germinie et Mlle de Varandeuil
26Une dernière voie nous est offerte par le roman pour conférer une sémantique politique à la vie minuscule, émaillée de violences corporelles, de Germinie Lacerteux. Il s’agit du diptyque qu’elle forme avec Mlle de Varandeuil, sa maîtresse et protectrice. Les résumés du roman passent souvent sous silence le tableau à double entrée que constituent ses deux premiers chapitres, qui présentent successivement le début de récit de soi de Germinie – au discours direct, avant que la parole de celle-ci ne cède la place à la restitution écrite – et la remémoration intérieure de Mlle de Varandeuil qui compare sa vie à celle de sa domestique.
27À première vue, tout oppose le destin de ces deux femmes. Alors que Germinie est née dans une famille auvergnate pauvre, qu’elle a perdu sa mère à cinq ans et que son père devenu grabataire et violent meurt à son tour avant son adolescence, Mlle de Varandeuil naît en 1782 « dans un hôtel de la rue Royale », tenue sur les fonts baptismaux par « Mesdames de France » (GL, p. 84), filles de Louis XV, d’un père qui avait une charge dans la maison du duc d’Artois (futur Charles X). L’une naît dans l’anonymat et la misère, l’autre dans les cercles les plus élevés de l’Ancien Régime. Tout concorderait pour opposer une vie loin de l’histoire à une vie placée au cœur de l’histoire politique et publique du Royaume. Mais la fin de l’Ancien Régime, qui fait justifier aux Goncourt l’élaboration d’une nouvelle poétique romanesque, vient compliquer ce schéma.
28Plus qu’une opposition stricte, les deux premiers chapitres semblent dessiner un parallèle, ou une symétrie, qui nous oblige à réévaluer ce premier constat. En effet, très vite abandonnée par sa mère, la jeune Mlle de Varendeuil grandit « abandonnée, sans caresses, sans autre mère qu’une femme morte à tous les siens et dont son père lui enseignait le mépris. » (GL, p. 69) Ce manque affectif s’aggrave lorsque son père apprend que son nom se trouve visé par une dénonciation révolutionnaire. Leur vie recluse ne tarde pas à devenir un calvaire pour la jeune fille, que son père fait rebaptiser « Sempronie » pour lui choisir un nom républicain, et sur laquelle retombent toutes les tâches d’un foyer privé de toute source de revenus :
Elle avait à subir les violences d’humeur, les exigences, les âpretés, les tempêtes d’un père, un peu matées et contenues jusque-là par le grand orage du temps. Elle restait vouée aux fatigues et aux humiliations d’une servante. (p. 69)
29D’un côté, Germinie perd sa mère et se retrouve seule face à un père violent – « et puis quand il rentrait, il nous battait, et fort… » (p. 62) ; de l’autre, Sempronie est abandonnée par sa mère et contrainte de devenir la « servante » d’un père aigri. De façon significative, la tournure employée ici (« Elle avait à subir les violences d’humeur, les exigences… ») est répétée à l’identique quelques pages plus loin, cette fois appliquée à Germinie pour décrire le harcèlement continu dont elle est l’objet dans le café où elle commence à travailler : « À toute heure, elle avait à subir les lâches plaisanteries, les mystifications cruelles, les méchancetés de ces hommes… » (p. 85). Bien que Mlle de Varandeuil ne connaisse pas le même degré de misère ni la violence traumatique du viol dont Germinie fera l’expérience, son corps est lui aussi le réceptacle des souffrances qu’elle traverse. Comme le frère de Germinie qui reçoit « des coups de sabot dans le creux de l’estomac » (p. 67) à la fête de Clermont pour avoir défendu l’honneur de sa sœur, Mlle de Varandeuil, alors qu’elle fait la queue des heures durant pour ramener du pain à sa famille, reçoit « un coup de sabot qui la retint près d’un mois au lit » et dont elle gardera « la marque toute sa vie » (p. 67).
30De cette structure parallèle initiale découle ensuite deux trajectoires symétriques, qui ont pour point commun le corps féminin. Germinie, après son viol, développe un rapport violent et traumatique à la relation sexuelle, de l’« affreux dégoût » que lui cause son agresseur et qui la laisse « comme frappée de la peur d’une bête éperdue » (GL, p. 87), jusqu’aux unions violentes qu’elle connaîtra avec Gautruche, que nous avons déjà commentées. De son côté, privée de tout rapport au monde par un père qui la tyrannise jusqu’à ses quarante ans, Sempronie de Varandeuil ne connaîtra jamais de relation sexuelle. Son corps semble suivre un trajet inversement symétrique, celui d’un racornissement, d’une perte progressive de tous ses attributs sensuels :
Elle demeurait comprimée et rabaissée, isolée auprès de son père, écartée de ses bras, de ses baisers, le cœur gros et douloureux de vouloir aimer et de n’avoir rien à aimer. Elle commençait à souffrir du vide et du froid que fait autour d’une femme une jeunesse qui n’attire pas et ne séduit pas, une jeunesse déshéritée de beauté et de grâce sympathique. Elle se voyait inspirer une espèce de commisération avec son grand nez, son teint jaune, sa sécheresse, sa maigreur. Elle se sentait laide et d’une laideur pauvre dans ses misérables costumes, ses tristes robes de lainage qu’elle faisait elle-même et dont son père lui payait l’étoffe en rechignant : elle ne put obtenir de lui une petite pension pour sa toilette qu’à l’âge de trente-cinq ans. (p. 69-70)
31À l’opposé du corps de Germinie, traversé par des pulsions et des expulsions violentes (vomissements, cris, larmes, toux12…), le corps de Mlle de Varandeuil est marqué par la contrainte (comprimée et rabaissée), le manque, les attributs maladifs. Quoique les deux femmes soient laides, nous dit le texte, leur laideur est presque antithétique. Celle de Mlle de Varandeuil est placée sous le signe du rapetissement et de l’aridité (teint jaune, sécheresse, maigreur), là où celle de Germinie est marquée par l’exagération des traits : ses yeux sont « d’un gris qui n’était pas une couleur, mais une lumière », traversés par la « fièvre » et l’« ivresse » et bordés par « une grosse veine bleue », son nez est « largement troué, avec les narines ouvertes et respirantes », elle a des « pommettes larges, fortes, accusées », une « trop large distance entre le nez et la bouche », « une grande bouche […] aux lèvres pleines, plates et comme écrasées » (p. 95-96). Son corps, quoique laid, dégage « une âpre et mystérieuse séduction » (p. 97). Le narrateur ajoute :
Une tentation sensuelle s’élevait naturellement et involontairement d’elle, de ses gestes, de sa marche, du moindre de ses remuements, de l’air où son corps avait laissé une de ses ondulations. (p. 97)
32Le corps sensuel de Germinie est le contraire de la « jeunesse qui ne séduit pas » de Mlle de Varandeuil, devenue vieille fille. À un corps rongé par le manque répond une chair en excès. À la souffrance d’une vie sans plaisir charnel répond la tragédie d’une vie détraquée par une violence sexuelle liminaire.
33Que pouvons-nous tirer de cette symétrie entre ces deux destins et ces deux corps féminins ? Celle-ci change avant tout notre regard sur le personnage de Germinie, qui n’est pas seulement un cas que le roman se donnerait pour seul sujet, mais un personnage au sein d’un système double, qu’il faut aussi interpréter en fonction de ce système. Dans leur lettre de réponse au compte rendu de Zola à la parution du roman, les frères Goncourt confirment sa lecture sociologique du destin de Germinie, corrompue par son « milieu » plus que par sa nature propre : « Oui, comme vous le dites parfaitement, donnez à Germinie un mari, des enfants, et tout son dévouement se règle. » (Goncourt, dans GL, p. 28913)
34Pourtant, il serait difficile d’en dire autant de Mlle de Varandeuil. Les souffrances de cette dernière sont toutes dues à la perte de la position sociale de son père au moment de la Révolution. En s’appuyant sur le système des personnages en partie double que nous avons mis au jour, nous voudrions alors contredire les Goncourt eux-mêmes, pour faire l’hypothèse qu’un mari et des enfants n’eussent pas non plus suffi à annuler le cas Germinie. Ou plutôt, pour ne pas céder à l’hypothèse pseudo-psychologique, que l’existence romanesque de Germinie fonctionne de façon indissociable de celle de Mlle de Varandeuil, et que la dimension invisible de son drame est l’exact corollaire de la dimension quasi-publique de celui de sa maîtresse – rappelons que cette dernière a été baptisée Sempronie par le citoyen Chaumette14, « dans la grande salle des Déclarations », après avoir dû montrer sa poitrine pour laisser « deux matrones […] s’assurer de son sexe » (GL, p. 68), dans une scène qui figure un viol symbolique. L’une fut déshabillée et « baptisée » (ou plus précisément débaptisée, renommée) en place publique sous la Révolution, l’autre fut violée dans le silence d’une boutique, un jour de revue au Champ-de-Mars. Si ces deux femmes sont liées par leur destin corporel et intime, on comprend que l’archi-causalité politique de la vie de Mlle de Varandeuil répond à l’infra-politisation de la vie de Germinie. L’échelle des violences respecte l’asymétrie sociale, mais le parallèle interdit qu’on sépare tout à fait la vie sans histoire (car loin de l’Histoire) de Germinie de la vie liée au cours de l’histoire politique de Mlle de Varandeuil. L’effet de système que crée le parallèle corporel autorise une lecture qui intègre le corps anonyme de Germinie à un sertissage politique.
*
35Ces éléments nous incitent à relire certains motifs du roman jugés infra-politiques à l’aune d’une expérience historico-politique qui a pu contribuer à leur genèse. Le lieu même que nous associions par excellence à la dimension anonyme de la vie de Germinie, la fosse commune du cimetière Montmartre, est peut-être, selon ce changement de perspective, le point de départ d’une reconfiguration du visible et de l’invisible, d’un réagencement politique du partage du sensible par le roman. Véronique Samson (2021) fait ainsi l’hypothèse qu’en exhibant la vie et la mort de Germinie comme des « lieux d’oubli », le roman rédime cette disparition silencieuse et devient aussi un « lieu de mémoire », fût-ce d’une mémoire de l’oubli (p. 35-44). Cette « fonction partagée de l’épitaphe et du roman » (p. 44) peut se lire, avec Jacques Rancière (2000), comme un geste fondamentalement politique, celui d’une reconfiguration par l’écriture du partage entre le visible et l’invisible.
36Dans un article, Jacques-David Ebguy (2007) se demandait ce qu’était un « auteur politique », en favorisant finalement les approches de Jacques Rancière et Jean-Claude Milner, selon qui le nœud entre esthétique et politique se joue dans « l’activité de reconfiguration à l’œuvre dans le texte romanesque » (p. 159). Cette conclusion prouve qu’il est alors nécessaire de déplacer l’objet du questionnement, de la définition de l’auteur politique à l’identification d’une politique de l’œuvre. L’expérience que nous avons menée avec le cas Germinie Lacerteux, étudié par le prisme du corps du personnage, nous enseigne que cette identification dépend à son tour d’un changement d’échelle du regard critique. Identifier une politique de l’œuvre ne signifie pas assigner un roman à une définition de ce que serait une œuvre politique, mais l’éclairer sous un nouveau jour de manière à donner à certains choix esthétiques une résonance politique au regard de leur situation historique propre. Il ne s’agit donc pas de nier les héritages critiques qui replacent la représentation du corps de Germinie dans une macro-histoire sociale ou dans l’évolution de la connaissance médicale, mais de proposer une archéologie historique de la figuration de la violence dont le corps de Germinie est la victime, de façon à révéler la réflexivité politique que le geste esthétique des Goncourt contient en puissance – à condition d’être lu sous un certain angle.