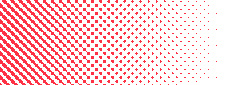Enjeux politiques du corps souffrant dans les poétiques dramatiques de Diderot et Mercier
1Le xviiie siècle est pour le théâtre une période d’intense renouveau théorique1 : les dramaturges s’interrogent sur les moyens à mettre en œuvre pour redonner aux spectacles une efficacité pathétique dont le genre tragique, à bout de souffle, apparaît comme désormais dépourvu2. Cette préoccupation n’est pas seulement esthétique, puisque le théâtre est alors généralement conçu comme une école de morale et d’humanité. Dans De la poésie dramatique, paru avec Le Père de famille en 1758, Denis Diderot écrit par exemple :
Le parterre de la Comédie est le seul endroit où les larmes de l’homme vertueux et du méchant soient confondues. Là, le méchant s’irrite contre des injustices qu’il aurait commises, compatit à des maux qu’il aurait occasionnés, et s’indigne contre un homme de son propre caractère. Mais l’impression est reçue, elle demeure en nous, malgré nous ; et le méchant sort de sa loge moins disposé à faire le mal que s’il eût été gourmandé par un orateur dur et sévère (Diderot, [1758] 1980a, p. 338).
2Pierre Frantz met en parallèle ce propos avec une affirmation de Louis Sébastien Mercier que l’on trouve dans Du Théâtre (1773), en soulignant que pour les deux auteurs, « c’est par l’émotion que le théâtre doit atteindre un but moral » (Frantz, 1999, p. 1743) :
Plusieurs hommes pèchent par une âme rétrécie et commune, et c’est faute d’avoir été dilatée par la chaleur du sentiment qu’elle demeure froide et engourdie ; mais si elle vient à sentir les charmes de cette sympathie qui lie un être à un autre, si des larmes ont fondu la glace de ce cœur, une fois amolli il prendra la direction de la vertu. (Mercier, [1773] 1999, p. 1147).
3L’idée qu’exposent ici Diderot et Mercier n’a rien d’original au xviiie siècle : elle appartient au contraire à une doxa communément partagée par le camp des Philosophes, Rousseau excepté3. On mesure sans peine les conséquences et implications politiques d’une telle conception : l’édification morale apparaît en effet comme la condition d’une vie sociale plus harmonieuse. Mais il est une infinité de manières d’être politique, et c’est là que Diderot et Mercier se séparent.
4La critique a remarqué à juste titre que « c’est sans doute Mercier qui est allé le plus loin » dans la volonté d’établir un « théâtre qui ait un rôle institutionnel reconnu » (Buffat, 2009, p. 267) : pour Mercier, les poètes ne sont rien de moins que les « citoyens les plus utiles » de la nation, puisqu’« ils répandent des lumières qui forment l’éducation publique », au point d’être « redoutés et [même] haïs des tyrans, parce que ceux-ci les jugent amis de la vérité et conservateurs des droits de l’homme » et qu’« [i]ls sont tels en effet » ([1773] 1999, p. 1142). Il conçoit donc le théâtre comme un genre éminemment pragmatique, qui expose au regard des spectateurs le tableau des injustices actuelles afin de les dénoncer et, idéalement, d’y mettre un terme. Chez Diderot, l’effet que doit produire la représentation dramatique n’obéit pas au même impératif d’immédiateté ni au même sentiment d’urgence. Jacques Chouillet (1973) l’a bien noté : « la signification sociale des drames de Diderot » n’a rien d’évident, puisque « prises statiquement, comme une galerie de types, ses “conditions” et ses “relations” n’ont aucune réalité », mais « procèdent de représentations a priori, donc antérieures à toute expérience », si bien que « par l’intermédiaire des “conditions” » ne s’écrit pas « l’histoire du présent » (p. 464). En somme, le rôle politique que Diderot et Mercier attribuent tous deux au théâtre diffère radicalement dans sa temporalité : alors que pour Mercier, les effets produits par la représentation dramatique ne trouvent leur accomplissement complet que dans un bouleversement concret de la réalité sociale, Diderot ne s’inquiète apparemment pas d’un horizon chronologique bien précis.
5Il nous a semblé que cette différence était particulièrement patente dans les enjeux que l’un et l’autre attribuent au corps souffrant : c’est ce que nous nous proposons de montrer dans cet article.
Contre les bienséances : le corps souffrant comme source privilégiée de pathétique
6Diderot et Mercier s’en prennent tous deux aux bienséances qui régissent la scène classique, les considérant comme un obstacle à la production du pathétique. L’inconvénient est double : esthétique d’abord, puisque comme l’a montré Sophie Marchand (2008), le public du xviiie siècle aime à pleurer et juge une pièce en fonction du degré d’émotion suscité, moral ensuite, puisque l’émotion est perçue comme la condition de l’édification du spectateur.
7Dans les Entretiens sur le Fils naturel, Dorval explique que « pour [lui], si un ouvrage dramatique était bien fait et bien représenté, la scène offrirait au spectateur autant de tableaux réels, qu’il y aurait dans l’action de moments favorables au peintre » (Diderot, [1757] 1980a, p. 93). Diderot personnage répond en s’exclamant : « Mais la décence ! la décence ! » (p. 93). Dorval ne manque pas de souligner ce que cette objection a de mécanique, comme l’indique déjà suffisamment sa formulation : le redoublement de l’exclamation montre qu’elle relève d’un psittacisme critique et d’un discours tournant à vide, pendant théorique d’une pratique théâtrale sclérosée.
Je n’entends répéter que ce mot. La maîtresse de Barnevelt entre échevelée dans la prison de son amant. Les deux amis s’embrassent, et tombent à terre. Philoctète se roulait autrefois à l’entrée de sa caverne. Il y faisait entendre les cris inarticulés de la douleur. Ces cris formaient des vers peu nombreux. Mais les entrailles du spectateur étaient déchirées. Avons-nous plus de délicatesse que les Athéniens ?... Quoi donc, pourrait-il y avoir rien de trop véhément dans l’action d’une mère, dont on immole la fille ? Qu’elle courre sur la scène comme une femme furieuse ou troublée. Qu’elle remplisse de cris son palais. Que le désordre ait passé jusque dans ses vêtements. Ces choses conviennent à son désespoir (p. 93).
8Dans la perspective matérialiste qui est celle de Diderot, il n’y a pas de solution de continuité entre souffrance morale et souffrance physique, puisque moral et physique ne se conçoivent pas et n’existent pas l’un sans l’autre – une douleur morale s’accompagne donc toujours de manifestations physiologiques, tandis qu’une douleur physique ne va pas sans troubles psychiques.
9C’est bien ce que montre l’exemple de Philoctète, dont tout le malheur vient d’une blessure au pied. La pièce de Sophocle mettant en scène ce personnage (- 409 av. J.-C.) s’ouvre sur ces paroles d’Ulysse à Néoptolème :
Voici donc, sur ce sol de Lemnos, qu’enveloppent les flots, voici le cap désert, vierge de pas humains, où j’ai jadis […] déposé l’homme du pays maliaque [Philoctète], le fils de Péas. J’en avais reçu l’ordre de nos chefs. Son pied suppurait sous un mal rongeur ; nous ne pouvions plus procéder en paix à une libation ni à un sacrifice : il emplissait l’armée entière sans trêve de clameurs sinistres : criant, gémissant… (Sophocle, 1990, p. 10).
10Néoptolème décrit ensuite à Ulysse ce qu’il voit dans la caverne de Philoctète : un « lit de feuillage », une « coupe en bois massif – œuvre d’un piètre ouvrier » et des « hardes qui sèchent toutes pleines d’un pus répugnant » (p. 11). Philoctète se trouve donc dans une position intermédiaire entre humanité et animalité, la douleur l’empêchant d’actualiser les caractères définitoires de l’humanité. Ce statut ambigu convient à Philoctète comme les cris conviennent au désespoir de Clytemnestre, puisqu’il signale et atteste une souffrance véritable, suffisamment forte pour priver le sujet de l’usage de la raison et entraîner ainsi l’impossibilité de recourir au langage articulé, remplacé par l’expression infra-réflexive de la douleur que sont les cris et les gémissements.
11La décence, définie par le dictionnaire de Trévoux (1778) comme une « honnêteté [et une] bienséance qu’on est obligé de garder à l’extérieur dans le geste, dans les habits », est fondamentalement incompatible avec la douleur. « [E]nnemie du génie et des grands effets » (Diderot, [1757] 1980a, p. 116), la décence suppose en effet maîtrise et contrôle de soi, alors que la douleur est une forme de dépossession, tant corporelle que mentale : la douleur ne se pense pas mais s’éprouve. C’est pourquoi Dorval voit dans les « cris inarticulés » de Philoctète la principale source de pathétique de la pièce de Sophocle, ainsi qu’il l’explique dans le Second Entretien :
Je ne me laisserai point de crier à nos Français : La Vérité ! La Nature ! Les Anciens ! Sophocle ! Philoctète ! Le poète l’a montré sur la scène, couché à l’entrée de sa caverne et couvert de lambeaux déchirés. Il s’y roule. Il y éprouve une attaque de douleur. Il y crie. Il y a fait entendre des voix inarticulées. […] Notre goût serait bien dégradé, si ce spectacle ne nous affectait pas davantage que celui d’un homme richement vêtu, apprêté dans sa parure, […] [s]e promenant à pas comptés sur la scène (p. 116-117).
12Pour Mercier comme pour Diderot, c’est par la représentation de la souffrance qu’un dramaturge est le plus susceptible d’émouvoir son public. Il n’est donc guère surprenant que l’on trouve chez Mercier la même condamnation des bienséances que chez Diderot.
13Critiquant la tragédie ancienne et moderne, il déplore que les poètes « poignard[ent] [leur] tyran d’une manière subtile et subite » au lieu de « montr[er] […] le monstre expirant dans la rage et payant l’énormité de ses crimes par les transes de la crainte et du désespoir ; […] la mort vengeresse s’imprimer par degrés sur son visage, ses traits s’allonger, le tremblement de la peur agiter ses membres et surtout cette main cruelle qui égorgeait l’innocent » (Mercier, 1999, p. 1185-1186). Il s’en prend plus particulièrement à « cet imbécile de Péchantré, [qui] en faisant la mort de Néron, n’a pas seulement senti la catastrophe » (p. 1186). Mercier écrit alors une véritable pantomime, ressource dramatique dont on ne saurait sous-estimer l’importance selon Diderot4 :
Je voudrais voir l’empereur seul, livré aux tableaux effrayants que ses crimes lui retracent, ne sachant ni vivre ni mourir. Sa douleur serait celle d’un impie, son repentir celui d’un lâche, son effroi celui d’une femmelette : il prendrait le fer d’une main tremblante, et l’essayant vingt fois il n’oserait s’en frapper ; il pleurerait, il porterait de tous côtés des regards suppliants, il implorerait le bras du plus vil esclave ; le sang de l’infâme coulerait enfin. Je voudrais le voir alors luttant contre la mort, tombant sur la terre, la grattant de ses mains, poussant des cris aigus en approchant du terme qui ramène tout à l’égalité. Je voudrais voir les mouvements convulsifs des muscles de son visage, jadis insensibles aux tourments de ses semblables, ses bras se raidir, sa poitrine s’enfler, tous ses nerfs se tendre sous l’effort de la destruction prochaine et terrible (p. 1186).
14Alors le spectateur pourrait « joui[r] du supplice du méchant » (p. 1186). Mais on voit que cette jouissance correspond à un effet considéré comme médiocre par Aristote dans sa Poétique : le spectacle d’un « homme foncièrement méchant tomb[ant] du bonheur au malheur […] p[eut] bien éveiller le sens de l’humain, mais certainement pas […] la pitié », la pitié « s’adress[ant] à l’homme qui n’a pas mérité son malheur » (1980, p. 77).
15Or, pour les théoriciens et dramaturges des Lumières, ce sont les « scène[s] pathétique[s] » que « le poète doit saisir de préférence », puisque « rien n’entre plus avant dans le cœur de l’homme » et qu’il n’est pas de « mouvement plus délicieux que de sentir son âme s’écouler, se fondre sous les impressions de cette passion généreuse » (Mercier, 1999, p. 1260). Immédiatement après avoir énoncé ce principe, Mercier donne un exemple de scène pathétique aux poètes :
Si vous avez à me faire entendre les soupirs de l’infortuné, amenez-le sous mes yeux, que je voie les lambeaux qui le couvrent, que j’entende ses gémissements ; cet œil sombre, cette pâleur qui couvre ce corps tremblant, ces cheveux qui cachent ce front baissé me dérobent le visage d’un frère… je les écarte, je tombe dans ses bras, je pleure, et je sens avec volupté que je suis homme ! (p. 1260)
16Il faut donc préférer au corps agonisant d’un tyran le corps durement éprouvé d’un infortuné qui, précisément, n’a pas mérité son malheur.
17Mercier répond à l’objection que la doxa critique pourrait lui faire : « Quoi ! me dira-t-on, montrer les lambeaux de la misère ! Et qui soutiendra ce spectacle ? » (p. 1261). Si l’objection est la même que celle soulevée par Diderot personnage dans les Entretiens, la réponse de Mercier diffère de celle de Dorval. En effet, Dorval s’en tient à un plan strictement esthétique : la douleur excluant par nature la décence, les bienséances, obstacle à la représentation d’une crise, empêchent que le spectateur soit émotionnellement « frapp[é] » ou » renvers[é] » (Diderot, [1757] 1980a, p. 93). Dans la réponse de Mercier, esthétique et politique se trouvent inextricablement mêlées :
Qui [soutiendra le spectacle de la misère] ? Tout homme qui ne sera pas indigne de ce nom. Quel est l’orgueilleux, l’ennemi du genre humain, l’insolent qui osera dire que toute image de la misère, d’indigence, enfin que toute idée de besoin est une image basse ? […] Je braverai la délicatesse française, qui me paraît fausse en ce point. Je ne sacrifierai pas à un goût factice l’abondance et la variété des sujets, la force et la variété des peintures. Je n’irai point fermer les sources les plus abondantes du pathétique, pour flatter et tromper une génération présente. […] Je me dirai que le poète est l’interprète des malheureux, l’orateur public des opprimés ; que son emploi est de porter leurs gémissements aux oreilles superbes qui, tout endurcies qu’elles sont, entendront le tonnerre de la vérité, en seront étourdies et touchées (Mercier, 1999, p. 1263).
18Montrer l’indigence en proie aux tourments physiques engendrés par des privations et des conditions de vie précaires relève donc du devoir du poète. Si ces images sont les plus susceptibles d’émouvoir le public, c’est parce qu’elles sont la mise en scène d’une réalité sociale violente que le poète, « orateur du grand nombre », doit dénoncer, puisqu’« il faut [toujours] qu’il compose sous l’œil sévère de la justice ; j’ai presque dit de la vengeance publique » (p. 1261), écrit Mercier. Dès lors, plus le dramaturge remplira son rôle avec probité, plus ses pièces acquerront une force pathétique.
La question du modèle
19Dans les Entretiens, Dorval dit que « rien peut-être ne nous est moins connu que les conditions, et ne doit nous intéresser davantage », puis s’exclame : « Les conditions ! Combien de détails importants ! d’actions publiques et domestiques ! de vérités inconnues ! de situations nouvelles à tirer de ce fonds ! » (Diderot, [1757] 1980a, p. 145). Les conditions ne constituent néanmoins pas le seul matériau poétique dont un dramaturge puisse faire usage, puisque chez Diderot, la scène est moins tribune politique qu’école de vertu, quoiqu’à terme, politique et morale se rejoignent. Le rôle des arts est en effet de « faire aimer la vertu et haïr le vice » (Diderot, [1758] 1980a, p. 338), but que l’on peut atteindre par la représentation de « la condition du juge […] forcé par les fonctions de son état, ou de manquer à la dignité et à la sainteté de son ministère, et de se déshonorer aux yeux des autres et aux siens, ou de s’immoler lui-même dans ses passions, ses goûts, sa fortune, sa naissance, sa femme et ses enfants » (p. 336), tout comme par la représentation de la « mort de Socrate », « sorte de drame où l’on présenterait la morale directement et avec succès » et qu’il faudrait, pour « trouv[er] froid », n’avoir « ni énergie dans l’âme, ni idée de la véritable éloquence, ni sensibilité, ni entrailles » (p. 340). Aussi l’essentiel est-il que les pièces fassent impression sur le public : « ce ne sont pas mots que je veux remporter du théâtre, mais des impressions » (p. 339) tout à la fois promesses et occasions d’épanouissement de la vertu5.
20Ces impressions ne peuvent se produire que si le poète offre aux spectateurs des tableaux doués d’une force et d’une énergie dont Diderot considère les mœurs contemporaines comme cruellement dépourvues, dans la mesure où « plus un peuple est civilisé, poli, moins ses mœurs sont poétiques » (p. 400), plus elles sont au contraire « faibles, petites et maniérées » (p. 402). Les mœurs poétiques n’appartiennent donc pas à une société ayant érigé la décence en valeur éthique et en norme comportementale, mais sont le propre d’une époque où l’expression et l’action passent par la démonstration. C’est ce que montre l’énumération que fait Diderot pour décrire le temps où « la nature prépare des modèles à l’art » (p. 400) :
C’est le temps où les enfants s’arrachent les cheveux autour du lit d’un père moribond ; où une mère découvre son sein et conjure son fils par les mamelles qui l’ont allaité ; où un ami se coupe la chevelure et la répand sur le cadavre de son ami ; […] où les veuves échevelées se déchirent le visage de leurs ongles, si la mort leur a ravi un époux ; où les chefs du peuple dans les calamités publiques posent leur front humilié dans la poussière, ouvrent leurs vêtements dans la douleur et se frappent la poitrine ; […] où des pythies écumantes par la présence d’un démon qui les tourmente, sont assises sur des trépieds, ont les yeux égarés, et font mugir de leurs cris prophétique le fond obscur des antres (p. 400-401).
21Dès lors, c’est en recourant à l’imagination que le dramaturge vivant dans une société au raffinement poétiquement délétère – « tout s’affaiblit en s’adoucissant » (p. 400) – parviendra à donner à ses œuvres la force pathétique nécessaire pour qu’elles fassent impression sur le spectateur : « il tâchera de les embellir [les mœurs de son époque] ; il choisira les circonstances qui prêtent le plus à son art ; il négligera les autres, et il osera en supposer quelques-unes » (p. 402-403).
22Chez Mercier, très logiquement, rien de tel : le poète n’a pas à imaginer, mais à observer le réel qui l’entoure. Aussi Mercier propose-t-il de mettre sur la scène des caractères et des conditions tels que le « prodigue, qui paye chèrement des frivolités », mais « qui parmi tant de dissipations n’a pas imaginé un acte de bienfaisance », l’« homme […] qui voit l’ouvrier sans pain réclamer son salaire, et qui sourit de l’avoir trompé » (Mercier, 1999, p. 1244), ou encore les « monstres qui ruinent les moissons avant qu’elles soient sorties de terre, qui par de coupables et sûres manœuvres font naître la famine tandis qu’ils tiennent enfermés les grains nourriciers, qui se réjouissent des soupirs du peuple, qui entendent avec volupté les cris que lui arrache le besoin, fondant leur opulence excessive sur la nécessité extrême qui lui exprimera la vie ou la dernière goutte de son sang » (p. 1248). La liste continue avec la mention de « monstres encore plus noirs » :
Il est des hommes qui environnés d’êtres souffrants, dans ces maisons publiques qu’a élevées la charité, sont durs et froids à leurs plaintes ; des hommes qui ne prennent le nom d’administrateurs que pour couper en deux le linceul qui couvre à peine ce moribond, pour lui ravir la goutte de bouillon qu’attendent ses lèvres épuisées, que pour marchander les secours qui peuvent lui racheter la vie, qui s’enrichissent en traçant des listes mortuaires, en comptant des cercueils, et qui roulent un équipage fastueux, composé le plus souvent des morceaux de pain retranchés à quatre ou cinq mille infortunés qui ont toujours faim » (p. 1248-1249).
23L’indignation augmente chez Mercier à mesure qu’il écrit, au point, dit-il, que « la douleur [l’]oppresse et qu’[il] n’aur[a] pas la force d’achever » (p. 1249). Cette mise en scène de soi comme sujet sensible incapable de supporter la pensée de douleur d’autrui est exactement l’effet qu’il espère que produira chez le public le spectacle de la misère : les vrais monstres ne sont pas à chercher du côté d’une mythologie gréco-latine qui ne dit rien de la société contemporaine, mais bien du côté de ceux qui tirent profit de l’« horrible inégalité des fortunes » (Mercier, [1783] 1994, p. 677), c’est-à-dire de la misère et de la souffrance de leurs semblables.
La scène comme tribunal alternatif
24Mercier conclut le chapitre « Nécessiteux » du Tableau de Paris en disant que « le malheureux qui monte sur l’échafaud, [lui] paraît toujours accuser un riche » ([1783] 1994, p. 678). La scène constitue pour lui un lieu de concrétisation de cette accusation implicitement portée par les condamnations à mort des infortunés, le théâtre étant un tribunal moral palliant les insuffisances et les injustices du système judiciaire. L’analogie est très clairement établie par Mercier :
Je sais que c’est au bourreau à frapper ces hommes sacrilèges ; mais enfin puisque les lois se sont endormies sur ces crimes épouvantables (que des supplices ne pourraient assez expier), c’est au poète à jeter son cri de douleur, et à réveiller ceux qui se taisent lorsque de tels forfaits déshonorent une nation et flétrissent le nom d’homme ([1773] 1999, p. 1248).
25La scène apparaît donc comme un tribunal alternatif, offrant un autre spectacle que celui que propose la justice pénale d’Ancien Régime, considérée par Mercier comme l’alliée objective des riches : « l’injuste distribution de la propriété a été maintenue par les lois mêmes et par les supplices » ([1783], 1994, p. 678). Dans Surveiller et punir (1975), Michel Foucault a montré que « dans les cérémonies du supplice, le personnage principal, c’est le peuple, dont la présence réelle et immédiate est requise pour leur accomplissement » (p. 61). L’une des fonctions de cette présence est d’assurer la publicité du crime et de son châtiment, ni l’un ni l’autre ne devant demeurer ignorés.
26Précisément, pour Mercier, le poète dispose lui aussi d’un pouvoir d’exposition lui permettant de « porter le flambeau de la vérité dans le repaire obscur où les méchants travaillent leurs iniquités, de percer dans le sein des grandeurs le vil automate qui s’érige en tyran, de le traîner tremblant à la clarté importune au crime » ([1773], 1999, p. 1196). Dans l’Éloge de Richardson, réinterprétant l’allégorie de la caverne de Platon, Diderot emploie une image similaire, mais sans lui donner la portée politique que lui confère Mercier :
[…] c’est lui [le romancier] qui porte le flambeau au fond de la caverne ; c’est lui qui apprend à discerner les motifs subtils et déshonnêtes, qui se cachent et se dérobent sous d’autres motifs qui sont honnêtes […]. Il souffle sur le fantôme sublime qui se présente à l’entrée de la caverne ; et le More hideux qu’il masquait, s’aperçoit (Diderot [1762], 1980b, p. 195).
27Si pour les deux auteurs, le poète dévoile et révèle, cette mise en lumière s’applique à des comportements humains et moraux chez Diderot, tandis qu’elle concerne des réalités politiques et sociales chez Mercier.
28C’est particulièrement tangible dans le rapprochement que Mercier établit entre le poète et le savetier de Messine : lassé de voir chaque jour des crimes se commettre sans jamais être punis, ce savetier décide de faire justice lui-même en exécutant les coupables. Si le poète ne doit pas lui ressembler parce que « cet homme, avec tout son zèle pour la justice, n’était qu’un assassin », il doit cependant
réfléchir profondément sur le caractère du savetier ; il doit sentir que n’armant, lui, que les traits invisibles de sa plume, il peut en quelque sorte imiter le juge et l’exécuteur de Messine, aller comme lui à la recherche des méchants, […] et les percer avec l’arme morale qu’il tient en main ; il doit leur livrer une guerre éternelle ; et plus heureux, il n’aura jamais de remords à connaître, en exerçant cette vindicte publique (Mercier, [1773],1999, p. 1200).
29Pour être morales, l’arme et la condamnation n’en seront pas moins efficaces, puisque le tribunal dramatique a lui aussi le pouvoir d’infliger l’infamie à ceux qu’il reconnaît coupables : si le poète remplit sa fonction de vengeur de la dignité publique, alors le théâtre sera bel et bien une « cour souveraine, où l’ennemi de la patrie ser[a] cité, et livré à l’infamie » (p. 1197). Rappelons qu’à l’époque, l’infamie est une sanction juridique : « sont infâmes », c’est-à-dire « déchu[s] non seulement des dignités et des charges ; mais encore de tout ce qui est fondé sur la réputation d’honneur et de probité », « tous ceux qui sont condamnés au fouet, au bannissement, à une amende pécuniaire en matière criminelle, à une aumône en matière civile », peut-on lire dans le Trévoux de 1778. Aux yeux de Mercier, le spectacle théâtral est donc tout aussi politique que le spectacle pénal.
*
30Si Diderot et Mercier considèrent tous deux que la force pathétique d’une scène gît dans la violence de la situation représentée, ils ne puisent pas cette violence à la même source. Dans une formule bien connue, Diderot écrit que « la poésie veut quelque chose d’énorme, de barbare et de sauvage » ([1758] 1980a, p. 402). Il trouve cette barbarie et cette sauvagerie dans une époque antique largement fantasmée, où la civilisation n’a pas encore poli les mœurs et où l’expression des passions n’est pas encore contenue par un impératif de décence et un idéal de contrôle de soi, mais libre et par conséquent spectaculaire et pathétique. Le corps souffrant est donc pour Diderot un objet esthétique susceptible de produire des impressions. Il n’en va pas exactement de même chez Mercier, pour qui la sauvagerie et la barbarie sont celles de ses contemporains prêts à laisser mourir leurs semblables pour s’enrichir. Dès lors, quand Mercier pense à un corps souffrant de mère, il pense à celui d’une « malheureuse mère, impuissante à nourrir son fils à la mamelle, [qui] voit son sein épuisé tromper la bouche affamée de l’enfant chéri, dont la débile existence pèse à celle qui lui a donné le jour, et qui ne peut retarder que de quelques instants la mort prête à l’enlever » ([1783] 1994, p. 653). Diderot songe quant à lui à Clytemnestre hurlant ou à une mère qui, venant d’apprendre le décès de son fils non pas mort de faim mais tué dans un combat singulier, pleure en serrant un crucifix dans ses bras6. Pour Mercier, le théâtre est un tribunal où le poète est tout à la fois juge, accusateur et bourreau : la scène est un échafaud vouant à l’infamie morale les coupables que ne condamne pas le système judiciaire, sanction garantie par l’adhésion pathétique du public au spectacle de la souffrance. Chez Mercier, esthétique et politique sont donc inextricablement liées.