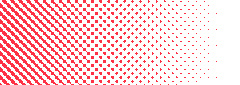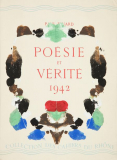
Poésie scientifique et poétique des sciences au xixe siècle
1Au xixe siècle s’invente une manière de concevoir le vrai qu’on appelle le positif, et celui‑ci est plus volontiers l’objet des sciences que des lettres. On assiste même à une séparation progressive, ou parfois par à‑coups brutaux, entre ces deux domaines de la culture, si bien que les sciences pourront revendiquer de détenir l’accès à la vérité et s’opposer en cela aux illusions et aux approximations littéraires dont la poésie est la fine pointe, c’est‑à‑dire le comble1.
2Pourtant, il faut se garder d’acquiescer à l’histoire positiviste du positivisme et ne pas prendre pour argent comptant le mythe qu’il s’est construit. Les sciences demeurent tributaires, bon gré mal gré, du langage, dans leur recherche de l’expression vraie, adéquate. De ce fait, elles ont besoin des lettres pour se dire et même pour s’élaborer : c’est ce qu’il convient d’établir en premier lieu en revenant sur la conception que des savants purent se faire de l’écriture de la science. Par ailleurs, la poésie, conçue ici comme travail du langage sur lui‑même pour affiner et renouveler son expression, est nécessaire voire consubstantielle à l’expression des sciences dans leur ambition véridictoire. Autrement dit, la vérité scientifique est une vérité poétique. On peut en effet montrer que les savants durent prendre conscience et affirmer que l’écriture de la science doit assumer sa poéticité, ou du moins sa figuralité. Enfin, on peut utiliser la poésie scientifique, ce genre poétique rare et méconnu, pour mettre en évidence que les mots de la science sont pris dans une large intertextualité qui les fait participer à la culture commune.
3En effet, le genre de la poésie scientifique dont il sera question à la fin de cet article, pratiqué au moins depuis Lucrèce et jusqu’à Raymond Queneau, connaît une flambée particulière en France dans les quarante premières années du xixe siècle2. Plutôt étranger au mouvement romantique, il préfigure une forme de modernité qui n’aura pas le succès de celle qui s’incarne en Baudelaire mais semble prêcher dans le désert l’union des sciences et des lettres. Volontiers académique ou érudite, parfois humanitaire ou politisée, produite par des amateurs autant que par des poètes patentés, la poésie scientifique documente les relations difficiles mais vivaces entre les lettres et les sciences en un siècle où chaque discipline de l’esprit tend à se spécialiser et s’autonomiser3.
4Les réflexions qui suivent entendent se situer à l’intersection de deux champs de recherche : d’une part l’histoire et la poétique de la littérature traitant des sciences, d’autre part la poétique des sciences.
5Dans le champ des recherches sur les relations entre littérature et sciences, après que Charles P. Snow a cru pouvoir diagnostiquer la séparation des « deux cultures4 », des études ont montré que les relations étaient pourtant vivaces. Ainsi, l’épistémocritique fondée par Michel Pierssens vise à mettre en évidence le rôle de la littérature comme véhicule de savoirs5. Dans un livre fondateur, Darwin’s plots, Gillian Beer s’est attachée à montrer d’une part que la démarche scientifique de Darwin était nourrie par une culture littéraire, d’autre part qu’elle offrait en retour des schémas narratifs darwiniens à la littérature6. L’histoire et la théorie des disciplines permettent de comprendre pourquoi celles‑ci semblent se tourner le dos alors que leurs liens sont indéfectibles7. Ces relations sont documentées, pour le domaine anglophone, par l’anthologie Science and literature fournie par Laura Otis, tandis que les cultural studies inspirent les science and literature studies, qui dépassent le point de vue disciplinaire8. Pour la période dont il est question dans cet article, à propos du domaine français, les travaux du projet « Biolographes » ont récemment mis au jour les relations qui unissent les sciences du vivant et la littérature du xixe siècle9.
6Prenant le point de vue des sciences, des travaux comme ceux de Jean‑Marc Lévy‑Leblond plaident pour réinscrire la science dans la culture10. Fernand Hallyn a pu montrer dans la rhétorique et la poétique des textes scientifiques les structures fondamentales de la connaissance scientifique et ses travaux fondateurs ont commencé à rendre possible la compréhension du tout culturel unissant sciences et lettres11. Ainsi, Frédérique Aït‑Touati a pu montrer que, à l’époque moderne, la fiction ne s’oppose pas à la science mais lui est consubstantielle12. Le présent article s’inscrit dans le sillage de ces travaux en proposant une méthode originale qui réunit les études sur « littérature et sciences » et la poétique des sciences. Il s’agit de mettre en évidence la poéticité du discours scientifique et d’expliquer ainsi que la poésie scientifique n’est pas une littérature d’inspiration scientifique, mais le visage littéraire de la science révélé dans la culture.
Les lettres au service de l’expression scientifique
7La poésie et la science, en France, au moment de la naissance du positivisme, peuvent être représentées comme des activités opposées de l’esprit humain. Ainsi, pour le grand paléontologue Georges Cuvier, figure incarnant littéralement la science officielle au début du xixe siècle, le poète est le contre‑modèle du savant et il utilise le mot comme une insulte pour qualifier ses adversaires intellectuels, Lamarck et Geoffroy Saint‑Hilaire. Leur conception du règne animal, selon lui, « n’a de réalité que dans l’imagination de quelques naturalistes plus poëtes qu’observateurs13 ». Il insistera lourdement en reprochant à Lamarck d’avoir eu « trop de complaisance pour une imagination vive » qui l’a fait mêler à la science « des conceptions fantastiques14 ». Il en conclut que le système de Lamarck « peut amuser l’imagination d’un poète15 ». Le nom de poète disqualifie ainsi le scientifique au nom d’une conception de la recherche de la vérité scientifique qui doit renoncer à l’usage de l’imagination pour se borner à l’observation. On peut alors supposer que vérité scientifique et vérité poétique emportent dans leurs divergences deux disciplines de l’esprit qui semblent irréconciliables.
8Mais savants et écrivains ont souvent accordé aux lettres, a minima, une fonction ancillaire dans la formation scientifique, considérant qu’un spécialiste des sciences a besoin de savoir écrire correctement pour communiquer le fruit de ses recherches16. La formation littéraire n’est donc pas un obstacle à la formation scientifique et, lors d’un débat à la Chambre à propos de programmes scolaires, le scientifique Arago et le poète Lamartine, tous deux députés, purent échanger des amabilités, témoignant que les disciplines étaient prêtes à reconnaître mutuellement leurs prérogatives et à collaborer17. Lamartine pouvait ainsi affirmer : « Bien loin de se nuire, bien loin de se combattre, elles se fortifient, elles se complètent l’une par l’autre : les sciences sont les éléments de la pensée, les lettres sont la lumière des sciences18 ».
9Ainsi, les textes ne sont pas rares où l’on rapporte les goûts et la formation littéraire de certains savants19. Mieux encore, ils sont parfois honorés du titre d’écrivains. Ce n’est plus alors une insulte qui les discrédite mais une valorisation de leur capacité à dire ce que leur science a mis au jour. Certaines figures majeures de la science ayant beaucoup écrit et ayant été lues au‑delà du cercle des spécialistes, la fin du xixe siècle invente même la notion d’« écrivain scientifique » pour désigner ceux qui devront particulièrement être lus par les élèves des filières scientifiques du nouveau baccalauréat20. Ce n’est là que l’enregistrement par les programmes scolaires d’une idée répandue depuis un siècle. Cuvier, reçu à l’Académie française, avait été loué pour son « talent de style21 », d’ailleurs reconnu par Balzac dans une page de La Peau de chagrin22. De même, après la mort du grand mathématicien Laplace, qui avait lui aussi siégé à l’Académie française, on rappela que celle‑ci
avait à distinguer dans M. de Laplace, l’écrivain correct et élégant, l’homme de goût fidèle aux doctrines classiques, le philosophe qui savait honorer les lettres. […] Aussi y avait‑il peu d’écrivains qui apportassent plus de soin à faire que la justesse et la clarté de l’expression répondissent à la précision et à la netteté de la pensée : aussi avons‑nous vu peu de littérateurs dont la mémoire fût mieux remplie des beaux passages de la poésie ancienne et moderne, et qui se plussent davantage à les rappeler23.
10Ainsi, le statut et le nom d’écrivain peuvent être reconnus aux savants, surtout s’ils sont imbus de culture littéraire. Lorsqu’émerge l’idée d’un style scientifique, elle s’inscrit dans la tradition classique et se caractérise par la clarté24. Le physicien Fourier en donne la formule la plus synthétique en en faisant la manifestation du génie de la langue française :
Le caractère principal de la langue française est la clarté. Soit qu’elle expose les principes des sciences, soit qu’elle décrive les plus grands objets de la nature, elle est simple, élégante, noble et précise ; l’expression ne laisse dans l’esprit ni obscurité, ni incertitude ; chaque élément du discours est un trait de lumière25.
11Toucher au vrai pourrait ainsi être la devise de l’écriture scientifique et ce qui la rattache à l’idéal classique. Ainsi, Ernest Renan, citant Fénelon alors qu’il fait l’éloge de Claude Bernard, réaffirme une communauté de principes entre le style du savant et celui de l’orateur, voire du poète, qui se consacrent tous à la recherche de la vérité. La rhétorique des sciences est « au fond identique à celle de l’orateur, “qui ne se sert de la parole que pour la pensée et de la pensée que pour la vérité !” Rhétorique au fond identique à celle du grand poète ! Car il y a une logique dans une tragédie en cinq actes comme dans un mémoire de physiologie26». C’est finalement dans la doctrine classique que l’on trouve le moyen d’unifier sciences et lettres : le physicien Jean‑Baptiste Biot, qui siège à l’Académie des sciences et à l’Académie française, invoque Boileau pour recommander aux écrivains de se tenir à une vérité qui ne puisse tomber sous le coup de la critique scientifique :
Rien n’est beau que le vrai : le vrai seul est aimable ;
Il doit régner partout, et même dans la fable27.
12À la lecture de ces discours de Daru, Fourier, Renan, Biot ou de bien d’autres encore, qui remontent à Descartes et Boileau pour définir le bon style scientifique, et qui en retrouvent l’exemple chez les contemporains Laplace et Claude Bernard, on peut comprendre que l’idée de style scientifique se soit développée dans un mouvement de réaction aux avant‑gardes littéraires du xixe siècle, en particulier contre le romantisme puis contre le symbolisme. En revanche, certains discours rapprochent cette ambition stylistique de celle des poètes parnassiens — ou pour le dire en des termes plus explicites, des poètes partisans d’un nouveau classicisme lexical, syntaxique et prosodique, particulièrement dans la seconde moitié du siècle et surtout après 187028.
13Mais, en dehors de ces variations historiques et à un niveau plus fondamental que celui de l’éducation littéraire ou que la comparaison de styles de communication, la poétique peut légitimement prendre pour objet le langage de la science.
La poéticité du langage scientifique
14Les discours qu’écrivent les savants ne visent pas seulement à communiquer leurs résultats mais ils sont également, et plus fondamentalement, l’expression de l’invention, c’est‑à‑dire la recherche des mots qui correspondent adéquatement à une vérité inouïe. Ainsi, pour innover en sciences, ou même ne serait‑ce que pour dire vrai, il faut disposer d’une langue adéquate. Et la langue scientifique ayant besoin de se créer son propre lexique, ou du moins un usage propre du lexique, elle use de métaphores, de figures, pour dire ses vérités.
15Les termes employés par les savants dans leur discipline sont souvent empruntés au langage courant ou à d’autres disciplines spécialisées avec un sens analogue et néanmoins différent. À ce propos, Fernand Hallyn rappelle que Max Black voyait dans la métaphore la partie apparente d’un modèle scientifique dont elle est non seulement un moyen heuristique et expressif mais éventuellement le noyau ou le point de départ29. Plus d’un savant, en effet, devant s’expliquer sur sa manière d’exposer ses travaux, reconnaît la difficulté de faire passer des idées nouvelles dans le langage commun et la fréquente nécessité de recourir à un usage figuré des mots courants. Ainsi, Claude Bernard admet que l’usage des mots dans le discours scientifique doit recourir à des « expressions littéraires » : « Il n’y a aucune réalité objective dans les mots vie, mort, santé, maladie. Ce sont des expressions littéraires dont nous nous servons parce qu’elles représentent à notre esprit l’apparence de certains phénomènes30 ». Il invoque à ce propos l’autorité de Newton qui écrivait que les corps tombent vers le centre de la terre « quasi esset attractio », comme si une force d’attraction s’appliquait à ces corps sans pourtant que l’on puisse observer cette force elle‑même. Les mots ne sont pas, dans de tels cas, une tromperie mais un expédient nécessaire pour rattacher le discours aux représentations communes quand on ne peut pas encore en redéfinir scientifiquement certains aspects.
16Dès le xixe siècle, ce point avait été théorisé par Augustin Cournot, qui considérait les figures comme un fondement du langage scientifique : selon lui, le langage figuré est nécessaire à l’expression de nombreuses réalités et le langage scientifique y a recours aussi bien que la poésie. L’usage des figures ne serait pas un risque mais plutôt une nécessité et un gage de qualité pour les sciences :
Les formes poétiques et figurées du langage sont souvent un moyen et parfois l’unique moyen d’expression pour la pensée philosophique. C’est ainsi que la philosophie s’allie à la poésie et à l’art, quand d’autre part, comme nous l’expliquerons, elle s’unit étroitement au système des connaissances scientifiques31.
17Les figures du langage ne parasitent pas l’information mais servent sa formulation et sa transmission claire et efficace. En effet, « la science la plus sévère a aussi son langage poétique et figuré, des images dont on ne pourrait lui interdire l’emploi sans nuire essentiellement à la concision, à la netteté de l’expression et à la clarté du discours32».
18Charles Darwin illustre bien ce point lorsqu’il commente ses choix d’écriture après qu’ils ont été contestés par ses adversaires. Dès l’édition de 1859 de On the Origin of Species, Darwin avait signalé que l’expression struggle for life avait une dimension métaphorique mais avait aussi expliqué pourquoi cette métaphore était utile et nécessaire33. Se voyant pourtant reprocher de s’être pris au piège de ses personnifications en prêtant à la nature des intentions qu’elle n’a pas, il répond dans l’édition de 1861 que « ces expressions métaphoriques » sont « nécessaires à la clarté succincte de l’expression », que d’ailleurs « chacun sait ce qu’[elles signifient] » et qu’on se « familiarisera » avec ces usages34. Il ajoute que personne ne se plaint de l’expression affinités électives, utilisée en chimie, alors qu’elle est très évidemment métaphorique et anthropomorphique35. Le chimiste Guyton de Morveau l’avait adoptée en 1786, malgré son caractère figuré, en reconnaissant qu’elle n’appartenait pas originellement à la chimie et que, « dans le discours figuré, [elle] ne s’applique guère qu’à des rapports moraux ou métaphysiques36». Quand Goethe retient le mot Wahlverwandschaften (affinités électives) pour titre de son roman en 1808, il le justifie au chapitre IV en remarquant le tropisme anthropomorphique des hommes qui appliquent à des êtres inanimés le vocabulaire caractérisant habituellement des êtres animés, particulièrement des humains37. L’anatomiste Étienne Geoffroy Saint‑Hilaire pourra même voir dans l’attraction et les affinités électives un fondement théorique à ce qu’il appelle lui-même « attraction de soi pour soi38 ». Les affinités électives sont ainsi passées du discours moraliste à la chimie puis à l’anatomie en assimilant entretemps l’idée d’attraction : la métaphore commode est devenue un principe d’analogie interdisciplinaire et relie des discours hétérogènes.
19On n’est donc pas surpris que Théophile Gautier trouve dans les « affinités » un principe propice à un traitement poétique, jouant de l’analogie entre le sens matériel et le sens moral. Le poème qui ouvre Émaux et Camées dès l’édition de 1852, après la « Préface », affiche un titre significatif : « Affinités secrètes. Madrigal panthéiste39 ». Gautier y chante différentes amours rangées sur une échelle des êtres s’élevant de la pierre à l’homme. Le cycle de la vie animé par les « affinités secrètes » est exemplaire de l’emploi analogique d’un terme qui permet de superposer un discours poétique et ses lieux communs à un discours scientifique, parce qu’il fait résonner en lui comme une polyphonie pluri‑disciplinaire.
20Mais cet aspect du langage scientifique prête le flanc à la critique, et notamment à l’accusation de confondre avec la réalité des vues de l’esprit construites dans le langage et y demeurant. Or, ce risque est une transgression flagrante de l’idéal de transparence et d’univocité qui anime la démarche positiviste. Un débat nourri a donc lieu au cours du xixe siècle autour des normes du langage scientifique et sur ce qui doit le distinguer des usages courants ou des usages littéraires40. La spécificité de l’usage scientifique de la langue tend en effet à devenir un critère de scientificité et cela implique qu’une langue scientifique se distingue nettement de la langue littéraire, coupant les ponts et brûlant ses vaisseaux, si l’on peut dire. Ainsi s’ouvre une ère du soupçon contre le mésusage des mots dans le discours scientifique et se développent une nomenclature et une rhétorique propres aux sciences. C’est même la mathématisation des sciences qui, à terme, les exclura de la langue commune. Malgré tout, le discours scientifique demeure, au moins provisoirement, partie prenante de la culture et, comme tel, trouvant ses ressources dans la langue commune, il y travaille et continue à faire partie de l’intertexte culturel global.
La poésie scientifique
21Si ce travail sur la langue se laisse apercevoir dans les textes scientifiques, il s’exhibe dans un genre littéraire peu connu et pourtant vivace au xixe siècle : la poésie scientifique41. Népomucène Lemercier, Jacques Delille, Victor Hugo, Jean Richepin, René Ghil et une pléiade de minores s’emploient en effet à formuler dans leurs vers la nouveauté que produisent les sciences et les techniques. Tandis que les savants luttent prudemment avec la langue pour qu’elle ne les trahisse pas, les poètes la sollicitent sans complexe — ou plutôt, ils traitent des mêmes matières mais en s’appliquant, les uns, les critères de scientificité, les autres, les règles du goût poétique.
22Ce n’est certes pas dans la poésie scientifique que se donne à voir la vérité scientifique mais c’est là, peut‑être mieux qu’ailleurs, que se révèle la nécessité d’une poétique des sciences, c’est‑à‑dire le fait que la science ne peut se contenter d’employer la langue telle qu’elle est mais qu’elle a besoin de la tordre à son usage. Ainsi, ce n’est pas directement la poésie qui donne une langue aux scientifiques mais c’est parce que ceux‑ci ont une culture indéfectiblement poétique que leur travail sur la langue est non seulement possible, mais qu’il peut être conçu comme une recherche comparable à celle des poètes42.
23Les théories scientifiques ne s’expriment pas en dehors de la langue. Elles dépendent donc pour se dire d’un usage, d’une tradition, du sens que les mots véhiculent dans un réseau de textes et une diversité d’usages (communs et spécialisés, propres et figurés, anciens et contemporains…), qui résonnent autour de chaque occurrence, y compris dans un texte scientifique43. Cette intertextualité, qui donne à chaque mot une virtualité plurivocalique, est particulièrement déployée par le texte poétique. On peut l’observer par exemple chez Anne Bignan, vainqueur du concours académique de poésie de 1835 avec une « épître à Cuvier », quand il s’interroge à propos du globe :
N’eut-il pas à subir ses guerres intestines,
Ses révolutions, ces combats d’élémens,
Des mondes en travail profonds déchiremens44 ?
24En 1835, le mot révolution convoque inévitablement l’image des événements politiques de 1789 et de 1830 ; en le coordonnant à « guerres intestines », « combats » et « déchiremens », le poète rend l’allusion transparente. Mais le mot, qui fut d’abord usité en astronomie dans un sens purement mécanique, fut employé au xviiie siècle pour désigner les bouleversements géologiques de la surface de la Terre. Cet usage a été rendu célèbre par Cuvier dans son Discours sur les révolutions du globe (1812) qui fut lu par un large public. Puisque le paléontologue pouvait compter sur le fait que, au moins autant que le souvenir des textes savants de Buffon, le terme évoquait un événement historique, la réalité de l’histoire récente pouvait renforcer la puissance de figuration de la notion convoquée et des temps géologiques. Le poète, en explicitant l’intertextualité du mot, manifeste le fonctionnement de la langue et fait communiquer poésie et géologie, histoire politique et histoire antédiluvienne. Dans les vers qui suivent, il se félicite aussi que les travaux de Cuvier confirment le récit biblique du Déluge et réconcilient ainsi la science avec la religion. C’est encore la cohérence et l’unité d’une culture qui est en jeu : le mot révolution est dans ce contexte une sorte de passerelle qui fait le lien entre deux domaines de la culture.
25Sur le même thème, lorsque Monbarlet aborde dans son poème géologique la théorie des catastrophes, encore très en vogue au début du xixe siècle, il entend rendre sensibles les révolutions géologiques en les rapportant à des dimensions humaines :
Plus d’une catastrophe a passé sur la terre,
Apportant aux humains de terribles leçons ;
Les ravages des eaux, les volcans et la guerre
Ont bien souvent détruit de brillantes moissons ;
Des races ont péri ; Ninive la superbe,
Dort perdue à côté de ses sphinx accroupis45…
26C’est parce que tout événement doit porter une « leçon » que les catastrophes géologiques sont rapportées à la chute des civilisations. Quand le poète parle des « races » qui ont péri, il use complaisamment de la syllepse comprenant sous le même mot des familles d’êtres vivants et des peuples humains. La disparition et la succession des espèces vivantes au long des âges géologiques est expliquée ainsi par une analogie avec la chute des civilisations, thème classique de l’historiographie contemporaine.
27Quand passe le goût pour les catastrophes et les révolutions, un nouvel imaginaire semble porter l’idée qu’un changement peut être progressif et l’on cherche les images et les mots qui pourront l’exprimer. Alors même qu’ils ignorent probablement les nouveaux travaux scientifiques plaidant pour des modifications géologiques lentes et graduelles, les poètes relèvent le défi de décrire des transformations continues en abandonnant le vocabulaire de la révolution46. Ainsi, abordant le sujet des déluges dans son grand poème philosophique sur Les Mystères de Flore, Alfred Leconte choisit de thématiser la contradiction entre évolution et bouleversements47. Il évoque en ces termes, en s’adressant à la déesse Flore, la main divine qui préside à la Création :
— Cette puissante main, ce pouvoir invisible
Qui te frappa d’un coup si lent ou si terrible,
C’est la loi du progrès, loi des attractions ;
La loi qui régit tout, loi des perfections48.
28Le bel oxymore d’un « coup si lent » manifeste la contradiction imaginaire irréductible entre l’idée de destruction des espèces et l’hypothèse de son opération progressive ; d’où l’alternative d’un coup « lent » ou « terrible », autrement dit d’une catastrophe soudaine ou d’un processus d’extinction. Or, Leconte fait pencher la balance du côté de la lenteur en écrivant plus loin :
— Au moment où la terre entr’ouvrait son abîme,
De ce pouvoir puissant elle‑même victime,
Tiraillée en tout [sic] sens par des convulsions,
Elle suivait le cours de ses transitions.
— Quels animaux hardis, quels êtres invincibles
Ont affronté les chocs de ces âges terribles ?
Lente dans ses efforts, sage dans ses excès,
Pas à pas la nature a réglé ses progrès49.
29Pour le député progressiste qu’est Alfred Leconte, la nature offre des analogies avec les passions et l’histoire de l’humanité. Le progrès donne ainsi naturellement un sens à la marche de la nature et la sagesse de celle‑ci prêche par l’exemple une sorte de patience. Sans même disserter sur les dates et les intervalles, l’imaginaire du temps long s’épanouit chez lui car il est en harmonie avec l’impératif politique de persévérance et de patience qu’appelle sa conception du progrès. Si la nature peut se montrer « sage dans ses excès » elle est aussi, et corollairement, « lente dans ses efforts », ce qui est presque une recommandation morale et politique faite au lecteur. La vérité scientifique recherchée dans un tel texte ne se cantonne pas à une théorie géologique : elle emporte avec elle toute une conception du monde naturel et humain. Le langage emprunté par le poète manifeste cette unité essentielle entre ce que cherche la science et ce que veut exprimer la poésie.
30Ainsi, l’expression poétique peut se révéler le test imaginaire des représentations scientifiques : les recherches des poètes mettent à l’épreuve de la verbalisation les théories des savants ou même les préfigurent. Ils puisent dans la topique traditionnelle, dans les manières de dire partagées et dans les ressources de leur imagination pour faire l’expérience de conceptions que les savants expérimentent ou observent par leurs propres moyens. C’est le cas, par exemple, lorsque Delille évoque la théorie de la végétation : ses descriptions de la sève font écho — peut‑être malgré lui — aux théories de Lamarck sur la circulation, alors qu’il ne le cite jamais et que sa documentation scientifique ne peut que l’en détourner.
31Que Delille soit absolument étranger aux développements des théories transformistes contemporaines ne l’empêche pas d’avoir sa place dans l’imaginaire évolutionniste, au contraire. Il n’est ni l’interprète poétique de sources savantes, ni l’inspirateur de savants en manque de modèles imaginaires. Imbu de la langue de son époque et de toute la tradition poétique, frotté de sciences et intéressé à leur popularisation, il est le témoin de ce que l’imagination peut formuler pour rendre sensible et touchant un phénomène naturel. La vision qu’il offre de la circulation de la sève manifeste ainsi les conditions de possibilité intellectuelles, esthétiques et linguistiques de l’émergence d’une dynamique des fluides vivants, qu’elle soit ou non exploitée par une théorie transformiste.
32Ainsi, en 1808, dans Les Trois Règnes de la nature, au chant VI consacré à la botanique, le poète s’émerveille que « le même suc » puisse, « dans ses métamorphoses », produire l’immense diversité des plantes. Il s’interroge alors :
Qui produit ces effets ? Les différents tissus
Façonnent à leur gré les sucs qu’ils ont reçus,
Et suivant les canaux que leur liqueur inonde,
Moulent différemment la sève vagabonde50.
33Les tissus végétaux « façonnent » les sucs et « moulent » la sève, ce qui implique que la morphogenèse n’est pas dirigée par le fluide lui‑même. Mais cette image amène toutefois l’idée que la forme naît autour de ce fluide et grâce à lui. Or d’autres vers, quelques pages plus loin, infléchissent l’image dans un autre sens :
Toutefois cet amas d’insensibles vaisseaux,
Tous ces sucs déployant leurs fluides réseaux,
Tout cet art merveilleux, ces machines vivantes,
D’êtres si délicats combinaisons savantes,
Long‑temps inaperçus échappèrent aux yeux51.
34Les fluides apparaissent alors comme les véritables agents formateurs du réseau tandis que les vaisseaux, eux, ne semblent pas susceptibles d’action, « insensibles » qu’ils sont. Le flux de la sève est représenté comme une puissance vitale et il véhicule, en outre, la substance de la plante comme cela apparaît dans ces autres vers :
Dois‑je vous dire encor ces minces vésicules
Qui ramassent la sève en d’étroites cellules,
Et ces nombreux canaux où les sucs épaissis
En un solide bois par degrés sont durcis52 ?
35La sève n’est pas ici le simple véhicule des éléments nutritifs comme le montrent les traités botaniques de l’époque. Elle ressemble aux eaux qui, selon Lamarck, charrient les matières comblant les océans, et au sang qui transporte la substance dont le dépôt accroît les organes. Le travail du poète sur la langue consiste ici à réorganiser les relations des termes sève, suc, liqueur, fluide, avec tissus, canaux, vaisseaux, réseaux ou encore cellules. Ses vers agencent à nouveaux frais des notions que les sciences sont en train de mettre en question. Nous pouvons voir ici affleurer, a posteriori, le paradigme évolutionniste qui transformera aussi la conception du règne animal. L’homme n’y est plus nécessairement le point de vue inévitable sur la nature : des poètes tels que Louis Bouilhet, Leconte de Lisle, Jean Richepin ou encore René Ghil écrivent des poèmes évolutionnistes qui cherchent dans la langue les ressources pour élaborer une poétique nouvelle53. Ce sont autant de textes qui montrent le travail dans la langue et dans l’imaginaire qui accompagne l’innovation scientifique.
*
36L’œuvre des poètes scientifiques apparaît aussi comme le lieu où se négocie l’intégration du langage scientifique dans la culture commune. Si l’on envisage avec optimisme ce phénomène, on peut y voir ce que Peter Galison nomme trading zone en parlant de la compréhension et de la collaboration efficace entre différentes disciplines : ce n’est pas un espace où l’on renonce à un savoir spécialisé mais où l’on pratique échange, traduction et interprétation du savoir de l’autre pour trouver un terrain d’entente satisfaisant les exigences épistémologiques des deux parties et garantissant l’efficacité dans le traitement des objets étudiés54. Sous un regard plus pessimiste, cela pourrait constituer un malentendu productif : les deux domaines spécialisés comprennent le terme selon des sens différents mais se donnent réciproquement l’impression de pouvoir se comprendre, ou du moins de ne pas s’invalider mutuellement. Négociation efficace ou malentendu productif, c’est dans une langue commune et au sein d’une culture partagée que se tient cette rencontre des sciences et des lettres.