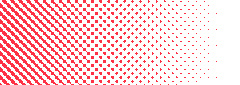Pour une déontologie poétique : la « justesse » du poème chez Roger Caillois
1On ne trouve peut-être pas au xxe siècle de plus âpre censeur que Roger Caillois. En 1933, les cinquième et sixième livraisons du Surréalisme au service de la révolution font paraître « Spécifications de la poésie », essai capital dans la pensée du jeune agrégé de grammaire, notamment pour ce qu’il laisse entrevoir d’une agressivité théorique qui déjà s’affirme. On y trouve, parmi d’autres fustigations du même ordre, la sentence suivante, qui sera reprise dans le — ou du — premier chapitre de La Nécessité d’esprit qu’il compose alors (et qui ne paraîtra qu’à titre posthume, en 1981, chez Gallimard) :
[...] il n’est pas possible à une pensée sévère de ne pas considérer la « poésie » comme le droit donné à n’importe qui de dire n’importe quoi, et cela sans garantie, sans obligation de rendre des comptes.
2Un temps compagnon des poètes du Grand Jeu puis membre éphémère, entre 1932 et 1934, du surréalisme, Caillois se forme, par opposition aux préceptes véhiculés par ces courants, une certaine idée de la poésie, une idée intempestive, inactuelle par de nombreux aspects, une idée exigeante. Comment comprendre, cependant, qu’il soit, à ses débuts, animé du farouche désir « de discréditer si possible la littérature tout entière », qu’il veuille œuvrer à sa « liquidation systématique1 » — pour ensuite reconnaître en la poésie « l’activité, la réalité suprêmes2 » ? Il ne s’agit pas, à notre sens, d’une tardive palinodie : non seulement parce que Caillois ne se livre que de façon malgracieuse à de tels dédits, mais aussi parce qu’il s’est plu, afin d’asseoir son esthétique conservatrice, à mettre en scène son retour à la poésie.
3La poésie contre laquelle Caillois vitupère est, selon lui, une « imposture », poésie déréglée, irresponsable, doublement affranchie des exigences classiques de la composition esthétique — travail, mesure, pérennité — et des tendances naturelles qui président à la naissance des formes. La poésie qu’il rejette, et ne cesse de rejeter, est une « sorte d’activité qui produit des textes qui […] ne sont pas entièrement susceptibles de justifier […] les éléments qui les composent3 ». C’est la poésie issue de l’écriture automatique, du dérèglement de tous les sens, la poésie qui, de la célèbre déclaration de Reverdy sur l’image poétique — « rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées » dont les « rapports » doivent être « lointains et justes4 » — ne retient que l’éloignement, alors que Caillois s’intéresse davantage à la justesse du rapprochement, et refuse de croire que « l’esprit [soit] capable de tout homologuer5 ». Une telle pratique de la poésie n’est que littérature, quand Caillois voudrait en faire une « science de la perception6 », un instrument de vérité.
4Caillois demande alors des comptes au poète : qu’il souscrive à une déontologie professionnelle, qu’il fonde ses vers et leurs images sur le réel ; car la poésie doit prouver, selon lui, à l’heure où elle est le plus réticente à le faire, qu’elle possède bien la dimension gnomique qu’elle prétend détenir. Si l’on est voyant, que l’on fasse voir ; si une vérité gît au fond du texte, qu’on la nomme, qu’on en explique la nature, qu’on en détermine la portée.
5Lancé sur la piste de l’imagination, tourmenté par ses prestiges et ses vertiges, ses réussites et ses échecs, Caillois veut en débusquer l’origine et en circonscrire les pouvoirs. On peut soutenir que l’effort théorique qu’il déploie l’est toujours en direction d’une élucidation des conditions de la pensée et de son expression, notamment poétique — d’une justification sévère des usages de l’imagination. Une sympathie profonde, pense‑t‑il, unit l’imagination aux phénomènes, aux signes que présente la nature — et l’étude de telles sollicitations de l’esprit par le monde doit faire l’objet non d’une littérature frivole mais d’une science de l’expérience vécue, d’une « phénoménologie » ou, comme il le dira ensuite, d’une « logique de l’imaginaire7 ». « Tous mes livres », avoue-t-il donc dans Cases d’un échiquier, « sont ainsi des analyses des données, des ressorts, des effets de l’imagination8 », précisant d’ailleurs qu’à cette période dernière de son parcours, il s’« intéresse beaucoup moins […] aux résultats de l’imagination » et s’ « interroge plutôt sur ses sources, ses démarches, ses ressorts9 ».
6Les « sources » de celle que l’on a pu nommer « la reine des facultés » se trouvent, selon Caillois, dans « la nature : seul registre, seul répertoire, inspiration manifeste ou occulte, tenant et aboutissant total, norme subreptice, table de référence latente et exclusive10 ». Comprendre de quelle manière l’imagination exprime sa vérité et ses égarements dans la poésie, c’est comprendre comment la nature — ses formes et leur genèse, les êtres et les choses qui la peuplent, les principes qui la soutiennent et qui assurent une cohérence où l’homme s’inscrit — sollicite, originairement, l’imagination elle-même. Oblique, la pensée traverse alors les disciplines, recompose les taxinomies, opère des rapprochements audacieux, entrelace les figures du monde et de l’homme, kosmoi fraternels, sur la trame évanescente de l’analogie. L’intelligence poétique de Caillois est, avant tout, une pensée de la nature, une pensée de l’image et des analogies d’abord visuelles qui assurent la continuité de l’univers, de l’esprit et du texte. Ainsi, la vérité du poème provient non de sa signification — le sens est absent de l’univers cailloisien —, mais de sa justesse, de l’adéquation de ses images avec les formes du monde. Si la poésie, selon Caillois, fonctionne comme métonymie de la littérature, l’image est métonymie de la poésie. Pour être juste, la forme doit se répéter, de la nature au texte, à travers les règnes et les métaphores, assurant ainsi, par réduplication, la cohérence de l’ensemble. Pour être efficace, l’image doit surprendre mais non pas étonner ni stupéfier : il lui faut opérer un rapprochement analogique neuf mais sûr, dont l’exactitude assure la pérennité. Pour être vrai, le poème doit publier les vertus de l’homme et les faire durer.
La nature de la poésie
7Il est un topos des plus anciens qui consiste à voir dans le poète un interprète naturel de la nature, qui participe de son intimité, par une mystérieuse sympathie — car, selon cette vision, la nature est d’une certaine façon déjà poète. Cette idée du liber mundi connaîtra, dans l’Antiquité grecque, dans le Timée de Platon ou chez Philon d’Alexandrie, par exemple, mais surtout sous l’influence du judaïsme puis du christianisme, un succès durable : Dieu s’exprime dans la nature, par la nature, sous le signe des phénomènes qu’il nous donne à lire, qu’il charge l’homme de déchiffrer, comme il lui a confié le soin de débusquer les quatre sens de l’Écriture — littéral, allégorique, tropologique et anagogique. Plotin parle d’un poème de l’Univers, poème dramatique où chaque élément a reçu son rôle de la Nature ; Augustin, à son tour, évoquera le chant du monde dont le rythme est le temps même11. Le xviie siècle, plus grammairien, s’intéressera particulièrement aux éléments linguistiques qui composent ce poème : la Nature est structurée comme un langage, système idéogrammatique dont le sens est abscons, parole hiéroglyphique qu’il revient au poète savant, au polymathe, de déchiffrer.
8Un tel poème égare l’esprit, son sens est occulte. Les signes — ou signatures — qui scellent les formes des êtres et des choses doivent indiquer à l’homme, dans l’esprit de Paracelse, leurs caractéristiques secrètes. Ce système signifiant repose sur des analogies visuelles : les formes se répondent, entrent en résonnance. Chaque signe cache une essence et cette morphologie est une ontologie. La Nature, qu’elle soit déesse elle‑même, ou entité distincte mais inféodée au Dieu unique, ou encore, selon la tradition chrétienne, simple création naturée12, est résolument tournée vers l’homme, vers son œil et son esprit. Elle veut être interprétée, n’a été conçue que pour cela. Kant n’en dira pas autrement, comme Goethe étudiant La Métamorphose des plantes (1829)13, et Novalis évoquant, dans Les Disciples à Saïs (1798), « cette grande écriture chiffrée que l’on retrouve partout », aussi bien dans « les formes extérieures » que dans « la structure interne » des choses, et dont l’homme « pressent » la « grammaire », ne pouvant toutefois que la subodorer, tant « ce pressentiment refuse de prendre des formes définies et […] nous livrer la clef des mystères14 ». Le sens du poème de la nature est réticent à se montrer, et l’homme ne peut en saisir que des bribes ; ou bien, selon la métaphore d’élection de ces poètes, la forme est pur graphisme ou pure mélodie. Quoi qu’il en soit, cette écriture chiffrée n’est pas à comprendre sur le mode discursif.
9Caillois adopte du monde une vision indocilement héritière de la cosmologie stoïcienne, de la signatura rerum renaissante, d’une certaine Naturphilosophie de coloration goethéenne, de certains pans de la phénoménologie, qui reconnaît l’univers comme un tissu de causes dont les apparences phénoménales, notamment lorsqu’elles se répètent, sont autant d’indices. La tâche du poète savant, usant de connaissances scientifiques mais les subordonnant à la perception esthétique, est de manifester, par un usage exact des ressources du discours, l’unité de cette pluralité des savoirs. La Nature naturante des Stoïciens est l’artiste qui se trouve à l’origine de toute la création, la cause primordiale de tout le processus causal sur quoi repose le cosmos, cette force invisible qui se manifeste dans tous les phénomènes. C’est en ce sens que, pour les philosophes du Portique, « la Nature aime à se cacher » : elle est la loi derrière l’apparence, l’unité dans la variété, la raison du monde. Et si Caillois hésite infiniment au seuil de la cause première, qu’il répugne à envisager et dont il récuse (parfois comme à regret) toute intentionnalité, il souligne à son tour l’unité du monde sous la bigarrure des phénomènes, le déterminisme qui contraint la matière des choses comme des mots, la nécessité dans laquelle seul l’homme, par ses calculs souvent fâcheux, peut introduire un semblant de jeu.
10Que la tâche du poète soit de « dire le monde », ce lieu commun est ancien et repose sur une relation mimétique. Dans le Timée, dans d’autres poèmes cosmologiques que l’Antiquité nous a légués, une relation ekphrastique unit le texte à l’univers : celui‑ci est un poème que tout poème ne peut que reprendre ou recréer par la démiurgie de la parole. Non seulement le poème appartient à l’univers, mais l’univers se recrée en lui, s’offre une seconde naissance qui donne à voir son dynamisme intrinsèque, que la perception a tendance à figer. Ainsi, le poète est‑il seul à même, selon les mouvements, écoles, théories qui se sont succédé pour gloser son étrange apanage, de recréer, de redynamiser ou d’interpréter le poème du monde. C’est bien là ce que Caillois tentera d’accomplir lorsqu’il s’attachera à recomposer, à partir de la fixité de la pierre, la turbulence de sa genèse, pour révéler sa fraternité avec celle des fantasmes issus de l’imagination. Les deux tendances, recréatrice et herméneutique, ne se font d’ailleurs pas pour lui concurrence et coexistent volontiers au sein d’une même pratique poétique. La perception esthétique du monde s’oppose ainsi à la fois à la perception usuelle, quotidienne, que l’homme en a, et à sa mathématisation scientiste. Il faut ainsi la comprendre comme un rejet de l’utilitarisme qui conditionne les sensations, la compréhension, la connaissance que l’observateur veut avoir.
La Nécessité d’esprit
11Mais le langage qui détermine la pensée trahit la vérité du phénomène et impose ses circonlocutions quand l’évidence de la chose devrait suffire, et où cette évidence ne peut plus se refléter. Caillois, misologue, se méfie des mots et de leurs stupéfiants colifichets, mais il sait bien aussi que c’est là tout notre patrimoine, le pauvre héritage dont il nous faut bien nous contenter, et jamais mésuser. Il rêve sur les pures formes des pierres, « seules stèles uniques sans être arbitraires » et qui ont l’apanage de « la pérennité et [du] sens15 », sur le « caractère chinois » qui se laisse deviner en l’une d’elles, quoiqu’elle dise : « “Je ne signifie rien […] mais j’ai su anticiper l’économie particulière du petit nombre de symboles qui composent une écriture”16 », sur les apparences minérales qui témoignent non d’un sens, mais presque d’un geste scriptural. Il rêve, avant cela, sur les « idéogrammes lyriques » qui, dans l’inconscient culturel et individuel, forment une espèce de langage de l’imagination toute pétrie de nature.
12Dans La Nécessité d’esprit, Caillois postule, ainsi que l’indique le titre même de cet ouvrage tenu secret, que l’esprit est au moins partiellement déterminé par l’influence des formes naturelles. Ce qu’il nomme les « idéogrammes lyriques » forment les soubassements et les manifestations de la fonction lyrique de l’esprit, le tissu conjonctif qui garantit la cohésion entre la psyché et les apparences sensibles — comportements animaux, formes naturelles, etc. Représentations, « unités mentales » à « résonances affectives et intellectuelles » qui « s’appuient sur un support concret », possèdent « une valeur emblématique relativement au sujet » et accumulent « une charge affective considérable », les idéogrammes lyriques assurent la fertilité et le dynamisme de l’association idéelle. Ce sont, suivant la théorie cailloisienne, des « représentations psychiques », des images mentales obsédantes qui peuvent devenir « tyranniques17 ». Elles surgissent d’abord dans le rêve et peuvent, si elles sont assez puissantes, assez suggestives, s’imposer aux activités conscientes et s’insinuer notamment dans l’expression littéraire. « Il s’agit donc », dit‑il, « d’organiser la poésie18 ». Caillois analyse ainsi certains des idéogrammes qui l’émeuvent — la femme fatale, le jeu d’échecs — et tente de les apparier à des symboles culturels ou à des images littéraires. Universel, exhibant sa récurrence à travers les âges, les genres et les auteurs, l’idéogramme lyrique peut être dit « idéogramme objectif ». Analysant ainsi la fascination récurrente qu’exerce la mante religieuse — sur sa propre pensée comme dans la mythologie, comme dans les œuvres également de certains poètes tels que Char et Breton —, Caillois conclut à l’existence d’une « continuité de la nature et de la conscience, particularité qui suffit à rendre compte à la fois de la possibilité et de l’efficacité des idéogrammes objectifs19 ». La mante, son aspect « spectral », ses capacités mimétiques, ses mœurs sexuelles expliquent les nombreuses légendes collectives comme les nombreux fantasmes individuels qui lui sont attachés et l’érigent en modèle d’« idéogramme objectif ».
13« Bien loin de jamais manifester l’arbitraire de l’esprit, chaque association ne [fait] que révéler une nécessité rigoureuse20 » qui est celle de l’intrication des images du monde, « idéogrammes lyriques » qui, dans certains cas, sont donc appelés à revêtir une dimension universelle. Ces « idéogrammes objectifs » sont des « objets qui [sont] si évidemment des signes qu’il devien[t] difficile à quiconque de ne pas être ému par leur présence ou leur représentation21 ». Caillois ajoute que l’« on comprend mieux comment un texte poétique paraît utilisable, puisqu’il est nécessairement fort rare qu’il ne comporte pas un ou plusieurs de ces idéogrammes prégnants où chacun peut trouver son compte22 ».
14Cette théorie qui doit à la psychanalyse autant qu’à Bergson, aux aliénistes autant qu’aux entomologistes, est symptomatique, pensons-nous, de la façon dont Caillois, savant « diagonal », polymathe irrévérencieux, use des postulats et des trouvailles des disciplines constituées pour, les déformant et les hybridant, servir à ses spéculations intrépides. Elle relève aussi d’une vision qu’il n’abandonnera jamais et qui place l’homme et ses arts, en particulier la poésie, dans la continuité de la nature. La théorie des « idéogrammes lyriques » révèle « d’abord la cohérence23 », une cohérence qui surplomberait toute la connaissance, scientifique et esthétique, que l’on peut avoir de l’univers, une cohérence qui réconcilierait la logique et l’irrationnel — et qui seule attesterait, en dernier ressort, de la vérité de l’expression poétique.
15Structurale avant la lettre — et toujours dans les marges —, la démarche de Caillois consiste donc à tenter d’expliquer l’utilisabilité, la communicabilité des images poétiques, leur pouvoir de contagion. Il ne procèdera pas autrement lorsque, dans le cadre du Collège de Sociologie qu’il contribue à fonder, il s’attachera à étudier — et à susciter — la contagion du sacré. Il adresse ainsi au poète, tout en refusant encore d’être reconnu comme tel, une injonction féroce : fonder en nature sa poétique d’après les nécessités de l’imagination humaine. L’Esthétique généralisée qu’il fait paraître en 1969 développe réellement une philosophie continuiste de la nature : seul référent, englobant à la fois l’artiste, l’œuvre et son récipiendaire, la nature est totale et son étude révèle à l’homme les lambeaux d’une totale immanence. L’art peut alors être considéré comme un prolongement des œuvres de la nature et trouve dans ce continuum sa légitimité. L’art abstrait ou brut en peinture, le ready‑made, le mythe en littérature, intéressent particulièrement Caillois parce qu’ils lui paraissent privés du dessein unique et arrogant d’un créateur qui se croit individuel. Soumis à des nécessités qui ne sont pas toutes humaines, ce sont, selon lui, les formes les plus proches de ce que produit la nature, non pas semblable à ses œuvres, ce qui est impossible, mais fraternelles. Étudier la genèse des formes naturelles, comprendre les procédés dont use la nature, constitue ainsi un travail préparatoire à la création — à travers la reconnaissance qu’il n’est de création qu’à la suite et dans les pas de la nature.
« Science de la perception »
16L’art qui se fonde en nature n’est cependant pas pure imitation et Caillois le répète à l’envi. Il y a danger pour l’homme de vouloir égaler la nature, mais un péril non moins grand réside dans la pensée que l’homme n’a aucune responsabilité esthétique envers l’univers. Il ne s’agit donc pas d’imiter servilement les apparences naturelles mais, comme l’écrivait déjà Plotin, de « remont[er] aux raisons, aux logoi, d’où résulte l’effet visible du processus naturel, ce qui revient à dire que l’artiste épouse, en quelque sorte, le processus de genèse des formes et opère comme lui24 ». C’est donc une mimésis médiate, qui intervient après une phase d’enquête scientifique et esthétique, et tente de s’élever jusqu’aux raisons séminales des apparences. Elle suit une méthode — des « voies » qui sont « toujours les mêmes »25 — plus qu’elle ne s’inspire d’un produit. Dans Pierres (1966), L’Écriture des pierres (1970) et Pierres réfléchies (1975), les textes qui livrent le fruit de ses méditations minérales, Caillois tente de comprendre, de se représenter et de recréer par la parole la fournaise des premiers âges qui engendra le spécimen qu’il observe et dont il offre une description, laquelle n’est pas étrangère à la méthode husserlienne de la variation eidétique. Il fait alors alterner les analogies esthétiques et les hypothèses scientifiques. Ces dernières tempèrent les dérives poétiques mais, fécondées par elles, loin de les abroger, leur fournissent aussi une assise. Caillois confirme bien souvent l’essence scripturale, testimoniale de la pierre : celle‑ci est une archive des formes que la nature puis l’art sont contraints de répéter.
17La nature se trouve à l’origine de toute beauté, de toute justesse — de toute vérité, pourrait‑on dire, quoiqu’il faille répéter que la vérité en tant que révélation du sens n’est pas un concept pertinent dans l’œuvre cailloisienne. De l’imagination, il lui paraît nécessaire de comprendre les rouages, pour justifier, en dernier recours, la littérature ; et l’imagination lui semble non seulement imprégnée par les formes sensibles que lui révèle la perception, mais elle obéit, en tant que faculté générative, aux mêmes lois qui expliquent ces formes naturelles. C’est pourquoi, dans la deuxième partie de son œuvre, Caillois opère un retour aux phénomènes et aux analogies qui les unissent. Il se lance dans une entreprise de rédemption de la perception et tente, à sa manière pourtant toujours livresque, de « sauver les phénomènes », de percer l’« écran26 » des mots pour accéder à la vérité des choses. Parce qu’il ne veut plus se payer des mots dont la « multitude, [la] mêlée confuse […] assaillent et […] stupéfient27 » l’esprit, parce qu’il refuse que des littérateurs, mauvais poètes, trament leurs enchantements sur un enchevêtrement de signifiants coupés de leurs signifiés, Caillois cherchera dans l’unique répertoire, c’est‑à‑dire dans la nature, le dépassement des logomachies poétiques et de la misologie, du désir d’en finir avec le langage, qui toujours menace le critique sévère :
Le domaine de la poésie commence avec le sensible et sa nature lui interdit de le renier. Son instrument est l’image, c’est‑à‑dire en premier lieu le pont jeté entre deux données que la science a pour vocation d’étudier séparément et surtout pas dans leurs similitudes éventuelles, qu’elle ne saurait considérer que comme apparences trompeuses28.
18Il s’agit du premier article de la déontologie poétique inlassablement développée par Caillois : si la poésie est faite avant tout de ses images, si elle repose essentiellement sur la métaphore, elle est instrument analogique de connaissance — du monde, de l’esprit, et de la continuité entre le monde et l’esprit. Elle explore des champs du savoir que la science méprise indûment. Pour être « utilisable », toutefois, c’est‑à‑dire utile à l’expression poétique et communicable aux lecteurs, l’image doit être juste. Elle doit, selon Caillois, opérer entre les formes naturelles qui mobilisent l’esprit des rapprochements féconds, mettre au jour des connivences secrètes mais sûres, et révéler, toujours, la cohérence du monde. L’univers peut bien alors être dépourvu de sens, mais pas de structures ; la tâche du poète est de manifester cette cohérence et d’indiquer aux hommes qu’ils y ont leur place. Ainsi, et c’est ce que tente d’expliquer la théorie des « idéogrammes », l’imagination re‑connaît dans la genèse et dans la répétition des formes naturelles une nécessité qui est aussi la sienne. L’image née de l’esprit répond, fait écho à celle du monde plus qu’elle ne la réplique. La perception permet alors de vérifier dans le monde la justesse de l’image, qui a germé dans la pensée et s’exprime dans le poème.
19Mais si tout est nature, celle‑ci même propose à Caillois, comme le sacré, un double aspect, fas et nefas. Les formes qui s’y voient sont toutes justes, et leurs répétitions sont seules susceptibles d’être choisies comme fondement des analogies poétiques. Mais les méthodes de création de la nature, quant à elles, ne sont pas uniment transposables à l’activité humaine, et le poète ne doit pas s’y tromper.
Menace végétale
20Goethe voyait dans la spirale une tendance fondamentale de toute croissance naturelle, notamment de la croissance végétale. Caillois, qui prétendait avoir lu « des rayonnages entiers de romantiques allemands », est séduit par une certaine Naturphilosophie romantique, laquelle prolonge les méditations des polymathes de la Renaissance : vision unitariste d’un univers tissé de répétitions que le savant, convoquant l’ensemble, ou peu s’en faut, des arts libéraux, associant les sciences expérimentales à une perception esthétique qui les domine, tente de déchiffrer. Par son refus, cependant, de toute métaphysique, de tout arrière‑monde, Caillois développe, dans son devisement des formes et des structures du monde, une approche qui n’est pas étrangère aux spéculations les plus matérialistes des Stoïciens et qui révèle une vision immanentiste et dynamique de la nature. Un « élément matériel », et non une « âme » divine, se trouve à l’origine des phénomènes, et cet élément, ce « principe de mouvement », se loge « à l’intérieur de chaque chose et de l’ensemble des choses » : « l’opération de la nature est donc tout à fait analogue à celle d’un art qui serait intérieur à la phusis29». La nature obéit à des lois dont Caillois martèle à l’envi l’irréfragabilité, lois universelles auxquelles rien ne saurait déroger de la matière ni de l’esprit : « la nature est une, ses lois sont partout les mêmes, ou, du moins, accordées, cohérentes, se correspondant dans les différents règnes et aux différents degrés30 ».
21Contrairement aux Stoïciens qui imaginent volontiers le développement des causes immanentes à la nature sur le mode germinatif, contrairement aux romantiques pour qui la vie végétative est l’objet de belles méditations, Caillois abhorre la plante et lui refuse toute noblesse. Ce que Goethe voit à l’œuvre dans le végétal — la croissance par la conjugaison des forces opposées de polarité (Polarität) et d’intensification ou d’ascension (Steigerung) — Caillois le transpose chez l’insecte, la coquille, l’homme, le cristal même ; mais il lui est impossible de faire place à la plante, symbole néfaste de la fermentation secrète, du grouillement indistinct et de la croissance asphyxiante. La plante est pour lui l’image de la pensée qui déborde ses tuteurs, de l’imaginaire qui brise les claies et rampe avidement, et ne s’élève qu’au détriment de la rigueur, de la justesse et de l’éthique. Le modèle en est la liane. La plante n’est jamais verticale chez Caillois, son mode de croissance tient de la reptation insidieuse, menaçante. Elle est le symbole d’« une fécondité aveugle, illimitée, que rien n’arrête, même pas son propre excès31 », contre‑modèle pour la poésie que la mesure, la rareté, le travail doivent gouverner.
22La pensée de Caillois, inlassablement, se cherche un modèle et un repoussoir. Le repoussoir de la pensée, de l’écriture, est la nature végétale ; quant au modèle, il est de pierre, aride, tranchant, stérile et immortel. Végétale, la nature menace l’homme et ses œuvres, en ses œuvres : cette prévention farouche contre les séductions du foisonnement, de la poussée de sève, de la luxuriance, « l’intransigeance de [sa] première attitude32 », Caillois prétend la fonder sur « une adhésion exclusive, jalouse, à l’aventure humaine33 », c’est‑à‑dire sur un humanisme volontiers acariâtre qui l’établit en héraut de la durée, de la résistance aux forces de dissolution.
23La liane, toutefois, se fait menaçante :
Je découvris au Brésil la végétation par excellence, dont la puissance redoutable balance celle de l’homme […]. Je me souviens de mes premières impressions devant l’immense et comme invincible réserve de forces femelles, à la fois passives, sournoises et voraces. Un déchaînement lent et silencieux qui me fit peur34.
24Invincible femelle, prédatrice affamée, la nature végétale est cette « femme fatale » dont « l’idéogramme lyrique » hante l’œuvre d’un premier Caillois éminemment misogyne : elle est la mante — et, selon une lecture psychanalytique, « l’amante » que L’Aile froide apprend à traiter avec morgue, à dédaigner par crainte d’un attachement préjudiciable à la maîtrise qui définit le clerc. Femme fatale, vagina dentata, — « les muqueuses roses et luisantes de feuilles au bord épineux, prêtes à se refermer au moindre contact comme des vulves gluantes et barbelées35 » —, absorption mutilatrice, sans retour, dans le sein de la selve, crainte et désir de l’indistinction, la pensée de la nature se complique d’une dimension érotique pernicieuse. Elle est le symbole de la mort qui gît au centre de la vie, de la fécondité qui abolit tout espoir d’éternité. Il existe, dans toute l’œuvre de Caillois, une incontestable velléité non seulement de psychologiser mais surtout de moraliser la nature. Femelle, païenne, lubrique hybris, la forêt est affligée des vices dont la culture occidentale, la pensée ecclésiastique en particulier, infuse la figure féminine.
25La selve, selon Caillois, est d’abord tentatrice : elle propose aux œuvres de l’homme un modèle qu’il ne peut qu’admirer, — et s’épuiser en vain à imiter. Elle est toute miracle — et presque sur-naturelle : forêt des songes et des contes merveilleux, aussi menteresse et labile que le sont les enchantements de la sorcière. Mais, l’éblouissement fané, elle révèle ses racines infectes. Dévoilée, cette nature n’est qu’horreur étrangère à l’homme, à ses aspirations, à ses pouvoirs. Paradoxalement, du moins sous les apparences d’un paradoxe, la biologie de Caillois est avant tout une pathologie : la vie y est toujours malade, et le paysage une terrible vanité. Tout de « mollesse », de facilité et d’abandon, le modèle poétique que cette nature propose oublie la valeur du travail et l’exigence de pérennité par quoi seules les œuvres de l’homme conquièrent leur sens. Cette idée soutient l’art poétique cailloisien : « La condition de la pensée l’appareille à la condition végétale36 ». La pourriture sur quoi s’élève — et que travestissent — les somptueuses floraisons est comparable à la tourbe de l’inconscient, où les surréalistes, réprouvés, mais en opposition à qui Caillois ne cesse de définir le poète selon son cœur, voulurent puiser la sève de leurs images, non moins séductrices, outrageantes et malades, non moins arbitraires et fugaces que les inflorescences tropicales. L’esprit qui prétend accroître sa liberté en rejetant les contraintes dont l’art est formé « n’a fait que redevenir nature et abandonner ses privilèges37 ».Il est impossible à l’homme, empêché, appesanti, faillible, de créer comme la nature : l’intention, le projet l’en dissuadent, et la débilité de ses moyens le lui interdit. La « secrète nostalgie » qui assaille le créateur à la vue de la facilité végétale est celle de l’indistinction du sujet et de la matière, de l’extension naturelle du créateur dans l’œuvre. C’est mensonge : l’homme perdrait sa qualité propre à poursuivre ce mirage. C’est aussi péril : la mort guette cette vie dénuée de tout artifice, que rien ne conserve.
26La poésie, si elle veut s’opposer durablement aux forces dissolvantes d’une nature dont le foisonnement menace — et dont procède l’exubérance imaginative —, doit se placer sous le signe de l’aridité patagonienne, revendiquer la sévérité minérale de cette « contrée toute d’espace et d’appel qui compose sur le sol un site comme il faudrait avoir l’âme38 ». Que l’homme soit incapable de créer comme la nature apparaît finalement à Caillois comme son privilège le plus rassurant. Les plantes jouent de la « simple durée », dit-il, l’emploient à l’expression de leur perfection formelle : le temps est ennemi de l’homme, qu’il doit vaincre en ses créations. Quand l’esprit doit être rigide, inflexible, insensible au « vent d’hiver », la molle prodigalité de la plante est condamnée sans appel par le bathos implacable : « Tout fut aisance, tout fut patience, tout fut paresse ». L’homme, à refuser ce modèle, y gagne sa dignité et conserve les honneurs de sa charge : « au moins son industrie en est‑elle entièrement responsable39 ». Caillois l’engage à se détourner de la terreur jaculatoire, de cette « perfection comme jaillissante qu’il constate partout autour de lui » et qui ne peut que décevoir, par le « zèle », le labeur, vertu qui définit sa condition et qui forme son orgueil.
27Pour rivaliser avec une nature végétale qui lui fait concurrence, l’artiste doit utiliser les mêmes motifs, suivre les mêmes tendances — afin d’assurer la justesse de son imagination — mais refuser d’employer les mêmes moyens. L’esprit humain se situe, selon Caillois, dans la continuité de la nature mais il doit, et c’est son unique prérogative, réguler les forces qui lui commandent, les images qui l’assaillent, non pour s’extraire du continuum, ce qui serait aussi courir à l’échec, mais pour que ses œuvres lui survivent et échappent à la malédiction végétale de la vie.
28Parfois pesamment, au prix d’un conservatisme littéraire et d’une misogynie indiscutables, ces moralia sylvestres suggèrent de nouveaux articles à la déontologie esthétique : non seulement le poète, s’il veut s’exprimer avec justesse, doit accorder ses images aux formes naturelles, mais il lui faut encore repousser les avances de la luxuriance végétale. Ce n’est pas en suivant son exemple que le poème pourra refléter la vérité du monde. L’homme est trop faillible et ses ressources sont à la fois trop pauvres et trop précieuses pour qu’il puisse créer efficacement sur le mode germinatif. Autrement dit, pour révéler la nature, le poète ne doit pas écrire en suivant sa nature. Entre l’image — l’idéogramme — dont la nature lui indique la justesse et le poème qui doit en déclarer la vérité, il lui est nécessaire d’interposer l’intention et le travail. Il lui faut donc ordonner les suggestions de son imagination et vérifier qu’elles s’insèrent dans le réseau des correspondances. Il lui faut également s’assurer que ses œuvres dureront, non tant pour satisfaire l’espoir douteux de se survivre — non omnis moriar — que pour « apporter au trésor commun » du savoir, « à force de décence et de rigueur, un jour heureux, la chance aidant, une minuscule paillette40 ».
Fraternité minérale
29Nous avons tenté de tracer à grands traits l’itinéraire que, selon Caillois, un art trop inféodé aux puissances végétales de la nature devrait suivre — ou a suivi. Il convient, à présent, d’envisager la pierre et le modèle positif qu’elle propose. Dans la pierre s’ébauche une beauté antérieure à l’homme et à la vie. La pierre propose moins un modèle qu’une archive, un répertoire des forces et des formes où l’homme est libre de puiser, où, en tout cas, il trouve un témoignage plus sûr de la justesse méthodologique et morphologique de ses créations. Le signe naturel tire en effet son autorité de sa répétition et la réduplication des images, de règne en règne, de la nature à l’imagination, assure la cohérence du monde. Le signe lisible dans la pierre semble souvent un hapax à l’intérieur du règne minéral mais évoque puissamment d’autres formes, les formes ultérieures de la vie que leur inscription anticipée dans la matière pétrée semble rendre moins suspectes :
Ce sont avertissements discrets, ambigus, qui à travers filtres et obstacles de toutes sortes rappellent qu’il faut qu’il existe une beauté générale, antérieure, plus vaste que celle dont l’homme a l’intuition, où il trouve sa joie et qu’il est fier de produire à son tour41.
30Le tropisme du secret esthétique que révèle l’ouverture de la pierre, son effeuillage, aimante nombre des méditations minérales. Il existe une beauté immanente à la nature ; « il faut », pour Caillois, que cette beauté existe, car il en va de la légitimité et de l’exactitude des œuvres humaines. Dans la lignée de la pierre, un rapport concurrentiel semble d’abord persister entre l’homme et la nature :
Je m’en tiens à la concurrence que font aujourd’hui les réussites de la nature aux œuvres des peintres et des sculpteurs, soit qu’elles paraissent représenter quelque chose, soit qu’elles procurent un signe pur, qui ne reproduit rien. […] La confrontation risque fort d’être révélatrice. À tout le moins, elle met en lumière d’étranges chassés‑croisés42.
31C’est que le signe lisible dans le minéral, l’image sans auteur de la « pierre autoglyphe », mime parfois un alphabet, un paysage ou encore un personnage et, d’autres fois, une « syntaxe despotique43 » de signes épars, dont l’énigme creuse offre un support à la rêverie. Ce peuvent enfin être seulement des « masses torturées, scoriacées des métaux forgés dans les fournaises de la planète44 », témoignages des violences de la matière et de la rigueur formidable de ses lois. Le « démon de l’analogie » susurre ses suggestions ; la paréidolie, cette « rage d’interpréter45 » les formes naturelles, joue à plein, mais sous le contrôle sévère de l’esprit, qui n’oublie jamais qu’il n’est ici que jeu de formes, car les images, si elles peuvent déclarer quelque parenté secrète, quelque jumelage morphologique, ne possèdent aucun sens. Ainsi, la nature minérale concurrence toujours l’artiste mais ce qu’exhibe l’écriture des pierres est « un phénomène […] d’une plus vaste portée46 » : l’unité du monde, encore une fois, mais une unité fraternelle, généreuse, secourable. Quand l’unité végétale menaçait, dans la pensée de Caillois, les œuvres de l’homme, l’antériorité minérale leur fournit son appui, sa caution. Le « dessin sans dessein », « l’empreinte insolite » qui se lit dans la pierre, « alarm[e], aimant[e]47 » l’imagination, stimule l’esprit analogique, le fascine, l’engage à créer, à son tour, à partir de lui, pour affirmer la même vérité : la vertu minérale se transmet au poète qui s’applique « à donner à [ses] phrases même transparence, même dureté, si possible — pourquoi pas ? — même éclat que les pierres48 ». Ekphrasis dynamique, tentant d’épuiser les suggestions de la gemme, le texte qui lui est consacré rend hommage, d’un même mouvement, aux signes immémoriaux et aux fantasmes fluides de l’imagination qui les perpétue.
32Dans la pierre, la nature ne serait ainsi plus la prédatrice vorace, la vie mortifère. Elle proposerait une morale du style, syntaxe lapidaire et ample développement, filon des images et parangon lexical, aller et retour de la science à la rêverie. Elle résoudrait les antagonismes végétaux, canaliserait les dérives de l’imagination dans une gangue infrangible, mais les accréditerait, les justifierait par l’inscription ancestrale. L’homme n’aurait ainsi rien à craindre de la pierre : la concurrence entre ses œuvres et celles de la nature, sur l’exemple extrême‑oriental que prolonge, en un sens, le ready‑made duchampien, se muerait plutôt en une collaboration fructueuse dans laquelle l’homme trouverait vraiment sa place, assumant le rôle qui lui est échu dans le cosmos esthétique :
En Chine, vers le milieu du xixe siècle, il arrive que l’artiste choisisse une plaque de marbre dont lui plaisent les taches ou les veines : il la délimite et l’encadre, l’intitule et y grave son cachet. De cette manière, il en prend possession et la transforme en œuvre d’art dont il assume désormais la responsabilité49.
33Ce faisant, l’homme confère à la nature, qui lui offre son dessin, ce qu’elle est incapable d’assumer : une responsabilité auctoriale. La pierre qu’il choisit pour ses qualités plastiques, par l’apposition presque magique du nom humain, quitte la sphère des phénomènes muets. Par la grâce de cette double invention, la pierre, trouvée et prise en charge, n’abandonne pas entièrement son statut naturel, mais le voit s’augmenter d’un surcroît éthique, culturel. Elle est œuvre hybride, aletheia phénoménale et ethos humain. Caillois esquisse, en ses textes, un geste semblable à celui des Chinois qui apposaient leur sceau sur des « pierres de rêves », qu’ils ne modifiaient pas autrement. Il élit, met en exergue, porte à la connaissance de l’homme l’évidence voilée d’une beauté naturelle qui justifie toute l’entreprise artistique. Mais il va au‑delà de la simple monstration : il recompose, il mime, il duplique par l’écrit. Ce geste de mise en évidence, cette enargeia du phénomène constitue, en quelque sorte, l’horizon de la démarche cailloisienne, cette vérité que les mots du poème approchent indéfiniment sans la saisir, et sans qu’il importe véritablement qu’ils la saisissent. Selon Caillois, l’homme ne fournit à la natura pictrix que l’intention qui manquait à son œuvre pour que celle‑ci appartienne au champ des arts. Il homologue, dans la pierre, la nature comme son ancêtre et son égale, comme l’éternelle contemporaine de ses soucis esthétiques. Il offre son projet à ce qui « ne fut dessein ni choix, mais simple accomplissement50 », à ces simulacres nés de lois incontestables autant qu’aveugles. La nature et l’homme, enfin réconciliés, travaillent de connivence. L’homme constate la vérité de ses images par leur représentation immémoriale dans la pierre. Celle‑ci, par l’intervention fraternelle de l’homme, bénéficie d’une promesse d’art.
34Éternelle pour n’avoir pas été affligée de la vie, pour n’être pas victime de la malédiction de croître et de se multiplier, de penser et de faire, la pierre offre enfin à Caillois sa leçon et son modèle : un acquiescement, une quiétude, l’extase sans transports d’une « mystique matérialiste ». La poésie n’est plus appareillée à la condition végétale. C’est sur le roc, désormais, qu’elle assiéra ses pouvoirs. « Eadem in diversis : modèles, simulacres, intentions, ambitions ou ce qui les annonce, sont les mêmes de la pierre jusqu’à la pensée agile51 ». L’exubérance des formes nées de la vie était suspecte ; l’impératif de croissance — qui naît de celui de la mort ou qui l’engendre — montrait à l’homme qu’il ne pouvait créer que hors de lui, discontinument, des œuvres brèves, closes, mortes. C’est à ce titre que la prolifération somnambule, inconsciente et facile, du végétal constituait une menace dans la première pensée cailloisienne, menace sous le signe de laquelle il s’en fallut de peu que l’auteur ne ramenât toute la nature. Mais quant à la pierre, d’une beauté en‑deçà et au‑delà de la perfection, elle ne peut en remontrer à l’homme. Elle est fixe, close, elle était morte avant la vie : « quoi donc est immortel qui d’abord n’est pas stérile ?52 ».
35Au moment où il abandonne les prestiges de la stérilité poétique, Caillois, censeur devenu poète, espère que la pérennité minérale assurera celle du texte. En outre, la beauté antérieure des pierres offre une nouvelle garantie que les formes se répondent, qu’elles tissent l’univers ; contrairement à ce qui paralysait Caillois dans la plante, l’« idéogramme » perceptible dans la pierre est parfois déroutant mais toujours lisible. Celui‑ci n’est jamais menaçant parce que sa croissance, arrêtée, est devenue observable, un vestige du dynamisme que l’esprit peut susciter à sa convenance. Par ailleurs, l’image pétrée confirme la justesse des créations de l’esprit. Enfin, si la description conclut souvent au caractère scriptural de la pierre, c’est que Caillois y voit une manifestation de cette raison séminale, de cette tendance qui, chez l’homme, explique l’expression poétique et en constitue la vérité première : la pierre, comme le poème, donne à voir et met en relation, fixes et fluides, incontestables et impossibles tout à la fois, les formes qui font le monde. Leur indécidabilité — silhouette, bâtiment ou figure géométrique… — est en fait un rapport d’analogie — silhouette, bâtiment et figure géométrique — et la pierre elle‑même un poème.
Les lois de la matière et de la poésie
36Afin de justifier ses vues sur la vérité poétique — qui est, tout ensemble, la vérité déontologique selon laquelle le poète doit écrire et la vérité phénoménale qu’il lui faut exprimer sur le monde qu’il décrit —, Caillois tente à son tour de repérer ce que Goethe nommait les Urphänomene à l’œuvre dans la nature, les schémas générateurs des formes du monde. Il s’attarde notamment sur la spiralité, principe alliant symétrie et dissymétrie. Caillois constate d’abord que la science échoue à proposer une explication satisfaisante de cette anomalie que constitue la vie : « le jeu du hasard et de la nécessité » ne suffit pas et voilà que la science « leur ajoute volontiers la mystérieuse téléonomie, une finalité interne et limitée, quelque tendance quasi inexplicable à la complication heureuse53 ». Cela équivaut, pour Caillois, à un aveu d’impuissance : il n’est pas envisageable de chercher en‑dehors du monde une explication à ce que le monde produit ; il est inacceptable que le monde ait un sens s’il est indémontrable, inaccessible à l’homme. Seule certitude :
L’univers demeure unique. On a beau en traquer la variété dans les recoins où il acquiert ses caractères les moins interchangeables, les aspects innombrables qu’il présente relèvent tout de même, à plus ou moins long terme, d’une structure identique, d’une organisation commune, de lois cohérentes qui s’articulent entre elles54.
37L’unité de l’univers doit ordonner et garantir une unité du savoir. Caillois hérite la polymathie des savants renaissants aussi bien que des romantiques allemands, ces « jeunes gens d’Iéna » qui lui révèlent qu’à partir de la science prométhéenne, de ses postulats, méthodes et découvertes, on peut penser contre elle et tenter de la réconcilier avec la perception sensible. Cette polymathie reparaît dans le plaidoyer qu’il prononce en faveur de ses chères « sciences diagonales ». Unifié, le savoir devrait, de façon « presque inévitable », faire émerger
[…] l’existence de lois si générales que leur juridiction ne serait affectée ni par la nature ni par l’échelle, ni par le niveau de leur objet, en sorte que leur seraient soumises aussi bien les relations des nombres, la matière inerte ou organique, les démarches de la pensée rigoureuse et jusqu’aux égarements de l’imagination amusée ou séduite55.
38Ces lois qui sont celles de la matière, du savoir et de l’imagination, sont aussi, pour Caillois, celles de la poésie.
39Ainsi pense-t-il avoir trouvé dans la dissymétrie, ou plutôt dans une dialectique entre symétrie et dissymétrie, l’une des lois fondamentales de la nature et de l’art. La symétrie à l’œuvre, par exemple, dans le cristal, et jusque dans l’organisation sociale, produit tout ensemble stabilité et entropie. La symétrie assure la cohérence et la solidité d’un ensemble qui se complique, « systèmes cristallins » aussi bien que « codes génétiques », et « canalis[e] » les énergies de la croissance pour qu’elle progresse vers « une solidité nouvelle ». Mais cette stabilité s’épuise si elle n’est pas relancée par le vertige :
L’organisation croissante agit comme un puissant coagulant. Elle paralyse toute dissymétrie qui ferait peser sur elle une menace de ruine. Une dissymétrie féconde peut toutefois apparaître. […] La voici exception et prouesse56.
40« Bon dernier » dans une « partie » qui se joue de toute éternité, l’homme, « à ses débuts, excroissance chétive et clairsemée d’une des dynasties du règne animal57 », doit son succès — ce « jeu » qu’il introduit dans le jeu de la nature, si « restreinte » que soit sa « faculté d’initiative » — à la dissymétrie. Il semble en effet « le point d’aboutissement d’une ascension de la dissymétrie58 » et « assiste, étonné, à une explosion de puissance efficace, dont il est l’agent et qui lui assure une place sans précédent dans la même nature d’où il sort et dont il s’écarte de plus en plus59 ». Ce faisant, il court le risque de fausser le jeu : si l’homme semble déroger à ces lois qui lui sont antérieures, qui sont immanentes à la nature à laquelle il appartient, « s’il recherche ou s’il s’écarte de la symétrie, c’est principalement, sinon exclusivement, l’effet de son choix60 ». Le libre arbitre, bien que Caillois ne le regrette pas explicitement, se définit pourtant toujours, de manière négative, par la liberté de faillir. L’individu semble méconnaître ce que la structure, naturelle, linguistique ou sociale, exhibe sans flancher ; mais cette liberté de faillir est un agent du déséquilibre, du vertige essentiel à la conservation de la vie, à la néguentropie. Pour être nécessaire, ce vertige n’en présente pas moins de nombreux dangers quand il est poursuivi pour lui-même : « Comme toute symétrie, la stabilité triomphante se révèle à la longue paralysie et verrou. Le respect, la règle se dégradent. Le vertige les remplace61 ». La « dépense improductive » en quoi Caillois voit le principe sacré, sacrificiel, de la fête, de la guerre et de l’art, menace alors de se muer en « gaspillage ostentatoire ». L’individu facteur de dissymétrie risque d’oublier sa place et le caractère transitoire du vertige : « c’est alors la glorification du Héros62 », c’est‑à‑dire du poète voleur de feu, du parnassien ou du surréaliste, professant l’intransitivité de la littérature et la tyrannie de l’originalité, la suprématie de la surprise éphémère sur la vérité durable.
41De la physique à l’esthétique, de la minéralogie à la sociologie, des démarches de la nature au champ littéraire, une même loi et une même tempérance doivent régner : l’homme se perdrait à vouloir faire fond sur la surprise seule, qui ne se conçoit que dans la rupture de la régularité. Nous touchons ici à une idée fondamentale de Caillois : le fantastique ne fait sens que comme accroc au réalisme ; l’ocelle du papillon ne fascine efficacement que par son surgissement de l’indistinction mimétique ; la métaphore n’est audacieuse et juste que si le cotexte, « le tissu de l’œuvre », la prépare et qu’elle ne le rompt que naturellement — « d’où le recours à une dissymétrie calculée, intense, brève, bien située, qui pour ainsi dire troue le réseau et le manifeste en le bafouant63 ».
42La vertu de cette surprise savamment préparée est d’« empêch[er] la raideur de prendre le pas sur le jeu », de relancer l’expansion du cosmos esthétique. Toute symétrie, l’œuvre est morte et sa vérité perdue ; toute dissymétrie, elle n’est que scandale sans fondement et sans véritable efficace — c’est‑à‑dire, dans l’échelle des valeurs cailloisienne, sans durée :
Des écoles poétiques [au premier rang desquelles l’école surréaliste, semble‑t‑il falloir lire] ont voulu que la relation imposée [entre les termes d’une analogie] fût tout à fait arbitraire. Elles ont même situé la force de l’image dans l’impossibilité pour l’imagination de percevoir la moindre ressemblance, de jeter le moindre pont entre les deux réalités comparées. La magie en devient inopérante. […] L’échec atteste une fois de plus que dissymétrie ne vaut que là où elle est garantie par symétrie bien tempérée64.
43De la sorte paraît un nouvel élément de la déontologie esthétique cailloisienne, émanant d’une interprétation « diagonale » des structures, à la fois esthétique et scientifique, orphique et prométhéenne. La symétrie du poème et du monde, c’est‑à‑dire la vérité scientifique et sensible sur quoi repose le discours poétique, assure la pertinence et la pérennité de celui‑ci. Ainsi, les textes que Caillois dédie aux pierres emploient abondamment le savoir minéralogique. Cependant, l’irruption de l’analogie poétique dans le discours savant, en contrepoint de celui‑ci, est factrice de dissymétrie : la « science de la perception » se substitue momentanément à la science expérimentale — ou plutôt elle la complète. Le poète aperçoit un signe dans la pierre ; il sait que ce signe n’en est pas un, qu’il est né de l’action conjointe de lois physiques que l’on ne peut pas toujours décrire, qu’il n’a aucune signification, qu’il ne représente rien. Mais cette pensée dissymétrique ne contredit pas, selon nous, la vérité du poème. Au contraire, elle révèle l’existence d’un « répertoire des formes » qui, de la pierre à l’imagination, de la matière inerte à la vie, est garant de l’unité et de la cohérence de l’univers. Ainsi, la dissymétrie féconde la symétrie, la perception esthétique et la pensée scientifique se soutiennent — et la poésie, si elle ne veut pas être lettre morte, doit obéir aux lois mêmes qui ont permis l’émergence et l’évolution de la vie. En retour, le discours scientifique nous semble avoir préparé le cadre que rompt momentanément l’image poétique, comme l’ocelle médusant, jaillissant tout à coup, ruine le camouflage de l’insecte mimétique mais fascine son observateur. L’image n’est donc pas gratuite, injuste, mensongère ; elle surgit d’une parole irrécusable mais incomplète qu’elle contribue à enrichir et à réconcilier avec la perception sensible. Dans la pierre, la « dissymétrie » de l’image minérale est préparée par l’implacable « symétrie » des lois physico‑chimiques qui ont présidé à sa formation. L’image minérale, comme la métaphore juste, est un déséquilibre nécessaire qui sollicite durablement l’imagination, contrairement aux analogies d’une poésie déréglée qui ne sont qu’impostures, feux de paille, qui éblouissent sans émouvoir, sans marquer leurs lecteurs parce qu’elles sont trop contraires aux lois de la nature et de l’esprit. La métaphore dissymétrique étonne parce que le rapprochement qu’elle opère est inattendu ; mais elle fascine parce que ce rapprochement est juste, conforme aux règles de l’univers qu’elle contribue à révéler — car c’est là toute leur tâche.
Déontologie esthétique
44L’appréhension de la nature, chez Caillois, est fondamentalement hybride. De même qu’il fait déraisonner le rationalisme en lui insufflant ce qu’il refuse de comprendre, la part obscure de la nature ou une raison supérieure à la raison humaine, de même les présupposés de sa vision du monde semblent farouchement positivistes. Mais il les dévoie toujours, et toujours emploie les méthodes et les découvertes de la science pour justifier, hors de leur champ, d’injustifiables théories fondamentalement poétiques. Celles‑ci reposent sur le postulat, alors anachronique, d’un tissage analogique du réel.
45La déontologie esthétique cailloisienne, ces règles auxquelles le poète doit plier sa parole s’il veut qu’elle soit vraie, comporte de rares mais profonds articles : la nécessaire justesse des métaphores qu’assurent les échos morphologiques traversant l’univers ; le travail, l’intention et la mesure qui permettent d’endiguer le foisonnement végétal de l’esprit et autorisent de rivaliser avec la nature (ou, du moins, de participer en conscience et maîtrise à son œuvre) ; l’obédience à la vérité scientifique « symétrique » permettant à l’analogie poétique « dissymétrique » qui semble la rompre d’être à la fois surprenante et vraie ; la pérennité, que tous autres éléments de cette déontologie doivent assurer et qui trouve son modèle dans la pierre.
46Pensé sur le modèle linguistique et ludique à la fois, le monde selon Caillois se propose à la sagacité de l’homme, à qui il revient, gloire et fardeau, d’en quadriller l’apparente luxuriance afin d’en manifester, même de façon fragmentaire, l’immuable ordonnancement. La recherche — aussi bien que la création poétique, qui est une recherche — apparaît clairement comme un plaisir terrible, un divertissement dans tous les sens du terme : l’homme doit souffrir l’absurdité de sa condition. Il ne lui faut toutefois pas, précise sévèrement Caillois, en prendre prétexte pour créer contre‑nature, en ignorant délibérément les grandes structures de la nature. La libido sciendi cailloisienne est inhérente à la condition humaine : il faut peut‑être même y voir une des tendances qui animent l’univers (et on le doit, tant c’est l’usage de Caillois d’appuyer la plus douteuse des conjectures par la sommation la plus irrécusable). La nature, selon lui, veut être comprise et ses « hiéroglyphes » doivent être déchiffrés. Ceux‑ci, toutefois, n’assurent pas à l’homme une révélation, sinon celle de son insignifiance, reflet de la leur. On peut comprendre les règles du jeu mais celui‑ci n’a pas d’autre but que sa propre perpétuation — prît‑elle la forme d’un poème. La libido doit alors réserver sa part à l’acedia, le savoir à sa vanité intrinsèque. L’apprivoisement de ce sentiment de vanité est la condition expresse d’un retour en grâce de l’écriture : « Je ne me suis réconcilié avec l’écriture », avoue Caillois, « qu’au moment où j’ai commencé à écrire avec la conscience que je le faisais de toute façon en pure perte65 ».
47La recherche ne peut ainsi, nous semble-t-il, mener qu’à la pierre dont l’insignifiance procure le repos, dont l’immémorialité apaise. Son impersonnalité et son inertie, au sens chimique, permettent au sujet de s’affirmer, sa structure cristalline lui fournit un modèle stylistique, son néant, enfin, le rassérène et le console de ses singulières déficiences. Seule la perception esthétique, poétique et picturale du monde semble d’abord offrir une « alternative » à la science. Mais l’inquisiteur diagonal ne tarde pas, sans pour autant cesser de déférer à son démon qui lui commande de dévoiler la trame de l’univers, de demander aux pierres, qui portent en elles la signature d’un flux figé, de lui procurer l’extase morbide de la « mystique matérialiste » : l’extinction momentanée de soi, le masque de l’indistinction, l’avant‑goût du destin de la matière, le prélude au silence, où il faut peut‑être voir, selon Caillois, la vérité de la poésie.