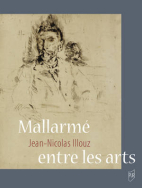
Entre diffraction et constellation. Mallarmé entre les arts
1Lauréat 2025 du Prix Henri Mondor de l’Académie française pour son ouvrage, Jean-Nicolas Illouz, professeur à l’université Paris 8 (Vincennes à Saint-Denis) et spécialiste de Nerval, de Mallarmé, du symbolisme et des rapports entre la poésie et les arts, propose dans Mallarmé entre les arts (Presses universitaires de Rennes), un travail critique inédit sur les interactions entre le poète de la Rue de Rome et les artistes de son temps – peintres, musiciens, photographes – ainsi que de ses relectures contemporaines. Le livre s’inscrit dans une tradition de recherche sur les relations entre les arts, mais il en renouvelle les termes par son refus de toute synthèse illustrative : loin de l’idée d’une œuvre d’art totale, Mallarmé devient chez Illouz l’opérateur d’un dispositif de diffraction formelle.
2Mallarmé entre les arts n’est pas un livre que l’on parcoure d’un trait : il se déplie, pli selon pli, à la manière d’une partition où chaque chapitre, autonome et résonant, module un rapport singulier entre les formes. Ce livre interroge une question centrale : comment une œuvre poétique agit-elle sur la lisibilité des autres arts ? Et plus largement : comment Mallarmé permet-il de penser un autre régime de coexistence entre le texte, l’image, le son et le silence ? Il faut saluer dans Mallarmé entre les arts une entreprise d’une rare exigence, qui ne se contente pas de revisiter une œuvre, mais en interroge les conditions mêmes d’apparition et de lisibilité. Jean-Nicolas Illouz ne suppose pas entre les arts une continuité de principe ni une transparence des langages : il interroge, avec finesse, les points de friction, les seuils de forme, les écarts de temporalité et de support. Il fait œuvre d’analyse dans le geste même de la dissémination, en se tenant au plus près des textes, des images, des sons, des silences qui constituent la constellation mallarméenne de la modernité.
3Le titre du livre est programmatique : Mallarmé entre les arts : ni au-dessus, ni à la croisée, mais dans cet intervalle agissant, ce suspens fertile que Derrida, Blanchot, Valéry ou Boulez auront lu comme un champ critique. Le projet critique ne vise pas une cartographie des influences, mais une relecture serrée des formes de coexistence, de diffraction, de seuil. C’est en cela que le livre d’Illouz ne suit pas la logique du commentaire linéaire : il module, déplace, replie les gestes du poète au contact d’autres arts. Lire ce livre, c’est entrer dans une composition de tensions et de reprises, où le visible devient lisible, où le poème fait trembler la peinture, la musique, la photographie.
4L’ouvrage s’ouvre sur un long Prélude, qui pose les principes méthodologiques et critiques de l’ensemble : Mallarmé y est lu comme un « opérateur » plus que comme un auteur, au croisement de pratiques formelles hétérogènes. Suit une suite de dix chapitres, modulaires, traversés de motifs récurrents (le pli, le blanc, le seuil, la diffraction), qui confrontent Mallarmé à des artistes peintres, musiciens ou plasticiens, de Manet à Boulez, en passant par Whistler, Gauguin ou Debussy. Chacun de ces volets fonctionne comme une variation autonome, tout en s’inscrivant dans un mouvement d’ensemble.
5Plutôt que de suivre pas à pas le fil des chapitres, nous proposons ici une lecture transversale, attentive à l’architecture d’ensemble et aux résonances critiques qui la structurent. Il s’agit de repérer les tensions méthodologiques, les modulations thématiques, les motifs qui travaillent le livre dans sa cohérence dynamique. Trois foyers d’énergie critique permettent d’en rendre compte : le livre comme dispositif critique; le visible et ses seuils; la voix moderne entre texte, son et silence. Chacune de ces tensions rejoue le geste mallarméen de diffraction, en dépliant les seuils entre les arts plutôt qu’en les rabattant dans une synthèse : c’est dans ses croisements, ses échos, ses modulations que le livre se donne à lire.
Le livre comme dispositif critique
6Le premier chapitre analytique illustre avec précision cette logique. Loin de lire L’Après-midi d’un faune comme épiphanie symboliste, Jean-Nicolas Illouz en fait le foyer d’une crise, une forme en transition où s’invente un art à la limite du poème, du théâtre, et des sons. « À l’interface du rêve et de la réalité » (p. 23), le faune déjoue les assignations : il est opérateur de diffraction, déjouant les formes… sans présumer de l’avenir.
7L’interprétation debussyste (1892) ne « met pas en musique » le poème, elle en déplie la logique suspendue, miroitante, inachevée. Le Prélude à l’après-midi d’un faune n’accompagne pas : il relance, déplace, prolonge le tremblement. De même, l’illustration de Manet ne vise pas la fidélité figurative : elle participe d’un montage, d’une stratégie de déplacement visuel. Typographie verte, mise en page, gravures : tout fait dispositif. Le livre devient laboratoire d’un art moderne de l’hymen « qui suppose à la fois l’union et la séparation » (p. 12).
8Jean-Nicolas Illouz historicise sans rabattre. Il pense en voisinages, en confrontations silencieuses, où chaque art se pense depuis l’autre, sans jamais chercher à l’absorber. Mallarmé n’illustre pas, il interfère. L’Après-midi d’un faune devient ainsi une scène critique en acte : non pas fusion des arts, mais réflexion de chacun sur sa limite propre.
9Cette pensée critique se rejoue dans Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. Jean-Nicolas Illouz replace le poème dans ses conditions concrètes de production, à l’intersection de l’édition moderne, de la typographie, de la perte et du deuil. Le geste n’est pas esthétique, il est critique. La césure « Je suis pour — aucune illustration » (p. 30) devient symptôme : le tiret, « figure du différend », dit l’hymen mallarméen entre texte et image.
10Le projet inabouti avec Redon, initié par Vollard, fait du livre un objet spectral. Les lithographies prévues (La Femme au hennin, L’Enfant à l’arc-en-ciel, La Femme à l’aigrette) s’insinuent dans les blancs du poème comme figures « en formation plutôt que déjà formées » (p. 100). Le poème devient un espace de diffraction plastique et typographique.
11Cette logique est radicalisée dans les réactivations contemporaines de Broodthaers et Pichler. Le premier remplace les mots par des barres noires : « image approximative » (p. 219), où la structure visuelle du poème subsiste sans le sens. Le second évide au laser le texte, laissant une sculpture ajourée, une grille, une partition sans notes (p. 229).
Le visible et ses seuils
12Jean-Nicolas Illouz engage ici une lecture d’une grande justesse, qui refuse les rapprochements hâtifs entre la suggestion poétique et l’indétermination picturale. Il s’agit de penser la modernité picturale dans ce qu’elle a de plus rétif à l’illustration : lumière, rythme, perception collective… Mallarmé ne se borne pas à défendre les impressionnistes : il les pense à partir de la littérature.
13La section « Lumière, lucidité » met en lumière la façon dont Mallarmé conçoit la lumière comme opérateur poétique, en résonance avec l’esthétique impressionniste. Dans Le Linge de Manet, c’est elle qui, bien qu’« elle-même invisible », devient le véritable sujet du tableau, en « pénétrant toutes choses et les altérant » (p. 45). Ce primat de la lumière, dissociée de l’objet, redéfinit l’acte de voir : le visible ne renvoie plus à une forme stable, mais à un pur apparaître. Ce processus suppose un déconditionnement du regard (p. 52) : le peintre, libéré des codes perspectivistes, voit comme pour la première fois. En cela, sa démarche rejoint celle du poète, tendue vers une clarté sans référent, où la langue devient elle-même milieu de révélation. Là où la peinture cesse de désigner, elle touche à l’abstraction du poème — non représentation d’un objet, mais vibration d’une présence.
14La photographie prise par Degas en 1895 dans l’appartement de Mallarmé est décryptée comme dispositif critique : « art du faux-tographe » (p. 111), mise en scène du retrait. Degas détourne le regard, Renoir semble absent, Mallarmé lit. L’image ne montre pas une simple empreinte de la réalité même, sans l’entremise de l’artiste, mais « un milieu, pur, de fiction » (p. 112, citant Mallarmé).
15Avec Vuillard et le poème Intérieur, c’est une esthétique du repli qui se joue. Jean-Nicolas Illouz parle d’une « compréhension générale » de l’espace, où figures et fond fusionnent dans une ambiance silencieuse, jusqu’à « désubjectiver » l’âme, diffusée dans « l’air et la vibration des couleurs » (p. 141). Le poème, de même, évacue tout événement : la logique du retrait y commande. La lumière efface les contours, le miroir détache les objets de leur essence, et les mots, comme les couleurs, ne valent que par les « transitions d’une gamme » (p. 139). Rien ne s’exhibe : tout se suspend.
16Whistler, enfin, condense cette logique du mystère visuel. Chez lui, l’image ne vise plus à représenter, mais à « créer dans une neuve atmosphère » « l’objet tu » (p. 165). Mallarmé insiste sur le rôle actif de l’indéfini : l’œuvre s’élabore à partir de « l’ombre exprès », de « la Nuit, l’Inexprimé, l’Abstraction » (p. 163). Dans les Nocturnes, ce n’est plus l’objet qui est figuré, mais « l’apparence visible de l’ombre » (p. 167), signe que le mystère devient mode de présence, et le retrait, condition du visible.
17Proust prolonge cette esthétique de l’effacement en y adjoignant une temporalité. À Vuillard, rappelle Jean-Nicolas Illouz, il doit « la fraîcheur d’un regard, “déconditionné” des conventions qui pré-forment la vision ordinaire » (p. 145). Mais plus encore, c’est l’idée d’une substance relative, sans essence propre, qui relie les choses par glissements : ce qui compte, ce sont les « relations multiples et mouvantes que chaque chose entretient avec d’autres choses » (ibid.). Par ce biais, Proust inscrit dans la durée la logique du pli : au silence de Vuillard et à la suspension mallarméenne du sens répond, dans La Recherche, un art de la réverbération, où l’apparaître naît du détour, de l’inflexion, de l’écho. Le mystère n’est plus à résoudre, il est à maintenir.
La voix moderne entre texte, son et silence
18Cette troisième séquence se propose d’articuler un réseau de tensions autour de la voix, du rythme, du souffle, en mettant en jeu plusieurs figures où la parole poétique se déplace vers le musical, le populaire, l’événementiel. Trois moments, trois dispositifs.
19Les Chansons bas, en écho aux Types de la rue de Raffaëlli, pastichent les « chansons illustrées colportées » tout en les désamorçant « avec un sourire ». La voix populaire y devient spectrale : « la chanson que l’on murmure tout bas » est réduite à un air — « l’air ou chant sous le texte », selon la formule que Mallarmé lui-même applique ailleurs (p. 67). Ce « chant dessous », dévocalisé, fonctionne comme opérateur critique. Le pathos se dégonfle dans ce que Mallarmé nomme, à propos de Banville, « l’éventement de la gravité » (p. 73). Le refrain, loin de porter une voix, agit alors comme surface de diffraction du cliché.
20Avec Debussy, l’approche est radicalement autre, mais toujours diffractée. Loin de « mettre en musique » L’Après-midi d’un faune, le Prélude en relance le miroitement, la suspension. « Mi-homme, mi-bête, mi-dieu » (p. 36), le faune lui-même est une figure instable, prise entre désir et effacement. Le poème « oscille entre le songe et le fait » (citant Mallarmé, OC I, p. 132)1, et Debussy, en le dépliant musicalement, en prolonge le tremblement. Jean-Nicolas Illouz insiste : « la musique, ici, ne vient pas surplomber le poème mais se couler dans son indétermination même » (p. 38), poursuivant « une extase, une extinction, une élision » (p. 37), selon un « dialogue suspendu des arts » (ibid.), où chacun « dissémine dans l’autre ce qui fait son “bien” propre » (ibid.).
21La modernité de cette voix poétique trouve un écho contemporain dans la Troisième Sonate de Pierre Boulez, inspirée d’Un Coup de dés. Jean-Nicolas Illouz y voit un transfert de structure plus qu’un hommage littéral : la partition n’est pas un simple support mais devient forme, « ouverte à la performance de son interprétation », un « acte de lecture devenu alors en effet pleinement musicien » (p. 200). La Sonate, écrit Boulez, « n’est plus conçue comme une “trajectoire simple” », mais comme un « labyrinthe » — un réseau de chemins possibles que l’interprète explore selon « des dispositifs très précis », où « le hasard joue un rôle d’aiguillage qui se déclenche au dernier moment » (ibid.).
22L’œuvre de Mallarmé est ici transposée, non imitée. Le dispositif mallarméen du Livre, lui aussi, engageait un opérateur, des fragments, des cycles, des permutations : la logique en est « circulaire » et spéculaire, « comme dans le Sonnet en yx », où le texte « se réfléchit de toutes les façons » (p. 213, n. 18). Jean-Nicolas insiste sur ce point : l’œuvre ne se referme pas, elle « se réfléchit », elle devient elle-même un principe de lecture.
23Boulez retrouve là ce que Mallarmé appelait le « rythme total » du poème — fait de « suspens », de « disposition fragmentaire » et de « vibration » (p. 194). La musique devient, comme le texte, constellation en acte. En cela, la Sonate est une réponse moderne au Coup de dés, par sa structure à la fois contrainte et mouvante, combinatoire et ouverte.
24Ainsi, de Raffaëlli à Boulez, en passant par Debussy, c’est toujours la même tension critique qui se joue : la voix n’est pas à entendre, mais à penser. Non pas présente, mais diffractée. Ce que Jean-Nicolas Illouz met au jour, c’est une déconstruction du lyrisme : « Loin de l’émission d’un sujet, il s’agit d’un rythme, non d’une voix » (p. 195). Chez Boulez, cette mutation prend une forme musicale ouverte, où « le nom du poète se refait avec le texte entier » (p. 210), selon une logique de circulation plus que d’expression. Le poème devient structure, constellation, miroir, et l’œuvre musicale, en réponse, un « legs en la disparition » (p. 210, citant Mallarmé, OC I, p. 374). Dès lors, il ne s’agit plus d’interpréter une voix, mais de composer avec ses spectres, dans un champ de résonance aussi fragmentaire que vibrant.
25Un dernier chapitre prolonge cette réflexion en explorant les réappropriations contemporaines d’Un coup de dés, à travers les gestes plastiques de Marcel Broodthaers et Michalis Pichler. Dans ces relectures, le poème devient « image » ou « sculpture », selon des procédés d’effacement, de transposition ou d’incision, qui interrogent la lisibilité même du langage. Broodthaers, en remplaçant les mots par des traits noirs (p. 216), propose une version visuelle du poème où la spatialité typographique devient surface muette, emblème d’un « totem » postmoderne de l’art (p. 222). Le dispositif de l’exposition qu’il conçoit, avec ses cartons d’invitation, ses plaques anodisées, ses lectures enregistrées, mime une cérémonie critique où l’œuvre se réfléchit dans son propre rituel (p. 217‑219). Pichler, à son tour, creuse les traits au laser pour en faire une partition pour piano mécanique (p. 229), et rejoue ainsi le rêve mallarméen d’un livre-musique sans voix. Ces gestes, qui déconstruisent la « présence » du texte, déplacent encore le geste mallarméen dans un espace critique, où le visible et le lisible se croisent sans se confondre. Jean-Nicolas Illouz en propose une lecture à la fois théorique et sensible, attentive à l’héritage mais aussi à la disjonction que ces œuvres opèrent, prolongeant, jusqu’au bout, l’hymen problématique entre les arts.
*
26En filigrane de cette lecture, Mallarmé entre les arts dessine une figure résolument critique du poète : non l’auteur d’un système, mais un opérateur de disjonction formelle, de tension entre les médiums. Jean-Nicolas Illouz ne cherche ni à totaliser, ni à synthétiser les arts autour de Mallarmé ; il en suit les interférences, les lignes de fuite, les points d’irisation.
27Le livre ne propose pas une étude d’influence, mais une pensée de l’entre : entre les arts, entre les formes, entre les silences. La poésie n’y est ni centre ni auxiliaire, mais ce que Pierre-Henri Frangne appelle une « plaque tournante » (p. 12), à partir de laquelle se réorganisent les régimes du visible et du dicible.
28En ce sens, Mallarmé entre les arts se lit comme une œuvre critique en propre, tendue entre la précision historique et la densité théorique, entre analyse serrée et intuition poétique. Le style de Jean-Nicolas Illouz épouse ce mouvement : informé, rigoureux, et subtilement musical. Il ne surplombe pas : il laisse résonner.

