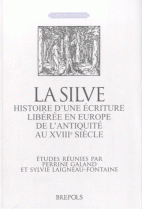
Une histoire de la silve : l’aventure d’un principe d’écriture dans les littératures européennes
1Issu d’un colloque international tenu à Gand en mai 2008, ce monumental ouvrage de plus de sept cents pages entend proposer l’histoire d’un genre, ou plutôt d’un mode d’écriture : celui de la silve. Il s’ouvre sur une éclairante mise au point introductive de Perrine Galand (« Peut‑on se repérer dans la silve ? », p. 5‑13), dont les travaux pionniers sur l’écriture silvaine font autorité1. Ce précieux avant‑propos donne d’indispensables repères historiques et théoriques, soulignant l’insaisissabilité taxinomique de la silve, qui ne se définit ni par une thématique, ni par le vers ou la prose, ni par son énonciation, mais par une « attitude idéologique », par une vision morcelée du monde. « Partie de la poésie de circonstance, des recueils philologiques et des collections de curiosités pour aboutir à l’essai autobiographique et dissident », la silve constitue, en dernier lieu, « un phénomène de résistance de l’individu aux tentations normatives de chaque époque », selon les termes même de P. Galand. Et c’est précisément selon ce principe que s’organise la materia dense et variée de ce beau livre, puisqu’il suit globalement un fil chronologique : ses cinq dernières parties sont successivement consacrées à l’Antiquité tardive, au Moyen Âge, à la Renaissance (en deux parties) et au « devenir de la silve aux xviie et xviiie siècles ». En revanche, les deux premières parties détachent certaines contributions de la chronologie : une première (« Silua, le terme et le genre : définitions antiques et humanistes ») présente un cadre théorique fort utile en début de parcours, tandis qu’une seconde est dédiée aux rapports entre la silve et les arts dans l’Antiquité et à la Renaissance, bien que son détachement du fil chronologique paraisse parfois plus artificiel. À la fois Rezeptionsgeschichte des Silves de Stace dans leur riche héritage européen et parcours érudit dans les avatars successifs d’un principe d’écriture libérée, ce livre, par son ampleur et sa richesse, nous contraint ici‑même à une certaine longueur pour tenter de rendre compte des stimulantes perspectives qu’il apporte à l’histoire littéraire européenne.
Avec ou sans Stace : l’écriture silvaine de l’Antiquité au Moyen Âge
2Deux contributions inaugurales, sous la plume de deux grands spécialistes de philosophie romaine, font un point très intéressant sur la sémantique du mot silua en latin, dans le prolongement d’un article du premier d’entre eux2. Partant des interprétations modernes du titre de Siluae choisi par Stace pour son recueil, qui recouvre pour certains critiques les caractéristiques d’improvisation, d’impromptu et de composition rapide de l’œuvre, pour d’autres celles de variété, de confusion et de mélange correspondant au stilus remissior revendiqué par le poète, E. Malaspina (« La formation et l’usage du titre Siluae en latin classique », p. 17‑43) retrace la préhistoire de l’emploi du mot, au singulier comme au pluriel, toujours lié au problème posé par la traduction du mot grec hylè (ὕλη), rendu en latin à la fois par materia et par silua. La valeur métaphorique naturelle de ce dernier terme au singulier (« forêt », « grande quantité ») est bien attestée dans le vocabulaire de la rhétorique, notamment chez Cicéron, avec une connotation de « confusion » liée à la phase de l’inuentio, tout en conservant une connotation secondaire, plus savante, par métalepse, le mot endossant des valeurs de hylè dont la traduction aurait logiquement dû être materia (« matière », « sujet »). À l’époque de Stace, toujours au singulier, silua est utilisé comme titre de mélanges érudits, avant que Quintilien ne s’en serve pour désigner une « ébauche », un « impromptu », cas unique où le terme est lié à la notion d’improvisation. Malaspina démontre enfin que c’est après Stace et ses déclarations préfacielles que l’on confère aux Siluae ce sens d’improvisation, bien que l’idée prédominante, chez lui, demeurât certainement celle de variété, de mélange. C. Lévy (« Note sur l’évolution sémantique de silua, de l’époque républicaine à saint Augustin », p. 45‑56) souligne lui aussi que, si silua est employé dans l’œuvre rhétorique de Cicéron, il se trouve néanmoins exclu par l’Arpinate du champ philosophique pour traduire hylè, qu’il rend alors par materia/materies, un tournant s’opérant au ive siècle avec Calcidius et Augustin qui confèrent à silua le sens de « ce à partir de quoi tout est fait », évolution qui n’est d’ailleurs pas étrangère à la conception que se feront les auteurs médiévaux et humanistes du sens de silua.
3Aucun article n’est proprement consacré à Stace (v. 40‑96), pourtant le créateur de ce genre d’écriture nouveau, mais l’archétype de la poétique silvaine est néanmoins présent à chaque page de l’ouvrage, ou presque. Poèmes de circonstance relevant pour partie des codes de l’épidictique, ses Siluae (« poèmes‑forêts »), dans lesquelles le poète porte un regard tantôt émerveillé, tantôt douloureux sur son univers, « se jouent des tabous génériques » pour « embrasser la variété du monde humain », selon les belles formules de P. Galand, en revendiquant leur inspiration « humorale » (le fameux subitus calor) comme leur nature improvisée. De ce point de vue, G. Sauron (« Deux exemples d’œuvres improvisées dans le Latium et la Campanie », p. 101‑112) souligne bien le goût de la performance et de l’improvisation en tant que jeu de société à l’œuvre dans la Rome antique, en se fondant sur le cas de deux œuvres : un court poème en hexamètres improvisé lors d’un banquet donné par l’empereur Domitien dans le triclinium de la villa impériale de Sperlonga, puis gravé sur marbre et affiché à l’intérieur de la grotte naturelle qui y avait été aménagée, puis une peinture ornant le biclinium de la maison d’Octavius Quartio à Pompéi, représentant Pyrame et Thisbé et peut‑être improvisée, elle aussi, à l’occasion d’un banquet.
4Bien que la latinité tardive ne nous ait pas laissé de compositions littéraires portant le titre de Silves, l’influence du modèle stacien sur Ausone, Ambroise, Prudence, Claudien ou Sidoine Apollinaire et le goût pour une écriture biographique qui associe franchise, spontanéité et érudition étaient déjà des éléments bien connus. Trois contributions étudient la fortune de cette écriture libérée aux ive, ve et vie siècles. B. Goldlust (« L’héritage de Stace : nature et culture dans l’écriture silvaine de la latinité tardive », p. 183‑211), définissant la silve comme un « phénomène littéraire mouvant » plutôt que comme une forme statique, retrouve ainsi les caractéristiques d’une écriture silvaine chez quelques auteurs tardifs : une liberté de ton permettant un regard critique sur le monde, lié à l’humeur et aux circonstances, une proximité avec d’autres genres littéraires (satire, anthologie, miscellanées) et un éclatement en des formes multiples qui se contaminent mutuellement, héritage de la poikilia alexandrine. Plus précisément, l’article s’intéresse à la dialectique à l’œuvre dans l’écriture silvaine entre nature et culture, entre spontanéité de l’écriture et modèles littéraires. Il analyse ainsi onze lettres de Symmaque à son père Avianius, soulignant la tension entre le naturel du sermo et les modèles culturels omniprésents, puis les Saturnales de Macrobe, ni véritables miscellanées, car ordonnées (à la différence des Nuits attiques d’Aulu‑Gelle), ni véritables silves. En revanche, le cas de Sidoine Apollinaire revêt une importance particulière pour notre histoire. Dans ses Carmina minora, l’évêque de Clermont fait nommément référence à Stace dans les poèmes 9 et 22, qui font allusion à ses Siluulae (« Silvettes ») et le présentent comme le poète favori de l’auteur. B. Goldlust distingue dans l’œuvre de Sidoine les poèmes épigrammatiques qui évoquent, par leurs descriptions et leur caractère circonstanciel, la poétique silvaine (12 et 17‑21), et les « vraies Silves » (9 et 22‑24), notamment la description du Burgus de Pontius Leontius, pétrie de réminiscences staciennes et se revendiquant d’une écriture libérée et naturelle contre « une conception fixiste de la généricité ». F. E. Consolino (« Sidonio et le Siluae », p. 213‑236) se concentre quant à elle sur le cas unique de Sidoine, dont l’imitation de Stace était déjà bien établie, et étudie son rapport de filiation avec son modèle supposé. À la lumière d’une analyse serrée des Carmina 9 et 22, elle démontre de façon convaincante que Stace est certes un modèle important pour Sidoine, mais certainement pas le modèle qui aurait inspiré son recueil. Enfin, un article de V. Zarini (« L’écriture de la silve dans les poèmes d’Ennode », p. 237‑250) est consacré à l’œuvre d’Ennode de Pavie, poète gallo‑romain du début du vie siècle, qui ne présente jamais ses Carmina comme une œuvre silvaine, bien qu’ils en revêtent quelques traits saillants : dans les poèmes profanes, une affectivité, en lien avec la rhétorique épidictique qui s’y trouve déployée, mais aussi une éthique propre à la silve, caractérisée par une leuitas qui passe par le refus des grands genres, par la brièveté, l’improvisation, ou encore la préciosité. V. Zarini soulève également la question de la possible « conversion » de la silve païenne dans les poèmes religieux, concluant à l’incompatibilité de l’écriture silvaine avec la poésie religieuse non épidictique dans l’œuvre d’Ennode.
5Le problème du Nachleben de la silve au Moyen Âge est plus complexe encore : en effet, après l’époque carolingienne, si les Silves de Stace ne sont plus lues, au contraire de sa Thébaïde et de son Achilléide, ce n’est pas le cas de ses imitateurs, en particulier de Sidoine Apollinaire, dont le carmen 22 évoqué plus haut devient le véritable modèle médiéval de la silve. Dans un bref mais stimulant article, F. Mora‑Lebrun (« Sidoine Apollinaire et Benoît de Sainte‑Maure : de la silve au dit ? », p. 253‑266) se demande d’ailleurs si le Moyen Âge a pu connaître une forme d’écriture libérée pouvant s’apparenter à la silve et formule la séduisante hypothèse qu’il pourrait s’agir du « dit ». Dans le prologue de son Roman de Troie (v. 1165), Benoît de Sainte‑Maure revendique en effet l’insertion dans son récit d’ekphraseis digressives (« aucun buen dit »), marques du « style gemmé » cher à Sidoine Apollinaire, écrivain très apprécié au xiie siècle et considéré comme un maître de l’amplificatio descriptive dans les arts poétiques médiévaux. Si le « dit » selon Benoît de Sainte‑Maure ne peut se réduire à la silve, cette dernière a pu constituer l’un des modèles de ces digressions et, plus largement, du « dit », qui devient un genre autonome au xiiie siècle et se caractérise par sa forme versifiée, son exigence de brièveté et une « prise en charge explicite par le “je” de l’écrivain ». A. Lamy (« Silua Siluestris. La matière d’une écriture silvaine dans la Cosmographia de Bernard Silvestre », p. 267‑287) analyse quant à elle le prosimètre Cosmographia, composé vers 1148 par Bernard Silvestre à l’imitation de la Consolation de Philosophie de Boèce, et dans lequel Silua est une allégorie de la matière première, sans ordre ni forme, à l’origine de la déconstruction du mythe de la création par le biais de l’intrusion de commentaires philosophiques au sein du mythe, de répertoires encyclopédiques au sein de l’écriture versifiée, ou de l’auteur lui‑même dans son texte. L’article repère ainsi des marqueurs de la poétique silvaine dans une écriture du foisonnement qui cherche à dépeindre la totalité du monde, dans un mélange de voix, de styles et de mètres et dans une énonciation polyphonique. Pour F. Rouillé (« Le goût pour l’obscurité dans l’épopée latine du xiie siècle, un avatar médiéval de l’écriture de la silve ? », p. 289‑313), cette œuvre de Bernard Silvestre pourrait justement être le chaînon manquant de cette histoire de l’écriture silvaine au Moyen Âge. Étudiant quelques épopées latines composées entre 1178 et 1188 (l’Alexandre de Gautier de Châtillon, l’Iliade de Joseph d’Exeter, l’Anticlaudianus d’Alain de Lille et l’Architrenius de Jean de Garlande), il montre que l’on peut trouver des traces des gemmea pratea siluularum de Sidoine dans l’épopée médiévale latine, dans le « style gemmé » et le mélange des genres (temperamentum) qui incorpore aux éclats épiques les raffinements délicats de la silve. En cela, l’écriture gemmée héritée de Sidoine est liée à l’obscurité poétique, via la théorie de l’integumentum, empruntée au Commentaire sur le Songe de Scipion de Macrobe, de l’allégorie qui cache sous le voile de la fable l’enseignement de la vérité. Les poètes épiques médio‑latins ont donc « songé » aux silves staciennes non pas en tant que genre, mais en tant que stilus gemmeus qu’ils ont pu intégrer à leur poétique de l’integumentum destinée à voiler le sens philosophique profond de leurs textes, influence imaginaire dont on peut retrouver le fil jusque chez Dante et sa Divine Comédie.
Le retour de Stace : commentaires humanistes & modélisations théoriques
6C’est seulement en 1417 que Poggio Bracciolini découvre, à l’occasion du Concile de Constance, un manuscrit des Silves de Stace qu’il fait immédiatement expédier en Italie. Cependant, le texte circule peu, du moins avant la mort du Pogge, en 1459, et l’édition princeps du grand œuvre de Stace, qui date seulement de 1472. G. Abbamonte (« La ricezione della silva di Stazio sulla villa Sorrentina di Pollio Felice nei commentari umanistici », p. 337‑372) livre une contribution tout à fait remarquable, qui se fonde sur le cas de la pièce consacrée par Stace à la villa sorrentine de son ami et patronus Pollius Felix (Silves, 2, 2). Partant des tendances actuelles de la critique, l’auteur constate que celle‑ci s’est surtout concentrée sur deux problèmes littéraires — celui de la poétique de l’ekphrasis en vers et celui de l’aspect éthique qui affleure dans la mise en scène du propriétaire de la villa — ainsi que sur les problèmes liés aux realia géographiques ou mythologiques et à l’établissement du texte lui‑même. Une comparaison précise entre le commentaire du véronais Domizio Calderini, publié en 1475, et celui d’Ange Politien, datant de 1480 mais demeuré inédit jusqu’en 1978, permet de réhabiliter le travail de Calderini, plus proche finalement des exégètes modernes de Stace que le grand Politien, dont le commentaire, rédigé en réaction (souvent polémique) à celui de son prédécesseur, se révèle être bien souvent une version réduite et simplifiée de celui de Calderini, qui a le mérite de proposer des introductions générales et des interprétations d’ensemble. Leur différence d’approche est notamment sise dans le fait que Calderini veut transmettre une interprétation des poèmes de Stace, tandis que Politien cherche à faire montre d’érudition et évacue, de fait, les problèmes proprement littéraires ou rhétoriques. Cela donne l’occasion à G. Abbamonte de retracer l’histoire du commentaire humaniste des Silves de Stace, qui débute dans les années 1460‑1470 à Rome, autour du cardinal Bessarion et de Pomponio Leto, et de souligner que la méthodologie du commentaire de Calderini doit beaucoup au travail réalisé à cette époque par Niccolò Perotti. Plus tard, le célèbre philologue calabrais Aulo Giano Parrasio, élève à Naples de Francesco Pucci, lui‑même ancien élève de Politien, s’est beaucoup intéressé à son tour à l’œuvre de Stace et la méthode de son commentaire signale la dette contractée à la fois auprès de Calderini et auprès de Politien : cette double influence apparaît nettement dans la mise en page d’un manuscrit des Silves annoté par Parrasio, qui sépare bien les remarques érudites de l’analyse stylistique et rhétorique. D. Coppini (« Calderini, Poliziano et il subitus calor di Stazio », p. 317‑335) s’intéresse en revanche aux positions de Calderini et Politien sur le genre et sur le rapport entre le subitus calor stacien et la théorisation humaniste du furor poétique. À cet égard, elle remarque elle aussi que les deux philologues relèvent dans l’œuvre de Stace les mêmes caractéristiques : le style élevé, les sujets variés et la préciosité culturelle. Du point de vue de l’inspiration, Calderini fait coïncider l’inspiration stacienne avec le furor poeticus, mais pointe une différence : pour lui, la silve se distingue des autres genres en ce que le furor se traduit par un subitus calor, par une inspiration improvisée et naturelle qui ne s’étend pas au‑delà d’un certain nombre de vers et que la silve est le fruit non de l’ars du poète, mais de son ingenium, ce qui rend les Silves de Stace supérieures à ses productions épiques. À cela souscrit également Politien, qui y ajoute l’idée d’un transfert du furor poétique sur le lecteur comme sur le commentateur, un aspect que l’on retrouve aussi dans sa propre silve Nutricia.
7À ces deux précieuses contributions s’ajoutent deux articles consacrés aux silves dans l’érudition humaniste. A. Maranini (« Silua est plena eruditionis et indiga interpretationis. Quand l’interprète de la silua ne satisfait pas les oreilles des érudits », p. 373‑416) retrace la tradition encyclopédique du xvie siècle sur le sens de silua, examinant notamment les rapports qu’entretient le genre avec les miscellanées. Un article en espagnol de F. González Vega (« Forêts cultivées : les Siluae morales de Josse Bade et la préhistoire de l’essai moderne », p. 417‑435) se concentre sur le cas particulier des Siluae morales cum interpretatione de l’imprimeur Josse Bade (1492), qui se situent à la fois dans la tradition de la silve politianesque et dans celle de la première centurie des Miscellanea de l’humaniste florentin (1489). Anthologie de vers antiques, médiévaux et modernes en latin destinée à la jeunesse, ces Siluae mélangent vers (dans les textes choisis) et prose (dans le commentaire paraphrastique qui leur est adjoint), mais instaurent également, par le biais d’un commentaire « familiariter expositum », une intimité discursive entre lecteur et commentateur.
8D’autre part, deux riches articles figurant au début du volume font le point sur la manière dont les arts poétiques humanistes ont appréhendé le « genre » insaisissable de la silve. V. Leroux (« Le genre de la silve dans les premières poétiques humanistes, de Fonzio à Minturno », p. 57‑78) explique admirablement comment les premiers poéticiens humanistes ont interprété la silve, en distinguant trois phases successives. Les premiers commentateurs se réfèrent toujours à l’œuvre de Stace et définissent la silve comme un « genre d’écriture », tels Perotti ou Calderini, ce dernier l’associant à la grandeur héroïque, à la variété et à l’érudition. Politien, quant à lui, insiste sur sa libre composition, sur sa longueur médiane qui la distingue de la breuitas de l’épigramme, sur son ornatus et sur le brouillage des normes génériques. Que ce soit dans les arts poétiques de Bartolommeo Fonzio (1490‑1492), qui la lie au genre héroïque avec lequel elle partage l’hexamètre et l’ornatus, de Pietro Crinito (1505), qui relève particulièrement son caractère éthique, ou de Lilio Gregorio Giraldi (1545), qui insiste plutôt sur son caractère autobiographique, la silve demeure indissociable du modèle stacien. Contrairement aux héritiers de Politien, une deuxième tendance, représentée par les poétiques de Marco Girolamo Vida (1510) et de Jacques Dubois (1516), ne cite ni Stace ni la silve, bien que l’on puisse isoler chez Dubois la défense d’une écriture du thaumaston et de la uarietas, ou, chez Vida, l’éloge de l’individualité, de la spontanéité et de la remissio, caractéristiques de la silve stacienne s’il en est. Enfin, une troisième tendance est représentée par les poéticiens qui cherchent à intégrer la silve dans une classification des genres et à réfléchir sur la question de l’intergénéricité : Joachim von Watt (1518) ne l’apparente plus à l’épopée, mais à l’épigramme, tandis que Francesco Robortello (1548) la rapproche davantage des satires et des épîtres horatiennes. Antonio Minturno (1559), enfin, n’y voit pas un genre singulier (singulare genus), mais un mode d’écriture lié aux circonstances, un « genre‑non genre », à la manière de Politien, tout en la ravalant au rang d’essai préparatoire et de genre médiocre. Dans la lignée de cette mise au point, G. Vogt‑Spira (« Cum igitur afflari possis ad meditandam syluam. Julius Caesar Scaliger und das Gattungsproblem der Silve », p. 79‑97) s’intéresse au cas particulier des Poetices libri septem de Jules‑César Scaliger (1561), l’opus magnum de la théorie poétique humaniste. Définies comme des poematia subito excussa calore, les silves posent un défi au cadre normatif de la théorie poétique de Scaliger, qui affirme l’essence panégyrique de la silve tout en la déclinant en sous‑genres correspondant aux circonstances de sa composition (epithalamium, propempticon…) et dont il peut, dès lors, présenter les règles en fonction de chaque occasion, s’inspirant pour ce faire des textes grecs de Ménandre le Rhéteur. Mais c’est aussi le fait que la silve fasse de la vie et de ses circonstances sa propre materia qui explique cette résistance à entrer dans la norme taxinomique scaligérienne.
Variations silvaines en tous genres dans l’Europe de la Renaissance
9Une grande partie des contributions du volume examine ensuite l’influence diffuse que la silve, du fait de sa plasticité générique, a pu avoir sur d’autres genres littéraires, par le biais d’études de cas précis. H. Casanova‑Robin (« Silve et bucolique : dialogue des genres et écriture de soi chez Giovanni Pontano et les poètes napolitains de la fin du Quattrocento », p. 439‑461) explore ainsi la perméabilité de la silve au genre pastoral, avec lequel elle a de nombreux points communs : la bucolique est en effet un genre humble, fondé sur un style simple qui n’est pas sans rappeler le stilus remissior stacien, ainsi que sur le mélange des genres (temperamentum). Se concentrant sur le milieu napolitain de la fin du Quattrocento, l’article explore brillamment ce phénomène de « dialogue des genres », lié au fait que la bucolique napolitaine s’inscrit également dans la tradition stacienne. C’est aussi un espace d’expérimentation poétique dont H. Casanova‑Robin retrouve les prémices dans les œuvres du ferrarais Matteo Boiardo (1463‑1464), du florentin Naldo Naldi (1460‑1465), et surtout dans les églogues pontaniennes Acon et Coryle (1463‑1464), lieu du uarius cantus et de l’hybridité générique. D’autre part, l’importance accordée à la phantasia et au travail sur la représentation du paysage donne lieu au développement d’une véritable « topo‑mythologie » napolitaine, surtout sensible chez Pontano et Sannazar. Enfin, l’écriture de l’intime à l’œuvre dans la bucolique, qui voit une dimension affective, voire onirique, colorer la représentation des perceptions personnelles, en fait un nouveau point de rencontre avec l’écriture silvaine.
10Étudiant les nombreux recueils de silves publiés en France dans les années 1500‑1520, S. Provini (« La silve entre épos et éloge pendant les premières Guerres d’Italie », p. 463‑489) s’efforce quant à elle de définir un genre de la silve héroïque, composé en réponse à des sujets et à des conditions d’écriture qui se prêtent mal à la composition de grandes œuvres épiques. Après avoir remarquablement retracé l’histoire de la diffusion de cette mode dans les milieux humanistes parisiens, liée à une influence italienne très nette qui transmet l’héritage de la poétique de Politien (Fausto Andrelini, Jérôme Aléandre, Quinziano Stoa, Josse Bade…), l’article étudie précisément les cas de quelques silves publiées à l’occasion de victoires du roi de France en Italie. Malgré des différences, un mode d’écriture silvaine se dessine clairement dans les œuvres étudiées, caractérisé par une même forme d’inspiration dictée par un sentiment patriotique ainsi que par la mise en œuvre d’une riche érudition et d’une imitation variée. Cette écriture libérée des normes stylistiques et génériques, qui laisse place à la subjectivité auctoriale, offrait donc, face au grand genre de l’épopée, une voie possible pour une écriture rapide, sous la pression des circonstances.
11Deux contributions s’intéressent également aux liens entretenus par la silve avec l’épigramme, déjà évoqués par certains poéticiens humanistes. S. Laigneau‑Fontaine (« Nicolas Bourbon, Ferraria – Nugae : de la silve à l’épigramme, mutations et convergences », p. 491‑508) présente une étude de cas dédiée aux rapports entre le recueil épigrammatique de Nicolas Bourbon, intitulé Nugae (1530‑1533), et la silve Ferraria, publiée au sein du recueil des Nugae et consacrée aux forges dont le père du poète était le propriétaire. Les déclarations préfacielles de Bourbon soulignent le caractère humble des deux genres, la dimension ludique de l’écriture épigrammatique, qui fait écho aux praelusiones staciennes, l’improvisation revendiquée pour certaines épigrammes, qui rappelle la spontanéité de la composition de la silve (nommée tumultuaria descriptio en 1530). De même, l’esthétique de la bigarrure, qui caractérise l’épigramme et qui se réalise dans le cadre du recueil, se retrouve dans la silve, œuvre « patchwork » tout en ruptures et dissonances, mais qui se réalise, elle, à l’intérieur même de la pièce, poussant en quelque sorte à leur paroxysme les critères définitoires de l’épigramme. La contribution de C. Langlois‑Pézeret (« Épigramme lyonnaise et lyrisme inspiré », p. 509‑523) porte elle aussi sur la renaissance de l’épigramme en France, en particulier à Lyon, revival qui n’est pas sans rapports avec la poétique de la silve. Soulignant la variété, la recherche du naturel, le dépassement des genres et la spontanéité à l’œuvre dans le genre épigrammatique, elle relie ces éléments à la question du « lyrisme inspiré », qui mime la composition spontanée et l’enthousiasme hérité de la doctrine néo‑platonicienne. Empruntant ses exemples aux recueils de Nicolas Bourbon, de Jean Visagier (1536‑1538), d’Étienne Dolet (1538), de Gilbert Ducher (1538), de Scévole de Sainte-Marthe et de Scève, l’article montre bien que l’épigramme se fait, dans le Lyon du début du xvie siècle, le « réceptacle du lyrisme inspiré » lié à la poétique de la silve.
12G. H. Tucker (« La poétique du centon, une poétique de la silve ? », p. 525‑564) examine les Centones ex Virgilio (1555) de Lelio Capilupi, poèmes de circonstance pseudo‑virgiliens ancrés dans la vie de la cour pontificale, et relève d’importantes coïncidences à la fois formelles, rhétoriques et esthétiques entre ces deux genres mineurs, en particulier leur ancrage dans la circonstance, leur caractère fragmentaire, bigarré, impromptu, lié à la variété et au jeu poétique. P. Ford (« George Buchanan et le concept de la silve », p. 565‑575) explore en détail les sept compositions portant le titre de Silves dans l’œuvre poétique de George Buchanan, composées entre 1539 et 1564, mais publiées seulement en 1567. Cet examen révèle que, pour le poète écossais, la silve est un poème en hexamètres dactyliques, à dominante épidictique, rédigée dans un style érudit, et dont la composition est liée à des occasions ou des événements particuliers et variés. J. Nassichuk (« Les silves polémiques de Léger Duchesne », p. 577‑600) démontre lui aussi les potentialités multiples de l’écriture silvaine, certes liée à l’occasion, mais offrant au poète un espace de liberté et une réelle richesse discursive. Le professeur de latin Léger Duchesne, catholique et anti‑calviniste virulent à l’époque où font rage les guerres de religion, nous a laissé, outre une Praefatio aux Silves de Stace, deux silves polémiques : une Silve parénétique adressée au roi Charles ix au moment de la paix de Longjumeau (1568) pour s’élever contre la pluralité religieuse et appeler le roi à préférer à une paix temporaire une guerre pouvant conduire à une paix durable, ainsi qu’une Silve célébrant l’assassinat de l’amiral de Coligny (1572), quelques mois après les massacres de la Saint‑Barthélémy, et encourageant le roi à parachever la destruction des calvinistes. Cette fois, la silve se révèle un genre propice au développement d’un discours polémique, violemment partisan, mettant en œuvre une poétique non seulement épidictique ou démonstrative, mais également délibérative. Enfin, H. J. Van Dam (« Batavian Woods : Siluae in the Low Countries from 1500 to 1650 », p. 601‑624) examine les recueils comprenant des silves publiées en Belgique et aux Pays‑Bas entre 1497 et 1650, notant que, sur ces vingt‑huit volumes, vingt‑et‑un ont significativement été composés après la publication des Poetices libri septem de Jules‑César Scaliger (1561) et après la fondation de l’université de Leyde. L’article présente un classement typologique de ces différentes silves, distinguant les poèmes relativement longs portant le titre de Silua au singulier, dans la tradition politianesque, les recueils anthologiques ayant pour titre Silua au singulier (Silua Odarum, par exemple) et les recueils ayant pour titre Siluae au pluriel, qui sont généralement de longs poèmes de circonstance en hexamètres. À cet égard, si l’on trouve par exemple dans les Silves de Jean Second toutes sortes de poèmes courts inclassables par ailleurs, à partir de l’époque de Daniel Heinsius et Hugo Grotius, la « silve batave » évolue vers une imitation plus sophistiquée et plus formelle des modèles anciens, très différente des silves italiennes ou françaises.
13Trois articles prennent par ailleurs pour objet les rapports entre la silve et d’autres arts. L. Scarparo‑Coutier (« La silve comme outil de construction de l’identité artistique, dynastique et territoriale à la Renaissance : l’exemple des Silves de Stace à Naples », p. 113‑130) souligne ainsi que la dimension descriptive et épidictique de la silve stacienne offrait aux poètes comme aux artistes l’opportunité de produire une image de l’identité politique, territoriale et artistique d’un territoire donné, se concentrant dans sa contribution sur le cas du Royaume de Naples à partir du règne d’Alphonse d’Aragon. Elle relève par exemple l’ancrage de la silve dans l’espace et son lien avec la rhétorique de l’éloge et la pratique de l’ekphrasis, puis étudie les cas de l’arc de triomphe du Castel Nuovo, véritable manifeste de l’art officiel du royaume, et de la mythification du territoire à l’œuvre dans la figure de la nymphe Parthénope. Émilie Séris (« La silve à la Renaissance : un modèle pour les peintres et les sculpteurs ? », p. 131‑155), également auteur d’un exercice d’écriture silvaine contemporaine publié en appendice de l’ouvrage, dédie une démonstration solidement argumentée et convaincante au De sculptura (1504) de Pomponius Gauricus, prouvant que ce grand lecteur de Stace, lui‑même auteur de silves, a développé une théorie de l’ars sculptoria qui s’apparente à l’ars poetica de la silve, notamment par la place accordée dans le De sculptura aux circonstances, à la phantasia, à l’innutrition poétique, à l’ornementation et à la blanda uarietas. Enfin, C. Deutsch (« La selva musicale comme compendium stylistique dans l’Italie du Seicento », p. 157‑180) s’intéresse à la mode de la selva dans la musique italienne du xviie siècle, partant de la Selva di varia ricreatione (1590) d’Orazio Vecchi, première transposition musicale de la silve littéraire en Italie, puis examinant avec précision les caractéristiques de ces silves musicales, peu nombreuses et principalement publiées entre 1590 et 1664, notamment leur hybridité générique et leur variété.
Derniers feux de la silve, du Siglo de Oro à l’essayistique allemande
14À l’issue de cette promenade dans les denses siluae de la Renaissance, qui débordent parfois sur celles de l’Âge classique, l’on pourrait croire à une disparition de l’écriture silvaine à l’issue de la période qui lui a rendu le plus bel hommage. Trois articles explorent cependant l’Afterlife de la silve du xviie au xixe siècle. R. Cacho Casal (« Quevedo y Marino entre las estrellas », p. 627‑656) nous entraîne dans la poésie espagnole du Siglo de Oro et rappelle que le terme de « silve » désigne alors à la fois une forme métrique, combinaison libre d’heptasyllabes et d’hendécasyllabes ouverte aux modèles humanistes des xve et xvie siècles, et un genre littéraire inspiré du modèle stacien comme des miscellanées à la manière de la Silva de varia lección de Pedro Mexía (1540). L’article étudie plus particulièrement l’Himno a las estrellas de Francisco de Quevedo, partie d’un groupe de silves composées au début du xviie siècle, mais publiées seulement en 1670. Principalement inspiré de l’Inno alle stelle de Giambattista Marino (1608), il mêle dans la liberté de la silve la tradition de l’hymne à celle de la lyrique amoureuse, la poésie néo‑latine à celle de Stace, le pétrarquisme au néo‑platonisme, les modèles de la Pléiade à ceux de Góngora ou Marino, en une véritable mosaïque poétique qui fait de la silve l’une des formes les plus innovatrices de la poésie baroque.
15En Grande‑Bretagne, le devenir de la silve est plus « curieux », selon F. De Bruyn (« The Afterlife of the Silua in the Seventeenth and Eighteenth Century », p. 657‑688) : se posant la question de la disparition soudaine du genre au début du xviiie siècle, alors même que l’influence des classiques demeurait prégnante sur les poètes vernaculaires et que la poésie latine était encore prospère, l’auteur étudie avec précision les mutations de la silve dans la littérature anglaise, de Francis Bacon à Dryden, en passant par Ben Jonson et Milton, dans des ouvrages en prose comme en vers toujours caractérisés par leur grande hétérogénéité. En dépit de sa malléabilité, la silve se voit finalement renommée, combinée à d’autres genres ou subsumée par de nouvelles formes d’écriture, comme le journal savant ou le magazine.
16In fine, un bel article de W. Adam (« Les silves en prose et l’essayistique allemande », p. 689‑716) retrace la tradition des Wälder allemands, en partant des Kritische Wälder du jeune Herder (1769), le prototype de l’essai‑silve, qui se revendique de la tradition des écrits de circonstance en prose définis par Quintilien. Soulignant son refus des normes et des règles, en art comme en philosophie, revendiquant la spontanéité comme signe caractéristique du génie ainsi qu’une esthétique de l’esquisse, Herder constituera à son tour le modèle des Altdeutsche Wälder (1813‑1816) des frères Grimm, revue dans laquelle les fondateurs de la philologie allemande peuvent publier les premiers résultats de leurs recherches, présentés comme des efforts provisoires, sous le signe de la variété, ou encore des Kritische Wälder de Theodor Mundt (1833). L’article – et l’ouvrage – s’achève sur l’examen de deux Kritische Wälder publiés dans les années 1970, preuve s’il en est que la silve n’avait jamais réellement disparu du paysage littéraire européen depuis les vers latins de P. Papinius Statius.
***
17Composé avec beaucoup de soin et fort agréablement présenté3, ce volume constitue désormais l’ouvrage de référence indispensable à qui veut étudier les caractéristiques de ce genre littéraire qui n’en est pas vraiment un et ses avatars dans la culture européenne. On regrettera cependant très vivement l’absence d’index nominum et d’index locorum, utile appendice qu’aurait mérité un livre aussi dense et varié et qui en eût facilité la consultation. De même, si la présence à la fin de chaque article d’une bibliographie est bienvenue, peut‑être eût‑il été préférable d’établir une bibliographie raisonnée en fin d’ouvrage, faisant la part des sources et de la littérature secondaire. Mais cela n’enlève rien à ce précieux ouvrage qui intéressera à la fois ceux qui étudient la littérature latine dans toutes ses dimensions spatiales et temporelles comme ceux qui souhaitent découvrir un aspect méconnu des racines anciennes de la littérature européenne.

