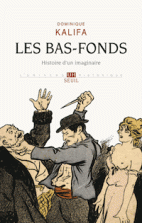
À la lumière des bas-fonds
1Que ce soit dans la production culturelle ou la recherche universitaire, la représentation des criminels, de la pègre et des bas‑fonds est un sujet rémanent. Sans jamais complètement disparaître, elle constitue une ligne de basse de l’imaginaire social, et se fait plus clairement entendre en période de crise. Jean Duvignaud arguait déjà, en des termes durkheimiens, d’une époque d’anomie sociale pour expliquer les criminels qui hantent le théâtre de la fin du xvie siècle1. Dans Les Bas-Fonds. Histoire d’un imaginaire, Dominique Kalifa situe quant à lui l’émergence d’une sous-société, les bas‑fonds, au milieu du xixe siècle, moment de basculement — et d’angoisses — de la société industrielle. Cet imaginaire à la fois transgressif et anxieux est une construction historique, liée à des périodes bien déterminées, révélant des bouleversements sociaux plus vastes que les seules représentations du crime. Les études sur le sujet suivent également — quoique dans une moindre mesure — un rythme cyclique, signe d’une réévaluation scientifique des marges sociales et de leurs clichés. Après les années 1950-1960, qui ont vu la parution d’ouvrages de référence (ceux de Louis Chevalier et d’Alexandre Vexliard pour ne citer qu’eux2), la dernière décennie a produit de nouveaux travaux concernant la pègre d’hier et d’aujourd’hui, historique ou imaginaire : qu’il s’agisse des livres du journaliste Jérôme Pierrat sur le milieu, ou, plus récemment, de l’historien Benoît Garnot sur l’Être brigand ou de la médiéviste Valérie Toureille, les bas-fonds ne cessent de resurgir3.
2D. Kalifa identifie avec justesse les ressorts de cette fascination et les motifs d’un imaginaire commun à toutes les sociétés occidentales. Les bas‑fonds ont encore et toujours quelque chose à révéler sur le monde qui vit à la surface. Le présent ouvrage offre un panorama historique des lieux mal famés, de leurs constructions et de leurs modes d’exploration en Europe comme en Amérique, du Moyen Âge jusqu’à l’époque contemporaine. Son objet est toutefois moins la réalité des bas‑fonds que leurs discours : l’historien ne vise pas tant à découvrir une pègre authentique qu’à interroger ses fictions. Adoptant une perspective généalogique et discursive, le livre porte un intérêt particulier aux mots qui désignent les bas‑fonds, aux catégories de la pègre, aux lieux communs et à leurs réactivations périodiques. Ce faisant, il prend des accents très actuels alors que resurgissent les discours populistes stigmatisant les « mauvais pauvres », les « profiteurs », les Roms et autres bandes de sauvageons. À cet égard D. Kalifa, parce qu’il révèle les présupposés et les artifices de l’imaginaire interlope, fait un usage particulièrement salutaire des bas‑fonds. Embrassant un vaste spectre de connaissances, l’ouvrage constitue un outil indispensable pour les études historiques, littéraires et discursives concernant cette période. Par ailleurs, le lecteur néophyte entrera facilement dans Les Bas-fonds, tant l’écriture se distingue par sa clarté et sa vivacité. L’ouvrage représente à la fois une somme impressionnante sur le sujet et une invitation à réfléchir plus avant sur les formes attribuées à ce « residuum »social (p. 37‑38).
Sables mouvants : où trouver les bas-fonds ?
3Toujours présent mais objet d’un intérêt périodique, oscillant entre une localisation précise et des migrations plus larges, voici un imaginaire pour le moins délicat à cerner. Ce mouvement pendulaire sert de fil conducteur à D. Kalifa, qui, tout en dégageant les invariants, va souligner leurs inflexions sur plus d’un siècle et en expliquer les significations sociales. Ce faisant, il se place dans la continuité de plusieurs travaux d’histoire contemporaine — ceux d’Alain Corbin, tout d’abord, auquel est dédié le livre et à qui est empruntée la notion de « paroxysme », défini comme un ensemble historique qui révèle dans l’affolement ou dans la crudité les angoisses les plus profondément enfouies4. D. Kalifa débute ainsi son étude en 1840, quand apparaît en France l’expression de bas-fonds dans son acception sociale, et la poursuit jusque dans les années 1930, moment où cet imaginaire va s’essouffler. La périodisation s’accompagne d’une analyse des crises et des discours sociaux qui n’est pas sans évoquer l’héritage de Michel Foucault, mais aussi les travaux de Marc Angenot — que D. Kalifa ne cite pas toutefois —, ne serait‑ce que par l’ampleur et l’éclectisme des matériaux étudiés.
4L’ouvrage de D. Kalifa se distingue cependant de la plupart de ceux qui sont consacrés à la pègre, en s’intéressant moins au peuple pégriot qu’à son arrière-plan, toile de fond souvent négligée par la recherche et qui pourtant engendre cette contre-société. Bien qu’il ne s’attache pas exclusivement aux décors interlopes (on le sens parfois plus tenté par les figures qui y évoluent), on pourrait rattacher ce livreà d’autres études de l’imaginaire des lieux, comme les travaux déjà cités de Louis Chevalier ou encore ceux de Simone Delattre sur le Paris nocturne5. Précisons néanmoins que Les Bas‑fonds relèvent moins d’une topologie imaginaire, associée à un lieu précis (Paris dans l’imaginaire bourgeois par exemple), que d’une topologie de l’imaginaire, transnationale, mouvante et susceptible d’une lecture globale. Les bas-fonds sont présents à l’esprit de plus d’un peuple ; ils essaiment à travers toutes les villes. Bien que pluriels, ils forment un imaginaire social, c’est-à-dire « un système cohérent, dynamique, de représentation du monde social, une sorte de répertoire des figures et des identités collectives dont se dote chaque société à des moments donnés de son histoire » (p. 20). Loin d’être seulement le symptôme d’une époque, cet imaginaire produit et institue le social plus encore qu’il ne le reflète. Pour ce faire, il doit s’incarner dans des histoires. D. Kalifa reprend ainsi une définition de Pierre Popovic particulièrement fertile (l’imaginaire social comme « ensemble interactif de représentations corrélées organisées en fictions latentes6 ») afin de montrer comment ce répertoire est actualisé et scénarisé au fil de la période.
5Partant de considérations lexicales sur les bas‑fonds (maritimes), il en déroule le sens social selon deux perspectives qui s’entrecroisent dans l’ouvrage. D’une part, il propose une approche thématique et diachronique : isolant d’abord les motifs récurrents des bas‑fonds du xixe siècle, il en cherche les racines dans les époques antérieures avant d’en examiner l’éclosion et le développement à partir de 1840. Ce volet fait l’objet de la première partie du livre (« L’avènement des bas-fonds ») et est complété par la troisième partie, traitant de « l’affaissement d’un imaginaire ». D’autre part, l’ouvrage déploie une approche que l’on pourrait qualifier de paradigmatique : dans la deuxième partie (« Scénographies de l’envers social »), D. Kalifa présente quatre des scénarios typiques des bas-fonds, qui réalisent ces lieux par la fiction sans en épuiser toutes les possibilités. Ces deux manières bien distinctes d’envisager le sujet s’imposent, tant les bas-fonds échappent aux cadres traditionnels de l’analyse. De fait, cette méthodologie à double entrée confère une souplesse très appréciable au propos.
Construction d’un sous-bassement
6Le premier chapitre (« Dans l’antre de l’horreur ») augure assez bien de ces deux approches puisqu’il pointe des éléments au fondement des bas-fonds tout en esquissant leur évolution, que les chapitres suivants examineront plus en détail. Il place d’emblée cet imaginaire dans le contexte de la ville — mais de la ville étroite, suintante, pré-haussmannienne, qui suscite l’urbaphobie du xixe siècle. Les bas-fonds, d’abord localisés à Paris, dont Eugène Sue dévoile Les Mystères à partir de 1842, s’étendent aux autres pays et aux villes secondaires, selon un mouvement d’irradiation. Après Paris, ce sont Marseille, Rouen, mais aussi Londres, puis Liverpool et Édimbourg, New York puis Philadelphie et Chicago, et ensuite les grandes villes coloniales (Bombay, Alger, Manille, etc.) qui se dotent de bas‑fonds. Cet imaginaire centrifuge se fait également souterrain. Les bas-fonds sont un renfoncement, une dépression du lieu urbain. Le sous-monde (Underworld, Unterwelt) agrège les images des Enfers, de la catabase, mais aussi du résidu social. Sorte d’« égouttoir » de la ville, il allie l’eau et le péché à travers le cloaque, les galères des condamnés ou la poésie lugubre que charrient la Seine et la Tamise. Dans ces lieux prospèrent la misère, le vice et le crime — trois éléments dont le dosage varie au gré des sensibilités idéologiques. Plus constamment, la saleté règne dans le monde du « bas corporel », de la débauche, de la pestilence sexuelle et spirituelle. Bien que les races et les corps s’entremêlent, on parvient à distinguer les cinq principales familles (les pauvres, les voleurs, les femmes, les prisonniers, les bohémiens) qui constituent une contre-société transnationale : les images des gueux puis de la pègre circulent d’un pays à l’autre, grâce à l’essor du livre puis l’émergence de la culture de masse — à tel point que D. Kalifa voit dans les bas-fonds l’un des premiers exemples de mondialisation culturelle.
7Le monde interlope n’est pas utopique, mais vagabond. Puisqu’il est difficilement localisable, mieux vaut d’abord en esquisser une généalogie. Le deuxième chapitre (« Cours des miracles ») montre comment les motifs évoqués trouvent leurs racines — et leur dynamique — dans un passé lointain, parfois mythique. L’urbaphobie charrie le souvenir des villes bibliques ou antiques. Mais c’est surtout le Moyen Âge qui fournit deux éléments importants avec l’invention du « mauvais pauvre » au début du xiiie siècle et de la gueuserie aux xv-xvie, qui accompagne la montée des peurs sociales et la multiplication des images de marginaux. Ces distinctions vont véritablement structurer la pègre. Avec elles s’enclenchent les pratiques d’étiquetage du peuple misérable. Il s’agit de différencier le vrai du faux mendiant, celui qui mérite son sort et celui qu’on peut secourir, mais surtout il s’agit d’y voir plus clair dans le Royaume d’Argot et de se préserver des ruses des vagabonds. Les premiers textes des bas-fonds ne se déparent jamais de ces fonctions de taxinomie, de détection et de répression de la gueuserie. Des ouvrages judiciaires aux œuvres littéraires, on retrouve les mêmes énumérations, les mêmes nomenclatures, que ce soit dans les récits de gueuserie en France, la literature of roguery en Angleterre, les Schelmenromane en pays germaniques, ou dans la littérature de crime et de bandit qui prend son essor au xviiie siècle.
8Si cet imaginaire existe depuis bien longtemps, quelque chose advient au xixe siècle qui le réactive et le réaménage dans un ensemble plus cohérent, socialement plus connoté, alliant relevés sociographiques, rhétorique de l’effroi, entreprises philanthropiques et intentions répressives. Le troisième chapitre s’intéresse ainsi à l’apparition des « classes dangereuses » en distinguant deux séquences de la peur sociale : l’une, vers 1820-1840, de choc et de malaise devant les bouleversements de la révolution industrielle ; l’autre, à partir de 1880, de désillusion face aux laissés pour compte de cette industrialisation. Cette inquiétude face au peuple se traduit par des images de débordement des bas-fonds, sorte de vomissement révolutionnaire, à moins que la pègre ne soit apparentée à un peuple sauvage, Mohicans de Paris ou de Londres, nés de la rencontre des peurs urbaines et d’un imaginaire à la Fenimore Cooper. Surtout, ce phénomène va de pair avec l’émergence d’un nouveau régime culturel, fondé sur la marchandisation et la massification de ses produits. Ce n’est pas le moindre des mérites de cet ouvrage que de replacer sans cesse son objet dans son contexte médiatique. Au-delà des feuilletonnesques Mystères de Paris, c’est toute la production romanesque qui cherche à représenter les plages d’ombre de la société. À la vague des romans du Paris pré-haussmannien dont Les Misérables constituent le point d’orgue en 1862 ou aux social-problem novels dans le sillage de Dickens, succèdent une production naturaliste prise d’une « bas-fondmanie », selon le mot de Maupassant7, les quotidiens de faits divers, les magazines spécialisés, ancêtres de Détective, et bientôt les dime novels et le cinéma. Les bas-fonds, au service de la culture de masse, sont façonnés par les « récits médiatiques8 » proposant une sociologie polarisée à l’extrême, mais plus encore par une production fortement sérialisée qui s’appuie sur les catégories de la pègre et leurs clichés. Ici, de manière éclatante, ce sont bien les médias et leurs conditions de production qui structurent l’imaginaire social.
Les taxinomistes, les princes, les ducs, la bohème
9La corrélation avec les médias apparaît encore plus clairement à travers l’étude des scénarios qui actualisent les motifs latents des bas-fonds. D. Kalifa en choisit quatre qui lui semblent cristalliser les principaux enjeux de sa période.
10Le premier — et sans doute le plus prégnant — se résume en un principe : la classification. Les bas-fonds sont représentés selon des nomenclatures qui se superposent, se répètent souvent, mais régies par différentes modalités. Il s’agit d’abord d’un « habitus policier » (p. 146‑155). La pègre a fait son entrée dans l’histoire avec les listes établies par les autorités pour contrôler les gueux et les vagabonds. Ces textes réalisent une opération de police, assignent en un même lieu des individus différents, leur donnent consistance et cohérence. Si ces nomenclatures évoluent à compter du xviie siècle (plus denses, plus structurées), elles demeurent à l’origine des récits « policiers » qui émergent aux xviiie‑xixe siècles, durant lesquels elles trouvent une présumée justification scientifique à travers les sciences naturelles. D. Kalifa cite François Vidocq qui se vante d’avoir construit ses célèbres Mémoires (1848) en s’inspirant de la méthode de Carl von Linné, mais nous pourrions ajouter que c’est l’ensemble du roman policier moderne qui a été durablement marqué par ces nomenclatures : il suffit par exemple de lire Pietr-le-Letton (1931) de Simenon (le premier « Maigret ») pour en constater la pérennité. Quoi qu’il en soit, les bas-fonds sont d’abord perçus à travers les yeux de la police et le bon policier est celui qui parvient à identifier le type de méfait, donc le type de population, puis le groupe, enfin l’individu susceptible de commettre ce méfait. Cette mise en ordre du monde est indissolublement liée au contrôle social et va engendrer une « criminographie » à laquelle s’ajoutent les planches anthropologiques de la fin du xixe siècle, qui terminent d’installer la pègre dans un grand tableau des familles délinquantes. Toutefois, l’instauration de listes peut procéder de motivations autres que le contrôle policier. La taxinomie s’impose aussi comme pratique philanthropique car de l’identification et du « classement des pauvres » dépend la « juste distribution des secours » (p. 155‑161). Faire la charité implique de distinguer les misères, de démasquer le « mauvais pauvre », d’enquêter, de s’introduire chez le nécessiteux pour s’assurer de sa « bonne » indigence. Cette véritable « paupérologie » va donner lieu à des classifications sociales très abouties, fortement empreintes du paradigme naturaliste, et dont on retrouve le principe dans les fictions (de Balzac ou de Sue par exemple) qui entendent dire la vérité du monde urbain, en mettant en scène des types bien déterminés (l’escarpe, l’ogresse, le gamin des rues, etc.). Enfin, les procédés taxinomiques sont accentués par les exigences productivistes de l’édition de masse, le recours aux inventaires constituant une facilité tant sur le plan documentaire que sur le plan narratif (p. 161‑170). Cet aspect pratique explique que la méthode perdure dans la culture de masse du premier xxe siècle alors que le modèle naturaliste est remis en cause par la jeune sociologie. La taxinomie ne commande pas seulement l’organisation du texte, mais s’impose comme principe éditorial à l’origine de séries et de collections dédiées aux bas-fonds. Dans tous les cas, ces « dénombrements à fatiguer Homère », comme l’écrivait Hugo, sont des instruments de normalisation au fonctionnement paradoxal, où se mêlent une logique distinctive et une logique cohésive, qui vise à rassembler les individus dans un univers homogène. Ces classifications fabriquent une société qui n’existe pas dans la réalité. Elles jouent dans l’ordre des représentations un rôle analogue à celui que jouent dans la pratique les institutions d’enfermement (asiles, prisons, etc.) : rassembler dans un même lieu des populations homogènes.
11Autre mode de connaissance des bas-fonds, l’exploration prend à contre-pied certains motifs et canevas abordés jusqu’ici : à la place d’une masse hétéroclite prête à envahir le beau monde, un individu aux intentions nobles et de bonne extraction choisit de faire une incursion dans les bas-fonds. Prenant d’abord pour modèle le « prince déguisé » des Mille et une nuits, D. Kalifa montre comment dans la seconde moitié du xixe siècle des explorateurs sociaux vont sillonner un monde interlope auquel ils n’appartiennent pas (p. 171‑202). Qu’il s’agisse de policiers, d’informateurs, de philanthropes ou de journalistes, tous sont animés par une certaine idée de la justice. On pense bien sûr au prince Rodolphe des Mystères de Paris,mais également au journalisme undercover qui se développe dans les aires britanniques et américaines. Contrairement à d’autres modes d’approche des bas-fonds, l’immersion ne se contente jamais d’une démarche descriptive. Elle engage fortement le narrateur (le journaliste doit désormais savoir courir des risques) qui exhorte à l’action, à la réforme, par la « puissance du récit » (p. 192‑202). Dans la majeure partie de ces témoignages, on trouve une dimension empathique qui accentue l’identification, une volonté de dénonciation, un souci de mise en scène valorisant le spectacle de l’horreur. Car, parallèlement à la mission de justice sociale revendiquée, le scandale et l’exhibition motivent l’activité de ces explorateurs : c’est parce qu’il s’ennuie que le Calife se mêle au peuple de Bagdad. De fait, les récits undercover côtoient les sensation novels qui émergent à la même époque, et se parent souvent d’un parfum d’érotisme exhalé par le vice des bas-fonds.
12Du désir de justice sociale, on passe ainsi au divertissement, ressort d’une autre forme d’exploration : la « tournée des grands ducs » qui émerge d’abord à Londres sous le nom de fashionable slumming vers 1820-18509, va se pratiquer dans toute l’Europe, notamment à Paris où elle trouvera sa forme la plus accomplie. Il ne s’agit plus d’un individu déguisé voulant se fondre dans le monde interlope, mais bien d’un groupe restreint de touristes qui, le temps d’une soirée, vont chercher un peu d’exotisme social dans un spectacle plus ou moins arrangé de la misère. La tournée suit un parcours codifié et surtout empreint de nostalgie : après l’haussmannisation de Paris, on cherche les dernières traces de la ville malfamée. Plus que par les bas-fonds, c’est par leurs vestiges que se constitue une mémoire urbaine plus ou moins fantasmée. Cette promenade archéologique consacre des lieux (les Halles, le quartier Saint-Merri avec « L’Ange Gabriel », mais aussi Whitechapel à Londres, puis Chinatown à New York ou encore la Casbah d’Alger) et des personnages pittoresques tels le maquereau et sa gagneuse, ou encore le guide, cicérone des Enfers urbains, que l’on retrouve largement dans la littérature et le cinéma contemporains. Plus encore, cette tournée des grands ducs, comme le révèle le retournement sémantique de l’expression, montre que la fortune des bas-fonds naît de leur confrontation avec leur parfaite antithèse, l’univers du grand monde, sans doute parce qu’ils n’existent vraiment que dans cette confrontation et par un dévoilement qui ne peut venir que d’en haut (p. 236‑239). Cette dialectique que la presse et la littérature ne cessent de mettre en scène engendre des « bas-fonds du grand-monde », peuplés de viveurs, de suborneurs, aristocrates lubriques et « nobles gueux » — retournement de l’ancien « royaume d’Argot » aux accents carnavalesques.
13S’écartant des bourgeois en goguette, le dernier scénario d’exploration des bas-fonds est celui de la « fuite poétique » (p. 241‑247), quand les artistes sillonnent les rues brumeuses en quête d’incertitudes esthétiques. Les œuvres en question, se glissant dans les interstices des catégories structurant le monde interlope, entrelacent les significations sans qu’aucune direction précise, sans qu’aucune lecture univoque ne soit imposée dans ce vagabondage. Récapitulant la longue histoire qui lie les artistes aux bas-fonds, D. Kalifa s’intéresse d’abord à la « bohème crottée » du milieu du xixe siècle (p. 242‑248), qui voit défiler des flâneurs du pavé, comme Nadar, Vallès, Champfleury, mais surtout Alexandre Privat d’Anglemont, noctambule invétéré ne cherchant point le pittoresque mais la « grande famille des existences problématiques » qu’il saisit, se gardant bien des typologies, dans une sorte de mouvement chaleureux. La seconde génération de la bohème urbaine est celle, postérieure à la Commune, de la butte Montmartre et des habitués du Lapin agile, à partir de laquelle se renouvelle la tradition de la chanson populaire et de la poésie de la pègre qui résonne jusque dans le tango de Buenos Aires. Cette modalité atteint son paroxysme dans l’entre-deux-guerres, notamment avec Francis Carco, Joseph Kessel, Pierre Mac Orlan qui forge la notion de « fantastique social ». Les personnages comme les lieux s’enrobent d’un brouillard ambigu, leur conférant une opacité existentielle et un air de tragédie du bitume. Plus que les textes, c’est la dimension picturale, la photographie et finalement le cinéma qui vont donner sa pleine expression à cette poésie. Le chapitre, parmi les plus subtils du livre malgré quelques inexactitudes10, donne parfaitement à comprendre l’indétermination qui caractérise cette esthétique. Il clôt de manière particulièrement heureuse l’exploration des bas-fonds en évitant d’enfermer leurs représentations dans des catégories trop rigides.
L’engloutissement des bas-fonds
14Cet imaginaire, parce qu’il est une construction socio-historique, est chronologiquement localisable. Il comporte un début et une fin, même si leurs dates restent imprécises. D. Kalifa considère toutefois que c’est au tournant du xxe siècle que les bas-fonds commencent à disparaître. Si l’imaginaire se replie, il ne meurt jamais complètement. La dernière partie de l’ouvrage en pointe donc l’affaissement, mais aussi les résurgences et les métamorphoses jusqu’à nos jours.
15La résorption des bas-fonds va de pair avec un renouvellement des représentations scientifiques, sociales et politiques de la pauvreté. Les couches modestes sont toujours classifiées, mais les instruments taxinomiques évoluent, notamment avec la grande enquête de Charles Booth en 1886 (Life and Labour of the People of London) qui, se détournant des représentations pittoresques influencées par les sciences naturelles, va privilégier les grilles de lecture sociologiques et quantifiées. À cette nouvelle vision s’adjoignent une nouvelle perception du chômage (plus seulement le fait des mauvais pauvres), de nouvelles pratiques d’assistance sociale (la philanthropie traditionnelle est dépassée par l’assurance sociale et la régulation étatique) et enfin une rénovation urbaine, détruisant les taudis où se nichaient les bas-fonds. Toutes ces transformations se font ressentir dans les termes employés pour désigner la misère : la figure du « bon clochard » se popularise dans l’entre-deux-guerres ; on parle à partir des années 1960 de « quart-monde », puis d’« exclus » ou de « SDF ». Surtout émerge la notion de « milieu » qui traduit, selon D. Kalifa, une élévation du crime hors des bas-fonds pittoresques. Le terme, qui prend son envol à partir des années 1920, désigne une criminalité plus organisée, plus riche aussi, mieux habillée, aux manières et aux méthodes moins barbares. Les apaches disparaissent et laissent place aux gangsters, de Chicago ou d’ailleurs. Si l’interprétation que fait D. Kalifa du milieu est tout à fait probante, il faut toutefois relever quelques imprécisions concernant la généalogie du terme. Contrairement à ce qu’affirme souvent la littérature secondaire, le mot français n’apparaît pas d’abord en 1920 dans la pièce de théâtre Mon Homme de Francis Carco, mais dans son roman Les Innocents paru en 1917 et — sachant que Carco se réfère le plus souvent à ses souvenirs de bohème des années 1910 — l’on peut supposer que le mot était déjà en usage dans l’argot d’avant-guerre, comme en atteste le livre du berlinois Heinrich Zille, Mein Milljöh (1913). Au demeurant, le terme est hérité de la biologie du xixe siècle. Si D. Kalifa cite bien Benedict Morel, Paul Broca et Cesare Lombroso, il omet l’évolutionnisme issu des travaux de Lamarck : le milieu désigne, par métonymie, l’influence de l’environnement, des conditions de vie sur le physique, l’esprit et la moralité des individus. Loin d’être une disparition totale de la pègre, ce sont des stigmates qui — ainsi que le montrait d’ailleurs Mon Homme de Carco — persistent malgré l’ascension sociale des personnages.
16Si les représentations traditionnelles des bas-fonds s’estompent, leurs ténèbres persistent dans la société (p. 305-333). La misère et le crime se reconfigurent ou sont parfois même occultés. D. Kalifa rappelle le sort des oubliés de la relégation en Guyane jusque dans les années 1950. Il pointe surtout la résurgence et la réactualisation de certains motifs, dans les périodes de crises économiques et sociales qui réactivent la figure du mauvais pauvre (désormais appelé « assisté », « punk à chien » ou « Rom »). Dans une perspective plus large, le motif de l’antimonde a migré vers d’autres imaginaires et d’autres médias que la seule littérature policière. Les super-héros des comics américains, les jeux vidéos, mais surtout la science-fiction (de La Machine à explorer le temps de H.G. Wells à Blade Runner de Ridley Scott) ou encore la veine très récente du steampunk ont profité de la valence des bas-fonds qui n’ont décidément pas épuisé leur potentiel d’inspiration créatrice.
17Cette persistance va fournir le point de départ au dernier chapitre de l’ouvrage, qui examine les raisons d’un tel engouement : que peuvent bien apporter les bas‑fonds pour qu’ils continuent de fasciner ? D. Kalifa leur accorde d’abord une valeur documentaire — ce qui ne manque pas d’étonner après le dévoilement des présupposés idéologiques à l’œuvre dans ces représentations. Toutefois, il prend soin de distinguer les tableaux d’ensemble, façonnés par les taxinomies et les discours sociaux en vigueur, et les notations secondaires, furtives, les détails qui restituent un peu de la vie des populations les plus disqualifiées. Plus encore, il rappelle que la valeur documentaire de ces représentations repose sur leur dimension contextuelle : elles révèlent les rapports de force, les angoisses, les préoccupations idéologiques et scientifiques de l’époque. En outre, les bas-fonds fournissent des repoussoirs, des modèles sociaux a contrario ; il n’est ainsi pas étonnant qu’ils émergent en période d’opacité, où se trouble la lisibilité sociale. Ils délimitent le cercle des honnêtes gens et constituent des garde-fous stigmatisant, comparables à la fonction de la prison décrite par Foucault. En contrepoint, l’ouvrage consacre un assez long passage aux fonctions « empathiques » et dénonciatrices de ces représentations. Quelle que soit leur perspective idéologique, les actions et l’engagement de milliers d’individus cherchant à soulager les souffrances de leurs contemporains ne sauraient être négligés. Les journalistes et les romanciers se chargent de décrire le monde, même celui qu’on ne veut pas voir, pour en dénoncer les dysfonctionnements. Leur indignation mène certes à des déformations, mais de nombreux textes (on pense aux muckrackers américains, à Upton Sinclair, à Albert Londres) conduisent les pouvoirs publics à des réformes très concrètes. Enfin, les bas-fonds séduisent par leur parfum d’interdit. Au-delà de cette réflexion un peu banale depuis L’Érotisme de Georges Bataille, D. Kalifa rappelle les ressorts du désir sexuel, de la débauche, mais aussi de la fascination pour la vitalité et l’inventivité de ces marges sociales — ainsi que leur exploitation commerciale qui n’a certes pas créé les bas-fonds, mais qui les a accompagnés, mis en valeur, parfois réactivés. Le plaisir se vérifie à la lecture de ces travaux. Même si l’ouvrage ne joue pas sur le goût du public pour le crime, cette fascination un peu licencieuse n’est jamais très loin quand on tourne les pages des Bas-fonds.
Creuser les bas-fonds
18Les Bas-fonds constituent indéniablement un ouvrage de référence. L’expression est éculée, mais il faut lui attribuer un sens critique, qui ne la rend que plus laudative : lecteurs et chercheurs d’horizons les plus divers peuvent s’y référer pour comparer, reprendre et parfois affiner ces vastes analyses. Car il faut bien reconnaître que, si les travaux sur la pègre ne manquent pas, une telle somme restait inédite. Les informations brassées sont impressionnantes, et les lignes générales de la réflexion ne perdent jamais en clarté. En ce qui concerne le champ littéraire, on ne peut qu’apprécier la place faite à des œuvres considérées comme mineures, à la paralittérature, ou encore la primauté accordée aux Mystères de Paris de Sue, souvent éclipsés par le génie hugolien des Misérables. Par‑delà les œuvres citées, l’ouvrage fournit des cadres idéologiques et des modèles narratifs d’une grande utilité pour interroger la littérature de cette période. On pourrait, par exemple, relire Germinal de Zola à l’aune des motifs pointés par D. Kalifa. Enfin, l’attention philologique portée aux mots de cet imaginaire procure de très précieuses pierres de touche pour l’analyse littéraire.
19L’ampleur de ces recherches a toutefois des contreparties. Citons-en deux. Tout d’abord, certaines pistes de recherches sont négligées (l’affaissement des bas-fonds en France n’est‑il pas aussi dû à la Première Guerre mondiale, qui a vu tomber une grande partie des « vrais de vrais », envoyés en première ligne, et qui a transformé l’image du peuple, désormais défenseur de la République ?), des particularités locales auraient pu être mentionnées (la pègre allemande et ses Vereine criminelles par exemple) et certaines figures littéraires (Fantômas, Chéri-Bibi…) manquent à l’appel. Il ne s’agit cependant que d’éléments complémentaires qui corréleraient plutôt qu’ils ne remettraient en cause l’ensemble d’un travail déjà bien riche.
20Deuxièmement — et cette critique est sans doute plus lourde —, on pourrait contester la mise sur un pied d’égalité des différents matériaux considérés. Cette diversité fait certes la richesse de l’étude et l’on a grand plaisir à voir défiler les œuvres du canon littéraire aux côtés de textes moins connus, de reportages, de films populaires, voire de jeux vidéo. Néanmoins, on ne peut que rester prudent quand les romans d’Allain et Souvestre, puis de Georges Darien, les articles d’Albert Londres et de Détective sont embrassés dans un même mouvement. Entendons-nous bien : il ne s’agit pas de conforter une hiérarchie culturelle qui dissimule souvent des préjugés idéologiques, mais simplement de distinguer au mieux les corpus, leurs conditions d’énonciation, leurs modes de consommation et leurs particularités esthétiques. Le chapitre sur « La fuite poétique » est à ce titre intéressant car il montre que, contrairement aux discours scientifiques ou aux directives policières, une spécificité de la littérature est de ne pas prescrire une signification arrêtée à son objet, mais de laisser les bas-fonds dans un brouillard d’indétermination qui appelle l’interprétation du lecteur. On peut se demander si, dans l’ensemble, D. Kalifa ne s’expose pas à un reproche qu’il pointe lui-même dans son ouvrage : la manie de la taxinomie n’épargne pas l’historien qui dresse des nomenclatures de bas-fonds, des scénarios types, et qui risque finalement d’homogénéiser des corpus très différents.
21Néanmoins, cette critique est tempérée par la subtilité des analyses (le dernier chapitre permet à cet égard quelques mises au point salutaires) et par la plasticité des quatre scénarios proposés. Comme le précise l’auteur, il ne s’agit que de répertoires qui n’épuisent pas les potentialités de cet imaginaire et, surtout, qui sont constamment réactualisés au gré des situations. De futures études auront à charge de les moduler en fonction de périodes historiques ou de production culturelle plus précises. En ce sens, on pourrait parler d’un pousse‑au‑crime de la part de Dominique Kalifa, qui nous invite à fouiller encore dans les bas‑fonds.

