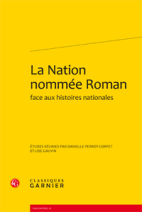
Écrire & penser le roman après la décolonisation : pour, contre ou au‑delà des nations ?
Le centre relégué au milieu d’autres centres, c’est à la formation d’une constellation que nous assistons, où la langue libérée de son pacte exclusif avec la nation, libre désormais de tout pouvoir autre que ceux de la poésie et de l’imaginaire, n’aura pour frontières que celles de l’esprit1.
1Nombreuses et passionnées furent les réactions suscitées par le manifeste de Jean Le Bris et Jean Rouaud appelant à l’émergence d’une « littérature‑monde » en français dans les colonnes du Monde en mars 2007. Ces derniers n’ont pourtant fait que reprendre, reformuler et diffuser plus largement au sein de l’agora intellectuelle française certaines thèses exprimées en France et à l’étranger depuis déjà plus d’une décennie et surtout certaines tendances manifestes dans la création littéraire contemporaine, tendances qui justifient l’importance critique accordée aujourd’hui au concept goethéen de weltliteratur2. L’émergence au cours des dernières années non pas tant d’une littérature‑monde que d’un discours qui mobilise de plus en plus ce concept s’accompagne d’une multiplication de postures, à la fois autrices et critiques, qui sont autant de manières de se situer dans l’espace mondialisé, multiplication aussi des débats sur les vertus en France des études postcoloniales et sur la signification de l’universalisme en postmodernité. Le présent ouvrage, issu du colloque « “La nation nommée Roman” face aux histoires nationales » organisé en juin 2009 à la Sorbonne sous la direction de Danièle Perrot‑Corpet et Lise Gauvin, s’inscrit donc parfaitement dans le climat intellectuel de notre présent. La diversité des contributions semble dès lors permettre de dégager une pluralité de directions théoriques et de positionnements qui reflètent les principaux enjeux du débat contemporain en France mais aussi en Espagne ou en Allemagne (vingt‑six contributions au total, dont une introduction).
2Le manifeste de J. Rouaud et J. Le Bris n’était pas sans ambiguïté. On pouvait y voir apparaître deux lignes définitoires de la littérature‑monde : l’une concernait l’énonciation, les auteurs ayant pris acte d’une remise en cause de l’ancien pacte entre littérature et nation, l’autre renvoyait plus à la représentation et notamment au fameux retour du référent, censé mettre fin à une époque jugée trop formaliste. L’intitulé de l’ouvrage opère certes une réduction générique de première importance en invitant à confronter les questions de géopolitique littéraire aux problèmes de poétique romanesque. Issu d’une citation de Carlos Fuentes dans son essai Geografía de la novela3, le titre tend par ailleurs à situer la problématique du recueil dans un espace résolument latino‑américain — nous verrons le statut d’exemplarité accordé à l’Amérique latine en matière d’autonomisation du littéraire par rapport au champ politico‑national — et dans une périodisation exclusivement contemporaine, « la nacion di la novela » désignant chez Fuentes une configuration historique unique propre à la création romanesque internationale depuis les années 1960. Les principales orientations du propos sont clairement mises en valeur par l’organisation tripartite du recueil : « I — le travail romanesque ou l’inlassable traversée des frontières historiques », « II — construction et déconstruction des « identités » nationales dans le roman », « III — le roman « universel » existe‑t‑il ? ». Je proposerai pour ma part un parcours alternatif à travers un bon nombre de contributions que j’essaierai de confronter aux problématiques de la troisième partie, c’est‑à‑dire à la nouvelle querelle des universaux qui, avivée par les études postcoloniales, constitue peut‑être le principal point d’achoppement d’une réflexion sur les rapports entre roman et nation.
Autonomie & internationalisme : vers un champ littéraire dénationalisé du roman
La « nation nommée Roman » & la « République mondiale des Lettres »
3Sur de nombreux aspects, les deux notions semblent se confondre ; elles tendent toutes deux vers un dépassement du cadre national qui prévaut dans notre entendement des œuvres littéraires, ce dont témoigne de façon exemplaire l’organisation dominante du système universitaire français en UFR de langues et littératures nationales.
L’avènement de la « nation nommée Roman » proclamée par Fuentes ne dirait‑il pas, mais en d’autres termes, l’accession à l’autonomie de champs littéraires jusque‑là dominés par une forme de « devoir national », notamment dans les aires postcoloniales et dans les « petites nations » européennes ? (p. 16‑17)
4Dès leur introduction, Danielle Perrot‑Corpet et Lise Gauvin proposent de rapprocher la réflexion de Fuentes de l’étude de Pascale Casanova La République mondiale des lettres, dont la parution en 1999 semble avoir fait date dans l’histoire contemporaine du concept de weltliteratur. Rappelons que dans son livre P. Casanova effectue à l’échelle de l’espace transnational une application des thèses bourdieusiennes qui font coïncider la « conquête de l’autonomie4 » avec la constitution du champ littéraire : à l’image de la littérature française qui, à l’issue d’un processus de deux siècles, semble s’être émancipée de la domination latine au moment de la querelle des Anciens et des Modernes, s’imposant dès lors comme modèle à l’ensemble de l’Europe, toute littérature nationale tend à affirmer ses lois de manière indépendante des problématiques politiques et du devoir national qui prévaut lors de sa constitution. La littérature s’autonomise donc en même temps qu’elle se dénationalise pour participer de l’universel. Ce processus en deux temps fonde la logique des rapports de pouvoirs entre les différents espaces, entre Centre et Périphéries, à l’intérieur de la république mondiale des lettres, celle‑ci apparaissant dès lors comme une communauté transnationale à l’image de celle imaginée par les humanistes renaissants.
5À cet égard, la littérature latino‑américaine, dont Fuentes est l’un des plus éminents représentants, connaît une évolution tout à fait exemplaire que s’attache à retracer de manière synthétique Daniel‑Henri Pageaux dans son article intitulé « Sur quelques espaces de l’imaginaire américain : région, zone, nation, continent, littérature mondiale ». La rapidité du processus d’autonomisation, symbolisé par la gradation des différents espaces mentionnés dans le titre de l’article, a pu autoriser les instances de consécration de la vieille Europe à parler de véritable boom latino‑américain. Entre le moment du roman argentin à caractère naturaliste et l’attribution du prix Nobel de littérature au très cosmopolite et très libéral Mario Vargas LLosa en 2010, il s’est produit un passage du régionalisme à l’universel et une entrée fracassante de tout un continent dans l’espace littéraire mondial. L’auteur évoque le rôle des grands noms du modernisme romanesque en Amérique latine, depuis Alejo Carpentier et l’invention du « réalisme magique » jusqu’à Fuentes, en passant par Marquez, Cortazar et bien sûr Bolaño. Toutefois, la notion de zone, en tant qu’espace transfrontalier (le rio de la Plata, la forêt amazonienne), désigne le caractère problématique de l’espace national en terre postcoloniale et ce dès les origines de ce formidable mouvement d’émancipation littéraire, au travers notamment des romans de Rómulo Gallegos (Doña Barbara) ou de Ricardo Güiraldes (Don Segundo Sombra). La zone ne coïncide jamais avec la région, encore moins avec l’espace national.
6La même démarche synthétique semble animer Lise Gauvin dans son article intitulé « Entre défense et illustration », où elle décrit l’évolution de la littérature québécoise, depuis les premières expérimentations linguistiques autour de la revue Parti pris jusqu’aux romans résolument ludiques et dialogiques de Régis Ducharme. La référence à Du Bellay est particulièrement signifiante. Pour P. Casanova en effet,
l’initiative de Du Bellay est bien cet acte fondateur, à la fois national et international, par lequel la première littérature nationale se fonde dans la relation complexe à une autre nation et, à travers elle, à une autre langue, dominante et en apparence indépassable, le latin5.
7C’est contre la France, puissance centrale, et contre sa langue littéraire que se constitue la modernité québécoise en usant des mêmes armes qui ont précisément permis l’émergence de cette littérature française. Toutefois, la distinction, qui structure l’article, entre défense et illustration suggère là aussi le passage d’une logique politique du contre à la conception d’une création plus autonome et qui puise dans l’« intranquillité créatrice » (p. 99) de sa situation « à la croisée des langues » (p. 83) les ressources nécessaires à son renouvellement.
« Fabriquer de l’universel » par la traduction
8L’intérêt traditionnel des comparatistes pour la traduction en tant qu’outil privilégié d’enrichissement du corpus (ou du canon) par appropriation des œuvres étrangères et donc en tant que principale voie d’accès à une forme d’internationalisme littéraire trouve dans le contexte de la « nation nommée Roman » une résonance tout à fait particulière. Toujours selon P. Casanova, « la traduction est la grande instance de consécration spécifique de l’univers littéraire »6 dont on méconnaît trop souvent la signification politique, amenée toutefois à varier selon la situation de la langue‑cible dans le champ mondial. En effet, l’idée de consécration et de reconnaissance critique renvoie au passage d’une langue périphérique vers une des langues centrales, tandis que la traduction d’œuvres issues de l’espace dominant dans les langues des petites nations dominées s’apparente plutôt à une importation de modèles en vue de favoriser un processus d’alignement. Pour Gisèle Sapiro, il importe dès lors de prêter une attention particulière aux contraintes à la fois politiques et économiques qui s’exercent sur la circulation des œuvres littéraires : la polarisation centre‑périphérie se double au sein du monde éditorial d’une opposition entre un pôle de production restreinte, dont la sélection obéit à des critères intellectuels, et un pôle de grande production, privilégiant les critères de rentabilité. La traduction acquiert ainsi une signification ambivalente selon ses usages, puisqu’elle peut tout aussi bien agir pour la mise en valeur des littératures dites « périphériques » qu’accroître la loi d’uniformisation du marché. La tension entre singularité et uniformisation, soulignée par G. Sapiro dans son analyse des conditions éditoriales de la traduction à partir de l’exemple français, se retrouve à une toute autre échelle dans l’étude qu’Isabelle Poulin consacre aux traductions française et anglaise de Cien años de soledad. Le rôle central de la traduction dans la constitution d’un espace littéraire transnational y est mis en relief par une série de microlectures ayant pour terme l’idée d’un « devoir d’exactitude » (p. 80) du traducteur, censé rendre justice au travail de l’écrivain contre les puissances d’abstraction du langage et contre l’idée d’une weltliteratur qui confinerait au nivellement des différences.
Un nouveau paradigme épistémologique
9Comme on peut le remarquer, l’objet d’étude que constitue la traduction montre à l’intérieur de ce seul recueil la possibilité de conjuguer une approche sociologique d’une très grande rigueur à une pratique d’analyse plus textualiste, au plus près des formes elles‑mêmes. La question de nos modes de lecture et surtout celle de nos approches critiques au sein du monde académique se posent nécessairement et de façon plus ou moins dramatique à partir du moment où s’opère une telle redéfinition de l’objet. Le glissement focal que constitue le passage du paradigme national au paradigme transnational dans les études littéraires, glissement que semble requérir la nouvelle situation de la création romanesque exposée par Fuentes dans Geografía de la novela, implique fortement notre réception en exposant de nouveau l’alternative, peut‑être trompeuse, entre close reading et distant reading. Tout un pan du recueil consiste dès lors à proposer de nouveaux outils critiques, de nouvelles démarches de lecture censées rendre compte des mutations de l’objet. Pour les chercheurs du groupe LEETHY (Littératures Espagnoles et Européennes du Texte à l’Hypermédia) ce questionnement passe avant tout par le dialogue interdisciplinaire :
Nous devons nous rendre au fait : les historiens ont historicisé l’idée de nation beaucoup plus tôt que les littéraires ; les historiens de la politique, du droit des mentalités ont appris à résister à la théologie nationaliste et, dans ces disciplines, la culture nationale est devenue un épisode rare de l’histoire culturelle. (p. 180)
10Histoire, cultural studies et anthropologie sont donc convoquées, même si le changement de paradigme se joue finalement pour les auteurs dans une attention accrue à l’hypermédia, celui‑ci apparaissant bel et bien comme le support d’une « véritable hétérotopie » (p. 190) capable de bouleverser radicalement nos modes de lecture. Autre contribution issue de l’université Complutense, l’article de Miriam Llamas, intitulé « Transformismes textuels », explore à partir de l’exemple du roman d’Hans Christoph Buch Haïti Chérie la possibilité de rendre compte du phénomène de « friction culturelle » (p. 239), propre au roman postcolonial, à l’aide d’un schéma ternaire qui viserait à identifier le sujet, la figure de l’autre et le tiers par lequel s’incarne en creux dans le texte l’idée d’un ordre, ce dernier schéma nous permettant en définitive de dévoiler la fiction de transgression culturelle produite par le texte et d’envisager la question du multiculturalisme en demeurant dans le cadre méthodologique strict de la microlecture.
Universalisme & diversité : une tension irréductible
Une euphorie pluraliste
11Il convient toutefois de souligner combien cette reconfiguration de l’espace littéraire s’accompagne dans l’ensemble de l’ouvrage d’une valorisation euphorique des notions de pluralisme et de mondialité, censées ouvrir le roman et ses lecteurs sur une conception plus riche et plus chatoyante de la relation identitaire. L’expression de Fuentes acquiert ainsi une dimension axiologique et non plus seulement descriptive : la « nation nommée Roman » est aussi ce que la littérature appelle. Dédié à la mémoire d’Édouard Glissant, l’ouvrage comprend une conférence inédite du poète, essayiste et romancier, décédé en 2011, dans l’œuvre duquel s’affirme une pensée de la mondialité comme ouverture au multiple, contre la pensée de l’Être sur le plan philosophique et contre la violence des États‑nations sur le plan proprement politique. L’éloge du multiple informe une quantité importante de contributions, qu’il s’agisse de l’opposition, faite par Valérie Déshoulières, entre un « schizo‑roman » qui correspondrait à l’œuvre de Romain Gary, jugée trop monoglotte, et un « rhizo‑roman » qu’incarneraient de façon exemplaire les textes romanesques de Glissant, ou qu’il s’agisse encore, comme dans l’article de Crystel Pinçonnat, de la confrontation des différents ethoi nationaux représentés dans les romans d’Azouz Begag, Hanif Kureishi et Fouad Laroui, lecture à l’issue de laquelle semble sortir gagnant le très postmoderne (et déjà très reconnu) Hanif Kureishi. Moins polémique, à mon sens, et donc moins travaillé par cette euphorie pluraliste où s’entremêlent toujours démarche descriptive et valorisation d’un discours politique sur l’identité, l’article qu’Emmanuel Bouju consacre à l’écriture d’exil chez trois écrivains issus de l’ancienne Yougoslavie (David Albahari, Aleksandar Hemon et Dubravka Ugrešić) s’oriente davantage vers une mise en relief de certaines métamorphoses complexes de la relation identitaire, liées au renouvellement d’un lieu commun : l’émigration de l’écrivain. En effet, du fait de la singularité du contexte historique balkanique, la relation d’appartenance semble se maintenir dans ces trois romans où elle « s’écrit comme douleur fantôme de l’histoire » (p. 193).
Le travail du roman
12L’éloge de la mondialité acquiert cependant une résonance particulière quand il s’agit d’un genre comme le roman dont l’esthétique est caractérisée principalement, depuis Hegel puis au travers des apports théoriques fondamentaux de G. Lukács et M. Bakhtine, par une exigence de totalité ouverte, différente de la totalité close qu’incarnerait plutôt l’épopée. Ainsi que le suggère le titre de la première partie du recueil, le propre du roman consisterait donc en un « travail » de remise en cause des frontières, qu’elles soient historiques, géographiques ou génériques. Une telle tripartition permet de rendre compte de nombreuses contributions. S’agissant des frontières historiques, Guy Astic peut ainsi évoquer l’anachronisme7 de romanciers comme Milan Kundera, Günter Grass ou Salman Rushdie qui « privilégient la nouveauté du passé » par la double référence aux origines du genre que sont les œuvres de Rabelais et Cervantès. C’est dans ces mêmes origines que l’écrivain Lakis Proguidis reconnaît lui aussi la racine de l’esprit de totalisation propre au roman. La traversée des frontières historiques concerne enfin les modalités de configuration du temps historique propre au récit de type romanesque, ce qui constitue l’objet de la contribution d’Alfonso de Toro, construite autour du concept de « roman historique transversal ».
13La remise en cause des frontières géographiques est le point central de l’ouvrage ; elle passe dans la chair même de l’écriture par le travail du plurilinguisme étendu non plus seulement aux sociolectes d’une même langue nationale, ce à quoi l’on pourrait réduire la théorie bakhtinienne, mais à une pluralité de langues nationales (hétéroglossie). L’exemple québécois est ici paradigmatique. Loin du cliché de la Belle Province, véritable conservatoire de formes linguistiques surannées brandies contre la menace de l’anglais, Lise Gauvin montre la révolution opérée par les auteurs groupés dans les années 60 autour de la revue Parti pris, lorsque ces derniers décident d’introduire dans leur texte le joual, langue hybride des classes laborieuses de Montréal, et donc de refuser la norme unique dictée par le centre français. Reprenant l’idée, chère à L. Gauvin, de « surconscience linguistique » (p. 83) de la littérature québécoise, Dominique Combe s’attache quant à lui au phénomène particulier des écritures migrantes en langue française. L’attention particulière prêtée dans le champ québécois aux relations entre fait migratoire et pratiques de la littérature lui semble relever de cet inconfort linguistique inhérent au brassage culturel si caractéristique de cette région. L’œuvre de Régine Robin, née Rivka Ajzersztejn, exhibe ainsi le problème insoluble de la langue en tant qu’« origine absente » (p. 172) et avec lui le sentiment d’absence d’une langue à soi. La traversée des frontières génériques découle enfin de l’idée même de plurilinguisme. La romanisation bakhtinienne des genres issus des anciennes taxinomies poétiques ne peut‑elle pas être envisagée dans les termes de Glissant, c’est‑à‑dire comme une créolisation ? Les œuvres tutélaires de ce recueil, celles de Fuentes, entre récit et essai, mais aussi celles de Glissant, unissant là encore poésie, récit et essai, sont ainsi exemplaires d’une exigence de pluralisme constitutive du genre romanesque.
L’universel en question
14J’en viens cependant au véritable point d’achoppement d’une réflexion sur la « nation nommée Roman » : il s’agit de questionner notre manière d’investir ou de ne pas investir la notion fuentesienne de notre conception occidentale et peut‑être même franco‑française de l’universel, associée à celle de l’humanisme. Au cœur de la réflexion de Pascale Casanova, on trouve notamment une dénonciation de l’universalisme français qui rend tout à fait problématique l’assimilation de la « nation nommée Roman » à la « république mondiale des Lettres ». Dans sa contribution au présent ouvrage, la critique s’attache à considérer le phénomène de « croyance nationale » (p. 282) qui accompagne l’émergence sur la scène mondiale des littératures issues des petites nations historiquement dominées. Elle s’appuie notamment sur les analyses de Kafka et sur leurs prolongements chez Deleuze, Guattari et plus récemment encore chez Fredric Jameson. L’autonomie, qui constitue le cas particulier de la littérature française, liée aux conditions historiques de son émergence, est érigée par le Centre en « impérialisme de l’universel »8, à l’origine d’une lecture en vérité ethnocentriste du phénomène littéraire à l’échelle mondiale. L’exemple du roman algérien tel qu’il est évoqué par Charles Bonn dans son article « Le roman produit‑il la nation ? » me semble assez éloquent à cet égard. À côté d’une démarche d’ « affirmation forte de l’espace d’énonciation »9 constitutive de la littérature postcoloniale, l’auteur voit se dessiner dans le roman algérien, à partir de Nedjma (1956),le roman fondateur de Kateb Yacine, un rapport de force beaucoup plus complexe entre centre et périphérie, cristallisé autour de l’adoption ou non de la langue française, qui coïncide avec l’entrée en modernité, soit en « autonomie » selon le terme commun à P. Bourdieu et P. Casanova. Le thème du sacrifice de la mère, commun aux romans de Mouloud Mammeri (La Colline oubliée), de Kateb Yacine (Le Polygone étoilé) ou de Rachid Boudjedra (La Répudiation), symbolise peut‑être ce renoncement à la croyance nationale qu’exige l’universalisme parisien.
15Si l’influence des études postcoloniales tend à dégager plusieurs lignes de faille qui contestent la possibilité même d’un accès à l’universel, tel qu’il semblait pourtant envisagé dans l’expression de Fuentes, inversement les études postcoloniales sont elles aussi mises en question dans le recueil, notamment par Michel Beniamino et Wolfgang Asholt. Le premier s’érige contre ce qu’il considère comme une doxa postmoderne ou plutôt comme un « nouvel académisme » (p. 340), soumis aux injonctions du marché culturel. Il met notamment en valeur la notion de francophilie en tant qu’impensé de la réflexion sur la littérature‑monde en français, prônant ainsi une définition de la francophonie qui ne se réduise pas au corpus exclusivement postcolonial. L’euphorie pluraliste, qui enjoint l’individu à bâtir son identité sur les débris des anciennes appartenances communautaires, ne participe‑t‑elle pas, en généralisant à l’ensemble de la population mondiale le phénomène de la migrance, à cette nouvelle doxa, voire à une forme de néolibéralisme culturel, ennemi de la diversité ? Derrière l’idée d’académisme se profile en effet la crainte d’une uniformisation des productions culturelles dictées par le capitalisme anglo‑saxon, celle d’une mondialisation qui irait dans le sens d’une globalisation. Exprimée dès 1952 par Erich Auerbach dans « Philologie der Weltliteratur »10, cette crainte est reprise par Irène Langlet dans son article ; elle s’appuie notamment sur David Damrosch qui invite à « ne pas confondre la littérature mondiale avec une littérature qu’on pourrait appeler “globale”, destinée à être lue dans des terminaux d’aéroports, imperméable à tout contexte que ce soit » (in What is World Literature, cité et traduit par l’auteur p. 356), une littérature qui allierait une pincée d’exotisme à un ensemble de traits stylistiques et thématiques convenus, fixés par les exigences du marché.
16À ces doutes et ces incertitudes répond toutefois une pensée du Lieu ouvert sur le monde, qui fait de l’universel « le local sans les mûrs », selon la belle expression du poète portugais Miguel Torga. Cette pensée du local esquisse un entre‑deux fécond entre uniformisation du village global et régionalisme. Elle paraît même relier les théories d’un Glissant et à celle d’un Fuentes selon Vincent Message. Ainsi, chez ces deux auteurs, « la province spirituelle serait […] le Lieu quand il n’est pas représenté dans son rapport à l’Ailleurs et quand il se ferme sur lui‑même » (p. 377). Doit‑on enfin jeter l’humanisme avec l’idée impérialiste d’universel ainsi que semble nous y inviter la critique postcoloniale ? À rebours d’une opinion si péremptoire, Wolfgang Asholt montre dans le dernier article du recueil l’influence de l’humanisme philologique d’Auerbach sur l’ouvrage fondateur d’Edward Saïd Orientalism (1978) ; il retrace notamment les controverses suscitées dans le milieu des études postcoloniales par la « Préface » à la réédition de l’étude en 2003, celle‑ci revendiquant le principe méthodologique d’identification empathique (Einfühlung) constitutive de la démarche critique du philologue occidental.
17L’introduction en Europe du paradigme postcolonial ne se produit donc pas sans heurt, en même temps que s’opère une redéfinition permanente de la vieille idée goethéenne de weltliteratur. Telle qu’elle est décrite dans l’ouvrage de Lise Gauvin et Danielle Perrot‑Corpet, la « nation nommée Roman » semble catalyser plusieurs de ces tensions. La méfiance, manifeste chez plusieurs contributeurs, vis‑à‑vis de la doxa postcoloniale contemporaine ne contredit pas réellement le sens d’une démarche intellectuelle qui consiste à interroger inlassablement la signification politique des textes mais aussi celle des méthodes d’analyse et leur adéquation aux nouvelles configurations géo‑culturelles de notre présent. Dans le dernier temps de cette réflexion, il m’importe toutefois de rendre justice à l’apport principal des études postcoloniales dans le champ du littéraire, à partir notamment de l’article de Joseph Jurt (« L’Étranger comme métaphore »). Le chercheur suisse s’attache en effet à décrire des œuvres en langue allemande encore largement ignorées par l’Université : ce sont les œuvres de ces écrivains qui, à l’instar de José F. A. Oliver, Gino Chiellino ou encore Emine Sevgi Oezdamar, ont adopté la langue allemande comme langue littéraire au mépris d’une assimilation obsolète de l’idiome à la vieille nationalité du sang. Aussi peut‑on considérer que l’apport indéniable des études postcoloniales, et des études culturelles en général en tant qu’expériences d’un décentrement critique, consiste dans ce geste fondamental par lequel se renouvèle le canon, de la même façon que « la nation nommée Roman » fuentesienne semble nous inviter à porter toute notre attention sur la poursuite hors d’Europe de l’histoire du roman.

