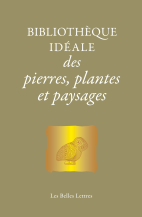
La « flamme verte » des textes antiques
1D’Homère aux Alchimistes, la Bibliothèque idéale des pierres, plantes et paysages de Laure de Chantal présente une sélection de textes anciens visant à donner un aperçu de l’évolution du regard sur la nature et sur les liens qui existent entre l’être humain et son environnement au fil de l’Antiquité, afin de nous replacer au cœur d’un monde perdu de vue. Pour ce faire, le livre n’hésite pas à jouer la carte de l’anachronisme en présentant les textes en termes actuels et en filant la métaphore d’une nature verte. En invitant à (re)découvrir les textes à la lumière de la crise environnementale que nous traversons, ce recueil n’est pas sans rappeler celui de Patrick Voisin paru chez le même éditeur1, et dont il reprend certains extraits et titres, en proposant une forme affranchie de guillemets et de tout traitement notionnel.
2L’anthologie comprend une courte introduction (5 pages) ; des présentations (1 à 2 pages) situent chaque auteur ou groupe d’auteurs dans leur contexte littéraire et esquissent la raison de leur présence dans la sélection. Ces quelques repères permettent une lecture non linéaire, malgré une disposition chronologique. Les textes sont présentés selon les traductions françaises déjà disponibles par ailleurs dans la CUF et les notes de bas de page sont très rares, ce qui facilite une lecture immédiate. Cette note de lecture propose de présenter le projet de ce recueil s’adressant à « nous qui cherchons désormais à nous reconnecter avec la nature2 » à travers une composition variée et parfois inattendue.
Un titre en triptyque
3« Pourquoi réunir en un même ouvrage les textes antiques traitant des pierres, plantes et paysages ? C’est que pour les Grecs et les Romains les trois forment un tout cohérent avec l’homme qui en est une émanation, un rejeton. » (p. 9) S’il s’agit des pierres, plantes et paysages, c’est d’abord du fait des trois mythes de l’origine des êtres humains qui expriment le lien qui les unit à la nature. Que ceux-ci viennent des pierres jetées par Deucalion et Pyrrha, des frênes et des Méliades, ou encore du sol terrestre même, ces récits mythiques nous disent que « non seulement un individu est une émanation de son milieu naturel mais [qu’] il lui est originellement lié » (p. 10). La diversité des mythes est citée pour rappeler que l’homme est « né fruit de la nature, un vivant parmi d’autres » (p. 10). Ainsi, le terme « nature » est employé au sens d’un principe de diversité et de cohérence des êtres auquel l’auteure, dans le sillage d’Hésiode3, donne le visage de « la matière d’origine, Gaïa, la Terre divinisée » (p. 11), sans hésiter dans le cours du recueil à s’y référer sous le terme de « planète », passant de la Terre divinisée aux ressources terrestres. Les termes du triptyque ne sont pas davantage définis.
4Le titre problématise ainsi la question du rapport à la nature entre juste mesure et démesure : « Un individu ou une société qui nierait ce lien originel [...] porterait atteinte au cosmos, à l’ordre naturel des choses. » (p. 11). Les pierres, les plantes, le sol sont aussi, comme le montreront les textes, les ressources caractéristiques des changements de paysages dont le titre invite à explorer les nuances en observant la place assignée à l’homme dans sa relation à la nature. « Rassemblés en un même volume, ces textes nous permettent de mesurer avec les changements de paysages, voire de climats, l’évolution du regard et des mentalités. » (p. 13) En différents espaces, différentes étendues de la terre à la mer : les paysages ne sont autres que les mondes perçus dans les textes de la sélection.
Une sélection diverse et chronologique
5Le livre propose une sélection variée d’environ cent textes, issus d’une quarantaine d’auteurs dont certains sont repris du précédent volume de la collection Signet de Patrick Voisin. La table des matières (p. 359-363) donne un aperçu des noms convoqués, proposant des auteurs de période archaïque, classique et hellénistique du viiie au iiie siècle (environ 2 pages), d’autres de la période républicaine et impériale (environ 2 pages) ; et d’autres de l’Antiquité tardive. À partir de ce panel, l’auteure invite à explorer la diversité des paysages en citant des noms incontournables (comme Homère, Virgile ou Ovide) ainsi que d’autres moins connus, comme les Carmina dits d’Einsiedeln, Nonnos de Panopolis ou encore les traités lapidaires. La variété des textes recouvre aussi celle des genres (poésie, lettres, dialogue, rhétorique, romans, traités théoriques etc.). Les textes théoriques pourraient cependant être complétés (ainsi, Théophraste éclipse son maître Aristote en raison de son texte emblématique intitulé ici « La naissance de l’écologie », p. 115-118).
6La disposition chronologique permet également à l’auteure de s’affranchir d’un traitement notionnel en proposant d’observer une évolution du regard sur la nature à l’échelle du corpus : elle propose ainsi « de nous enthousiasmer avec les Grecs [...] et de regretter avec les Romains » (p. 13) en citant par exemple la littérature idyllique et les romans érotiques, mais aussi la « Rome avant Rome » de l’Énéide de Virgile ou l’extrait d’une lettre de Sénèque déplorant l’homo destructor (p. 253) dont l’outre mesure renverse la place et l’ordre des choses. La nature grecque est présentée comme « un espace d’investigation gigantesque […] tandis que les textes latins nous présentent le regret indulgent ou critique d’une nature […] qui n’est plus » (p. 13). La formule pourrait sembler un peu générale, cependant la diversité du recueil lui ajoute certaines nuances, que l’on pense par exemple au texte de Cicéron sur la « générosité de la nature » dans le De natura deorum (p. 175). La citation des textes introduits avant tout par leur titre se fait du point de vue de l’auteure : on peut citer ici l’extrait de la Géographie de Strabon qui décrit comment « les nombreuses carrières de pierres, les forêts, enfin les cours d’eau » ont été utilisés et domptés pour façonner la beauté et l’efficacité de Rome et dont le titre « Comment Rome a détruit la terre romaine » (p. 243) propose de souligner, au-delà de « l’urbanisme maîtrisé que les Grecs n’ont jamais atteint », la question de la destruction4. Dans le recueil, les pierres, plantes et autres éléments font partie du paysage ou en sont extraits : les roches et minéraux, les arbres ou les fleurs, ou encore les cours d’eau. On voit ainsi des pierres retirées, taillées, excavées, des arbres abattus, voire des sols déformés. Si certains textes semblent venir compléter la diversité d’approche de la nature dans l’Antiquité, la problématique chronologique proposée est bien visible à travers des textes emblématiques ainsi que leurs présentations.
Pour un recueil au présent
7D’un point de vue général, on ne peut ignorer la couleur verte de la couverture que l’auteure emploie également comme une métaphore filée. L’introduction s’ouvre anachroniquement sur le « poumon vert de l’Antiquité » (p. 9), une expression transgressive qui, pour ainsi dire, annonce la couleur5. Qu’est-ce que ce « poumon vert de l’Antiquité », assorti d’une citation de Libanios (Antiquité tardive) racontant le thrène homérique sur un arbre abattu ? Cette ouverture décalée, qui mérite que l’on s’y arrête, se saisit d’une expression contemporaine figurant notre sentiment d’appartenance à un ensemble naturel plus vaste. La couleur est bientôt reprise pour décrire le « cosmos vert où chacun a sa place mais où tout communique et interagit » (p. 11), et choisie pour l’impression ; une manière habile de faire parcourir la problématique sans avoir à la répéter dans chaque présentation. Ainsi, la question de l’anachronisme n’étant pas explicitée, n’y a-t-il pas un risque d’oublier l’antiquité des textes, leur ancrage dans un autre temps et dans une autre langue ? Pour tenter de « revenir vers le présent, lesté de problèmes anciens », selon une expression de Nicole Loraux6, le recueil propose quant à lui de recourir à l’évidence anachronique.
8Pourquoi donc ajouter une épithète à l’ensemble du projet ? Tout au plus voit-on passer au palais d’Alkinoos le verger « vert en toute saison » (p. 22). C’est que la couleur impose une lecture actuelle des textes, comme dans l’extrait des Questions Naturelles de Sénèque : « ce n’est pas aujourd’hui seulement que la cupidité, scrutant les veines du sol et des pierres, a cherché des trésors insuffisamment cachés dans les ténèbres. » (p. 265). À quelle époque se rapporte « aujourd’hui » ? Sénèque ne semble-t-il pas s’adresser à nous ? À cet égard, l’objectif de Laure de Chantal est de dépasser le seul regret d’une nature originelle et « que ces textes […] nous réconcilient avec la nature » (p. 13), tels qu’ils sont présentés.
*
9Dans sa nouvelle bibliothèque idéale, Laure de Chantal réunit des textes sur les « pierres, plantes et paysages », se faisant l’écho des préoccupations actuelles liées à la crise environnementale. Le titre choisi reflète tout à la fois la pluralité originelle des êtres humains et les ressources exploitées d’un monde changeant. S’adressant à un lectorat le plus large possible, à l’être humain presque oublié que le Titan Prométhée avait voulu sauver du dénuement en volant pour lui un peu de la flamme des dieux, l’anthologie, à travers son choix de texte, recompose une histoire antique des rapports de l’être humain au cosmos. Au-delà de l’anthologie classique, il s’agit d’un recueil engagé et situé qui, par sa mise en forme, propose de dire l’évidence en éclairant les textes à la lueur d’une « flamme verte » (p. 13) contemporaine.

