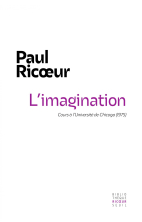
L’imagination philosophique et la fiction comme la création
1L’image n’est pas imagination. Cette leçon est bien connue des phénoménologues. Et pourtant, c’est à partir de cette confusion que réside la condamnation de l’image par Platon et la nécessité de chasser le mythe de la construction philosophique de la cité qui aura donnée à l’imagination ses mauvaises lettres de créances. Jusqu’à Descartes et Malebranche, l’imagination apparaît comme la folle du logis. Elle est le grand négatif de la raison dialectique. Elle doit être chassée hors de la cité de la philosophie, car la fausseté des images contredit les méthodes que se donne la raison pour atteindre la vérité. Voilà en quelque lignes ce que pourrait être une histoire métaphysique de l’imagination. Elle appelle une contre-histoire qui devra remettre en valeur l’imagination à partir de son pouvoir créateur. Elle passe par les autres grands noms de la philosophie : Aristote, Spinoza et Hume, avant d’arriver chez Kant qui libère l’imagination pour en faire un point de rencontre théorique entre l’expérience empirique et le domaine de la raison pure. Ainsi, l’imagination a quitté l’incertitude et la fausseté de l’image trompeuse pour entrer de plain-pied dans l’expérience de la connaissance humaine. Elle prend part au schématisme des concepts et devient à proprement parler une étape de la connaissance rationnelle et objective. Elle a une vocation épistémologique. De même, avec Kant, pour la première fois dans l’histoire de la philosophie, s’affirme l’opposition entre l’imagination reproductrice et l’imagination créatrice. Ce moment est important. L’imagination devient une étape de la connaissance objective, alors que les philosophes précédents ont toujours tenu l’imagination pour un « problème de l’intermédiaire », selon l’expression de Paul Ricœur, c’est-à-dire un entre-deux hybride qui se situe entre la sensation et l’idée, entre la perception et la pensée. Ce moment de sursaut hors de l’intermédiaire ouvre des voies fécondes. Pourtant, ni le romantisme allemand ni la phénoménologie ne parviendront à entièrement dégager et à théoriser cette sortie de l’entre-deux. Au contraire, ils prennent le risque de sombrer dans l’écueil de l’image comme reflet affaiblit de la réalité, ou de l’image comme une forme d’absence. Ainsi, l’imagination demeure sous la tutelle de l’image et de sa capacité à reproduire la réalité extérieure, sans pour autant enrayer sa propre capacité productive.
2Tel est le postulat qui amène Paul Ricœur à affirmer qu’il n’existe pas vraiment de grande philosophie de l’imagination. Celle-ci a été essentiellement pensée à partir du paradigme de la reproduction et non de sa capacité créatrice à engendrer de nouvelles formes. Le cours donné par Paul Ricœur sur l’imagination à l’Université de Chicago durant l’année 1975 avait pour ambition de montrer une imagination qui ne soit pas réduite à sa seule fonction reproductrice. Il entendait réanimer grâce à Bachelard la possibilité d’une épistémologie de l’imagination créatrice, tout en ouvrant la voie vers une réflexion sur l’imagination poétique. La traduction et la publication simultanée de l’édition française et américaine de cette suite de cours est importante, car elle restitue aujourd’hui une partie importante de l’édifice de la pensée de Ricoeur que beaucoup avait pressentit, mais pour lequel il manquait donc un ouvrage qui articule explicitement cette problématique centrale de l’imagination. Au cours de l’automne 1975, lorsque Ricœur donne ses conférences sur l’imagination dans le cadre d’un cours à l’Université de Chicago, il a également donné par ailleurs une série de conférences sur l’idéologie et l’utopie, publiées plus tard sous le titre de Lectures on Ideology and Utopia, où l’imagination est un sous-texte important. L’année précédente, Ricœur avait organisé un séminaire d’étude phénoménologique et herméneutique dans le cadre de son séminaire de la rue Parmentier qui prenait pour axe des recherches phénoménologiques sur l’imaginaire1, et qui devait se clôturer le 25 avril par une intervention intitulée « Métaphore et image ». Ici, tout en traçant le rapport profond entre imagination et métaphore, l’originalité de l’approche de Ricoeur est d’introduire le langage comme un foyer intense de genèse des images, pour proposer une voie qui va du langage vers l’image et non l’écueil inverse dans laquelle tant de philosophes se sont égarés. Ces réflexions préparent aussi à leur manière la publication de La Métaphore vive de Ricœur, qui paraît la même année que les cours de l’Université de Chicago en 1975. La portée de ce texte est de redonner l’essor à la métaphore « en ce qu’elle vivifie un langage constitué » tout en donnant un élan à l’imagination pour tenter de « penser plus » au niveau du concept et revivifier la portée du discours philosophique.
3L’arrière-fond de ce débat est une réponse à Jacques Derrida, qui dans son texte « La Mythologie blanche »2 s’interroge sur la forme ou le bon usage de la métaphore dans le texte philosophique, c’est-à-dire les limites même du discours philosophique avec la non-philosophie. Derrida pointe vers une certaine « usure de la force métaphorique dans l’échange philosophique ». Il voit dans le jeu de la métaphore comment un excédent de sens qui permet de défier les concepts philosophiques, ne voyant en ceux-ci guère plus que d’anciennes métaphores usées. Dans La Métaphore vive, Ricoeur approche la fonction poétique de la langue, en se concentrant sur le concept de trope et de métaphore. Sa thèse principale est que cette dernière met en place un procédé cognitif particulier qui possède sa propre valeur heuristique, et permet donc de créer des significations nouvelles afin de révéler des vérités nouvelles qui se trouve dans le langage. Il s’agit d’une réflexion sur la manière dont les métaphores peuvent enrichir notre compréhension du monde, en offrant des perspectives nouvelles qui dépassent les limites du langage littéral. Les positions sont donc claires : d’un côté, la métaphore morte qui dissout le discours philosophique par ses images usées qui tombent sous le joug de la déconstruction derridienne, et de 1’autre, la métaphore vive qui en constitue le fondement dynamique d’une imagination créative et qui relance la possibilité même de l’herméneutique à partir d’une théorie de la fiction. L’écart entre Ricoeur et Derrida ne touche pas seulement au statut de la métaphore dans son rapport à l’image, mais plus fondamentalement aux ressources que l’on peut espérer tirer du langage dès que l’on oppose la déconstruction à une possible reconstruction via l’herméneutique. Tel était le fond du débat autour duquel Ricoeur entendait élaborer une philosophie de l’imagination productrice et créative. Comme l’atteste la chronologie des travaux de Ricœur sur l’imagination, le philosophe a été très immergé dans le thème de la créativité et de l’imagination pendant une bonne partie des années 1970. Malgré l’importance du thème de l’imagination durant cette décennie chez Ricœur, certains regrettent de ne pas trouver une articulation plus systématique de cette problématique dans ces écrits. Voici donc que le cours et les réflexions sur l’imagination productive offrent l’armature théorique à partir de laquelle Ricoeur développera une part importante de sa pensée.
Une théorie générale de l’imagination
4Les cours rassemblés ici sous le titre de L’Imagination proposent une théorie générale de l’imagination dans le but de développer une théorie distincte de l’imagination productive. Ricœur affirme que l’imagination productive se divise en quatre sous-groupes : l’imagination sociale et politique, l’imagination poétique, l’imagination épistémologique et l’imagination religieuse (p. 243). En plus de fournir sa théorie générale, le volume actuel élabore à la fois l’imagination poétique et l’imagination épistémologique. Ricœur soutient que les Cours sur l’idéologie et l’utopie développent sa théorie de l’imagination sociale et politique, et il laisse la discussion sur l’imagination religieuse à d’autres de ses écrits. Il est donc essentiel de comprendre que la théorie de Ricœur sur l’imagination productive traverse les deux séries de conférences qu’il a données à Chicago en 1975. La structure combinée des deux séries de conférences est tout à fait magistrale, tout comme leur portée dans différents domaines est très ambitieuse, comme la recherche d’une théorie commune reliant des domaines apparemment très différents.
5Les lectures se divise en trois parties. La première est composée de cinq conférences, dans lesquelles Ricœur évalue la théorie de l’imagination dans la philosophie antique et la philosophie classique avec des conférences sur Aristote, Pascal, Spinoza, David Hume et deux sur Emmanuel Kant. La seconde partie se tourne vers des philosophes contemporains et aborde l’imagination chez des philosophes analytiques comme Gilbert Ryle, Price et Ludwig Wittgenstein — et chez les tenants de la phénoménologie continentale avec des philosophes comme Edmund Husserl et Jean-Paul Sartre. La troisième partie comprend les développements sur la propre théorie de la fiction et sa conception sur l’imagination productive pour montrer comment le philosophe entend déplacer la problématique de l’image vers la dynamicité langagière de la fiction.
6On conçoit la nécessité de parcourir la pensée philosophique sur l’imaginaire, de la tradition antique jusqu’à l’aboutissement de la grande pensée classique avant d’aboutir à la synthèse de la pensée critique, où l’imagination assure un rôle de médiation entre sensation et idée. La thèse philosophique de Paul Ricoeur repose sur l’idée que l’imagination ne peut se réduire à une simple faculté psychologique. L’imagination entraîne un pouvoir sémantique important. Ricoeur distingue entre deux types d’imagination : l’imagination reproductrice, qui se contente de reproduire des images ou des expériences passées, et l’imagination productrice, qui crée de nouvelles significations possibles. Pour Ricoeur, l’imagination productrice est essentielle pour penser l’utopie et la critique sociale Elle permet de voir le réel autrement qu’il est et de concevoir des alternatives aux structures existantes. L’imagination devient ainsi une force créatrice qui peut transformer notre perception du monde et ouvrir des voies nouvelles pour l’action humaine. Si la première partie du cours, qui offre une perspective historique des théories et des approches de l’imagination, prépare le terrain d’une sorte de dépréciation philosophique de l’imagination jusqu’au seuil de la révolution kantienne — celle-ci finit par inscrire l’imagination comme une étape constitutive du schématisme transcendantal et par ouvrir la voie vers une philosophie de l’imagination —, la seconde partie montre comment à partir de la phénoménologie de l’imaginaire chez Husserl et chez Sartre se prépare une régression autour du statut de l’image tandis que l’ouverture tant recherchée se découvre chez les philosophes anglo-saxons et leur réflexion sur le langage. C’est là où Ricœur découvre un champ langagier nouveau à partir duquel il devient possible de formaliser une nouvelle approche théorique de l’imagination, où le travail sur le langage cherche à préciser le rapport aux images mentales. L’apport de ces trois philosophes analytiques forme le développement de contributions extérieures données lors du séminaire de 1973-1974 sur les Recherches philosophiques sur l’imaginaire3. Initialement, l’argument de Ricoeur posait un développement qui allait de Kant à Husserl, et le détour par la pensée anglo-saxonne s’est articulé autour du fait que malgré leur originalité d’approcher l’imagination comme un fait linguistique, leur démarche tombe dans des difficultés similaires à celles rencontrées par les phénoménologues. Tel est le cas de l’analyse de l’image mentale chez Ryle qui note que l’on dispose d’un modèle séduisant mais trompeur pour décrire comment une image dans notre esprit peut ressembler à une image dans le monde. La ressemblance erronée du portrait et du modèle nous amène à considérer le problème du « simuler » développé par Ryle. Sartre est aux prises avec la même problématique et aura recours à l’intentionnalité pour résoudre cette difficulté, bien que la lecture de Ricoeur semble par moments réduire la position sartrienne au simple choix de cette négation de l’image. C’est à partir d’une telle analyse que Ricoeur enracine sa philosophie de l’imagination productrice et fonde sa nécessité en vue de l’élaboration de sa propre théorie de la fiction.
7Ricoeur détecte parfaitement l’écueil d’une philosophie de l’imagination qui mise ses avancées sur une théorie de l’image. Or l’imaginaire ne peut se réduire à une théorie de l’image. Il systématise une telle approche à partir d’un diagramme qui tente d’épuiser les possibles approches d’une philosophie de l’imagination. Il trace ce diagramme au tableau pour ses élèves au cours de la première leçon et lui donne une quadrature à partir de laquelle il peut orienter ses recherches sur l’imagination, tout en interprétant les philosophies de l’imagination dans le passé. Au centre de ce diagramme, Ricœur place l’image mentale telle qu’elle est produite par l’imagination. Ensuite, ce diagramme s’établit autour d’un axe horizontal qui va de la présence à l’absence et d’un axe vertical qui mesure l’écart entre croyance et distance critique. Si chacune des dimensions permet de cerner une approche particulière de l’image mentale, on peut y placer des problématiques propres comme le tableau ou la trace dans les dimensions de la présence ou la fiction et l’hallucination pour les dimensions de la présence. Une telle quadrature permet de cerner les dimensions d’une philosophie générale de l’imaginaire, tout en comprenant certains des choix qu’opère Ricœur dans son approche et la délimitation de la problématique qui l’intéresse. Tout en voulant éviter l’écueil d’une philosophie de l’image qui nous entraîne vers une ontologie de l’absence, il pressent qu’à l’encontre d’une pensée de l’image ou comme tableau, c’est au langage d’endiguer l’écueil vers lequel conduit une philosophie de l’imagination construite principalement comme une théorie de l’image ou comme tableau. Les poètes et Gaston Bachelard ont mis en évidence comment le langage lui-même génère des images et serait capable de s’ouvrir vers une philosophie de l’imagination productrice comme fiction.
La fiction selon Sartre et Ricoeur
8Si la tradition philosophique depuis Platon a généralement critiqué la capacité reproductive et mimétique de l’image comme une illusion trompeuse qui nous éloigne de la vérité, elle disqualifiait en l’occultant la capacité créative de la fiction. En tentant de réhabiliter cette puissance créatrice de l’imagination dans le cadre d’une théorie générale de l’imagination, la question de la portée de cette réhabilitation demeure ouverte. Est-ce qu’une philosophie générale de l’imagination doit systématiser l’ensemble des dimensions de la quadrature avec laquelle Ricoeur ouvre son cours, ou bien faut-il suivre Ricoeur dans sa démonstration des limitations d’une théorie de l’image pour montrer que toute la créativité et la capacité productrice de l’imagination ont été insuffisamment développées jusqu’à présent ? Dès lors, il convient de rappeler certaines inflexions élaborées par ce cours en vue d’une argumentation de l’imagination comme fiction. Tout d’abord, le séminaire de 1973-1974 développait la problématique de l’image chez Bachelard ou dans la philosophie imaginal d’Henry Corbin ; on s’étonne par exemple de l’absence des tenants de l’imagination symbolique chez un philosophe comme Gilbert Durand, dont les travaux sont contemporains de ceux de Ricoeur. Que ce soit dans les métaphores des poètes, les schèmes imaginaux de la spiritualité des religions du livre ou dans les archétypes des images symboliques, la potentialité productive de l’imagination créatrice est à l’œuvre, requérant une approche herméneutique qui valorisent la portée et la spécificité du récit. Ainsi, quitte à développer une problématique propre qui délimite son champ de réflexion, l’éclipse du problème de l’imagination souligne une absence. Ricoeur ambitionne d’expliquer cette absence, tout d’abord en affirmant qu’il n’y a pas de philosophie de l’imagination. Doit-on comprendre que celle-ci n’existe pas, parce qu’elle ne peut pas exister implicitement comme théorie de l’image ou bien que la démonstration glisse de l’imagination vers la question de la fiction comme seule possibilité pour une philosophie de l’imagination productive. Cette éclipse d’une philosophie de l’imagination peut paraître étonnante au premier abord. Face à Sartre, il existe une autre tradition avec Bachelard et Henri Corbin qui développe une philosophie de l’imagination créatrice. Si celle-ci émerge des textes poétiques ou des récits mystiques de la tradition orientale, elle parte du langage, du livre ou de la parole sacrée et se déploie essentiellement comme langage et non comme image. Quant à Sartre, il est évident que sa théorie de l’imaginaire s’inscrit dans l’héritage de la phénoménologie husserlienne4, qui toutes deux structurent leur théorie de l’image à partir de la reproduction d’un original, et bien qu’insistant sur l’importance du mode de donation de la phénoménologie sartrienne, Ricœur lui reproche un manque de précision car le néant autour duquel Sartre fonde son analyse relève d’une catégorie trop générale. Il y aurait là une mauvaise foi, qui voudrait ignorer comment le néant de la théorie sartrienne de l’imagination prépare toute la dialectique de l’en-soi et du pour-soi qui fonde la phénoménologie de la conscience sartrienne développé à partir de L’Être et le Néant. Cette capacité de l’imagination à néantiser est donc bien un acte de conscience, mais en généralisant cette notion du néant chez Sartre, Ricoeur rappelle comment celle-ci englobe des sous-catégories qui impliquent une contradiction inhérente, puisqu’elle regroupe autant la non-existence, l’absence que la présence neutralisée, tandis que cette non-existence contredit la possibilité même d’une existence du référent. La contradiction n’est que temporelle, c’est-à-dire non-dialectique, car elle refuse de rentrer dans le mouvement même de la conscience imaginante qui néantise la référence même de la chose pour créer une image. La différence entre le néant sartrien et la fiction chez Ricœur est que le premier néantise l’être en-soi de la chose — c’est-à-dire la conscience imaginante — tandis que la fiction construit son propre référent. Doit-t-on soupçonner de la mauvaise foi dans la généralisation qui préside à la démonstration de Ricœur ou bien plus simplement que l’image sartrienne et la fiction chez Ricœur prennent place à des niveaux ontologiques différents ? La première cherche à clarifier cette dialectique de la conscience qui imagine une chose tandis que la seconde vise un mode de narration qui construit une logique de monde. Lorsque Ricoeur constate qu’il est possible chez Sartre de passer de l’absence à la fiction, faut-il rappeler que tel est le mouvement qui pousse Roquentin vers la nausée devant un tas de feuilles pourries dans un parc avant que l’imagination l’arrache de sa mélancolie pour s’adonner à la création d’une fiction sous forme de roman ? Ultimement, Ricoeur en vient à reconnaître combien l’imagination chez Sartre s’épuise à produire un « anti-monde », qui dans cette création même de l’immonde finit par devenir la fiction de son propre journal.
Les avatars de la fiction
9Si l’image signale l’absence, l’imagination, elle, tend vers l’irréel. Or cette tension concentre les qualités de l’imagination, que Ricœur qualifie d’intuitive, de dynamique, de productrice. Le principe est simple. Reproduire le réel est une opération qui passe à côté de ce qu’il nomme la « référence productrice », c’est-à-dire cette capacité de la fiction à ouvrir de nouvelles perspectives sur la réalité, quitte à ce qu’elle soit utopique. Une telle ouverture est impossible tant que l’image ne devient pas sa propre référence et qu’elle positive son contenu. L’image fait référence au réel en le copiant, par une sorte d’hallucination de l’image qui devient impuissante face au réel. L’image n’est pas en mesure de façonner la réalité et la ressemblance devient une négation par rapport au génie de la fiction qui peut changer la réalité en élargissant notre vision du monde. Ricœur veut montrer comment l’imagination peut opérer une refonte en décrivant à nouveau cette réalité au moyen d’une fiction heuristique. Si la dernière partie du cours développe cette fonction heuristique de la fiction, le philosophe l’oppose à cette opération négative de l’image pour considérer à partir de Bachelard et de sa Poétique de la rêverie comment s’élabore une ontologie de l’imaginaire en montrant que dès que l’on retire de l’équation la chose ou la réalité sur laquelle se fonde la reproduction, cette absence de référent (et donc de néantisation) permet de positiver l’opération de l’imagination par une ouverture sur un monde. Le point critique est de comprendre comment la métaphore, qui est œuvre de discours, peut produire de l’image. Comment quelque chose dans le discours peut donner à voir ? Ici, Ricoeur prend à rebours le mouvement du raisonnement philosophique « ascendant » qui nous mène de l’image au concept pour montrer comment quelque chose dans le concept lui-même donne à voir, tout en hybridant celui-ci. Le discours fait figure, disait Aristote. L’originalité de Ricœur est d’élaborer une philosophie de l’imagination productrice à partir de la capacité du faire discours et du faire image. La portée ontologique de l’imagination productrice est donc de produire de l’être « au seuil » de l’expression poétique. L’opération relève de ce que Ricœur nomme « l’augmentation iconique » d’après François Dagognet et travaille l’espace de la référence productrice. Tout en cherchant à combattre les écarts entre poétique et épistémologie, et à combiner les différentes stratégies du langage qui déploient des images, c’est à partir de la corrélation entre le modèle et la métaphore que se trouve la transition entre imagination poétique et imagination épistémologique par un dépassement du problème de la dénomination entre l’image et le mot. Si la métaphore est la figure rhétorique qui permet le transfert-transport du nom à partir de la ressemblance, elle est essentiellement une fonction de ressemblance. Pour l’homme imaginant, c’est la métaphore vive qui ouvre vers de nouvelles significations. C’est elle qui se déploient à travers la puissance créatrice de la fiction. Si les premiers écrits de Ricœur laissaient entendre la nécessité d’une ontologie et d’une philosophie de l’imaginaire, à celle-ci s’adjoint une anthropologie poétique.
10La psychologie de l’illusion chez Sartre ferme la voie à une ontologie de la fiction, car la vie imaginaire se réduit à une tentative désespérée de « posséder la chose en son absence » (p. 345). Il n’y a aucune transformation magique du réel mais la feinte d’une possession qui est de fait une dépossession. Face à ces difficultés philosophiques à développer une ontologie de la fiction s’ajoute les difficultés du langage poétique contemporain car l’esthétique de la poésie est tout aussi anti-ontologique que la peinture abstraite l’est dans sa perte de la référence au réel. Une poésie de pur langage qui n’est pas tournée vers la réalité extérieure, devient aux yeux du philosophe un contre-exemple de l’ontologie de la fiction. En faisant référence à Roman Jakobson, qui rappelle dans son texte « Linguistique et poétique » que tant que le sens du poème se réfère au son, il n’est pas dirigé vers l’extérieur. Le poème est enfermé dans une forme phonétique et dans un monde d’image déployé par le langage. En reprenant le langage de la phénoménologie, Ricœur conclut qu’une telle poésie opère l’épochè de la réalité. Le langage n’existe que pour lui-même et non pour ce qu’il dit, pour sa capacité à décrire la nervure du monde. Cette critique se rapproche des poétiques qui durant les années trente s’en prenaient à l’esthétisation de l’art pour l’art et qui perdait la possibilité pour la poésie de dire quelque chose sur le monde. Roger Caillois rappelait comment la poésie de Saint-John Perse cherchait à épuiser les taxonomies du monde, élaborant une « une science du concret » qui dénombre la richesse et la variété des modèles poétique. Un tel mouvement souligne les difficultés de passer d’une théorie de la métaphore à une théorie de la référence secondaire. L’opération suppose la reconquête de second ordre en passant par la peinture et l’épistémologie afin de dépasser l’effondrement du langage descriptif. Ce n’est qu’au détour de ces deux domaines que le philosophe pourra opérer un transfert du modèle à la métaphore. Ceci présuppose que l’on délaisse le problème de la référence et de la phrase ou encore de la métaphore isolée pour considérer le poème dans son entièreté. Mais ce sera la peinture qui ouvrira le chemin à la référence productrice, en suivant la pensée de François Dagognet dans Écriture et iconographie. Ricoeur montre comment se forme le paradigme de la transformation iconique de la réalité, en soulignant que l’image ou la peinture n’appauvrissent pas la réalité selon le précepte que la copie est inférieure au modèle, mais l’augmente à partir d’un principe de plus que réelles qui gît au cœur de la fonction iconique. Il faut pour cela partir d’une image physique, publiquement connue comme un tableau et qui s’oppose à une image mentale. L’œuvre picturale est une œuvre fictionnelle qui est toujours un tableau, permettant un double niveau d’articulation entre le tableau et la peinture. Alors que le premier oppose sa dimension physique à l’image mentale, la seconde nous fait entrer dans le domaine de la techné, qui implique les procédés de la production. Du point de vue du langage, celui-ci aussi est produit en suivant certaines techniques, toutes en suivant les catégories de genres qui sont productrices de l’œuvre. Ce tournant de la phénoménologie de l’imagination créatrice de l’image mentale vers une œuvre de fiction retrouve la critique de Platon devant la peinture et l’écriture qui confie le processus de création à un médium extérieur. Cette extériorisation de la créativité inscrit la pensée hors d’elle-même pour rompre radicalement avec la tradition de l’image comme ombre. La promotion de la réalité revient à promouvoir une créativité qui inscrit ses intentions dans un médium extérieur. La seconde étape de l’augmentation iconique vise le choix d’un alphabet (ou ce que Ricoeur nomme un écran structurel) à partir duquel la peinture va lire la réalité selon certaines règles herméneutiques. Au sein du tableau, c’est-à-dire au sein de l’espace du cadre, on découvre un monde en miniature qui est exprimé selon un processus d’abréviation. Suivre l’alphabet du peintre revient à capturer l’univers dans un réseau de signes abrégés. Tout en suivant la leçon de Nelson Goodman qui établit la distinction entre les symboles épais de la peinture et les symboles discrets de l’écriture pour les inscrire dans un cadre commun de leur fonction connotative, Ricœur cherche à établir une fonction générale d’iconicité pour démontrer que finalement — et ce ne sera pas là le dernier des paradoxes — au plus le langage s’éloigne de la réalité dans la vision, au plus il s’en rapproche du cœur de la réalité qui n’est plus un objet manipulable. C’est au moment où la peinture rompt avec sa fonction figurative qu’elle déploie pleinement sa fonction mimétique. Dès qu’elle n’est plus figurative, la peinture devient complètement fictionnelle. Lorsqu’on ne peut plus nommer les objets dans une toile, nous sommes rejetés vers les tensions qui nous relient au monde (p. 358). L’avilissement de la référence descriptive déploie une référence plus fondamentale vers un monde d’avant l’objet manipulable, un monde originaire, celui où l’on naît sans pouvoir nous orienter. Nous entrons dans une vie pré-objective, dont la part connotative présuppose toujours une part ontologique.
11Ce parcours que propose Ricœur de la matérialité du tableau, qui est toujours une copie de quelque chose, vers la possibilité pour la fiction de créer son propre référent indique que le tableau est un lieu de production au sein duquel le philosophe fait jaillir la fiction, où l’imagination créatrice est à l’œuvre dans le travail que je pense percevoir. Ensuite, le philosophe nous invite à nous tourner vers le modèle épistémologique pour saisir la fonction heuristique de la fiction. Nous entrons dans le domaine dense de l’articulé, dans l’opacité discursive du savoir sur les sciences. Il s’agit de mettre en évidence la fonction de dévoilement de la poésie et la créativité du langage, où le langage semble fonctionner pour lui-même alors que dans le cadre épistémologique, il prolonge et grandit la connaissance. Ceci permet à Ricoeur de poser la similitude entre le modèle et la métaphore car ce n’est qu’à partir du moment où une théorie de l’imagination des processus cognitifs permet de comprendre le rôle de l’imagination poétique que l’on touche à une conception générale de la pensée humaine qui s’articule autour de l’universalité de l’imagination créative.
12Dès qu’on évoque une lecture des modèles, un tel geste implique déjà une interprétation. Regarder une maquette ou un modèle implique une opération de filtrage qui revient à la lecture de l’original au sein de la structure du modèle. Ici, la lecture de Ricoeur se base sur Black et son principe d’isomorphisme. L’opération d’abstraction qui permet de passer du modèle à l’original en opérant un déplacement qui relève de la métaphore, le passage vers un modèle mathématique et enfin théorique indique que contrairement à une maquette que l’on peut voir, ces modèles donnent à voir autrement et à parler autrement, faisant du langage le lieu même du domaine d’application. Ici s’opère la production d’une nouvelle information résultant de la rencontre de deux domaines sémantiques différents au sein d’une même structure. Le modèle fait l’objet d’une description qui présuppose sa propre transposition à l’intérieur même du langage. Le modèle théorique devient donc une fiction scientifique : la transposition est une référence productrice. Un nouveau langage s’introduit, celle qui opère le déplacement du modèle vers le nouveau concept. Plus tard, avec la poésie, le philosophe traquera la transposition même du modèle. Ceci présuppose une mobilité initiale des concepts de nos modèles qui forme un saut conceptuel et permet d’établir une relation symbolique. Tel est aussi le mouvement de la métaphore en poésie, alors que la transposition présuppose une interprétation herméneutique. Mais, Ricœur montre que le paradoxe central de la fiction tient au fait que l’absence de référent direct offre la possibilité d’avoir un référent indirect qui augmente la réalité et ouvre sur un monde. Or le problème de la poésie relève d’une difficulté particulière à savoir que le langage œuvre pour lui-même, pour « sa propre gloire ».
La nature langagière de l’imagination
13Cette théorie générale de la fiction comporte quelques difficultés quant à son horizon ontologique, comme le rappelle Jean-Luc Amalric dans les dernières pages de l’ouvrage, où l’éditeur tente de dégager les lignes de force d’une théorie générale de l’imagination. L’argumentation qui se déploie à travers ce cours est assez claire : la tradition philosophique d’Aristote à Kant nous livre une théorie de l’imagination reproductrice en ignorant la potentialité productrice et créatrice. Il impose une philosophie de la présence en accordant un primat à la perception et réduit l’absence comme une figure dérivée et secondaire. Kant forme une rupture décisive avec ce primat ontologique de la présence, le primat phénoménologique de la perception, de la représentation et la critique de l’illusion. Cette rupture attribut un sens transcendantal à l’imagination. Mais Ricœur tente de dépasser Kant et la subjectivation de l’imagination par une théorie de la fiction qui dépasse la troisième critique et la coupure que la théorie du génie pose entre esthétique et épistémologie. Bien que nourrie des sources de la phénoménologie, cette théorie de la fiction est une tentative d’élargir et de renouveler le schématisme kantien et de surmonter la coupure entre le cognitif et l’esthétique par une théorie unifiée et ontologique de l’imaginaire. Cette théorie de la fiction reprend l’essentiel des thèses de La Métaphore vive et répond à la dépréciation généralisée de l’imagination par la tradition philosophique. Ainsi, l’imagination est trop importante pour être réduite à l’illusion du « faire croire ». Le néant de la fiction est une puissance de reconfiguration de la réalité. Tel est le pouvoir créatif de l’imagination productrice. La créativité langagière de la métaphore opère à partir de ce point de rencontre entre le verbal et le non-verbal, entre le sens et l’image, entre l’acte du discours et l’expérience. Ainsi, le philosophe nous mène dans un mouvement qui va du langage à l’image, afin de schématiser le déplacement métaphorique qui produit un sens nouveau et une ressemblance nouvelle. La thèse de la référence métaphorique est porteuse d’une ambition ontologique qui serait l’être comme pendant du « voir comme » chez Wittgenstein. Tel est la référence productrice, une créativité qui fait de l’image une signification à l’état naissant, émergeant. Si Jean-Luc Almaric questionne ce détour de l’imagination par la métaphore, qui scelle le couplage imagination-langage, celui-ci demeure équivoque. Est-ce une étape dans la démonstration de Ricœur, ou bien la métaphore souligne-t-elle la nature foncièrement langagière de l’imagination productrice ? Bachelard suggérait lui une telle conclusion lorsqu’il écrivait dans Fragments d’une poétique du feu : « Des beautés spécifiques naissent dans le langage, par le langage, pour le langage5 ». À peu près à la même époque, Roger Caillois ambitionne une théorie générale de l’imagination dont le centre est une grammaire ou ce qu’il nomme une syntaxe de l’imaginaire, couplé à une réflexion sur l’image poétique et la métaphore. Comme chez Ricœur et Bachelard, l’ambition est d’unifier les démarches de la pensée poétique et scientifique autour de la rencontre entre Saint-John Perse et Mendeleïev. Enfin, Henri Corbin a exploré à partir d’une herméneutique du livre qui dévoile le sens caché des textes sacrés de l’univers visionnaire de la mystique persane, plaçant le langage et son interprétation au cœur de son ontologie de l’imaginal entendu comme imagination créatrice. Tel est l’horizon dans lequel Ricoeur vise la valeur référentielle du langage poétique pour affirmer l’unité de la pensée dans la science et la poésie. Ce que Jean-Luc Amalric nomme « le tournant imaginatif » est donc un « plaidoyer pour la fiction6 », qui s’impose autant comme une réalité ontologique, politique et esthétique. Contre les ontologies négatives qui fixent l’image en creux, dans un entre-deux ou plus radicalement comme une absence dérobée, Ricoeur mobilise les ressources de l’affirmation pour nous inviter à repenser l’imagination.

