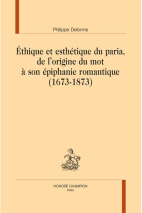
Défense et illustration de la condition de paria à l’époque romantique
1Cette somme de Philippe Delorme, déjà docteur en gestion, est issue d’une thèse de doctorat en langue et littérature françaises soutenue à l’université de Pau en 2022 et peu remaniée, malgré quelques coquilles persistantes1. Elle se justifie par l’importance du sujet, cependant négligé ; deux choses exposées de façon étayée dès l’introduction. Malgré l’importance évidente du terme paria dans Les Pérégrinations d’une paria2 de Flora Tristan (1837) ou dans Chatterton et Servitude et grandeur militaires (1835) d’Alfred de Vigny3, il est vrai que le terme ne faisait jusqu’alors l’objet d’aucune étude conséquente.
2Philippe Delorme y effectue un gros travail de constitution d’un corpus primaire d’une trentaine d’œuvres, mettant en valeur le jalon essentiel de La Chaumière indienne4 de Bernardin de Saint-Pierre, qui offre, en 1791, la première véritable apparition de la figure du paria dans la littérature française. Il expose sa méthode interdisciplinaire ambitieuse et justifie d’étendre son étude jusqu’en 1873, date de parution des Amours Jaunes5 de Tristan Corbière.
Archéologie d’un mot et d’une figure
3L’ouvrage s’apparente d’abord à une enquête car il s’agit de remonter la piste des occurrences du terme paria en cessant de recopier les mêmes erreurs, reprises au fil des dictionnaires sans combler d’importantes omissions. L’auteur tente ainsi de déterminer si le mot, qui fait sa première entrée dans une encyclopédie française en 1765, est emprunté à une langue indienne ou si, au contraire, il n’a jamais appartenu au vocabulaire des Indiens (p. 50). Au terme d’une investigation aussi convaincante que nécessaire, impressionnante par son sérieux et sa difficulté (elle s’étend jusqu’à des textes néerlandais ou portugais), Philippe Delorme avance « la possibilité que le mot “paria” soit un emprunt direct à la langue tamoule », fort d’un « faisceau de considérations historiques, géographiques, littéraires et linguistiques » (p. 52). Ce faisant, il remet en cause les travaux de l’abbé Jean-Antoine Dubois6 (1825) et même d’Eleni Varikas7 (2007).
4Philippe Delorme se met ensuite en quête du premier emploi du mot paria en français. Il parcourt ainsi les relations écrites de voyage des missionnaires catholiques, Anquetil-Duperron8 en 1771, de l’abbé Guillaume-Thomas Raynal9 en 1770... jusqu’à parvenir à l’année 1673 et aux récits — récemment édités10 — de Barthélémy Carré, agent de Colbert et courrier de Louis XIV (p. 69).
5Philippe Delorme peut alors poursuivre son exploration :
Après les premières apparitions du mot « paria » dans les relations de voyages en Inde et son enracinement durable dans la langue française, la constitution du paria en motif littéraire a été rendue possible par un contexte très favorable marqué par l’orientalisme en général et l’indianisme en particulier. (p. 70)
6Philippe Delorme apporte quelques précisions intéressantes sur ce contexte de meilleure connaissance de l’Inde et de diffusion d’œuvres littéraires indiennes dans les milieux cultivés d’Europe, contexte marqué par la parution de trois histoires françaises de la littérature indienne, de 1839 à 1860. Il dégage en outre un deuxième jalon : Le Paria11, tragédie en 5 actes de Casimir Delavigne, créée en 1821 au Théâtre Français.
7Au terme de ces précieuses clarifications, dans un deuxième chapitre, Philippe Delorme entreprend d’exposer une « surprenante métamorphose », sur trois plans : à partir de la publication de La Peau de chagrin de Balzac en 1831, le paria n’est plus un personnage exotique ; il n’est plus géographiquement rattaché à l’Inde. En outre, sa condition de paria ne semble plus déterminée par sa naissance mais par l’écrasement du destin. Enfin, « le paria se voit attribuer les plus grandes qualités morales » (p. 85) et devient une figure chrétienne. Les protagonistes de Bernardin de Saint-Pierre et de Delavigne sont ainsi « deux recréations littéraires » (p. 92) ; le « rattachement à l’exotisme ne se fait que par les artifices formels de l’écriture » (p. 93). « Le mot “paria” passe ainsi, selon un processus métaphorique, du sens propre correspondant à sa réalité indienne à un sens figuré caractéristique de sa figure littéraire » (p. 95). Face à la variété des réécritures littéraires qui vont suivre, Philippe Delorme interroge alors la caractérisation (proposée par Edward Said) de l’orientalisme comme discours européen univoque (p. 99), piste intéressante mais qui restera finalement peu creusée.
Méfiance face à l’injustice du sort !
8Philippe Delorme expose la mutation décisive présente chez les auteurs de son corpus : la mauvaise fortune semble y remplacer l’impureté native du paria. L’auteur met ainsi en avant la notion de sort, qu’il définit comme les aléas de la vie dus au hasard, aux circonstances ou au destin (p. 102). Il prend pour premier exemple Alfred de Vigny, avec son drame Chatterton et le poème des « Destinées ». Cependant, il ne relève pas que la notion de destinée, chez Vigny, est interrogée comme une croyance aliénante, une force d’abord langagière, d’interprétation et de suggestion12. Il n’est donc pas exact d’affirmer que « Vigny conditionne chaque existence par un déterminisme implacable » (p. 103). La forte présence du champ lexical de la destinée chez Vigny porte une réflexion sur ce qui peut être considéré comme vraiment écrit d’avance ou relevant essentiellement du discours, en occultant les mécanismes humains. Le recueil des Destinées dit ainsi, au fil des poèmes, la possibilité de construire ses destinées. Chatterton interroge le poids respectif des tendances suicidaires du poète et des conditions inacceptables que la société lui réserve. La figure du paria y est problématisée justement sur la question de l’inéluctable, qui soutient en fait un plaidoyer pour un changement social. La vocation de poète semble s’apparenter à une malédiction psychologique, comme de naissance, mais celle-ci est aggravée par l’exclusion sociale, que Vigny voudrait changer. Les questions de naissance et de condamnation sociale restent donc cruciales : les premières pages de l’ouvrage de Philippe Delorme permettent de les éclairer. Il est dommage que l’ouvrage les évacue ensuite pour mettre en valeur un glissement général dont Vigny est loin d’être le modèle. Se fait sentir le besoin d’une lecture des œuvres en profondeur, au-delà des occurrences de mots-clés auxquels on ne peut s’arrêter ; travail bien sûr colossal étant donné l’ampleur des lectures déjà entreprises par Philippe Delorme.
9Dans les pages consacrées à l’idée de destinée chez d’autres auteurs, Flora Tristan ou Victor Hugo, il est nécessaire de distinguer entre sens passif, une existence tumultueuse et douloureuse, difficile à diriger, et sens actif, une force supérieure agissante. La simple présence du terme destinée, ou d’un synonyme, dit assez peu. Ce sont des mots à analyser, comme Philippe Delorme l’a si bien fait pour paria. Il aurait aussi fallu, dans un travail fin sur les occurrences, examiner la distance ou la proximité entre les apparitions des termes « paria » et « destinée », et chercher à comprendre l’emploi de ce dernier terme, les facteurs agissants qu’il semble recouvrir. Trop souvent, les citations sont très longues et peu commentées, de l’ordre de l’illustration ou du relevé ; elles demandent encore une analyse pour pouvoir prouver et convaincre. Ainsi, après une citation explicite de Balzac (Une ténébreuse affaire) qui affirme la fatalité, mais sur un autre plan — « Les lois de la physionomie sont exactes, non seulement dans leur application au caractère, mais encore relativement à la fatalité de l’existence. Il y a des physionomies prophétiques. » (p. 109) —, le commentaire est très superficiel, sans analyse du passage, et rabat trois cas très différents sous la même conclusion généralisante :
Balzac préfère ici le terme « Fatalité » là où Hugo et Vigny auraient sans doute employé « Destinée » ou « Ananké », mais l’idée reste la même, celle d’une vie de paria que les vicissitudes de la vie expliquent mieux que les conditions de la naissance. (p. 109)
10Cependant, l’importance des conditions sociales de la naissance de Jean Valjean et, d’après Balzac, de l’apparence physique, ne permet pas de balayer si vite le poids de la naissance pour montrer une évolution de la figure du paria ; il y aurait peut-être plutôt là matière à mettre en valeur la persistance de la première acception du terme, avec des variations intéressantes à considérer. De même, la prédétermination sociale semble cruciale dans de nombreux textes du corpus, mais elle demeure relativement occultée dans l’ouvrage de Philippe Delorme.
Du renversement à la confusion
11Autre renversement exposé au chapitre II : « les plus grandes vertus substituées à la complète dépravation » (p. 111). Mais les parias en Inde étaient-ils considérés comme dépravés et pleins de vices, ou exclus par principe et du fait de la position leur revenant ? Germaine de Staël, mentionnant La Chaumière indienne dans De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations (1796), évoque un « homme d’une race maudite, abandonné de l’univers entier, [...] faisant horreur à ses semblables sans l’avoir mérité par aucune faute13 ». Cette présentation littéraire n’est pas démentie par les études ethnologiques et anthropologiques, telles que l’article « Marques et signes des identités “paria” : Intouchables et “castes criminelles” en Inde » d’Alexis Avdeeff et Harald Tambs-Lyche, qui donnent cette définition en préambule :
En Inde, l’intouchabilité frappe des communautés socio-économiques endogames qui, de par leurs occupations traditionnelles, sont considérées comme en état de « pollution » rituelle permanente. S’acquittant des tâches les plus dégradantes aux yeux de la société indienne — comme l’enlèvement des ordures, le tannage, le fossoyage —, ces communautés sont ainsi mises à l’écart du reste de la société, leur simple contact étant considéré comme « polluant »14.
12Cela n’empêche pas de parler d’une évolution du regard mais on s’interroge sur la nécessité de développer l’évocation des vertus pouvant caractériser les personnages de parias. Ce développement est du reste contestable quand il porte sur le personnage du vieil officier dans « Laurette ou le Cachet rouge », la première nouvelle de Servitude et grandeur militaires de Vigny. Thierry Ozwald a suggéré la façon dont on peut s’interroger sur la pureté des motifs du pauvre soldat obéissant, et voir plutôt en lui un « père libidineux qui confisque l’objet du désir de son fils15 ».
13On peine aussi à suivre Philippe Delorme quand il suit le fil de la « rupture avec l’acception indienne du mot “paria” » (p. 130) sans citer d’emplois du mot, procédant par associations (d’« enfants parias [...] désignés par des paraphrases très explicites » telles que, simplement, « vagabonds » ou « infortunées victimes » chez Flora Tristan) ou amalgames, amenant à mentionner les lamas comme « sortes d’animaux parias » (p. 129) !
14On apprécie en revanche l’objectif de définition de la représentation littéraire du paria au chapitre III même si, chemin faisant, des questions se posent qu’on aimerait voir abordées, notamment le passage du groupe à l’individu : comment l’exclusion d’une personne (telle que Flora Tristan) peut-elle en faire une paria ? Le cas individuel ne doit-il pas revêtir une dimension sociétale ? Cette approche manque à plusieurs reprises. Saluons cependant le recours à des travaux théoriques récents, assez clairement présentés et cités dans la longueur, permettant une certaine appropriation critique, par exemple l’étude de Xavier Garnier sur l’antipersonnage de roman16 (p. 148 sq). La confirmation, à travers l’exemple du paria, du « potentiel trans-générique de la figure littéraire » (p. 160) est également intéressante. On s’inquiète néanmoins de la mention de « la célèbre triade rhétorique et aristotélicienne de l’épique, du dramatique et du lyrique » (p. 160), citation des cours d’Antoine Compagnon à l’appui17, alors que, comme y insiste le professeur, cette triade est romantique, posée par Schelling, la poésie lyrique étant hors champ pour Platon et Aristote.
15On retient malgré tout la définition donnée au terme de la première partie :
la figure littéraire du paria donne à voir une personne que son destin condamne à une marginalité et des souffrances extrêmes, à cause de vertus exceptionnelles auxquelles malgré tout elle ne renonce pas, ce qui lui confère une grandeur paradoxale. (p. 142)
Réancrage du paria dans l’époque romantique
16La deuxième partie de l’ouvrage de Philippe Delorme envisage le paria comme un « miroir déformant de la société et de l’artiste lui-même », offrant des éléments de contexte bienvenus et rappelant qu’il « existe en France à cette époque (1791-1873) une forme d’exclusion qui se radicalise ou touche des catégories de personnes jusque-là épargnées, de sorte que les mots habituels s’avéraient inopérants pour en rendre compte » (p. 178). On consent cette fois à suivre l’auteur quand, commentant une citation de Claire de Duras en introduction à son roman Édouard (1825) — « Les anciens plaçaient la fatalité dans le ciel ; c’est sur la terre qu’elle existe, et il n’y a rien de plus inflexible dans le monde que l’ordre social tel que les hommes l’ont créé18 » — il écrit que la « figure littéraire du paria est un marqueur de ce changement de paradigme dans la définition de la destinée » (p. 186).
17C’est un des intérêts de l’ouvrage que de nous introduire — même brièvement — à des auteurs et autrices relativement peu étudiés, comme « le chiffonnier Louis-Marie Ponty [qui], quoique très peu connu aujourd’hui, a fait partie des poètes ouvriers les plus lus de son temps », et collabora au recueil Poésies sociales des ouvriers, publié en 1840 par Olinde Rodrigues19. La mention des nombreuses pièces de théâtre dont le pauvre est le héros (p. 196) est également intéressante. Philippe Delorme élargit enfin le tableau à « une forme de représentation évangélique du pauvre » (p. 200) du fait de l’évolution du christianisme, qu’il rappelle en quelques pages. L’évocation de la figure du paria en littérature est ainsi l’occasion d’une petite histoire culturelle du xixe siècle intéressante pour les néophytes.
18En revanche, tenter de synthétiser la position de ceux considérés comme les grands auteurs du corpus vis-à-vis de la pensée chrétienne paraît une entreprise assez vaine. Riche en synthèses intéressantes, renvoyant à une quantité et à une variété de sources considérables, l’ouvrage ne nous en apprend finalement que peu sur ces « grands auteurs »...
19Le chapitre V, « Une figure archétypique du mouvement romantique », est d’abord assez général lui aussi mais il se prolonge, au chapitre VIII, sur une conclusion ferme qui se veut un apport critique notable, contestant L’École du désenchantement de Paul Bénichou20 :
le désenchantement romantique possède une dynamique ascendante et non descendante, guidée par la quête esthétique et métaphysique du Beau idéal. Cette quête est pour le poète source d’une marginalité plus importante, c’est-à-dire à la fois plus marquée et associée à une forme de grandeur que traduit la majuscule au mot « Paria ». Ainsi, la force de la figure littéraire du paria tient dans sa capacité à unir en une seule représentation le caractère fondamentalement dichotomique de l’exclusion de l’écrivain romantique, paria dans la boue, Paria s’il en fait de l’or. Ce que propose de ce point de vue le romantisme au « monde social » est une dynamique de rupture avec le désenchantement (associé au paria) et de révélation de la Beauté du monde (associée au Paria).
[...] Le romantisme propose le dépassement du désenchantement par un Absolu syncrétique auquel on accède par la voie de l’esthétique.
Nous voulons croire que le Paria, avec sa majuscule, est une figure majeure du Romantisme, figure dont la rareté renforce l’éclat. Dans la noirceur du désenchantement, sa brillance paradoxale suffit à empêcher le triomphe complet de l’obscurité. (p. 388-389)
De quoi le paria est-il le nom ?
20Entre-temps, des hypothèses moins décisives sont formulées, comme celle du chapitre VI selon laquelle
les auteurs qui ont recours à la figure du paria correspondent eux-mêmes assez bien à la définition que nous en proposons : une personne que son destin condamne à une marginalité et des souffrances extrêmes, à cause de vertus exceptionnelles auxquelles malgré tout elle ne renonce pas, ce qui lui confère une grandeur paradoxale. (p. 254)
21Philippe Delorme avance d’abord que « les auteurs qui emploient le plus le mot “paria” sont ceux qui précisément se sont trouvés dans les circonstances les plus défavorables à la résolution de leur complexe d’Œdipe » (p. 255) : Vigny, Balzac, Baudelaire, Hugo. Il émet ensuite l’hypothèse, étayée par des lectures neuropsychologiques récentes, que « la précocité intellectuelle, aujourd’hui appelée surdon, a pu, chez les auteurs qui nous intéressent, constituer une puissante source de souffrance et d’exclusion, suffisamment marquante pour les prédisposer dans leur œuvre au recours à la figure du paria » (p. 267). Il questionne, enfin, la marginalité des auteurs, notamment à la lumière de la notion de bohème (p. 288 sq) et du motif du poète maudit. Il conviendrait toutefois, au-delà des possibles rapprochements, de ne pas occulter les différences de conditions effectives, notamment des « mages romantiques » — Vigny académicien, Hugo député et pair de France... La peinture d’une évolution amène cependant des distinctions et, avec elles, la justification de la borne chronologique finale de la période d’étude : « Ce qui change au cours du xixe siècle est la mobilisation de l’auteur pour la défense de son idéal » (p. 291) ; « L’auteur du xixe siècle est un paria qui croit de moins en moins à son cri. Plus le siècle avance, plus la poésie multiplie les marques de son autoréférentialité » (p. 292). En quoi toutefois cette dernière serait-elle un « suicide du texte » (p. 459) ? L’autoréférentialité croissante de la poésie n’a pas à être le signe d’un manque de foi dans la littérature mais il reste qu’elle marque, selon Philippe Delorme, « la fin de la grandeur paradoxale de l’écrivain paria » (p. 293).
22La troisième partie présente plus largement le paria comme « une métaphore de l’Homme », en premier lieu (chapitre VII) du fait qu’il est « un support privilégié pour le déploiement d’un lyrisme de forte intensité » (p. 302) et « une figure lyrique par excellence [qui] représente le point ultime de “vaporisation” possible du sujet » (p. 453). Fort heureusement, Philippe Delorme annonce que « [l]a figure littéraire du paria mérite [...] d’être étudiée selon les critères modernes de définition du lyrisme, qui diffèrent ou ne se limitent plus au seul critère romantique de l’expression par l’auteur de ses sentiments personnels » (p. 303). Il n’empêche que des mises au point telles qu’en offre le tout récent Dictionnaire du lyrique21 coordonné par Antonio Rodriguez (2024) semblent parfois manquer. Philippe Delorme récapitule ses analyses en conclusion :
La figure littéraire du paria entre en résonance avec tous les marqueurs établis du lyrisme : la rencontre de l’amour et de la mort, le sentiment du sacré, qui s’enracine dans l’aléatoire et le précaire, l’intimité de lieux qui témoignent d’un rétrécissement de l’espace. (p. 453)
23« Mais la figure romantique du paria porte aussi une vision éthique qui non seulement récuse la morale de son époque, mais surtout défend des principes souvent repris et plus que jamais actuels » (p. 459) ajoute-t-il pour rendre compte de son dernier chapitre. Fidèle à sa méthode rigoureuse, Philippe Delorme l’assoit sur un fondement théorique qu’il expose au préalable :
Selon Paul Ricoeur, l’éthique se distingue de la morale en ceci que la première correspond à la visée téléologique de ce qui est estimé bon (héritage aristotélicien), quand la seconde renvoie au point de vue déontologique de ce qui s’impose comme obligatoire (héritage kantien). (p. 394)
24Et de conclure provisoirement que « la figure littéraire du paria apparaît [...] comme le produit d’une conception jusqu’au-boutiste » (p. 398). La démonstration convainc pour « Laurette ou le cachet rouge » de Vigny. Mais comment peut-on considérer que Jean Valjean est jusqu’au-boutiste quand il vole un pain pour nourrir sa famille ? Il semble y avoir là un vice de méthode qu’on déplore à plusieurs reprises dans l’ouvrage, quand son auteur veut rabattre la singularité des textes dans des catégories qui n’éclairent plus dès lors qu’elles négligent la complexité.
25On lira avec plus d’intérêt et de profit les pages sur le paria comme « catalyseur d’émotions et figure éthique » (p. 406), résumant de façon efficace d’utiles pistes du tournant éthique de la théorie littéraire et les confrontant avec pertinence au paria, figure poussant à « l’improvisation morale » (p. 460) et « au service d’une “morale non moralisatrice” » (p. 412). Philippe Delorme se place ici dans le sillage de Sandra Laugier, en soulignant « le plus fort investissement émotionnel du lecteur » (p. 419) dans la sympathie et la pitié.
26Pourquoi, dès lors, conclure l’ouvrage, à la fin du dernier chapitre mais aussi en conclusion générale, par un couplet anti-wokisme, critiquant « les voix qui s’élèvent aujourd’hui au nom de la lutte “éveillée” pour une reconnaissance pleine et entière des minorités opprimées » (p. 450) ? « L’Occident actuel aime résoudre les problèmes de différence par la négation de la différence. Les genres se liquéfient, l’“ère du Transsexuel” évoquée par Baudrillard en 1993 semble advenue » (p. 448), explicite Philippe Delorme. Il en conclut à la « brûlante actualité » de son sujet mais veut aussi donner cette « leçon d’humanité : les problèmes qu’engendre la différence ne se règlent pas avec la crispation identitaire » (p. 450). Mais en quoi le parallèle est-il justifié avec la figure du paria, pourtant longuement étudiée ? Et comment devraient se régler « les problèmes qu’engendre la différence » alors même que « la figure littéraire du paria a pris les traits de bien des soldats, jeunes écrivains, femmes ou enfants, tous victimes impuissantes des transformations brutales de la société » (p. 455) ? « Dans un contexte historique marqué par la disparition de l’altérité radicale, la figure littéraire du Paria affirme la nécessité morale de sa survie » (p. 460), note encore l’auteur. Est-ce à dire que les personnes exclues pour leur différence devraient le rester car ne pas renoncer à la marginalité et à ses « souffrances extrêmes » (selon la définition du paria proposée dans l’ouvrage) « confère une grandeur paradoxale » (p. 452) ? De nouveau, et malgré l’appel à l’ouverture et à la dénonciation de paradigmes périmés, on semble se heurter à un certain conservatisme, celui-là même, peut-être, qui ramenait à un état de fait indiscutable les mentions pourtant problématiques de la destinée.
27Pour mieux rendre justice aux intéressantes figures de paria dont la somme de Philippe Delorme nous permet désormais de prendre la mesure, de mieux connaître la généalogie et de suivre la trace, il reste sans doute à se mettre à l’écoute des textes dans la continuité et le détail, sans souci de taxonomie ou de rapprochement qui risquent parfois l’amalgame ou la réduction, contraires aux riches figures de parias.

