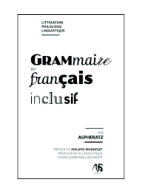
Et al ? La grammaire inclusive, le genre neutre et leur usage
1Ce n’est pas le moindre des paradoxes que parmi les variantes linguistiques du français, celles proposées par le français dit « inclusif » engendre le plus de divisions. Une déclaration de l’Académie française du 26 octobre 2017 y voyait un « péril mortel » pour le français ; la même année, des sondages contradictoires établissaient, tantôt que 75% des Français·es y étaient favorables, tantôt que 85% y étaient opposé·es1. Quoi qu’il en soit, 12% seulement se sentaient capable de définir ce dont il s’agissait2.
2La Grammaire du français inclusif d’Alpheratz3 compte parmi les ouvrages qui pourraient réparer cette ignorance4. Elle se donne pour ambition de faire connaître des variantes « inclusives » des formes du français traditionnel où le genre masculin, soit masque le féminin, soit s’impose là où l’expression du genre n’est pas motivée5. Cet exposé doit permettre, explique Philippe Monneret dans sa préface, de juger du français inclusif sur pièce plutôt qu’à travers ses déformations médiatiques6. Pourtant, la méthode à la fois plus systématique et plus expérimentale d’Alpheratz porte une ambition bien différente : elle est davantage force de proposition que description d’un corpus.
3Les travaux d’Éliane Viennot ont habitué notre sentiment linguistique à la féminisation des noms et des adjectifs (« professeuse », « autrice », « inventeresse »…). Ainsi, ce qui étonne d’abord dans cette Grammaire du français inclusif, c’est plutôt la poésie des formes du genre neutre, exposées habilement au début de l’ouvrage, avant même les pages de définitions et de théorisations du genre neutre lui‑même. Si certaines sont tirées d’un corpus numérique collecté ad hoc7, la plupart sont déduites de la systématisation des principes ayant présidé à leur formation. Certaines formes neutres ont un visage féminin (« Afghaine », « assassaine »…8) ; d’autres portent des suffixes qui rappellent l’anglais (« écrivan », « nouval »…9). D’autres enfin semblent radicalement irrégulières (« certæn », neutre de « certain » ; « bial », neutre de « beau »10). Surtout, beaucoup ressemblent, comme le signale l’autaire al‑même, à des formes d’ancien français : « maréchalx » (neutre de « maréchal »), « compaing » (neutre de « compagnon »), « diex » (neutre de « dieu » et « déesse »)…11, voire du latin : « dux » (neutre de « duc » et « duchesse »)12, sans doute pour la raison qu’en ancien français, l’expression du genre est plus aléatoire qu’en français moderne13.
4Il est bien sûr permis de trouver à certaines de ces propositions un caractère « byzantin et contraint »14, comme le fait Danièle Manesse. Comme l’écrit Gilles Siouffi, les formes du français inclusif sont « ludiques peut‑être, créatives ou “artistiques”, pourquoi pas – en tant qu’étranges ou intrigantes, sans aller nécessairement jusqu’à un jugement esthétique –, pleines de bonnes intentions, certainement ; mais commodes, sans doute pas »15. Quoi qu’il en soit, la Grammaire du français inclusif est donc emblématique d’une « époque d’expérimentation intense » autour de l’écriture inclusive16 ; l’on peut également y voir la preuve que les humanités numériques sont une source majeure de renouvellement des structures et des styles de la vie intellectuelle française. L’on aurait tort, d’ailleurs, de lire l’élaboration de variantes inclusives en françaisseulement comme l’écho lointain des expérimentations anthropologiques portées par le mouvement queer américain, ne serait‑ce que dans la mesure où la question de l’effacement du genre féminin ne se pose guère dans la grammaire anglaise et que les débats français sur l’« inclusive writing » suscitent l’étonnement des observataires anglo‑saxonz17.
5Dans le détail, les pages théoriques de l’ouvrage sont parfois moins convaincantes que ses habiles propositions pratiques. La relation entre les rapports de genre dans la grammaire et dans la société françaises est solidement décrite, d’après les analyses de Ph. Monneret, comme un rapport d’« iconicité diagrammatique »18. Dès lors, l’autaire définit le français inclusif comme « l’ensemble des variations langagières fondées sur le rejet d’une hiérarchie entre les représentations sociales ou symboliques qui sont associées aux genres grammaticaux »19, à quoi l’on pourrait ajouter, au vu de l’introduction du genre neutre, le rejet de la binarité des genres grammaticaux masculin et féminin. Toutefois, la Grammaire d’Alpheratz protège l’audace des propositions visant à mettre en œuvre ces rejets par un emploi problématique de la notion d’« usage » : « seule la communauté linguistique francophone a le pouvoir de faire entrer ou sortir des unités ou des principes linguistiques dans l’usage »20. Or, dans la masse des formes féminines et neutres mises en avant dans l’ouvrage, bien peu sont illustrées par des exemples, et il n’y en aurait presque aucune si les hapax n’étaient pas ici considérés comme des usages21. Plus d’une fois, l’autaire cite sa propre prose22, ce qui (combinæ à une conception maximaliste de l’« usage ») lui confère une sorte de regrettable omnipotence linguistique. Du XVIIe siècle à nos jours, cet « usage », dont la grammaire fait si grand cas, permet d’opposer la langue française publique aux caprices particuliers des accapareurs de langues (les rois, l’Académie…), comme l’a montré Hélène Merlin‑Kajman23. L’utilité publique de ce concept est perdue si l’on y inclut indifféremment toute occurrence linguistique et les hapax, qui sont par définition les produits du particulier, au lieu de s’en tenir à « l’usance commun de parler » que défendait Pantagruel.
6Il est vrai que, comme le remarque encore Gilles Siouffi, le caractère « commun » du « bon usage » est aujourd’hui diffractée en une pluralité d’usages linguistiques24, correspondant sans doute à ce que l’on appelle parfois l’archipel français, c’est‑à‑dire la fragmentation de ses « publics » – sans même parler de l’ensemble de la francophonie. Ainsi, quoique « le sentiment d’une lacune dans l’expression de l’identité de genre en français standard »25 semble répandu, sa résolution par des formes de genre neutre demeure marginale, au point que la plupart des caractéristiques du français inclusif présentées dans l’ouvrage ne nous semblent pas relever de l’usage26. Ainsi, quoique le locutorat inclusif soit « trop varié pour constituer un “groupe social” »27 (comme l’écrit Alpheratz), il ne l’est pas encore assez pour constituer un groupe éthique ou « diaéthique »28. Ne pourrait‑on pas plutôt l’appeler « utopique » ? Car somme toute, la Grammaire du français inclusif pourrait bien constituer une grammatisation de l’utopique « société sans sexe » défendue par Monique Wittig29.
7Le travail théorique ne fait donc que commencer, et il n’est pas jusqu’à l’expression de « genre neutre » qui ne soit contestable (ne faudrait‑il pas plutôt parler de « genre commun », comme l’envisage un instant Alpheratz, dans la mesure où les mots neutres désignent potentiellement les deux genres à la fois plutôt qu’aucun des deux ?30). Ouvrir le débat avec inventivité et intrépidité est l’une des grandes qualités de l’ouvrage. Le genre neutre que présente cette grammaire permet aussi d’entrer au cœur de la fabrique du genre grammatical, et fait entendre al locutaire francophone que, comme l’écrivait Judith Butler lors d’un échange à propos de l’inclusivité, « all identities fail to be fully structured »31.

