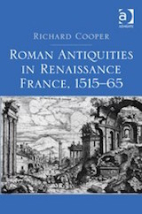
Paris-Rome, allers & retours : le développement du goût antiquaire dans la France du XVIe siècle
1La passion de la Renaissance européenne pour l’Antiquité gréco-romaine est un sujet qui suscite aujourd’hui un nombre croissant d’investigations dans des champs de recherche très variés, qui vont des « Classical Reception Studies » à l’histoire de l’art, en passant par l’histoire de la philologie ou l’épigraphie. Plus particulièrement, une attention accrue semble dévolue à la fois aux relations entre la France et l’Italie aux xve et xvie siècles, objet de plusieurs colloques et publications ces dernières années, et à ces personnages d’une cruciale importance que sont les « antiquaires ». Toutefois, en regard de la profusion d’études consacrées à la redécouverte des antiquités romaines dans l’Italie de la Renaissance1, la France pouvait paraître quelque peu déficitaire, et ce malgré les excellents travaux de Margaret McGowan ou de Frédérique Lemerle-Pauwels2, par rapport auxquels Richard Cooper se positionne. En effet, contrairement au premier, ce livre porte davantage sur la première moitié du siècle, ce qui paraît on ne peut plus justifié, dans la mesure où il s’agit certainement de la période durant laquelle les échanges franco-italiens furent les plus intenses, et, à la différence du second, il s’intéresse moins à la redécouverte des antiquités de la Gaule qu’à celle des vestiges de Rome. Plus particulièrement, Roman Antiquities in Renaissance France entend étudier le développement du « goût antiquaire » en France sous les règnes de François Ier et Henri II. C’est donc un angle bien spécifique qui a été choisi : R. Cooper se propose d’examiner les modalités de la réception des antiquités romaines par la cour, les artistes et les écrivains, en s’attachant notamment à la mode de la collection, au rôle majeur des diplomates et à l’impact du développement de cette mode sur la peinture ou la littérature. L’entreprise consistant à retrouver le reflet des goûts ou des modes d’une époque, bien souvent impalpables, dans des documents d’archives (correspondances, inventaires…) et dans des productions artistiques ou littéraires peut parfois relever de la gageure. Néanmoins, malgré la difficulté de la tâche et des résultats parfois contrastés, ce livre propose des réponses convaincantes aux délicates questions qu’il soulève dans son introduction, en se fondant sur une étude précise et documentée de sources nombreuses, abondamment citées et commentées3.
La fascination de l’antique : premiers aiguillons (1500-1530)
2Bien entendu, comme le rappelle l’introduction de l’ouvrage, l’intérêt de la Renaissance française pour l’Antiquité n’est pas sorti tout armé du crâne de François Ier, mais se trouve être également l’héritier d’une longue tradition : le Moyen Âge connaissait évidemment les monuments romains présents sur le sol français et manifestait un goût certain pour la collection, notamment d’objets antiques. S’il y a peu de preuves, au début du xvie siècle, d’un intérêt français pour les antiquités classiques qui fût équivalent à celui qu’éprouvait l’Italie depuis plus d’un siècle, les nombreux vestiges découverts en France avaient néanmoins déjà suscité des recherches archéologiques et stimulé l’intérêt des collectionneurs.
3Dès la fin du xve siècle, avant même que les Français ne manifestent une vive passion pour les vestiges romains mis au jour en Italie, un certain nombre d’humanistes et d’artistes étrangers, notamment italiens, accordent une attention croissante aux antiquités françaises, en particulier aux inscriptions latines. En revanche, peu de documents démontrent, au cours des deux premières décennies du xvie siècle, un intérêt semblable pour les antiquités de la part des voyageurs français en Italie, bien que bon nombre des plus grands humanistes de l’époque, de Guillaume Budé à Aymar du Rivail, aient passé les Alpes à cette période, généralement en vue de suivre des cours dans quelque prestigieuse université italienne. R. Cooper relève tout de même quelques exceptions notables, comme Geoffroy Tory ou Claude de Bellièvre, qui se rendent à Rome dans les deux premières décennies du siècle et montrent une connaissance précise des monuments ou des sculptures antiques de l’Vrbs. Dans le domaine de l’édition, si la France ne produit pas encore d’ouvrages consacrés aux antiquités romaines, les imprimeurs parisiens, puis lyonnais, publient néanmoins des travaux d’antiquaires italiens comme Raffaele Maffei, les célèbres faux d’Annio de Viterbe, ou encore les Illustrium imagines d’Andrea Fulvio (1524), catalogue de plus de deux cents portraits gravés d’hommes illustres, assortis d’une biographie et puisés aux sources numismatiques lorsque celles-ci étaient disponibles.
4C’est surtout à Lyon, véritable centre de l’érudition antiquaire en France, que se manifeste de la façon la plus éclatante le goût croissant au début du siècle pour la collection d’antiquités, essentiellement de monnaies et d’inscriptions (Jean Grolier, Pierre Sala, Claude de Bellièvre…), mais dans d’autres villes au glorieux passé romain, comme Nîmes, des collectionneurs passionnés sont également à l’œuvre. En revanche, il ne semble pas y avoir, à Paris et à la cour, un engouement comparable à la même époque, si l’on excepte la collection du trésorier Florimond Robertet et la collection royale, puisqu’il apparaît clairement que François Ier a cherché à l’enrichir dès les années 1520, notamment en matière de sculptures classiques, en se servant d’ambassadeurs ou d’agents à Rome pour acquérir ou faire faire des « antiquailles ». Il en va de même pour les arts figurés en France, où l’on peine à trouver les traces d’une inspiration antique : R. Cooper ne note ainsi que les exemples de Jean-Pèlerin Viator, qui fait illustrer son De artificiali perspectiua par des gravures représentant des bâtiments inspirés de monuments réels, et des enluminures réalisées par Godefroy le Batave pour trois volumes des Commentaires de la Guerre des Gaules de François du Moulin. Enfin, malgré les campagnes italiennes de Charles VIII et de Louis XII, les entrées royales ne sont pas encore marquées par des éléments antiquaires significatifs, à l’exception de la présence épisodique d’arcs de triomphe, qui deviendront des éléments dominants dans les décennies suivantes.
Le roi, l’ambassadeur, la cour : la passion de la collection
5C’est plutôt au cours de la seconde partie du règne de François Ier, dans les années 1530, que se développe de façon très nette la mode de la collection d’antiques. L’un des apports majeurs du livre de R. Cooper est certainement la lumière précise qu’il jette sur le rôle capital joué par les diplomates français en Italie, qui procurent originaux, dessins ou copies d’antiquités romaines à d’importantes figures de la cour, mais qui s’affirment également comme des collectionneurs avertis. À cet égard, la figure centrale de l’ouvrage est indubitablement le cardinal Jean Du Bellay, présent à chaque chapitre ou presque, et dont le parcours, pour singulier qu’il soit, n’en demeure pas moins un exemple particulièrement bien choisi pour étudier la formation du goût classique en France.
6Alors évêque de Paris, celui-ci séjourne d’abord deux mois à Rome en 1534, logé chez Rodolfo Pio da Carpi, fervent antiquaire avec qui il visite les ruines de la ville, puis, élevé au cardinalat, il y retourne pour six mois l’année suivante, accompagné à chaque fois d’humanistes fascinés par l’Antiquité, tels Rabelais, Philibert de L’Orme ou Guillaume Pellicier. Dès cette époque, il commence à faire des fouilles, à collectionner des objets antiques pour lui comme pour d’autres passionnés, notamment le connétable Anne de Montmorency, et à exporter ses nouvelles acquisitions vers son château de Saint-Maur-des-Fossés. Une douzaine d’années plus tard, en 1547, Henri II ayant demandé aux cardinaux français de demeurer à Rome, il s’installe au Palazzo Colonna et demeure dans la cité papale jusqu’en 1550. À l’imitation d’autres prélats comme Alessandro Farnese, il entreprend alors des fouilles archéologiques dans le Forum romain, essentiellement autour de la Curie julienne, autrefois église de Sant’Adriano al Foro, dont il obtient le titre cardinalice en 1548. Stimulé par les quelques soixante collections privées de sculptures existant à Rome à cette période, Du Bellay commence à en bâtir une qui devient rapidement des plus respectables et dont les recherches précises de R. Cooper donnent un éloquent aperçu. Malgré les réticences croissantes des autorités locales et pontificales, qui ne l’autorisent pas à tout emporter et procèdent à des confiscations, sans compter une cargaison perdue lors d’une attaque de pirates, il parvient néanmoins à rapporter en France une bonne partie de sa récolte.
7En 1553, il se rend à nouveau à Rome pour une dernière mission, accompagné notamment de son cousin Joachim, et s’installe au Palais Farnèse, puis au Palazzo della Rovere, avant de faire construire au milieu des ruines des Thermes de Dioclétien une villa, les Horti Bellaiani, scrupuleusement reconstituée par R. Cooper et située en face de la future basilique Santa Maria degli Angeli. Du Bellay repart alors à la chasse aux « antiquailles » pour embellir sa nouvelle villa et ses jardins, l’essentiel de sa collection romaine ayant été exporté à Saint-Maur. Les sculptures installées par le cardinal dans les Horti Bellaiani sont connues par deux inventaires, l’un de 1556 qui recense des sculptures achetées à un marchand milanais, et l’autre de 1560, réalisé après son décès4 : la collection comprenait ainsi une trentaine de statues entières, essentiellement à sujets mythologiques, qui devaient être en partie antiques et en partie « restaurées » à la mode de l’époque (une tête antique placée sur un corps nouvellement sculpté, par exemple), une quarantaine de bustes, une centaine de têtes et une quarantaine de torses. À la mort du cardinal, cette énorme collection, prise au milieu d’une querelle d’héritage qui ne sera réglée que dix-sept ans plus tard, sera en partie vendue pour rembourser les dettes énormes de Jean Du Bellay.
8Les autres diplomates français à Rome ne sont pas en reste et s’intéressent eux aussi aux ruines de Rome et aux recherches antiquaires, comme François II de Dinteville et, surtout, Georges d’Armagnac ; ce dernier, comme du Bellay, collectionne pour son propre compte et exporte vers la France, tout en patronnant de nombreux humanistes (Guillaume Philandrier, Pellicier, Pierre Paschal). Sous François Ier, les ambassadeurs à Rome et à Venise jouent donc à l’évidence le rôle de marchands d’antiquités pour la collection royale ou pour le compte d’autres grands personnages de la cour qu’ils aident à embellir leurs châteaux et, sous Henri II, qui avait insisté pour que ses cardinaux résidassent à Rome, le nombre d’exportations vers la France va croissant, bien que les plus actifs en la matière aient été Du Bellay et D’Armagnac.
9L’autre versant de cette frénésie antiquaire à Rome se trouve évidemment en France où, loin des modestes collections du début du siècle, se développe indéniablement un goût pour les antiquités classiques. Si les intérêts de François Ier le portaient au départ, tout comme ses prédécesseurs, vers de petits objets (monnaies, médailles) utilisés pour la décoration, après 1540, il s’intéresse plus particulièrement à la sculpture. Toutefois, à l’origine, ce n’est pas du sol français que provient l’essentiel de la collection royale, mais bien d’Italie, et tout particulièrement de Rome, d’où Italiens soucieux de complaire au roi de France, mais aussi ambassadeurs et agents expédient des marbres, malgré les difficultés d’exportation de plus en plus importantes. Pour enrichir encore sa collection, François Ier envoie également le Primatice à Rome entre 1540 et 1545 : le peintre y est prioritairement chargé d’acquérir des originaux pour le roi, mais aussi de réaliser des moules et des dessins de statues et de monuments antiques, notamment des collections papales du Belvédère. Installés à Fontainebleau à partir de 1541, les moules réalisés à Rome permettent de fondre des copies en bronze qui sont d’abord exposées à l’intérieur du château, sans doute dans la Galerie François Ier. Quelques années plus tard, la disposition de la collection sera transformée par la collaboration entre le Primatice et Catherine de Médicis : d’une galerie de sculptures, le goût évolue vers un jardin d’antiques sur le modèle des jardins romains et les bronzes seront redéployés tout au long du siècle lors des modifications successives réalisées dans les jardins de Fontainebleau. Quoi qu’il en soit, cette évolution de la collection royale révèle également le projet de rebâtir Rome en France, à Fontainebleau en particulier, « quasi una nuova Roma » selon le mot de Vasari.
10En outre, par un effet d’émulation, les collectionneurs se multiplient parmi les membres importants de la cour, d’autant que les antiquités romaines sont rapidement utilisées comme cadeaux dans le monde de la diplomatie. Parmi les plus importants collectionneurs de l’époque figurent ainsi Anne de Montmorency et le cardinal de Lorraine Charles de Guise. Richard Cooper dresse à cette occasion une liste impressionnante de passionnés d’antiquités romaines, prélats, hauts fonctionnaires, écrivains, juristes, dont les collections comme les bibliothèques attestent parfaitement la frappante évolution du goût à l’œuvre dans la France du xvie siècle.
Vérités & mensonges des antiquaires : quelques réflexions méthodologiques
11Nous avons déjà dit plus haut à quel point il peut être délicat de tenter de retrouver dans des documents écrits ou dans des productions artistiques la marque d’une évolution des modes et des goûts. Mais il est un autre écueil auquel l’historien peut être confronté : en effet, lorsqu’il s’agit pour lui de reconstituer les collections d’antiquités en possession d’importantes personnalités, d’examiner les catalogues de bibliothèques d’écrivains ou d’aristocrates, d’analyser des récits de voyages et des recueils d’inscriptions ou d’antiquités romaines, son chemin est pavé de chausse-trappes. Ainsi, comme le signale l’auteur, les inventaires des bibliothèques ou des collections d’œuvres d’art, quand leur authenticité même ne soulève pas de problèmes, ne permettent pas toujours d’identifier les livres ou les œuvres — quand ce sont bien des antiquités, et non des œuvres modernes all’antica, qu’il est souvent bien difficile de distinguer des premières sans les connaître précisément. De même, il n’est pas sans risques de se fier sans réserve aux écrits des antiquaires humanistes, dont les méthodes sont fort éloignées de celles des archéologues ou des épigraphistes contemporains : lorsqu’ils affirment avoir vu de leurs propres yeux tel ou tel monument antique dont ils rapportent l’inscription ou qu’ils font représenter, mieux vaut prendre leurs déclarations avec la plus extrême circonspection.
12Le cas des Horti Bellaiani offre un bon exemple des problèmes soulevés par les inventaires et les descriptions de l’époque. Richard Cooper se sert notamment avec beaucoup de précautions du témoignage de Jean-Jacques Boissard qui, dans ses Partes Romanae urbis topographiae, affirme avoir visité la collection du cardinal Du Bellay : entre les inscriptions fausses ou d’authenticité douteuse qu’il rapporte et les œuvres qu’il localise erronément dans les Horti, tant sa description des jardins, qui évoque des statues qui ne sont pas mentionnées dans les deux inventaires, que les reproductions de monuments qu’il prétend y avoir vus imposent de prendre son témoignage avec la plus grande prudence et soulèvent d’autres questions encore. Les reliefs accompagnant les inscriptions inventées de toutes pièces par Boissard étaient-ils également des faux de la Renaissance ou bien des antiquités « embellies » par des restaurateurs ? Ces œuvres reproduites sur les gravures ont-elles même existé ou sont-elles issues de l’imagination de Boissard ? Autant dire que ce type de sources pose finalement davantage de problèmes qu’il n’apporte de réponses.
13Qu’on nous permette d’invoquer un second exemple, portant certes sur un point de détail, mais qui aura, cette fois, échappé à la sagacité de l’auteur. R. Cooper déclare en effet (p. 62) sa perplexité face à une inscription latine que rapporte André Thevet dans sa Cosmographie universelle (1575), en indiquant qu’elle ne figure pas à sa connaissance dans le Corpus Inscriptionum Latinarum et qu’elle n’a pas survécu, à moins qu’elle ne soit le fruit d’une erreur de copie. En réalité, à l’exception d’une petite inexactitude (Papyrius au lieu de Papirius) et du développement de certaines abréviations, celle-ci figure bien dans le CIL et fait partie des fameux Fasti Capitolini retrouvés par hasard en 1546 sur le Forum romain, puis installés au Palazzo dei Conservatori sur ordre du cardinal Alessandro Farnese5. Plus précisément, cette inscription se lit sur l’un des vingt-six fragments de marbre des Fasti triumphales, qui avaient été publiés bien des années avant la Cosmographie, notamment par Bartolomeo Marliani (1549), Carlo Sigonio (1550) ou Francesco Robortello (1555). Contrairement à ce que prétend Thevet, il ne s’agit donc pas plus d’une « sepulture » que d’une « table de marbre quarree, avec son soubassement et architrave ». Les termes même de la description attestent en fait qu’il connaît seulement cette inscription à travers les Illustratione de gli epitaffi et medaglie antiche du florentin Gabriele Simeoni (Lyon, Jean de Tournes, 1558, p. 37), où elle est publiée au sein de la gravure d’un monument qui ressemble parfaitement à la description qu’en donne Thevet, mais absolument pas à l’original romain6. Autant dire que, lorsque le cosmographe précise « comme j’ay veu » avant de rapporter l’inscription, il se voit pris en flagrant délit de mensonge ; de même, lorsqu’il affirme que ce monument avait été mis au jour « moy estant aussi à Rome », il est bien possible que ce ne soit pas tout à fait exact, puisque, selon les hypothèses de R. Cooper, il s’y trouvait en 1548-1549, mais pas en 1546-1547, époque de la mise au jour des marbres du Capitole7.
14Enfin, lorsque l’architecte Philibert de L’Orme évoque « le septieme arc dessous le Campdoille » (cit. p. 171) pour désigner l’arc de Septime Sévère, on peut envisager que ce contresens pour le moins curieux provienne, plutôt que d’un lapsus, comme le suggère l’auteur, d’une erreur de lecture ou de compréhension d’une source écrite en italien (« l’arco di Settimo sotto il Campidoglio ») ou, moins probablement, en latin (arcus Septimi sub Capitolio). Les erreurs de localisation qui le conduisent à situer à Bénévent l’arc de Trajan et à Rome l’arc d’Ancône laissent également à penser que ses connaissances de la topographie romaine ne sont pas aussi précises qu’on pourrait le croire de prime abord, ni que ses sources soient nécessairement de première main ou liées à son séjour à Rome. Ces quelques exemples ont au moins le mérite de rappeler qu’il est parfois risqué d’accorder toute confiance aux récits de voyage et aux revendications d’authenticité, d’autoscopie ou de rigueur philologique de certains antiquaires, qui cachent parfois une source livresque.
Artistes & humanistes : du voyage à Rome aux entrées royales
15La seconde moitié du livre s’intéresse quant à elle à l’impact qu’a pu avoir sur la littérature et sur l’art français du temps cette mode de l’antique, si bien perceptible dans la manie de la collection qui prend un essor considérable entre 1530 et 1560. À partir des années 1530, il apparaît ainsi qu’un nombre croissant d’artistes se rend en Italie, à des fins le plus souvent documentaires, leurs intérêts les portant davantage au départ vers l’architecture que vers les paysages all’antica ou les ruines. C’est par exemple le cas de l’architecte Philibert de L’Orme, qui se sert dans ses traités d’architecture des dessins de monuments qu’il a pu contempler au cours de son voyage, notamment à Rome, où il s’était livré à des travaux pratiques d’archéologie, procédant à des mesures et à des excavations afin de retrouver les tailles originelles des bâtiments. Ses travaux, malgré les réserves que nous avons notées ci-dessus, démontrent en tout cas une connaissance relativement détaillée de la topographie romaine. Dans les années 1540, d’autres architectes comme Jean Bullant et Jacques Prévost étudient également sur place les monuments romains afin de préparer leurs études sur les ordres de l’architecture. Le cas de Jacques Androuet du Cerceau, longuement étudié par R. Cooper dans le chapitre V, est plus problématique : s’il a pu aller en Italie, il est cependant tout-à-fait possible qu’il se soit fondé pour ses propres publications sur des dessins, des estampes, des monnaies anciennes ou même des ouvrages imprimés comme les Epigrammata antiquae urbis de Iacopo Mazzocchi (1521). Quoi qu’il en soit, ses publications orléanaises des années 1549-15508 présentent des monuments réels, idéalisés ou reconstitués, mais aussi des vestiges en ruine, ou encore des « capricci », de véritables fantaisies sur l’antique.
16Tous ces artistes retournèrent en tout cas en France après leurs séjours italiens dans les années 1530, tandis qu’à partir de la décennie suivante, d’autres feront le choix de s’installer à Rome, tel Antoine Lafréry, appelé à devenir le « leader » incontesté du marché de l’art antiquaire. Installé à Rome au début des années 1540, il produit, de 1545 à sa mort en 1577, plusieurs centaines de gravures, dont un bon nombre de vues de monuments romains et de statues antiques, s’engageant dans une veine qui avait été exploitée par quelques artistes italiens, mais qui n’avait pas encore été ni popularisée ni véritablement développée sur le plan commercial : celle des paysages pittoresques avec des monuments en ruine. Il se spécialise ainsi dès les années 1540 dans les vues de vestiges de la Rome antique, mais sans nulle finalité topographique ou architecturale : au contraire, il s’agit plutôt d’un habile « “montage” de réflexion morale, de découverte épigraphique et de sentiment poétique » (p. 197). Ces gravures présentent en effet une scénographie qui les rapproche du « capriccio » et insistent tout particulièrement sur l’état de ruine des vestiges, sur l’écrasante supériorité des pouvoirs de la Nature sur ceux de l’Art. Le succès rencontré par Lafréry provient aussi du fait qu’il avait choisi de ne pas se limiter à des « vedute » de paysages en ruines, mais s’était également intéressé à d’autres types d’antiquités : aux statues, qui offraient des modèles aux artistes européens, et aux reliefs, précieuses sources de renseignements sur la vie quotidienne dans la Rome antique. Enfin, l’atelier de Lafréry publiait aussi des gravures de monuments non pas en ruine, mais reconstitués dans leur supposé état d’origine, ainsi que des vues d’ensemble de l’Vrbs. Le même goût pour les monuments antiques reconstitués et les vues d’ensemble se retrouve encore chez le peintre et graveur Étienne Dupérac, qui s’installe à Rome dans les années 1550.
17Dans l’art français, le développement du goût antiquaire qui aboutit à la mode des ruines du milieu des années 1540 tire pour l’essentiel son origine d’artistes italiens, qui s’inspiraient de leurs aînés Raphaël, Marcantonio Raimondi ou Giulio Romano, tels Rosso Fiorentino, qui utilise les ruines comme éléments de décor dans ses fresques ou ses médaillons de la Galerie François Ier à Fontainebleau, le Primatice, dont les moules et les dessins romains sont également transformés en gravures par Antonio Fantuzzi, ou, à partir de la décennie suivante, Niccolò dell’Abbate et Francesco Salviati. La circulation des gravures de Lafréry, diffusées par Guillaume Roville à Lyon, mais aussi par les voyageurs revenant d’Italie, offraient en outre de nombreux modèles pour les artistes français du milieu du siècle. Mais les artistes italiens — ou flamands, comme Léonard Thiry — n’étaient pas les seuls à promouvoir ce goût des ruines en France, puisque dès la fin des années 1540, les ruines ou les motifs antiques étaient courants chez les artistes français, que l’on pense à Jean de Gourmont ou à Jean Cousin l’Ancien. De même, Paris et la cour de France n’avaient pas le monopole du goût antiquaire, car des preuves de l’essor de cette mode se retrouvent également en province, chez des graveurs lyonnais comme Bernard Salomon ou Georges Reverdy, ou encore dans les peintures réalisées vers 1546-1550 par Noël Jallier pour la galerie du château d’Oiron de Claude Gouffier, dans lesquelles les décors architecturaux témoignent d’une importante influence du style romain des années 1530.
18De plus, les artistes de l’École de Fontainebleau montrent un désir de plus en plus patent de précision historique, à l’opposé des tendances de la génération précédente, et, influencés par les dernières recherches antiquaires, tentent d’offrir des reconstitutions idéales de monuments classiques, voire de cités entières, comme Rosso dans la fresque L’Unité de l’État ou le Primatice dans la Galerie d’Ulysse. Dans les années 1540, sous l’influence des gravures de Lafréry, cet intérêt pour les restaurations idéales de monuments antiques va croissant, tout comme émerge, parallèlement à cette recréation de l’Antiquité, un désir d’imaginer comment ces villes et ces monuments ont pu tomber en ruine, perceptible dans des gravures représentant des monuments en feu, en plein effondrement ou en proie à la destruction. La volonté de précision historique se lit encore dans la fascination des artistes pour les cérémonies anciennes, notamment les scènes de funérailles, de sacrifices ou de triomphes. Quoi qu’il en soit, les antiquités romaines deviennent au cours de la période un décor conventionnel dans les sujets mythologiques, souvent associé à des nus, au point qu’au terme de la période étudiée, le paysage classique s’est fermement installé dans la peinture française. De même, dans les manuscrits enluminés, livres d’heures ou psautiers, qui reviennent à la mode à l’époque d’Henri II, se retrouvent encore des éléments antiquaires en lien avec le goût de la cour, tout comme dans les peintures et les estampes à sujet religieux.
19Enfin, R. Cooper, qui avait consacré plusieurs de ses travaux précédents à ce sujet, se penche aussi sur l’évolution au cours du xvie siècle des entrées triomphales, manifestations qui sont l’occasion d’une rencontre entre humanistes, poètes, peintres, graveurs et architectes. Ces cérémonies officielles, consistant à accueillir un monarque ou un haut personnage dans une ville parée d’un décor architectural éphémère, connaissent en effet un tournant notable durant le règne de François Ier (1515-1547), essentiellement à partir des années 1530. À la forme traditionnelle du rituel se mêle désormais l’influence de modèles classiques et italiens, et les défilés royaux évoluent progressivement du modèle allégorique médiéval vers une forme de recréation des triomphes romains, tant dans la procession que dans les architectures éphémères bâties le long de la route : costumes à l’antique, couronnes de lauriers, figures empruntées à la mythologie ou à l’histoire antiques, décor recréant et mettant en valeur le passé gallo-romain de la ville… Sous Henri II (1547-1559), les entrées royales sont plus clairement encore marquées par un net changement de goût et par un style différent. Si les éléments allégoriques et religieux persistent, l’influence classique se fait plus prégnante encore et la parade à l’extérieur de la cité perd de son caractère religieux pour revêtir les apparences d’un triomphe romain, dont l’imagerie s’inspire des Trionfi de Pétrarque, des œuvres de Mantegna, du Songe de Poliphile comme des reliefs romains. Mais c’est surtout au cours du défilé du roi à l’intérieur de la ville que le nouveau style antiquaire apparaît le plus nettement, dans les monuments érigés le long de la route : arcs de triomphe, temples, portiques, colonnes, obélisques… En revanche, après l’éphémère règne de François II, les entrées de l’époque de Charles IX (1560-1565), organisées au cours des deux dernières années de la période étudiée par Richard Cooper, sont moins ouvertement marquées par le goût antiquaire que celles d’Henri II et relèvent finalement d’un rituel plus authentiquement français que romain.
L’Antiquité des romanciers & des poètes, entre réel & imaginaire
20Qu’en est-il de la littérature ? Les deux derniers chapitres du livre s’interrogent en dernier lieu sur l’impact que la passion des antiquités romaines a pu avoir sur la fiction et sur la poésie. Le premier d’entre eux, qui peut parfois décevoir tant la récolte paraît mince, s’ouvre paradoxalement sur les « détracteurs de l’Antiquité » au nombre desquels figure, de façon un peu curieuse, le prince des humanistes, Érasme. En effet, R. Cooper tient à rappeler que, si les écrivains dont il traite dans son ouvrage sont des admirateurs passionnés de l’Antiquité, il ne faudrait pas oublier que d’autres auteurs voyaient en cette admiration une marque de la recrudescence du paganisme. Érasme, il est vrai, dans l’Éloge de la folie et surtout dans le Ciceronianus (1528), se gausse des antiquaires et des collectionneurs, critique l’inspiration mythologique dans l’art et voit dans la passion pour les antiquités une forme d’idolâtrie qui confine au paganisme. Quoique cette présentation de la pensée érasmienne tienne peu compte du contexte bien particulier — et souvent hyperbolique — d’un pamphlet férocement teinté d’anti-italianisme, il est bien vrai que ces attaques, malgré la défense virulente de Jules-César Scaliger en faveur de la numismatique, de l’épigraphie et de l’archéologie, trouveront un écho favorable chez un certain nombre d’auteurs protestants, qui condamnent cette passion pour l’Antiquité, taxée d’immoralité et associée à la corruption de Rome, attitude qui, mêlée à un profond anti-italianisme, deviendra majoritaire vers la fin du siècle.
21Le premier écrivain traité est Jean Lemaire de Belges, qui avait eu l’occasion, lors de deux missions à Rome, en 1506 et 1508, de voir les ruines de l’Vrbs. Néanmoins, la moisson est particulièrement maigre : si celui-ci évoque bien deux temples lyonnais dans sa Concorde des deux langages ou dans son Temple d’Honneur et de Vertu et s’intéresse à l’histoire et aux découvertes archéologiques de sa région natale, dont il rend compte dans son traité Des anciennes pompes funeralles (1507), force est de constater que ses travaux d’antiquaires sont presque exclusivement fondés sur des sources littéraires. La réception française de la « fantaisie antiquaire » de Francesco Colonna, la fameuse Hypnerotomachia Poliphili, parue à Venise en 1499, offre davantage de résultats. Cette œuvre qui, malgré sa complexité, eut une influence immédiate et durable sur la littérature européenne, est traduite en 1546 par Jean Martin, qui en donne moins une traduction qu’une adaptation destinée au public français, accompagnée de nouvelles illustrations qui se conforment au goût français du temps en renforçant notamment la présence des ruines dans les gravures. R. Cooper souligne ainsi que le succès du Poliphile français n’est pas seulement lié à la mode des emblèmes, mais aussi à l’engouement pour les ruines. Si l’influence du Songe de Poliphile sur de nombreux auteurs était un fait bien connu et bien étudié, le livre met néanmoins l’accent sur son importance dans le développement du goût antiquaire en France, dans la diffusion du vocabulaire technique de l’architecture, ou encore dans l’association de la mélancolie des ruines à l’expression des douleurs de l’amour tragique. Il semblait par ailleurs plus que légitime de tenter de repérer les traces d’une profonde connaissance des antiquités et de la topographie romaines dans l’œuvre romanesque de cet antiquaire passionné que fut Rabelais. Une évolution est ainsi perceptible entre la parution de Pantagruel (1532), où l’on peut retrouver des références, généralement dans un contexte comique, à des monuments gallo-romains, à l’obélisque du Vatican ou à la statuaire antique, et celle de Pantagruel, qui suit son premier séjour à Rome dans le sillage de Jean Du Bellay (1534). Néanmoins, c’est à partir du second séjour à Rome (1535-1536) que se multiplient les références aux antiquités classiques dans son œuvre, simples allusions ou références plus précises. Enfin, Richard Cooper note encore une influence parallèle de Francesco Colonna sur Herberay des Essarts dans ses adaptations en français du cycle d’Amadis : à la différence de l’original espagnol de Montalvo, qui ne montrait que peu d’intérêt pour l’antique, celui-ci insère en effet des éléments antiquaires dans ses descriptions et évoque la fascination de son héros pour les ruines, conformément au goût français de l’époque.
22Le dernier chapitre du livre, consacré à la poésie et dont la figure centrale est naturellement Joachim Du Bellay, est particulièrement réussi et tout à fait convaincant. Il prend successivement le contre-pied de deux idées reçues, la première étant que Du Bellay est un phénomène isolé, le premier poète à composer des vers latins et français sur les antiquités romaines. Or si, comme on l’a vu, le contexte intellectuel, artistique et littéraire dans lequel il évoluait connaissait déjà un intérêt marqué pour les antiquités, il existait surtout avant lui et à son époque une poésie des ruines en France : sous le règne de François Ier, des poètes célèbrent Fontainebleau en la comparant à Rome, tandis que d’autres racontent en vers leurs voyages en Italie, que d’autres encore montrent une connaissance précise du vocabulaire technique de l’architecture ou tirent leur inspiration de monuments et de statues antiques comme all’antica. R. Cooper évoque également les Poemata de Jean du Bellay, dont il a donné en 2006 une belle édition critique en collaboration avec Geneviève Demerson, ainsi que l’œuvre de son ami L’Hospital. Outre les poèmes dans lesquels le cardinal utilise comme interlocuteurs certaines statues de sa villa, les vers de Michel de L’Hospital adressés à Du Bellay lorsqu’il repart à Rome en 1553 sont particulièrement intéressants : cherchant à le convaincre de rentrer en France, il fait parler ses statues de Saint-Maur en larmes, évoque la destruction qui menace son château, ou présente son destinataire comme vivant dans un monde de rêves, dans une ville en ruine. Un autre poème du chancelier, récit en vers latins d’un voyage fait à travers la France en 1559, mentionne aussi certains vestiges romains et fait contraster la grandeur passée des lieux qu’il visite avec leur état présent, exprimant l’émotion du poète face à la désolation des ruines.
23La seconde idée reçue contre laquelle R. Cooper prend position prétend que les poèmes romains de Du Bellay ne sont pas visuels et ne portent pas sur des vestiges réels, mais qu’il s’agit au contraire de ruines stéréotypées et symboliques, d’un décor qui relève davantage de l’imaginaire du Poliphile que de la topographie des antiquaires humanistes. En effet, malgré le séjour de leur auteur à Rome (1553-1557), les poèmes du cycle romain ne paraissent guère plus spécifiques que, par exemple, les odes de 1549 sur la chute des empires. On trouverait en vain des références précises à des monuments romains dans les Antiquitez de Rome, même si les Regrets offrent un peu plus de détails. En revanche, R. Cooper identifie pour la première fois avec succès des allusions à certains monuments romains dans les sonnets du Songe, en les confrontant aux illustrations de l’édition londonienne de 1568-1569 dues à Jan van der Noot. Il appert en tout cas que cette collection de visions en rêve de monuments antiques est bien plus ancrée dans la réalité archéologique qu’on pouvait le penser et que ses qualités visuelles ont au moins suffi à susciter des illustrations. Les vers latins de Du Bellay ont, quant à eux, un « parfum antique » plus marqué, notamment la Romae Descriptio, qui évoque de façon laudative les antiquités que les fouilles archéologiques mettent quotidiennement au jour. L’attitude du poète est donc des plus complexes : s’enthousiasmant dans certaines pièces pour une Roma rediuiua, pour la grandeur de l’ancienne Rome qui survit malgré la ruine, mais aussi pour la nouvelle, il présente un point de vue résolument contraire dans le même cycle romain lorsqu’il dépeint une ville morte, rongée et ruinée par la décadence morale. Bien que ce soit cette dernière image que l’on retienne le plus souvent des poèmes romains, en excluant les vers à la gloire de la Ville, les poèmes de Du Bellay offrent en réalité les deux visages que prend Rome dans la poésie française du temps, celle d’une cité vivante comme celle d’un lieu de corruption et de désolation. On retrouve d’ailleurs cette même ambiguïté chez les imitateurs de l’Angevin qui fleurissent dans le sillage des Regrets, comme dans les sonnets du protestant Jacques Grévin (1568), composés à l’occasion d’un voyage à Rome, ou dans les mélancoliques méditations sur les ruines des antiques Augustodunum et Burdigala composées par François Perrin à Autun et Maurice de Marcis à Bordeaux.
***
24Au terme de ce parcours érudit et solidement argumenté, le lecteur ne peut que rendre grâce à l’auteur d’avoir réussi le pari non seulement d’étudier la naissance et le développement de ce « goût antiquaire » dans la France du xvie siècle, mais aussi d’ouvrir la voie à d’autres recherches que son livre ne manquera pas de susciter. Rédigé avec soin et d’une lecture agréable, Roman Antiquities in Renaissance France est, en outre, d’une pédagogie exemplaire : organisé en neuf chapitres d’une quarantaine de pages chacun, il fait alterner des vues perspectives et de très précises études de cas, qui se fondent sur le dépouillement de nombreuses sources, imprimées comme manuscrites, répertoriées dans l’abondante bibliographie qui complète le livre (p. 383‑425) en compagnie d’un utile index nominum (p. 427‑435). Bien évidemment, un sujet d’une telle ampleur laisse nécessairement dans l’ombre un certain nombre d’aspects, comme par exemple le rôle qu’a pu jouer le duché de Milan dans la naissance de ce goût pour les antiquités9, ou la mode des Hieroglyphica et des livres d’emblèmes. Mais Richard Cooper rappelle lui-même que la question de l’intérêt de la Renaissance française pour les antiquités classiques outrepasse largement l’objectif premier de son livre, qui se concentre sur la cour et ses agents en Italie ainsi que sur les échos littéraires et artistiques de cette mode. Il pointe également deux aspects volontairement négligés dans son livre : la naissance de l’archéologie française et le développement de l’érudition antiquaire en France à la même période, qui seront l’objet d’un second livre, rédigé en français, dont la publication prochaine est annoncée. Gageons que ces deux ouvrages destinés à se compléter l’un l’autre constitueront bientôt un ensemble de référence sur la réception de l’Antiquité dans la France du xvie siècle.

