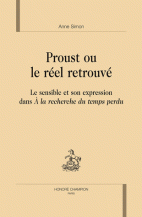
La Recherche en mouvement
Proust & la philosophie : encore ?
1Aussi connues qu’elles puissent paraître, les analyses de Paul Ricœur et de Vincent Descombes consacrées à Proust, respectivement dans Temps et Récit II (1984) et Proust. Philosophie du roman (1987), ont‑elles été suffisamment prises en compte par les lecteurs et commentateurs ? On peut en douter, si l’on observe la production critique de ces dernières années, en langue française, anglaise, allemande et italienne, en particulier, sans même parler des nombreux articles de presse anglo‑américains, intéressants en ce qu’ils reflètent la vulgate critique. Beaucoup de commentateurs de l’œuvre proustienne ne tirent pas les conclusions des mises en garde de Ricœur, par exemple sur « les débris [de la] spéculation philosophique » que contient la Recherche, ou sur la fictionalité de ce texte— entre autres analyses contenues dans ces fameuses pages. La fictionalité oblige en effet à distinguer les positions du je proustien de celles de l’auteur (Proust), comme le signale V. Descombes avec malice, lorsqu’il invente la figure d’un « pseudo‑Marcel », « philosophe inconnu » auteur d’une pensée que la Recherche ne contient pas directement, mais que des lecteurs et certains critiques tentent de recomposer, avec plus ou moins de bonheur.
2La réédition du livre d’Anne Simon, dans une version mise à jour, apparaît donc comme l’occasion de remettre à l’honneur une discussion centrale dans la critique et la réception proustiennes : celle de la relation de Proust à la pensée, et en particulier à la philosophie. On commencera par rappeler les propositions principales de l’ouvrage, paru pour la première fois en 20001, dont la discussion de « l’idéalisme » proustien et des thèses de Deleuze2, avant de revenir sur certaines des questions soulevées par cet ouvrage traitant des relations entre littérature et philosophie.
3Pourquoi choisir le rapport à la réalité — « effectivité ou actualité brute » (p. 9) dans la langue usuelle — pour lire À la Recherche du temps perdu ? A. Simon l’explique d’emblée, rappelant la distinction entre réalité et imagination ou souvenir, d’une part, réalité et possible, d’autre part ; mais elle choisit d’utiliser comme synonyme le réel, considéré comme « le rapport entre un sujet et un monde qui s’influencent mutuellement » (p. 218). C’est de la déception du héros proustien que part cet ouvrage, et de la conception du réel qu’elle suppose. Le héros, on s’en souvient, est en effet déçu par la réalité, de manière répétée : dans les salons mondains, face à une jeune fille auparavant fantasmée, ou une fois arrivé dans une contrée longtemps imaginée. Déçu, il l’est d’autant plus cruellement que la réalité apparaît dans ces circonstances sous un jour négatif (sauf lors des révélations épiphaniques) : le héros de la Recherche apparaît alors pris entre « l’imaginaire, en proie à un défaut d’être, et le réel, en proie à un défaut de profondeur » (p. 10). Conclure que « le réel est décevant, irrespirable […][,] le monde mental est falsification et appauvrissement du réel » (selon les termes de G. Picon, cités p. 118) entraine, comme corollaire, un jugement négatif sur l’art, en raison de la conception qu’en possède le protagoniste, dans les parties initiales du roman. L’art et la vie sont ainsi liés dès les premiers moments de la diégèse, contrairement à une conception répandue selon laquelle les deux s’opposent dans la Recherche du temps perdu jusqu’aux révélations du Temps retrouvé.
4« [S]auver la vie, c’est sauver l’art, et vice‑versa » (p. 10), pour A. Simon, qui invite à mettre en relation le sujet et le monde de la Recherche à travers le réel conçu comme un « réseau » (p. 223) ou un « sillon » (on reviendra sur ce dernier terme). Se trouve remise en cause, par conséquent, la définition du fait, qui intègre désormais son (apparent) opposé, l’illusion, l’imaginaire, le possible, le symbolique ; A. Simon propose de penser la réalité comme ce « lien même, mouvant et soumis à révision » entre le sujet et l’objet, lui‑même mobile, pris dans le mouvement et dans le temps, sans être superficiel pour autant, puisqu’il est doté d’une « profondeur ontologique » (p. 12). Ce dernier terme est pensé, dans la troisième partie, comme
une direction ou un niveau par lequel le sensible s’entrouvre sur des horizons d’invisibilité qui soit la condition même de sa manifestation (p. 143).
5C’est en relation avec cette resémantisation du réel que se comprend le recours à la notion de sensible — qui constitue le sous‑titre de l’ouvrage. A. Simon souligne la différence qui sépare sa lecture des interprétations idéalistes qui dévalorisent le sensible au profit de l’esprit, puisqu’elle le définit comme « dynamisme et fluctuation, comme dimension ou niveau (et non comme étant) » (p. 14), en rappelant l’importance du caractère temporaire de la « rencontre » entre le je et le réel — à la suite de Merleau‑Ponty, qui évoque « la première vision, le premier contact, le premier plaisir », dans Le Visible et l’Invisible (1964). Le terme même de sensible permet de renvoyer à cette rencontre, en ce qu’il est propre, par sa polysémie (on peut être sensible au sensible), « à suggérer le mouvement de réversibilité entre le monde et le moi ». Le lien avec la temporalité devient alors explicite : l’occasion de rappeler que la révélation du Temps retrouvé est un accès non au hors temps, mais à toutes les dimensions de la temporalité. L’introduction passe ainsi en revue les aspects les plus cruciaux (et difficiles) du roman proustien : outre le temps (ou plutôt : la temporalisation), elle évoque le réel, le souvenir, le sujet… en proposant des alternatives aux idées les plus courantes attachées à l’œuvre de Proust. A. Simon s’intéresse ainsi à la double valeur de l’adjectif retrouvé, qui désigne non seulement une manière de renouer avec le passé, mais aussi une façon d’accéder à la réalité du temps présent dans tous ses possibles, de le dévoiler, « de mettre au jour cela qui a été mais que nous ignorions avoir été », ce qui « n’a pas encore été vécu comme [réel] […] et qui pourtant a été puisqu’on peut s’en souvenir » (p. 50) — première analyse de la conciliation des contraires dans la Recherche.
6Proust ou le réel retrouvé apparaît en effet construit comme un roman policier dont on connaitrait le dénouement dès l’introduction (lorsque les thèses principales sont posées), mais dont le lecteur suivrait néanmoins la démonstration pour découvrir d’autres lectures d’éléments parfois très connus — passages de la Recherche ou citations. Il y a une forme de récit dans cet ouvrage, qui commence, dans sa première partie (« De l’essence à la réalité »), avec les erreurs successives du héros, erreurs dont Proust expliquait dans une lettre de 1914 à Jacques Rivière, on s’en souvient, qu’il devait commencer par les peindre.
7Le héros proustien, tout au long du roman, cherche en vain à atteindre l’essence des choses (des clochers, des aubépines ou d’un lieu, qui tous suscitent du plaisir) en les observant, comme médusé ou en tentant de les saisir par ses autres sens (odorat, ouïe), en les extrayant de leur contexte : « Ils avaient l’air de cacher au‑delà de ce que je voyais, quelque chose qu’ils invitaient à venir prendre » (p. 28 ; t. I, p. 176). Les échecs répétés induisent chez le héros la conviction que la perception est défaillante et le sensible décevant, contrairement à l’art. Faut‑il y voir, comme un certain nombre de commentateurs — A. Simon évoque l’ouvrage de Henri Bonnet3 pour rappeler la généalogie de cette idée —, une opposition entre l’apparence et l’être, voire une formulation d’une théorie partagée par Proust, qui le rapprocherait de l’idéalisme ? Ce serait, selon elle, considérer la peinture des erreurs d’une manière très univoque et dualiste ; et croire sur parole les conclusions du héros (dont l’attitude ambivalente serait alors négligée) en considérant que son erreur se résume à vouloir saisir l’essence.
8Rappelant le contexte littéraire et philosophique de la formation du jeune Proust, A. Simon discute en particulier l’influence que Darlu a pu avoir sur lui, et en vient à réfuter les lectures univoques de type idéaliste, dans le sillage de V. Descombes, qui a mis au jour le flottement de la position du héros. Elle montre l’ambivalence du texte, le balancement entre valorisation de l’esprit et primat de la sensation (p. 38), et rejette l’idée que le monde ne serait que représentation ; si le héros ne parvient pas à atteindre l’essence (ou ce qu’il considère comme tel), il ne faut pas en conclure à une dévalorisation de la sensation, qui n’est, en aucun cas, simplement un « premier stade, imparfait, d’accès à la connaissance ». Le texte proustien montre au contraire le lien entre sujet et objet, avec lequel s’accorde le style de Proust, son « écriture de la relation » qui vise à « l’approfondissement » de la perception, où l’esprit a déjà sa part (p. 43) — se trouve ici formulé, avec des variantes, l’un des fils directeurs de cet ouvrage.
9Le même souci des nuances caractérise les analyses sur l’essence et la temporalité (en l’occurrence la dialectique entre hors‑temps et inscription dans le temps), lorsque l’auteur signale — à la suite d’Anne Henry — la resémantisation des deux termes, ce qui n’empêche pas la présence ponctuelle de traces de l’héritage philosophique (vitaliste, mais aussi substantialiste) auquel on ne saurait pourtant réduire la position de « Proust ». A. Simon propose ainsi, après Jauss, une interprétation de la fin du Temps retrouvé à distance d’une lecture trop littérale opposant hors‑temps et inscription dans la temporalité ; elle dégage ainsi les vestiges du symbolisme, d’un idéalisme néo‑platonicien, qui entrent en tension avec la conception nouvelle de l’essence (p. 51 sqq.). Ce n’est toutefois ici qu’un exemple du dépassement d’oppositions encore trop courantes : faut‑il voir dans le fait que le texte suggère qu’une chose peut contenir une âme (on songe ici à la « croyance celtique » évoquée dans Swann) une trace de l’influence schopenhauerienne dans la Recherche, ou cela rapproche‑t‑il le roman de la poésie du xxe siècle (p. 47) ? À leur manière, ces analyses illustrent la place de pivot de la Recherche, prise « entre deux siècles ».
10Envisager les incidences sur la conception du moi (p. 50) ou sur les relations entre intelligence et sensibilité (p. 57‑58) amène à discuter frontalement la lecture proposée par Proust et les signes4. Le chapitre II note l’ambivalence de l’ouvrage de Deleuze, qui associe des conceptions transcendante et immanente du sens, alors que le cheminement du héros le conduit vers l’immanence, si l’on suit les analyses d’A. Simon, qui remet d’ailleurs en question la centralité du parcours herméneutique du héros. Elle souligne les conséquences de l’amalgame entre héros et narrateur sur la détermination de la position de Proust, ainsi que la manière dont Deleuze minimise l’importance de la matérialité au profit de l’essence (alors que pour elle, « l’objet n’est […] pas à “oublier” : il est le lieu même de l’émergence de la signification », p. 91) dans son analyse du signe. Ce point est important puisque, à la suite des analyses d’A. Henry relatives au corps de la Berma (bien que, sur le fond, le propos d’A. Simon diffère grandement des thèses d’A. Henry), l’auteur montre que les réflexions sur l’interprétation théâtrale valent pour les relations entre sens et sensible (p. 66), signifié et signifiant : elles posent donc la question de la possibilité d’une herméneutique (p. 73) et de la verbalisation. On pourrait conclure que pour A. Simon, le Deleuze lecteur de Proust est moins hardi que le Deleuze philosophe, en ce que sa lecture de la Recherche paraît en retrait de conceptions philosophiques exposées dans d’autres ouvrages.
11Dans une deuxième partie dont le titre aux allures mathématiques (« existence + imagination = réalité ») pastiche une note de Proust lui‑même, l’auteur développe les remarques esquissées précédemment sur le rôle de l’illusion et des croyances, s’insurgeant contre une lecture simplificatrice considérant la Recherche comme « un itinéraire qui mènerait le héros des illusions de l’enfance aux vérités de l’âge mur » (p. 100), où les illusions seraient dissipées — cette analyse constitue l’équivalent de la lecture idéaliste qui conçoit le signe matériel comme inférieur à une essence transcendante. Dans ces chapitres où l’accent est mis sur le corps, « le sentir » (un processus, une expérience, distincts de la sensation) lié au rêve, à l’imagination, à l’intelligence (p. 95), la rencontre avec Elstir est présentée comme l’étape fondamentale modifiant la conception que le héros proustien possède de la réalité (même s’il a déjà l’intuition de ce qu’Elstir lui enseigne), réorientant ses tentatives de perception du monde, en réhabilitant l’illusion, considérée par A. Simon, à la suite de Merleau‑Ponty, non comme « une erreur à dépasser mais comme un moment privilégié de notre lien à l’être brut » (p. 100). A. Simon en relève de nombreuses occurrences au fil de la Recherche, et note l’expression du plaisir sensoriel qui leur est attaché, ainsi que la manière dont elles sont valorisées. Toutes les analyses sont ramenées au fil directeur posé en introduction : « l’immatériel (qui ne se confond pas avec le non‑être) appartient de fait à notre perception du réel » (p. 108). On devine les conséquences sur la conception de la création artistique et du langage : apprendre à percevoir (en incluant ces illusions) et à utiliser le langage autrement vont de pair, en dépassant des oppositions instituées par la raison. Il convient donc de se méfier des lectures simplificatrices, qui rejettent totalement les illusions et les croyances, ou qui ne saisissent pas l’importance des moments de veille et de repos sur le chemin de la vocation, en raison de leur lien avec la « joie sensorielle “banale” » (p. 140).
12La dernière partie se concentre alors sur l’écriture proustienne, en examinant sa « profondeur » — définie, on l’a vu, comme « une direction ou un niveau par lequel le sensible s’entrouvre sur des horizons d’invisibilité qui soit la condition même de sa manifestation » (p. 143) — et l’importance du lien entre « [l’] appréhension […] du monde et l’expression qui la supporte ou l’engendre » (p. 143). La « surimpression stylistique » répond dans sa matérialité (sa dimension « charnelle ») à l’enchevêtrement, à la « stratification » du réel, où l’être ne s’oppose plus à l’apparaître (p. 145), selon A. Simon, qui interroge les modalités par lesquelles l’écriture peut approcher l’in‑sensible — par l’ineffable, afin de suggérer le silence. L’analyse des courbes, rayons, tracés… qui se réfère à plusieurs reprises à Jean‑Pierre Richard, met en valeur la synesthésie à l’œuvre dans la phrase proustienne, qui peut associer image et son. Les couleurs, elles, sont présentées comme manifestation de la profondeur, à travers des analyses de textes (sur la mer à Balbec, sur l’ogive vénitienne) qui entendent dépasser le dualisme entre surface et profondeur (p. 184), pour révéler l’esthétique de la surimpression mise en œuvre dans la Recherche — et dont les réminiscences constituent l’illustration la plus exemplaire. À l’arrière‑plan se profile toujours la relation entre philosophie et roman, lorsque l’auteur montre comment les perceptions du héros dans son lit dépassent les catégories héritées de la philosophie, telle la représentation du temps (p. 139) ; de même que l’importance accordée au sensible, dans la Recherche, apparaît comme une réhabilitation et une subversion des représentations liées à la philosophie (où l’apparaître est disqualifié comme apparence ; p. 145).
13On pourrait presque inviter le lecteur inquiet (la théorie et la philosophie n’ont pas toujours bonne presse, en littérature) à commencer par la conclusion, qui propose un parcours récapitulatif, de la critique de l’idéalisme à des considérations stylistiques sur l’écriture proustienne qui, par « surimpression », exprime la sensation (p. 215), tout en mettant en garde contre la constitution d’un nouveau dualisme, qui pourrait naître de la distinction entre sensation et écriture :
la réalité vécue [est] toujours, déjà, tramée de croyances ou de rêves linguistiques (p. 219, voir aussi p. 186),
14comme le note A. Simon à propos du célèbre incipit de la Recherche. La conception du réel (dans le roman proustien comme chez ses commentateurs) a partie liée avec la conception de l’écriture : pour l’auteur, cette dernière est
une « recherche », une enquête qui tente de coller à la labilité de son objet et de le constituer dans le mouvement même de sa poursuite (p. 221),
15mouvement sans fin qui possède une valeur performative, puisque l’écriture est « une expérience du monde qui se découvre et se produit à mesure qu’elle se formule » (ibid.), ce qui empêche d’en rester à une opposition entre art et vie, souvent attribué (à tort) à Proust.
16De la conclusion — qui propose une ouverture vers les questions de la nature, de Dieu, de la liberté, de la conception de l’histoire ; et une esquisse des raisons expliquant les éclipses en 1930‑1940 puis la nouvelle faveur du texte proustien depuis les années 1960, au prix de malentendus — on retiendra surtout l’insistance sur la nature progressive de la réalité, processus, « tissage entre le présent et le sentiment, le fantasme ou le passé » (p. 219), « dynamique » (p. 220), et sur l’importance de la suggestion dans le style proustien, apte à faire ressentir « l’arrière‑plan de silence » (p. 224 et t. III, p. 757).
Philosophie & microlecture
17L’une des grandes réussites de l’ouvrage d’A. Simon, et l’une des clés de sa force démonstrative, consiste sans doute en l’équilibre entre, d’une part, le commentaire précis de passages tels que la promenade du Bois de Boulogne ou l’arrêt du train (p. 118 sqq.), les scènes où apparaît la Berma (p. 83 sqq.) ; d’autre part, les analyses plus abstraites, en dialogue avec Deleuze et, surtout, Merleau‑Ponty.
18Les commentaires invitent à replacer dans leur contexte des phrases extraites de la Recherche, auxquelles des générations de critiques ont pu faire dire tout et son contraire (p. 55) ; ce qui permet à A. Simon de répondre pied à pied à des objections possibles, en évoquant des formules aussi célèbres que la « leçon d’idéalisme » ou « l’équivalent spirituel » (t. IV, p. 457), pour démontrer la resémantisation des termes : la prise de risque est maximale, la démonstration semble inattaquable. Toutefois, comme on l’a signalé à propos de la fin du Temps retrouvé, un commentaire précis ne signifie pas une adhésion à la lettre du texte — puisqu’il faut remettre en contexte, ce qu’A. Simon ne rappelle pas ici, être prudent avec la « lettre » d’un roman marqué par la mouvance textuelle, en particulier pour les volumes parus après la mort de Proust, en 1922. Ces microlectures sont pour A. Simon l’occasion de manifester ce qu’elle doit aux commentaires antérieurs, d’autant qu’elle n’hésite pas à citer des textes critiques moins connus ou délaissés, tels ceux de Ghislaine Florival5, de Gaëtan Picon6, de Jean Petitot, de Ramon Fernandez, ou tel article de Jauss. Elle s’appuie en particulier sur V. Descombes, pour les réflexions relatives au solipsisme et à l’idéalisme ; sur J.‑P. Richard pour les analyses textuelles ; mais aussi sur l’important livre d’Alain de Lattre7 à propos de la dichotomie entre intériorité et extériorité, de l’impossibilité de réduire le réel à une forme d’idéation (p. 41), ou de l’effet de la raison (qui divise en « répartitions », p. 106), et de l’importance des croyances (p. 115), ou encore de la différence entre le Combray passé et le Combray ressuscité par la réminiscence (p. 86), un Combray « avec tous ses horizons déployés ».
19En contrepoint, plus que la place de la philosophie comme motif romanesque, ce qui intéresse A. Simon ici (comme dans des interventions ultérieures8) est la manière dont Proust, contemporain des publications de Husserl, annonce tout un pan de la philosophie du xxe siècle : par exemple sur l’essence, telle que Proust la redéfinit (p. 46). Cette « impatience de la connaissance » (Broch) qui fait de la littérature une éclaireuse de la philosophie — A. Simon le rappelle à propos de la filiation entre le xixe siècle en littérature et le xxe siècle en philosophie —, est toutefois susceptible de susciter des erreurs : il convient de ne pas céder à l’illusion téléologique, et de ne pas chercher à tout éclairer par une référence unique.
20Ces précautions prises — contrairement à d’autres études qui laissent ces problèmes dans l’implicite ou plaquent sur la Recherche une conception « philosophique » — il apparaît possible de convoquer Merleau‑Ponty, légitime en raison des rapports de fait existant entre son œuvre et celle de Proust : le philosophe est un lecteur assidu de la Recherche, comme en témoignent les exemples retenus dans Phénoménologie de la perception en 1945, avant Le visible et l’invisible, paru en 1964. Plus importantes encore, des ressemblances profondes entre le roman proustien et l’essai philosophique sont mises au jour par A. Simon, à chaque étape de sa démonstration9. Lire Proust avec Merleau‑Ponty, c’est bien sûr lire Merleau‑Ponty à la lumière de la Recherche, faire ressortir le côté Proust du philosophe, mais A. Simon ne se perd pas dans les échos vertigineux entre les textes : les formules de Merleau‑Ponty retenues lui permettent de condenser, d’expliciter, d’approfondir ses remarques sur le roman proustien. Toutefois, les pages consacrées à la Berma (voir p. 62‑63) le montrent d’une manière exemplaire : si Merleau‑Ponty est à la fois clé de lecture (point de départ) et point d’arrivée du propos critique, entre les deux, c’est au plus près du texte de la Recherche qu’A. Simon propose sa propre lecture. Elle met ainsi en perspective des vestiges théoriques (de l’idéalisme, du nominalisme) qui ne possèdent pas la même importance que la position majoritairement assumée dans la Recherche.
« Ce livre est trop court » (J. R. R. Tolkien)
21On pourrait certes discuter certaines catégories, littéraires ou philosophiques, ou des démonstrations rapides, qui appelleraient des prolongements10.
22Dans le premier cas, le sens implicite donné par A. Simon (voir p. 86) à l’expression « étude philosophique », que l’on trouve chez Proust dans le « Carnet de 1908 »(« Faut‑il en faire un roman, une étude philosophique, suis‑je un romancier11 ?»), mérite discussion, et explicitation : on peut estimer qu’il doit plutôt être compris en un sens balzacien — l’alternative ne porte pas ici sur le choix entre littérature et philosophie, mais entre des genres romanesques. De manière secondaire, l’introduction présente également la Recherche, en passant, comme l’imitation d’une autobiographie, puis comme une « autobiographie fictive » au « caractère proprement romanesque » (p. 23) : ce télescopage entre fiction et non fiction mériterait d’être déployé.
23Tout comme pourrait être réévalué le choix consistant à utiliser comme synonymes réel et réalité sur la foi de Proust, qui les emploie indifféremment : on sait que chez lui, pourtant, une métaphore n’en est pas forcément une, une loi non plus… et que, plus largement, il est risqué de reprendre à son compte l’usage proustien de certains vocables (voir p. 1412). On songe ici au sillon, présenté comme une définition métaphorique du réel, alors que le terme, dans le Temps Retrouvé se rapporte plutôt à l’effet produit :
le petit sillon que la vue d’une aubépine ou d’une église a creusé en nous, nous trouvons trop difficile de tâcher de l’apercevoir (t. IV, p. 47013).
24On connait également, dans cette page, l’image de « l’impression […] double, à demi engainée dans l’objet, prolongée en nous‑même ».
25La même question relative aux duos lexicaux pourrait être adressée à propos des termes « profondeur » et « épaisseur » (dont Jean Milly a noté la fréquence sous la plume de Proust), souvent utilisés indifféremment (voir p. 163), mais aussi accolés (et non confondus) à l’occasion, (p. 174). Enfin, on peut se demander s’il est pertinent pour A. Simon de recourir à des termes (êtres, essences), dans son analyse positive de l’écriture proustienne, termes dont elle a précédemment montré l’inadéquation, ou la nécessaire et permanente resémantisation (voir la remarque sur l’être, par exemple, qui oblige à des rappels syntaxiquement acrobatiques, p. 188) — pourquoi ne pas avoir proposé, ici, une alternative au lexique obsolète ?
26À l’inverse, certaines formules demanderaient sans doute à être dépliées, expliquées, comme le fait de ranger sous la bannière de l’insensible (l’in‑sensible ou « “l’insensoriel” »), dans le même geste, « silence, obscurité, mais aussi sentiments et idées » (p. 147) ; ou telle manière de considérer « le fantasme [… comme] créateur d’existence » (p. 12). Odette fantasmée en Zéphora ne devient pourtant pas Zéphora, et ce sont ses actes (« réels » au sein de la fiction) qui causent la souffrance de Swann : Odette‑Zéphora reste imaginaire, et si A. Simon montre bien que l’imaginaire appartient désormais au réel, estimer ici qu’il se confond avec lui, n’est‑ce pas considérer que le tout (le réel) est aussi une partie qui forme le pendant de l’imaginaire ? La discussion pourrait être poursuivie à propos de l’épisode des Jeunes Filles, l’un des plus poignants de la Recherche, où le héros allègue une raison fallacieuse pour ne plus voir Gilberte, « un mystérieux malentendu, parfaitement fictif » (t. I, p. 621), afin de provoquer chez elle une réaction. C’est l’absence de question de la part de son amie qui entraîne leur éloignement : « ce malentendu […] devint pour moi quelque chose de réel auquel je me référais dans chaque lettre » (t. I, p. 622), note le narrateur ; mais ne peut‑on estimer qu’il y a ici remplacement d’un malentendu fictif par un autre malentendu, né de l’attitude effective de Gilberte, sans pour autant que le premier devienne « réel » autrement que pour le héros ? Le texte proustien procède souvent par contraction et ellipse de ce genre.
27À l’arrière‑plan de ces questions, on retrouve celle des relations entre réel et fiction : interroger le monde proustien, est‑ce réfléchir au monde du lecteur ? Question banale, mais aux implications importantes, pour l’objet de ce livre : si l’écriture proustienne construit le réel, s’agit‑il du « réel fictionnel », interne à l’œuvre, ou bien la phrase proustienne crée‑t‑elle littéralement un fragment de réalité, pour A. Simon ? Le fait que le lecteur reconnaisse dans la Recherche un élément commun avec sa propre réalité suffit‑il pour que cet élément devienne réel ? Les analyses d’A. Simon dépassent parfois le cas de la Recherche — comme semble l’indiquer la phrase placée en exergue de l’introduction :
Si la réalité était cette espèce de déchet de l’expérience […]. Mais était‑ce bien cela, la réalité ? (p. 9).
28Ces interrogations montrent que l’ouvrage d’A. Simon appelle un prolongement, de la part du même auteur, qui pourrait aussi expliciter les rapprochements ponctuels proposés avec Baudelaire, Claudel, Valéry… et, plus rarement, avec un auteur étranger : ainsi, pourquoi Rilke plutôt que Joyce (pour la surimpression) ou Musil (sur les possibles) ?
29On peut déjà espérer que la réédition de cet ouvrage contribuera à le faire découvrir d’un plus grand nombre de lecteurs, même si sa complexité le rend sans doute moins lisible que d’autres textes en apparence plus faciles et séduisants. L’idée est de faire avancer la recherche proustienne, en faisant justice de lectures réductrices et d’oppositions superficielles, de clichés (le supposé rejet de l’intelligence par « Proust »), d’assimilations hâtives — entre le héros et Proust via « Marcel », ou son corollaire, la confusion entre la Recherche et une autobiographie — … au moins dans le Temps.
30S’il paraissait inutile de revenir ici en détail sur les remarques stylistiques proposées par Anne Simon dans la troisième partie de son essai, on saluera toutefois le style de l’ouvrage lui‑même et les formules suggestives qu’il propose, à l’instar de celles sur l’importance du corps, « berceau d’une réalité temporalisée, creusée de songes et de sentiments » (p. 215), formules appelées à d’autres développements14. Dans l’un des rares moments de réflexivité explicite, A. Simon s’interroge sur le caractère « énigmatique » des annonces proposées dans les premières pages de la troisième partie, se demandant « comment parler de la réalité autrement que métaphoriquement » (p. 145). Cette interrogation apparaît en fait comme une manière d’exorcisme, rien dans l’ouvrage ne demeurant obscur par la faute de l’auteur, qui ne fait pas l’erreur de calquer son style sur celui de Proust, par fascination ou imitation inconsciente — alors que nombre d’ouvrages sur la poésie ou l’essai se veulent « poétiques » ou « essayistiques », par un mimétisme impensé15. L’écriture d’A. Simon concilie au contraire précision et recherche d’images suggestives, pour « approche[r] la qualité particulière de la chose » (peut‑on dire en appliquant à son écriture une de ses remarques sur la Recherche). À cet égard, la clausule de la deuxième partie restera dans la mémoire du lecteur, par son évocation de la fin du Temps retrouvé :
Dernier instant qui est retour aux origines temporelles et charnelles du personnage et qui trace la courbe parfaite et enfin comprise d’une vie qui possédait d’emblée, sans le savoir, ce qu’elle cherchait : son insertion dans le monde, rendue enfin sensible par la joie d’un dernier rayon de lumière avant la nuit totale. (p. 140)
31

