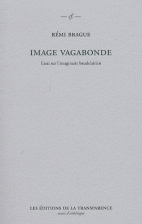
Baudelaire & le culte des images
1Le parcours que propose Rémi Brague dans cet essai déroute le lecteur à plus d’un titre. Par son sujet tout d’abord. Spécialiste des philosophies juives et arabes, R. Brague a, par ailleurs, abondamment travaillé sur la philosophie grecque et l’histoire du christianisme européen. Toutefois, ce n’est pas en philosophe qu’il se dit aborder ici la poésie baudelairienne. Au contraire d’un Vincent Descombes appliquant sa philosophie à Proust et lisant le romancier au regard des catégories qu’il propose1, R. Brague propose plutôt une déambulation au cœur de l’œuvre de Baudelaire. Ce parcours étonne, également, par son étendue : le philosophe connaît bien le corpus baudelairien, depuis ses écrits poétiques — bien entendu — à ses écrits esthétiques, ou à sa prose intime. Le plus surprenant reste sans doute les lectures fraîches de simplicité et de raffinement qu’il suggère pour un certain nombre de poèmes des Fleurs du Mal, pour le moins canoniques2.
2Sa réflexion s’initie à partir d’une note de Mon cœur mis à nu enjoignant le poète à « glorifier le culte des images » puis « le vagabondage, ce que l’on appelle le bohémianisme, culte de la sensation multipliée »3. Cette lecture propose ainsi fort habilement de voir dans l’œuvre de Baudelaire une passion, non pas tant pour les images, mais plutôt pour leur culte ; déplaçant légèrement le focal, il réoriente dès lors notre lecture. R. Brague cherche ainsi à montrer que les notions favorites du poète forment un tout ordonné, sinon un système. L’auteur engage, pour cela, une réflexion qui le conduit dans les arcanes de la création poétique, et décompose ainsi implicitement ce qui pourrait se lire, non pas comme un art poétique, mais comme un art du « devenir poète ». De ce fait, et par ce parcours, R. Brague s’aventure dans une exploration du recueil qui semble avoir été initiée par Baudelaire lui-même (lorsqu’il parle pour son livre de « vie mystérieuse des œuvres de l’esprit4 » ou « d’un commencement et [d’]une fin5 »), puis relayée par Barbey d’Aurevilly qui évoquait « l’architecture secrète » de l’ouvrage de son ami6. La bibliographie baudelairienne est riche de nombreuses spéculations à cet égard. Si la classification adoptée par Crépet et Blin7 se dégage de manière consensuelle, elle ne fait pas pour autant l’unanimité. On pourra donc lire dans cet essai de R. Brague une nouvelle lecture des Fleurs du Mal, une nouvelle proposition herméneutique. En osant relever ce défi, R. Brague se mue en ce « semblable » lucide et complice que le poète appelle de ses vœux.
Le vagabondage : de l’imagination à la décomposition
3R. Brague propose une rapide déambulation au cœur des Fleurs du Mal à partir de l’étude successive de quatre poèmes. Ce cheminement inédit dans la poésie baudelairienne nous projette vers de nouveaux horizons de manière simple et convaincante. Disons-le clairement, R. Brague ne s’intéresse pas tant à l’art poétique baudelairien qu’à la posture du poète ; il scrute minutieusement les attitudes de celui-ci pour en percer les secrets et semble l’observer très simplement au fil des poèmes. Sa démarche séduit par sa simplicité et son efficacité.
4Il constate tout d’abord, par l’étude de « Bohémiens en voyage », que le bohémianisme donne accès à « une atmosphère vague », laquelle rend possible le vagabondage. Si le voyage se révèle bien être — et ce n’est pas une surprise — un exutoire pour le poète et une condition pour la création poétique, il n’est qu’une étape, parce qu’après le vagabondage vient l’élévation. Elle en est un prolongement. Le voyage ne se présente pas comme une ascension vers un sommet, mais bien plus comme un survol, un mouvement planant. La quête poétique baudelairienne ne convergerait donc pas vers un foyer lumineux, qui permettrait d’élucider les mystères, ni même vers une unité ou un principe d’unité qui semble, d’ailleurs, totalement ignoré. Le sonnet « Correspondances » décrit, à ce titre, un mouvement sensiblement parallèle à celui constaté dans « Élévation » : si leurs premières parties respectives pourraient esquisser un même mouvement ascensionnel et vertical, ces deux poèmes décrivent en réalité une translation horizontale, qui débouche sur une unité, résultant et résultat d’une certaine confusion. Comme le constate efficacement R. Brague : « les correspondances supposent donc le vagabondage » (p. 38). Celui-ci se présente ainsi comme une condition nécessaire, mais non suffisante de la création poétique.
5En réalité, seule l’imagination permet d’accéder aux correspondances, dans la mesure où elle dispose d’un pouvoir de décomposition : le poète ne parviendra à saisir les effervescentes correspondances qu’à condition de rompre l’unité apparente et fallacieuse du réel, et de la décomposer. Il propose à cet effet de lire « Une charogne » comme un art poétique, dans lequel la charogne représenterait « l’allégorie de la nature et du traitement que lui fait subir l’imagination du poète » (p. 47). Le soleil brûle la charogne, et la décompose : c’est au poète et à la poésie d’engager alors le travail de recomposition. Ce n’est d’ailleurs pas anodin si le poème se termine par le quatrain suivant :
Alors, ô ma beauté ! dites à la vermine
Qui vous mangera de baisers,
Que j’ai gardé la forme et l’essence divine
De mes amours décomposés !
6Le poète reste le seul dépositaire de « la forme et de l’essence divine » de cette nature décomposée. « La charogne est donc la condition par laquelle doit passer tout ce que l’art transforme » (p. 50). À la lecture de ce poème, R. Brague pose un premier jalon : la décomposition est un premier état auquel doivent parvenir les choses au contact du poète. Celle-ci appelle — néanmoins — son pendant et son symétrique : la recomposition. Le travail poétique consiste dès lors à restructurer cette nature défaite et « à mettre des idées et des images sur le papier » (p. 61).
Le travail poétique ou l’art du flâneur
7Le monde sous le mode de l’imagination doit apparaître sous un jour nouveau : « Tout l’univers n’est qu’un magasin d’images et de signes auxquels l’imagination donnera une place et une valeur relative »8. La poésie est d’ailleurs définie, dans Puisque réalisme il y a, comme un « dictionnaire hiéroglyphique »9. Baudelaire ne s’en tient donc pas à une simple lecture néo-platonicienne — indéniablement présente, pourtant, dans sa poésie —, et propose d’associer la poésie à un dictionnaire, rompant ainsi avec une tradition poétique séculaire : le poète n’est plus celui qui rend compte de l’ordre profond du monde et qui en dégage toute l’harmonie10. La présentation du monde en dictionnaire et non en livre prend ses distances avec une vision du theatrum mundi pour décrire le monde comme un livre qui n’est pas composé, un livre où les mots ne sont pas ordonnées, mais arbitrairement rassemblés. Le monde s’offre donc au poète comme des brides de mots et d’images, comme un livre dont les feuillets seraient détachés. La nature, en tant que dictionnaire, n’est ni plus ni moins qu’un objet. Ainsi, on ne peut lire la nature — et le dictionnaire — que comme un flâneur qui glane ci et là différents éléments, et non plus en contemplateur.
8La flânerie est l’expérience avant tout du citadin. La nature n’est plus un grand livre : ce rôle est désormais dévolu à la ville : « toute phrase doit être en soi un monument bien coordonné, l’ensemble de tous ces monuments formant la ville qui est le Livre11 ». La ville fonctionne comme livre humain ou comme dictionnaire humain. La grande ville est le Livre par excellence ; elle annonce peut-être Mallarmé et le rêve d’une élimination totale du hasard de la nature par un chef-d’œuvre absolu. Les hommes sont dans la ville, comme les mots dans un dictionnaire : ils restent isolés, formant des unités de sens décontextualisées.
9La poésie baudelairienne se doit donc de stabiliser le fugitif, de « perpétuer la rencontre des éléments s’entrechoquant, immobiliser le mouvant, donner au nouveau la rigidité de l’ancien ».12 Bref, R. Brague retrouve, par ce cheminement, le credo baudelairien de Mon cœur mis à nu : « Créer un poncif, c’est là qu’est le génie ».
La nature ou son improbable définition
10Baudelaire voit dans la grande ville, un paradigme faisant coïncider le chaos et le cosmos. Le poète doit la considérer telle une gigantesque machine à décomposer, une forme de « labyrinthe » dont il faut s’élever. C’est à cette fin et à ce titre que le poète se fait « chiffonnier » de la grande ville. La réalité ne prend un tour poétique qu’au prix d’une rencontre imprévue ; la figure du chiffonnier, que Walter Benjamin avait déjà étudiée13, est proche de celle du poète. Comme lui, l’ivresse y contribuant, le poète trébuche et se heurte aux objets. La réalité lui paraît ainsi toujours nouvelle, dans ce qu’elle est à de fragmenté et de parcellaire.
11De ces chocs et de ces heurts, le poète ne voit que la nouveauté, et comme il le précise dans « Le cygne » où « tout devient pour [lui] allégorie », l’allégorie permet de saisir le cosmos, et de figer le beau. Cette démarche poétique, quelque peu complexe, passe donc tout d’abord par une individuation ou décomposition du réel, puis par sa recomposition via la figure de l’allégorie. Se pose alors nécessairement le problème de la définition de la nature et son existence.
12Rappelons tout d’abord combien il paraît difficile de savoir ce que Baudelaire entendait précisément par nature. R. Brague évite toutefois un écueil récurrent de la bibliographie baudelairienne ; comme l’écrit Antoine Compagnon, « toutes les explications de Baudelaire par l’allégorie dissimulent une figure toujours présente : celle de la discontinuité, ou de la cassure interne, de la disproportion »14. Or justement, selon R. Brague, le terme même de « nature » désignait davantage une réalité conceptuelle : il s’agirait avant tout de « continuité ». Rejeter la nature et le naturel consisterait donc pour le poète à briser cette continuité. Le « surnaturalisme » serait donc avant tout un anti-naturalisme. Il revient à la poésie d’imposer un choc et du discontinu. La seule discontinuité véritablement intraitable serait le gouffre qui sépare le monde du sujet (« le monde ne peut me toucher car il ne me touche pas »). La finalité de l’art sera donc moins de dégager une vérité générale que de fixer une sensation individuelle. On retrouve alors la notion toute baudelairienne de la bizarrerie, en ce qu’elle fixe et concrétise le choc. L’image rend bizarre parce qu’elle isole un moment dans la continuité de la vie. De l’indéfinition de la nature, R. Brague oblique alors sur celle de l’image.
Étude de l’expérience de l’image
13L’amour est idolâtre ; il est donc, à ce titre, un cas particulier du culte des images. Aussi, l’expérience de l’amour consistera-t-elle à changer tout visage en image. Ce moment de la démonstration constitue, à nos yeux, la partie la plus neuve de cette étude et la plus séduisante. R. Brague y précise, en effet, la manière dont Baudelaire imagine — au sens littéral du terme — l’amour et la femme. En d’autres termes, la femme doit devenir image pour être aimée. Par là, l’auteur rejette les lectures sadiques ou fétichistes que l’on a pu régulièrement faire de Baudelaire, tout simplement parce que le sadisme et le fétichisme sont tous deux des idolâtries. La femme ne devient idole que quand on la fait taire, quand on lui retire son sens15. Ainsi, on ne dépasse pas la nature en la transcendant vers un ailleurs, mais en entourant certains des éléments qui la composent d’un cadre. Le maquillage se lit alors comme un cadre artificiel qui cerne le visage naturel de la femme. Le cadre, en isolant de la nature, change ce qu’il encadre en image16. Comme en témoigne « L’invitation au voyage » et surtout sa version en prose, la « correspondance » ne vise pas à assurer la continuité de la nature, mais à arracher la chose à son contexte en la rattachant à une autre. L’encadrement exerce une fonction surnaturalisante en défaisant le tissu continu du monde pour renvoyer l’un à l’autre les éléments de celui-ci.
14L’effort de Baudelaire consiste ainsi à aboutir à un art le plus proche de l’image et le plus éloigné du visage : R. Brague y retrouve l’art de l’arabesque.
15Ce culte de l’image confine inexorablement au narcissisme et à sa propre admiration. Comme le précise « La mort des amants », on n’aime que son image. Dès lors, rien ne vaut la mer — et plus précisément l’eau —, elle qui offre un support permanent à l’admiration. Pour l’homme, « la mer est un miroir […]. Il se plaît à plonger au sein de son image »17. R. Brague propose alors de parfaire la théorie baudelairienne par une description de l’homme destiné à vivre dans un univers d’images. Cet homme est le dandy. Le dandy se choisit lui-même par le vêtement dont il se pare. Il pousse ainsi à l’extrême la non-distinction entre le cadre et le contenu, qui, donnant à celui-ci son cadre, en fait une image. Le dandy ne vise pas l’amour mais « le culte de soi-même ». Le dandysme est donc un culte du moi. Une forme de duel s’instaure alors au cœur même du dandy : il est à la fois artiste et œuvre d’art. Le dandy fait subir à sa propre personne l’opération « barbare » que l’artiste fait subir à l’œuvre qu’il compose.
***
16La démonstration de R. Brague est séduisante à plus d’un titre : elle suggère une théorie baudelairienne affinée et cohérente, et propose, en ce sens, une grille de lecture opérationnelle et très souvent éclairante. On pourrait, cependant, lui reprocher d’avoir sciemment éviter la bibliographie baudelairienne. On s’étonne, par exemple, que l’ouvrage de Patrick Labarthe sur l’allégorie baudelairienne, ne soit pas mis à profit pour sa démonstration18, tout comme d’autres ouvrages devenus incontournables sur cette question19 ; la contextualisation historique qu’il propose aurait sans doute permis de préciser certains points. Cette démarche lui permet, néanmoins, une forme de liberté d’analyse et d’interprétation, sans laquelle son parcours n’aurait sans doute pas été possible.
17Quoiqu’il en dise, par ailleurs, cette lecture laisse poindre à plusieurs reprises les réflexes du philosophe : la conceptualisation et l’abstraction de certains développements ne font pas toujours la part belle au commentaire et tendent à faire de la poésie de Baudelaire un système achevé — ce qu’elle n’est manifestement pas. On pourrait ainsi se demander dans quelle mesure R. Brague ne confond pas allégorie et allégorèse, tant la lecture proposée semble parfois englobante.
18On pourrait, enfin, lui objecter qu’en quelque sorte, le culte des images ne serait, ni plus ni moins que l’imagination. Ce serait, alors, manquer un point essentiel de sa réflexion et l’une de ses plus fines conclusions : l’imagination est — d’abord — un rapport aux images, et non un moyen d’y accéder.

