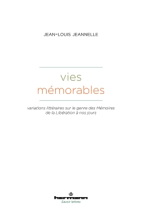
Retrouver les Mémoires : nouveaux regards critiques sur les Vies mémorables au XXe siècle
1C’est à partir d’un paradoxe propre aux Mémoires que Jean-Louis Jeannelle initie sa réflexion dans l’ouvrage Vies mémorables : variations littéraires sur le genre des Mémoires de la Libération à nos jours : le succès éditorial du genre est certain, lorsqu’on regarde les parutions contemporaines de personnalités politiques ; leur valeur littéraire est pourtant contestée de toute part, comme a pu le prouver la polémique lors de l’inscription des Mémoires de Charles de Gaulle au programme du baccalauréat de français en 2010. Le critique choisit dès lors de présenter le genre sous l’angle de ses multiples variations, en regroupant des articles parus dans des collectifs ou des numéros de revue1, afin de réhabiliter un genre perçu traditionnellement sous son visage monolithique et désuet et d’illustrer, par l’étude de nombreux cas, la vitalité du genre à travers ses nombreuses métamorphoses. L’enjeu de l’ouvrage consiste alors à comprendre comment les Mémoires, sous toutes leurs formes — mêmes fictives — rendent possible « pour un individu de prendre en charge l’écriture d’un passé collectif2 » (p. 319).
Déclin et renouveau au xxe siècle
2À travers cette série d’articles réécrits, Jean-Louis Jeannelle se concentre sur la deuxième moitié du xxe siècle, période qui entretient un rapport paradoxal avec le genre des Mémoires. Alors même que les événements historiques semblent appeler les récits de la mémoire, les champs de la connaissance, à la fois littéraire et historique, paraissent à l’inverse réticents à valoriser le geste mémorialiste. Jean-Louis Jeannelle se confronte à cette contradiction apparente tout au long de ces chapitres afin de comprendre le rôle accordé, au mitan du siècle, à ce que l’auteur appelle tantôt les Vies majuscules, tantôt les Vies mémorables. Les nombreux Mémoires étudiés de révolutionnaires, de résistants et de combattants (Charles de Gaulle, Victor Serge, Guy Debord, Claude Roy, Régis Debray), ou encore de figures intellectuelles et artistiques généralement de gauche (Louis Aragon, Simone de Beauvoir) sont bien la preuve que les événements historiques du xxe siècle réactivent l’écriture mémorialiste, en incitant les individus à s’interroger sur leur mandat3, c’est-à-dire sur leur exemplarité à travers le rôle qu’ils ont pu jouer au sein d’une génération touchée par des événements aux résonnances mondiales inédites (Révolution russe, Occupation, conflits de décolonisation, guerre froide). À cette amplitude chronologique répond la diversité des corpus étudiés, et le genre des Vies majuscules paraît investi d’une grande vitalité au xxe siècle. Cependant, à travers l’exploration des variations des récits de la mémoire4, il devient clair que, si une diversification du genre a bien eu lieu grâce à l’appropriation des codes mémorialistes par de nouvelles figures, une méfiance se déploie tout autant chez les critiques que chez les auteurs vis-à-vis d’un genre à la légitimité désormais contestable. Cette suspicion prend sa source aussi bien dans l’historiographie que dans le champ de la critique littéraire et se pose comme une spécificité de la deuxième moitié du xxe siècle aux yeux de Jean-Louis Jeannelle, qui prend cette tendance à rebours à travers l’étude de cas individuels.
3Sur le plan littéraire tout d’abord, le xxe siècle a vu les écritures de soi se diversifier, au point d’occulter le genre des Vies majuscules5. Avec la nouvelle hiérarchisation générique, les Mémoires sont rentrés en concurrence avec des genres (l’autobiographie et l’autofiction principalement) qui ont gagné non seulement en popularité mais aussi en valeur littéraire en déconstruisant le concept d’identité sur lequel justement les Mémoires se fondent et en valorisant l’introspection quand les Vies majuscules établissent un cloisonnement plus ou moins imperméable entre l’intime et la vie publique6. Mais au-delà de la diversification des écritures de soi tout au long du xxe siècle, qui a eu pour effet de fragiliser l’assise auctoriale des Mémoires, ou en tout cas de produire un décalage entre la production éditoriale et la réception critique du genre, Jean-Louis Jeannelle insiste sur l’importance de deux auteurs dans la marginalisation contemporaine des Mémoires — et il est d’ailleurs étonnant de ne trouver ce développement que dans la conclusion de l’ouvrage7, tant ces hypothèses éclairent le basculement narratologique et mimétique qui s’est opéré au xxe siècle. La conclusion met en lumière le rôle prépondérant de La Recherche du temps perdu de Marcel Proust et des œuvres de Claude Simon (notamment Les Géorgiques) dans la réflexion sur la possibilité d’une mimésis historique ; Jean-Louis Jeannelle laisse entendre que la reconstitution fragmentaire, elliptique et désordonnée de la mémoire, telle que Claude Simon la mène dans son œuvre, rend difficilement tenable l’ethos mémorialiste après les années 1980. L’ouvrage des Vies mémorables se confronte ainsi aux soupçons qui pèsent sur le genre, autant chez les critiques que chez les écrivains.
4Mais les Mémoires étant un genre à la croisée de deux disciplines, les lettres et l’histoire, leur valeur n’est pas uniquement contestée dans le champ littéraire : il apparaît que l’historiographie prend également ses distances avec les Vies mémorables. Jean-Louis Jeannelle détecte en effet un changement de paradigme qui affecte un genre autrefois considéré pour sa valeur historique8. La confrontation du champ historiographique à celui de la critique littéraire mène l’auteur des Vies mémorables à cette conclusion : les Mémoires sont mis en difficulté à cause de la légitimité de plus en plus contestée du Mémorialiste en tant que voix d’autorité. La figure mémorialiste entre effectivement en concurrence depuis la deuxième moitié du xxe siècle avec deux nouvelles figures émergeantes de l’historiographie : à savoir d’une part l’historien (figure visant à objectiver le savoir historique loin d’une recréation biaisée et guidée par une perception romantique du grand homme que l’on retrouve de façon plus ou moins assumée dans le genre des Vies majuscules) et d’autre part le témoin (qui, à l’inverse de l’historien, livre une expérience dans toute sa subjectivité, mais dont la légitimité est assurée grâce au crédit que l’on accorde désormais à la parole traumatisée). Les thèses philosophiques sur l’histoire, notamment celle d’Hannah Arendt9, ainsi que le déclin de la conception romantique du grand homme10, seraient donc également responsables du soupçon qui pèse sur les Mémoires.
5Alors même que le xxe siècle semble, par la succession des bouleversements historiques qu’il a connue (révolutions, guerres, désillusions), le temps privilégié des Vies mémorables, les changements de paradigme qui s’opèrent tant du point de vue de la narration que concernant l’autorité de la voix historique ont pu réfréner les velléités mémorialistes, ou du moins reléguer les œuvres produites aux marges de la littérature et de la littérarité. Mais loin de tirer des conclusions morales voire réactionnaires de ce basculement axiologique et de cette substitution de figures historiques11 qui se fait au détriment des Mémoires, Jean-Louis Jeannelle se rend attentif à l’intérêt grandissant pour les récits de témoins (et ce jusqu’à l’époque contemporaine) sans pour autant dévier de son corpus originel : il se propose bien de peser les conséquences sur le genre des Vies majuscules, et de révéler les métamorphoses par lesquelles le genre doit passer pour subsister face à cette concurrence aux frontières de la littérarité. Il propose ainsi un corpus secondaire bigarré, composé d’œuvres formellement ambiguës, voire d’anti-mémoires ; il étudie par là-même les biais trouvés par ces auteurs et autrices pour dépasser l’aporie et contourner l’impasse de l’illégitimité affectant la figure mémorialiste. Finalement, à travers cette cartographie renouvelée du genre des Vies mémorables qui se fait à rebours des tendances critiques, Jean-Louis Jeannelle nous invite à interroger nos réflexes de lecture et à nous demander qui est investi d’une parole d’autorité lorsqu’on en vient à raconter son rôle dans l’Histoire : face à la figure émergeante du témoin, et au côté des autobiographes supposément plus sincères, les mémorialistes12 — c’est-à-dire des individus qui revendiquent avoir eu un rôle historique à travers une narration dont ils maîtrisent chaque étape — ont-ils encore quelque chose à nous raconter de l’Histoire ?
Construction de l’ouvrage : essence du genre et continuum mémorialiste
6C’est pour répondre à ces problématiques soulevées par le renouvellement de l’historiographie et par les mutations de la mimésis historique que l’auteur regroupe des articles sur des variations parfois très éloignées du genre initial étudié, et il faut envisager cet ouvrage comme une exploration des confins de l’écriture mémorialiste. Certains des auteurs sélectionnés semblent incarner eux-mêmes, d’une manière ou d’une autre, la suspicion détectée par le critique à l’égard du genre des Vies mémorables, soit en refusant cette dénomination pour leurs œuvres, soit en en subvertissant les codes dans un jeu d’intertextualités plus ou moins explicites13. Ainsi, loin de déduire des soupçons pesant sur les Mémoires l’obsolescence programmée du genre, Jean-Louis Jeannelle s’efforce, tout au long de ces chapitres, de confronter les réticences qu’éprouvent les critiques, les historiens, et les auteurs eux-mêmes, et d’explorer les frontières du genre, afin de détecter, à contre-courant des critiques de la deuxième moitié du xxe siècle, un substrat persistant de l’écriture mémorialiste, que ce soit sous une forme renouvelée, sous une forme parodiée, ou sous une forme fictive.
7La construction de cet ensemble d’articles tend ainsi à déployer les multiples variations à travers une essence établie. Jean-Louis Jeannelle propose une réflexion en trois temps : un premier temps consacré à un triptyque initial dont il est question sur la quatrième de couverture (Victor Serge, Charles de Gaulle, Simone de Beauvoir), un deuxième temps consacré aux auteurs réticents voire hostiles à l’écriture mémorialiste mais qui se sont pourtant positionnés par rapport au genre dans leurs œuvres (Jean-Paul Sartre, Louis-Ferdinand Céline, Louis Aragon), et un troisième consacré à des auteurs plus récents qui se réapproprient d’une manière ou d’une autre les codes mémorialistes14, soit par une intertextualité assumée (Guy Debord, Claude Roy, Regis Debray), soit par un détournement fictif de l’ethos mémorialiste avec l’étude du cas polémique des Bienveillantes de Jonathan Littell, soit par l’invention d’une nouvelle temporalité des Mémoires (et le cas particulier de l’historien Daniel Cordier qui imite l’écriture diaristique pour recréer a posteriori un carnet de résistance qu’il ne pouvait, par souci de clandestinité, pas tenir). La conclusion de l’ouvrage offre un dernier corpus, contemporain, avec l’étude des œuvres d’Annie Ernaux, de Pierre Guyotat, de Jean Rouaud en guise d’ouverture.
8Derrière cette structure exposée dans la table des matières, une autre logique, implicite, peut apparaître. Un premier temps serait ainsi consacré à des Mémoires se donnant pour tels (Serge, de Gaulle, Beauvoir) et regroupés sous le concept essentiel du mandat15 (mandat révolutionnaire, mandat national, mandat intellectuel). Le reste de l’ouvrage offre, à partir de ce triptyque initial, des variations, comme l’entend l’auteur, des déclinaisons à partir des codes génériques exposés dans la première partie de l’ouvrage. La perspective de Jean-Louis Jeannelle à travers une première exploration d’œuvres orthodoxes16 du point de vue du genre est avant tout de mettre à jour le cahier des charges des Vies majuscules. En adoptant une approche inductive, et partant de l’exemple particulier pour établir les contours d’un genre plus mouvant qu’il n’y paraît, Jean-Louis Jeannelle exhibe les notions essentielles dont il se sert dans la suite de l’ouvrage pour jauger les œuvres aux frontières du genre : les notions de mandat, de jugement, de justification, de destin, de responsabilité, d’exemplarité, ainsi que les codes narratifs et la réflexion temporelle qui en découle, comme l’entrelacement constant du parcours individuel et du destin d’un collectif, ou encore l’organisation téléologique des événements. En posant cette essence au préalable, le critique affine la définition du genre et le distingue des autres écrits de soi tout en lui redonnant la valeur que la démultiplication récente des autobiographies et des autofictions lui a ôtée. De plus, en abordant chaque œuvre dans ses singularités — et non pas avec une approche comparatiste, même si des lignes de force se dessinent et que des points communs émergent à la lecture — il prouve que le genre n’est pas dénué de tensions, de contradictions internes17 et d’ambiguïtés, et qu’il est tout autant capable de mettre en scène une réflexion sur l’identité, au même titre que l’autobiographie.
9Finalement, ce que l’on aurait cru être le cœur du livre (à savoir le triptyque initial) n’est qu’une petite partie de la démonstration de Jean-Louis Jeannelle. Le premier temps, consacré à de « véritables » Mémoires, pose une base générique et permet de rappeler l’essence du genre à travers trois postures mémorielles assumées. La démarche du critique consiste ensuite davantage à dresser un continuum générique : par cette approche, il envisage les ambiguïtés du genre et prend en compte l’hétérogénéité d’un genre que l’on a souvent relégué au second plan de la critique précisément à cause d’une perception manichéenne des œuvres — plus perçues comme des créations monolithiques que comme des œuvres complexes. Le fait de placer le chapitre intitulé « la reconquête du mémorable » à la fin de l’exploration du continuum prouve, à travers l’étude des œuvres aux formes hétérogènes de Claude Roy, de Régis Debray et de Guy Debord, que le genre des Mémoires continue de hanter l’écriture de soi dans la deuxième moitié du xxe siècle, même si l’ethos mémorialiste fidèle à la cause défendue est difficilement assumé par ces auteurs qui ont pris leurs distances avec les actions qu’ils retracent et avec les valeurs politiques qu’ils ont autrefois incarnées.
10Les chapitres intermédiaires consacrés à « l’imposture mémoriale », et l’étude des œuvres de Sartre, de Céline et d’Aragon, permettent de redéfinir le genre par la négative. En critiquant, en parodiant, en subvertissant le genre, les auteurs d’anti-mémoires se positionnent par rapport à celui-ci et tiennent ainsi compte d’une essence mémoriale. Parallèlement aux anti-mémoires, Jean-Louis Jeannelle se consacre aux Mémoires qui n’ont jamais été publiés, jamais achevés, laissés à l’état d’une possibilité. Cette double approche l’autorise à intégrer dans son corpus secondaire des œuvres sans existence, des œuvres restées une potentialité, des œuvres pensées comme horizon plus ou moins avoué, mais également des écrits secondaires, parallèles, qu’on aurait pu considérer comme anecdotiques (entretiens, lettres, essais, fragments, esquisses) au regard des Mémoires (genre ambitieux, totalisant et conclusif par excellence). L’approche négative de Jean-Louis Jeannelle prend une grande place dans ces chapitres : il cherche à donner sens à ce qui n’existe pas (dans la continuité des travaux de Gérard Genette qui se prête à « une exploration des divers possibles du discours18 »), et la méthode adoptée dans « l’imposture mémoriale » a le mérite d’inscrire des textes satellites jugés sans doute secondaires dans son corpus. En explorant les écrits en devenir, en explorant les écrits anecdotiques, le critique contourne les réticences des auteurs et réévalue un certain nombre d’écrits au statut générique trouble19 au regard du cahier des charges mémorialiste.
11En posant les frontières du genre et les frontières mêmes des œuvres, Jean-Louis Jeannelle cherche à percevoir un substrat mémorialiste par-delà les dénominations. Il démontre, par cette approche critique, à la fois la persistance du genre et sa complexité, et offre ainsi la possibilité de contourner la doxa anti-mémoriale qui hypostasiait le genre et qui ne voulait en percevoir qu’un monument empreint de la vanité de son créateur.
L’enjeu de la dénomination
12Ce que Jean-Louis Jeannelle met au jour à travers cet ouvrage, c’est avant tout la force d’attraction de ce genre qu’on aurait pu croire tombé en désuétude, mais qui s’est constitué, au fil des événements du xxe siècle comme un genre par rapport auquel se positionner, et la figure mémorialiste comme l’éthos à mettre en scène à travers la reconstitution d’un parcours individuel et d’un destin collectif. Le corpus secondaire étudié, bien plus hétérogène que le corpus primaire, et proposant un spectre élargi des idéologies politiques du xxe siècle, nous fait découvrir des ouvrages qui réinventent les codes au point de faire figure d’hapax générique (comme l’œuvre poétique inachevée d’Aragon). Il est dès lors dommage de ne pas trouver une bibliographie en fin d’ouvrage pour nous guider dans ce corpus prolifique20.
13Cependant, si une bibliographie exhaustive ne vient pas accompagner l’étude des déclinaisons hétérogènes du genre, on sera sensible à l’effort de dénomination perceptible à travers tout l’ouvrage. Allant parfois à rebours des intentions d’auteurs réticents à dénommer leur écriture de soi des « Mémoires » (dans le cas de Sartre par exemple), ou à rebours de la critique littéraire qui refuse par moment de percevoir la dimension mémorielle des écritures de soi (dans le cas par exemple du diptyque de Simone de Beauvoir, La Force de l’âge et La Force des choses), Jean-Louis Jeannelle oppose au refus de nommer les Mémoires une démultiplication de concepts. À travers son exploration de ce continuum générique, l’auteur offre à la réflexion toute une série de concepts empruntés ou forgés, nous permettant ainsi d’explorer le spectre mémorialiste dans toutes ses nuances : anti-mémoires, mémoires par prétérition, mémoires par procuration, récits de désaveu, mémoires feints, « Mémoires ambigus » et « Mémoires de fabrique21 », écriture « auto-socio-biographique22 », ou encore l’autobiographie politique voulue par Jean-Paul Sartre... Les dénominations égrenées au fil des chapitres témoignent de la vitalité du genre des Vies majuscules, et viennent enrichir dans le champ de la critique une nomenclature qui peinait à suivre les linéaments d’un genre bien plus flexible et sujet à la métamorphose qu’on ne pouvait se le figurer.
*
14Le regroupement d’articles est ainsi marqué par une tension constante : il s’agit de montrer la pérennité du genre à travers le jeu d’intertextualités et de positionnements par rapport aux codes des Mémoires auquel se sont prêtés les auteurs et autrices tout au long du xxe siècle, et en même temps d’avouer l’obsolescence du genre — du moins sous une certaine forme. La conclusion achève de démontrer que les Mémoires restent « mémorables » (en ce qu’ils hantent les écritures de soi contemporaines) mais que le modèle générique tel qu’il a été institué à travers la tradition littéraire est devenu difficile à assumer sans une mise à distance critique par le « je » racontant. Le genre paraît incompatible avec la sensibilité moderne, et il ne paraît plus valide depuis le double assaut de Marcel Proust et de Claude Simon. Jean-Louis Jeannelle prouve en tout cas à travers l’étude de ce corpus hétérogène que le modèle des Mémoires, qu’il soit à remanier ou même à dépasser, oblige les écrivains à réinventer l’énonciation et l’inscription de soi dans son temps historique, par la prise en compte des différents changements de paradigmes historiographique et littéraire qui ont eu lieu au cours du xxe siècle23.

