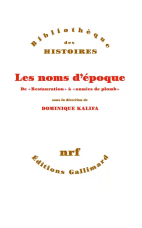
Le nom fait (l’)époque
« Mais il arrive parfois, ce que Lord Acton ne disait pas, que la période soit précisément le problème1 »
1Après La Véritable histoire de la « Belle époque » 2017), Dominique Kalifa faisait paraître en janvier dernier un ouvrage collectif sur Les Noms d’époque — nul ne pouvait alors savoir qu’il nous quitterait en septembre, et que ce volume serait son dernier livre. L’ouvrage paru dans la collection « Bibliothèque des idées » des éditions Gallimard se présente comme un recueil d’articles qui tient à la fois du dictionnaire — les titres des articles sont autant d’entrées en forme de périodes historiques — que d’une grammaire des noms d’époque faisant discuter l’histoire et la linguistique. En effet, le nom d’époque est envisagé, non comme désignant ou toponyme événementiels, mais comme chrononyme, en fonction du concept proposé par Eva Büchi. Ainsi les quatorze articles scientifiques qui constituent l’ouvrage sont‑ils autant d’essais pour saisir les enjeux de la nomination du réel, soit un aspect du problème du rapport entre les mots et les choses :
Un aspect est cependant resté en retrait, qui concerne les noms de périodes historiques, ainsi que les représentations qui s’y attachent. Car on ne se contente pas de découper le temps, on le nomme également, et cette opération est tout sauf insignifiante. Nommer est en effet toujours porteur d’intentions ou d’effets. Même réfléchie, la désignation d’une période charrie avec elle tout un imaginaire, une théâtralité, voire une dramaturgie, qui peuvent en gauchir l’historicité propre et donc le sens. Elle peut aussi venir effacer des termes et des significations préexistants ou concurrents. Elle recouvre donc presque toujours le passé d’une gangue d’anachronisme qu’il importe d’élucider. (p. 9)
2Aussi l’attitude globale et la méthode retenue consistent‑elles principalement à dénaturaliser un nom qui peut sembler aller de soi et dont le contexte d’apparition n’est plus connu :
Les noms propres que l’on donne au temps ne sont donc pas de simples artefacts, quantité négligeable que l’on peut balayer d’un revers de main. Capables de condenser dans un seul terme ou dans une seule expression une quantité considérable de représentations, « d’éveiller la mémoire des faits par la seule mention du nom », ils organisent la matière événementielle, lui donnent accès, visibilité, et la construisent comme mémoire sociale. Essentialisés, détachés de leurs conditions d’élaboration ou de leurs usages successifs, ils peuvent se muer en « réalités tangibles », mais le plus souvent anachroniques. Autour d’eux se construit un feuilleté sémantique, un feuilleté mémoriel, qui facilite l’emprise des grands récits collectifs. Les élucider, en identifier la nature, les écarts ou les usages se révèle donc essentiel pour qui souhaite traquer l’anachronisme, récuser les lectures finalistes ou tout simplement restituer cette part d’historicité complexe, contradictoire, parfois kaléidoscopique, qui s’attache aux représentations du passé. (p. 10)
3Faisant donc dialoguer la linguistique et l’histoire, soit, de façon simplifiée, l’étude de la langue et celle du passé, Dominique Kalifa s’interroge sur les noms d’époque du lendemain de la Révolution française à nos jours. En dépit de leur discontinuité, ces études ont vocation à proposer une réflexion globale sur les façons de découper le temps, ce que nous proposons de qualifier ici de grammaire des noms d’époque :
Les essais rassemblés dans ce livre ne prétendent évidemment pas épuiser la gamme très large et presque illimitée des chrononymes. Prenons‑les comme des coups de sonde, même si nous les avons voulus représentatifs des principales façons de nommer le temps ou des structures qui les organisent. (p. 19)
4Pour rendre compte de cet ouvrage, et étant donné que la forme du dictionnaire laisse le lecteur libre et fait appel à son intelligence, nous proposons de reconfigurer les deux axes qui ordonnent le livre, à savoir « nommer son temps » d’une part, et « Remémorer, réinventer le temps » de l’autre, en fonction de trois pistes parfois convergentes voire poreuses : compter, nommer et symboliser le temps.
Compter le temps : livres d’heures & d’années, le début, la fin et l’entre‑deux
5Dans « Stunde Null. L’introuvable an I de l’histoire germanique », Johann Chapoutot oppose deux lectures de l’histoire, l’une, euphorique, qui s’intéresse aux fondations, aux ans I, tandis que l’autre, dysphorique, est placée sous le signe effrayant du zéro. L’auteur démontre comment cette lecture idéologique s’applique notamment à l’histoire d’un pays comme l’Allemagne, en raison des défaites et des capitulations essuyées par le pays, notamment lors des deux guerres mondiales. Dans ce drame, les horloges jouent un rôle particulier, qu’on les remonte ou qu’on les arrête, la fin de la Seconde Guerre mondiale ayant sonné à minuit le 9 mai 1945, c’est‑à‑dire à zéro heure — Stunde Null. Mais l’auteur montre aussi comment et surtout ce que ce mythe peut avoir de positif, la tabula rasa permettant, comme on dit, de repartir à zéro, en particulier au moment de la dénazification.
6À la différence des autres contributeurs, Emmanuelle Retaillaud part d’une époque pour en chercher les noms. Il s’agit en l’occurrence des années vingt, dont le découpage proposé est celui qui va de la fin de la Première guerre mondiale (1918) à la crise de 1929. L’auteur montre la manière dont l’économique, le social et le culturel se mêlent pour nommer des années dites rugissantes puis folles, d’abord en Amérique, puis en France. Contrairement à ce qu’une certaine mythologie d’époque laisse penser, les roaring twenties ne sont pas à prendre à la légère ; le vent violent des mutations de cette époque décoiffante est à chercher dans les quarantièmes rugissants — roaring forties. En outre, cet âge oscille entre les lumières du Jazz Age décrit par Francis Scott Fitzgerald et les ombres de la Prohibition Era. Les années qui deviendront ensuite la période de l’entre‑deux‑guerres font néanmoins l’objet d’une réévaluation nostalgique dont témoignent toutes les biographies des personnalités qui, comme le siècle, avaient vingt ans à l’époque, et vivaient leurs folles années.
7Pascal Ory enquête, quant à lui, sur les Trente glorieuses, expression dont l’origine peut être assignée à Jean Fourastié, auteur des Trente glorieuses ou la révolution invisible de 1946 à 1975, ouvrage paru en 1979. Après avoir indiqué l’origine du chrononyme, à savoir les trois glorieuses de la Révolution de Juillet 1830, le chercheur montre que, si le nom d’époque permet de lutter contre l’impensé et l’insensé, il peut néanmoins faire l’objet de remises en cause à nuancer, en particulier dans le cas présent, celle de la connotation positive perçue comme jugement de valeur. En effet, l’auteur montre que le livre de celui dont la posture est celle de l’intellectuel organique de la croissance, conduit à minorer la tonalité pessimiste de l’ouvrage ainsi que la récurrence de termes comme « morosité », « insatisfaction » ou encore « inquiétude ».
8Willa Z. Silverman enquête sur les enjeux du passage de l’expression fin du siècle à fin‑de‑siècle. Se fondant sur le lieu commun, qui se cristallise avec une force particulière à la fin du xixe siècle, et selon lequel la fin de siècle équivaut à l’épuisement d’une civilisation, l’auteur montre le faisceau d’idées qui entourent cette posture, notamment la décadence et le pessimisme, voire la dégénérescence. Ce système de pensée s’éclaircit lorsqu’on rend explicite son opposé : la Belle Époque. En effet, l’expression, qui est principalement utilisée entre 1880 et 1900, est parfois ramenée à la défaite de 1870 contre la Prusse et étendue jusqu’au début de la Première Guerre mondiale en 1914. Même si l’auteur montre le lien de cette pensée négative — lorsqu’elle se concentre sur des thèmes comme le scepticisme face au changement ou l’obsession du déclin de civilisation — avec l’antisémitisme de certains essais pamphlétaires, elle montre également le paradoxe de la fécondité d’une époque qui dépasse, de façon créatrice, son malaise. La fin‑de‑siècle annonce en effet la modernité et coïncide avec une kyrielle de petits mouvements artistiques souvent occultés par l’impressionnisme tels que symbolisme, fauvisme, expressionisme, japonisme, Rose‑croix, nabis ou encore sécession viennoise. Le Zeitgeist, ou esprit du temps, de la fin de siècle, est : « tout comme le moment culturel qui l’engendra, […] une série de récits où les fins côtoyaient les commencements, où le déclin voisinait avec le progrès. » (p. 119). Cette « histoire de tournants » (p. 119) articule donc le passé au futur en fonction de multiples tensions dialectiques liées à une pensée eschatologique : espoir/désespérance, cataclysme/rédemption, utopie/dystopie. Dans la littérature française, c’est un personnage de Huysmans, Jean Floressas des Esseintes, dans le roman À rebours, qui incarne la décadence et rend évidente la manière dont la complaisance à l’artifice, à la déviance et au pessimisme est une façon de s’opposer à l’idéologie bourgeoise.
9Dominique Kalifa, directeur du présent ouvrage, trempe sa plume dans le nom particulièrement intéressant d’une période qui apparaît comme en creux : l’entre‑deux‑guerres. Le nom de l’époque semble précisément adéquat, étant donné son caractère mineur entre deux événements belliqueux. En outre, cette période historique possède l’avantage de bornes temporelles claires, de 1919 à 1939. Ce découpage sert même pour les pays qui n’ont pas participé à un conflit réputé mondial, malgré les récentes lectures postcoloniales qui visent à provincialiser l’Europe. Déjà utilisé en France pour la période qui s’étend de 1870 à 1914, l’entre‑deux‑guerres est compris comme l’épisode larvé d’une nouvelle Guerre de trente ans par De Gaulle et Churchill. Stigmatisée par les pétainistes pour son esprit de jouissance, cette époque fait également l’objet d’une lecture téléologique à l’aune de la montée des périls.
Nommer une époque. Autour de la matrice « l’âge de… »
10Miles Taylor consacre son attention à une expression anglaise : Victorian Age — l’ère victorienne. Après avoir signalé la fortune d’un terme présent dans le nom de nombreuses institutions et repris par de nombreuses figures politiques comme Margaret Thatcher, l’auteur cherche l’origine d’un adjectif qui commence à être employé vers 1850, puis rapidement à tort et à travers : « Le mot “victorien” fut dès lors mis à toutes les sauces, appliqué par exemple à l’art, aux cathédrales, au mouvement antialcoolique et aux bouleversements sociaux survenus durant cette période. » (p. 89). L’ère victorienne est donc appelée ainsi du vivant de la reine Victoria dont l’un des jubilés a lieu en 1887. En étudiant les dénominations qui précèdent, le chercheur fait une découverte susceptible d’intéresser les gender studies. En effet, l’ère victorienne est précédée par l’ère élisabethaine — Elizabethan Age. Mais lorsque le monarque est un roi et non une reine, son nom n’est alors pas transformé en adjectif comme en témoignent l’Âge d’Édouard III — the Age of Edward III — et celui de George III — the Age of George III. Or, la discrimination au cœur de cette façon d’appeler les époques peut se comprendre de la façon suivante. Les reines sont davantage considérées, de façon passive, comme les produits de leur époque tandis que les rois en sont les acteurs. Loin d’être façonnés par leur époque, ce sont eux qui la font.
11C’est l’expression de gilded age qui retient l’attention de Venita Datta. Forgée par Mark Twain et Charles Dudley Warner en 1873, elle subvertit le mythe de l’âge d’or pour montrer toutes les perversions liées à l’auri sacra fames aux États‑Unis d’Amérique. Ainsi, cette expression critique, que l’on doit traduire de façon péjorative par « âge doré » voire « âge du toc », est‑elle reprise à leurs comptes par des historiens comme Lewis Mumford, Charles Beard et Vernon Parrington, dans leurs ouvrages respectifs : The Golden Day (1926), The Rise of the American Civilization (1927) et Main Currents in American Thought (1929). L’expression se stabilise donc pour décrire négativement la période qui s’étend globalement de 1870 à 1890, en particulier à cause de l’inégalité des revenus. Mais l’expression tend à devenir un paradigme qui sert à rendre compte des États‑Unis du xixe siècle à nos jours et des contradictions propres à Mark Twain entre désir d’enrichissement et désintérêt comme condition sine qua non de la création artistique, selon une formule « presque générique, servant à dénoncer la cupidité, la collusion de l’argent et du pouvoir, la corruption politique » (p. 97‑98).
12Après une esquisse de grammaire des noms d’époque en Russie — emprunt à un nom d’époque venu d’un autre pays, nom russe lié à un projet ou une personnalité politiques —, Marie‑Pierre Rey se concentre sur la notion d’âge d’argent : « les deux premières décennies du xxe siècle, durant lesquelles la poésie d’abord puis, par extension, la culture et l’art, gagnés par des courant modernistes, connurent un essor extraordinaire » (p. 210). L’enquête de l’auteur invite, in fine, à étendre cette période de 1890 à 1922. Il s’agit d’un moment faste, dont le nom, qui renvoie à un schéma ternaire, est emprunté à Hésiode. Dans cette perspective, l’âge d’or de la littérature russe coïncide avec l’époque de Pouchkine, Gogol, Tolstoï et Dostoïevski. L’article invite également à nuancer l’attribution de la paternité de l’expression à Nikolaï Berdiaev, mais de s’orienter, en amont, vers l’un des membres de la diaspora russe, Sergueï Makovski, auteur d’un recueil d’articles paru en 1962 sous le titre Sur le Parnasse et l’âge d’argent ainsi que vers Nikolaï Ostoup, avant de revenir en Russie avec l’ouvrage inaugural de l’écrivain et éditeur Ivanov‑Rzaoumik Un Regard et quelque chose en 1925.
Symboliser une époque : concepts endogènes & concepts exogènes
Les mouvements de l’histoire : restaurer, changer, bouger, ressurgir
13Les concepts endogènes sont des concepts temporels qui mettent l’accent sur les différentes modalités du mouvement de l’histoire, entre ruptures et continuités. La Restauration est la période qui suit l’effondrement de l’empire napoléonien et qui précède la monarchie de Juillet. Philippe Boutry indique d’abord quels sont les termes concurrents, qu’ils fassent consensus comme « rappel », « retour », « rétablissement » ou qu’ils soient polémiques comme « contre‑révolution » ou « réaction ». La Restauration est donc restauration de la monarchie sous la figure de Louis XVIII. Le terme retenu par l’histoire désigne progressivement d’abord un événement, puis une période, et enfin un régime. « L’historien des chrononymes » (p. 38) analyse l’ensemble des discours de la période, de la presse éphémère à l’ouvrage historique plus stable en passant par la chanson et la correspondance, notamment royale. Il met précisément en lumière la façon dont le terme gagne ses lettres de noblesse en glissant d’un sens dénotatif « remettre dans un état antérieur » à un sens connotatif (positif) : « remettre en bon état ». C’est donc une notion morale méliorative qui est transférée en histoire étant donné que le terme signifie redonner de la force, réparer ou encore rétablir et qu’il est lié à une dimension religieuse qui appelle le vocabulaire de la rénovation ou de la réforme, renovatio et reformatio en latin.
14Carlotta Sorba s’intéresse, quant à elle, à un mot italien, « terme‑clé du “roman national” » (p. 55), risorgimento. Ce resurgissement est souvent assimilé à une renaissance, voire une résurrection. La force du terme réside à la fois dans son expressivité ainsi que dans le flou qui entoure son sens. En conséquence, il peut faire l’objet de nombreuses captations. Or, en Italie, ce terme, à la croisée de la littérature, de la religion et de la politique, sert à désigner le « moment‑fondateur de l’État‑nation » (p. 69), comme le montre notamment son exploitation muséale : « drapeaux noircis par le feu des batailles, lambeaux d’uniformes portés par les combattants, chapeaux à plumes, projectiles rouillés, mèches de cheveux, tabatières politiques » (p. 69). Renvoyant à la période pré‑unitaire, le terme se comprend par rapport à la dialectique déclin/résurgence. Antithèse de la décadence, contrepoint aux occupations étrangères, le risorgimento, nouant le passé au futur, apparaît comme un objectif à atteindre. Synonyme de la transformation d’une péninsule morcelée en un État, le terme supplante son rival rigenerazione à tel point que les dissidents politiques cherchent à s’approprier le terme officiel ou à dévoiler le mensonge qu’il occulterait.
15Jeanne Moisand étudie le rapport entre deux termes, transicion et movida, dont seul le premier est traduit en français par le calque « transition ». Ces deux vocables permettent d’avoir un aperçu de la rupture entre « le long tunnel du franquisme et l’émergence foudroyante de la modernité » (p. 144). La démonstration invite notamment à voir comment un vocabulaire conservateur, d’orientation irénique, exclut les termes de rupture ou de révolution, notamment aux profits de chrononymes cycliques vulgarisés par l’école. Ainsi la Révolution de septembre de 1868 et la Première République de 1873 deviennent‑elles pudiquement le sexennat démocratique – sexenio democratico. La transition démocratique relève donc du discours historique officiel et s’oppose à un concept comme celui du pacte de l’oubli de la fracture entre deux Espagnes, fracture cristallisée notamment par la guerre civile. En conséquence, l’articulation du terme transition à celui de movida permet de se faire une idée plus nuancée de l’histoire de l’Espagne contemporaine, ouvrant « une brèche récente séparant l’archaïsme représenté par le franquisme et la modernité incarnée à la fois par la démocratie (pour la transition) et par la libération des mœurs (pour la movida) » (p. 143). En effet, la transition s’effectue entre 1975 et 1984, soit entre la mort de Franco et l’avènement du premier gouvernement socialiste. Mais il est à noter que les termes de réforme, d’ouverture (apertura) et de développementisme (desarrollismo) sont déjà présents dans le vocabulaire de certains Franquistes à partir de 1945. En outre, la transition se fait sur fond de désenchantement (desencanto), ce qui explique peut‑être certains aspects de la movida, nom d’époque qui s’applique davantage à la capitale madrilène qu’à l’ensemble de l’Espagne, et dont les connotations sont au moins autant artistiques qu’historiques :
La movida désigne d’abord un courant culturel incarné à l’étranger par les premiers films de Pedro Almodovar. Le terme provient du lexique familier : il qualifie un mouvement désordonné, et par extension une bringue et/ou une embrouille, et est employé dans le Madrid des années 1980 pour parler des nuits festives et des « galères » liées à la recherche de drogue. (p. 144)
L’usage de concepts exogènes : couleur, matière, saison
16Les concepts exogènes ne renvoient pas à l’histoire, mais sont empruntés à d’autres domaines de la vie quotidienne, voire à d’autres conceptions du temps comme celle, non plus linéaire, mais cyclique. Pourquoi nommer une époque d’après une couleur ? Pour répondre à cette question, Laurent Douzou s’intéresse aux années noires, c’est‑àdire à la période qui va de 1940 à 1944 et qui est aussi connue sous les noms d’Occupation ou encore de régime de Vichy, par une métonymie spatiale. Pour l’auteur, nommer une époque consiste à résumer — narrativiser — une phrase grâce à un mot ou une expression. Ainsi l’image des années noires est‑elle une variation sur le thème de la nuit, qui prend le parti des Résistants et dont le noir n’est pas seulement la couleur d’une désespérance, mais aussi d’une clandestinité finalement victorieuse.
17Isabelle Sommier s’intéresse au nom d’une période historique italienne : les années de plomb — anni di piombo — de 1968 à 1982, période de violence marquée par 12 690 attentats imputés principalement aux deux extrêmes, celle de la droite et celle de la gauche. L’auteur rappelle l’origine cinématographique allemande de l’expression : Die bleierne Zeit de Margerthe von Trotta en 1981. Le film est présenté à la Mostra de Venise, où il obtient le Lion d’or, sous deux titres : Tempi di piombo et Gli anni plumbei. Or, si la première version, qui peut se traduire par « les années de plomb », renvoie à la matière des balles, la seconde, « les années plombées » retient de l’époque son caractère étouffant. De même, l’expression n’est pas traduite en anglais par years of lead, mais par years of the Bullet alors qu’il se trouve que l’extrême‑droite utilise des explosifs tandis que l’extrême gauche recourt aux armes à feu. L’enjeu de l’expression est donc de savoir si elle exonère ou non une partie des auteurs de violence. Quoi qu’il en soit, la fortune de l’expression est faite et on la retrouve au Brésil où les Anos de chumbo sont celles de la dictature militaire en place de 1964 à 1985.
18Jean‑Claude Caron part du principe général que le nom d’une époque dépend du sens officiel qu’on veut lui donner. Ainsi le printemps des peuples est‑il un grand mouvement révolutionnaire européen qui s’étend de fin février à début juillet 1848. Alors que son extension mensuelle — mars à juin — explique le nom saisonnier qui lui est donné, ce nom se charge néanmoins d’un vocabulaire voire d’une image climatique qui suggère l’expression antithétique « hiver des peuples » ainsi que la manière dont le chaud et le froid soufflent en histoire : guerre froide, glaciation, réchauffement ou encore dégel. L’auteur montre l’importance de cet événement, en Allemagne notamment où il coïncide avec l’unification de la nation allemande par le nationalisme qui transforme progressivement le Volk en Reich. Jean‑Claude Caron montre enfin la manière dont l’expression du printemps des peuples renvoie à une formule qui associe conflit, liberté et nationalité, ce qui explique sa résurgence après la Seconde Guerre mondiale, aux prémisses de la guerre froide puis, dans les années 1990, lors des printemps arabes.
***
19L’histoire compte, nomme et symbolise donc les époques. La gradation ici choisie s’oriente de la quantité vers la qualité, de ce qui peut être exactement mesuré vers ce qui fait l’objet d’interprétations multiples et contradictoires parfois. Les Noms d’époque permet en effet de construire une grammaire des chrononymes, qu’ils soient contemporains ou ultérieurs. Les différents auteurs montrent quels noms sont en concurrence pour une même période, puis comment et pourquoi l’un d’eux l’emporte, de façon momentanée ou plus durable. Différents domaines s’affrontent et les idéologies à eux liées. L’ouvrage articule de nombreux types de discours de la presse éphémère à l’histoire plus stable, des discours singuliers aux discours collectifs. Il prouve également la nécessité du recours au concept d’échelle, car une époque peut forger son propre nom ou celui d’une époque antérieure. Aussi un chrononyme se trouve‑t‑il parfois déterritorialisé, valant pour un lieu, tel la movida madrilène ou le régime de Vichy, une personne — le Gilded Age et le cas de Mark Twain —, une autre époque, voire une grille de lecture permettant d’analyser, à travers les périodes — avec un tropisme particulier vers l’actuel —, un phénomène porté aux nues par ses thuriféraires et voué aux gémonies par ses détracteurs. En épilogue, Dominique Kalifa réfléchit sur les façons de nommer l’époque contemporaine, le temps présent, et propose « l’ère des post— », au premier rang desquels la postmodernité. Si l’on convient que l’on a quitté le vingtième siècle, sans pour autant savoir vers où nous allons, il n’est pas interdit de dire après quoi nous venons.

